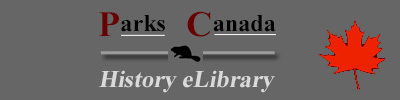|
Résumés parc
Québec
Tous les textes et photos sont la propriété de Parcs Canada ou le Répertoire canadien des lieux patrimoniaux
(Sauf indication contraire) et ont été extraites de l'une ou l'autre Parcs
Canada ou Lieux patrimoniaux du Canada. Les parcs avec un fond
gris sont gérés par Parcs Canada.

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada 57-63, rue Saint-Louis
Québec, Québec
Partie d'un important panorama urbain.
Le lieu historique national du Canada du 57-63, rue Saint-Louis réunit
trois bâtiments de deux étages et de deux étages et demi. Ces maisons en
pierre du début des XVIIIe et XIXe siècles sont situées à l'intérieur
des murs de la Haute-Ville de Québec, au pied du parc du
Cavalier-du-Moulin. Elles font partie du panorama du Vieux-Québec.
Le lieu historique national du Canada du 57-63, rue Saint-Louis a été
désigné en 1969 parce que les bâtiments qui le composent s'inscrivent
dans un panorama urbain important.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du 57-63,
rue Saint-Louis réside dans le paysage de rue uniforme que crée ce
groupe de bâtiments datant du régime français et dans leur contribution
à l'ensemble du paysage culturel du Vieux-Québec. Elle est illustrée par
la masse, les matériaux, la conception et l'exécution des composantes du
paysage de rue, et par son implantation à l'intérieur des murs de la
vieille ville. Le lieu historique national constitue un exemple
important de la continuité des valeurs architecturales et paysagères du
XVIIIe siècle associées au régime français dans le paysage historique du
Vieux-Québec.
L'édifice du 59-61, rue Saint-Louis a été construit sous le régime
français, au début du XVIIIe siècle et agrandi en 1796. Les bâtiments
situé au 57 et au 63, rue Saint-Louis, des anciennes dépendances du
début du XIXe siècle, formaient avec l'édifice du 59-61 une seule
propriété. En 1811, la propriété tout entière a été vendue au
gouvernement britannique qui en a fait une résidence pour officiers. Les
autorités britanniques construisent également un hôpital militaire, dans
la partie sud du terrain. La maison et ses dépendances ont conservé les
formes architecturales, les matériaux et l'organisation spatiale
qu'elles avaient au début du XIXe siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, N. Clerk, 1997 |
Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Édifice-de-la-Douane-de-Montréal
Montréal, Québec
Construit au début du XIXe siècle, l'ancien édifice de la douane de
Montréal est un élégant bâtiment en pierre de deux étages de style
néo-palladien. Situé dans le port du Vieux-Montréal, face au fleuve
Saint-Laurent, il est entouré de bureaux, de boutiques et de
restaurants. Depuis 1992, l'édifice de la douane fait partie de la
Pointe-à-Callière, le Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, et
est relié par des passages souterrains à d'autres bâtiments de
l'ensemble muséal.
L'ancien édifice de la douane est un magnifique bâtiment de style
néo-palladien aux façades élégantes, aux proportions harmonieuses et aux
détails architecturaux équilibrés. C'est un des derniers bâtiments
publics construits au Canada dans le style néo-palladien, un style
inspiré de l'architecture domestique anglaise, très populaire au pays
entre 1800 et 1820. Malgré les travaux d'agrandissement de 1881-1882,
qui ont comporté la reconstruction de la façade sud et l'ajout de portes
et de fenêtres sur les élévations latérales, l'extérieur de l'édifice de
la douane a conservé son apparence d'origine.
L'ancien édifice de la douane de Montréal est le premier bâtiment
dessiné par John Ostell, l'architecte le plus en vue de Montréal à
l'époque, qui avait reçu sa formation en Grande-Bretagne. Après l'ancien
édifice de la douane, John Ostell a conçu vingt-cinq des bâtiments les
plus prestigieux de la ville en autant d'années, puisant dans divers
styles. L'agrandissement de 1881-1882 est l'oeuvre de Alphonse Raza.
La construction de l'ancien édifice de la douane en 1836-1838 marque une
étape importante de l'évolution du port de Montréal, qui se voit ainsi
doté de son propre service des douanes. Jusqu'en 1828, les droits de
douane étaient perçus dans la ville de Québec, le principal port
d'entrée du Haut et du Bas Canada. Au début du XIXe siècle, la
construction du canal de Lachine, l'amélioration des transports
maritimes entre Québec et Montréal, la diversification de l'économie de
Montréal et l'essor du commerce avec l'Europe ont entraîné le
développement accéléré du port de Montréal. L'augmentation considérable
de l'activité portuaire justifiait la perception des droits de douane à
Montréal dès 1828. L'édifice de la douane a été construit peu après
cette date, témoin de la nouvelle importance du port de Montréal qui
devient rapidement le principal point de transbordement des marchandises
en provenance et à destination des Grands Lacs au Canada. Le port est
aussi le lieu d'où partent les matières premières destinées à l'Europe;
il conservera ce rôle jusqu'à l'ouverture de la voie maritime du
Saint-Laurent en 1959. Le bâtiment a servi de douane pour Montréal de
1838 à 1871.
|
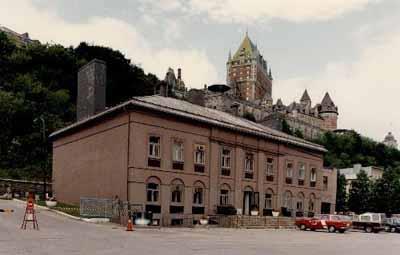
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2003 |
Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Édifice-de-la-Douane-de-Québec
Québec, Québec
Le lieu historique national du Canada de
l'Ancien-Édifice-de-la-Douane-de-Québec est situé dans la basse-ville de
la ville de Québec. Situé près du fleuve Saint-Laurent et du Queen's
Wharf, le bâtiment de deux étages se distingue par son style
néo-classique élégant mais conservateur. Il présente une façade en
granite, un toit à quatre versants à faible pente et deux larges
cheminées d'extrémité symétriques. L'entrée de l'édifice est encadrée
par quatre colonnes doriques légèrement en saillie de deux étages, et de
fenêtres disposées régulièrement le long de la façade à neuf baies, dans
des arcades aveugle au premier étage et encadrées de pierre taillée au
deuxième étage.
Construit entre 1831 et 1832, l'ancien édifice de la douane de Québec
est une conception d'Henry Musgrave Blaiklock, un des premiers
architectes professionnels à pratiquer au Canada. Bâti à côté du fleuve
Saint-Laurent, l'édifice est un rare exemple survivant d'un bâtiment
fédéral dans le style néoclassique des années 1830. Sa conception
néoclassique est évidente dans son extérieur élégant et ses détails
intérieurs impressionnant en bois et en plâtre. L'édifice simple mais
monumental est un symbole du rôle de la ville de Québec comme port pour
le Haut et le Bas-Canada, et ses revenus de douane sont devenus une
source économique importante pour la région. S'étant acquitté de son
rôle d'origine de maison des douanes jusqu'en 1841, l'édifice a depuis
servi plusieurs rôles, et abrite aujourd'hui des bureaux
fédéraux.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Jacques Pleau & Michel Pelletier, 2001 |
Lieu historique national du Canada de l'Ancienne-Aluminerie-de-Shawinigan
Shawinigan, Québec
Le lieu historique national du Canada de
l'Ancienne-Aluminerie-de-Shawinigan, se compose d'une aluminerie, et de
ses centrales hydroélectriques, situées aux chutes de Shawinigan sur la
rivière Saint Maurice, dans le secteur sud de la ville de Shawinigan.
L'ensemble est composé de douze bâtiments en brique érigés sur un
plateau dominant la rivière, d'une centrale hydroélectrique sur la rive,
et des vestiges des fondations d'une seconde centrale, également en
bordure de la rivière. Construits entre 1899 et 1927, les bâtiments sont
dans bien des cas mitoyens ou reliés par des passages. Quelques édifices
ont été renovés et constituent à présent des espaces culturels ouverts
au public.
La valeur patrimoniale du lieu tient à ses associations historiques,
c'est à dire son aménagement qui favorise l'intégration des processus de
fabrication à une source d'énergie et qui est devenu un modèle canadien
pour les entreprises industrielles faisant appel à l'hydroélectricité
ainsi que les bâtiments qui subsistent, érigés entre 1899 et 1927,
période pendant laquelle l'aluminerie de Shawinigan était la seule de
son genre au pays. L'aluminerie a été le théâtre de plusieurs premières
canadiennes : premier lingot d'aluminium coulé dans le bâtiment 7 en
1901, premiers câbles d'aluminium produits dans le bâtiment 3 en 1902 et
premiers conducteurs d'aluminium à âme d'acier réalisés dans le bâtiment
3 en 1910. L'aluminerie a été exploitée jusqu'en 1945.
Première aluminerie bâtie au pays, l'ensemble de Shawinigan est associé
aux débuts de l'industrie de l'aluminium et de la fabrication de
produits en aluminium au Canada ainsi qu'aux débuts de l'utilisation de
l'hydroélectricité pour appuyer une industrie lourde. La transformation
de l'alumine pulvérulente en métal en fusion nécessite d'énormes
quantités d'électricité. L'inventeur américain, Charles Martin Hall, a
mis au point cette technique métallurgique à la fin du XIXe siècle,
alors qu'on venait de réussir à capter l'eau en mouvement pour produire
de l'hydroélectricité.
À la demande de la Shawinigan Water and Power Company, Charles Martin
Hall et son entreprise, la Pittsburgh Reduction Company (PRC), ont bâti
la première aluminerie en sol canadien et une centrale électrique sur la
rivière Saint Maurice, réunissant ainsi deux technologies de pointe.
L'ensemble a été exploité par une filiale de la PRC, la Northern
Aluminum Company Limited, devenue par la suite l'Aluminum Company of
Canada Limited (ou, plus communément, l'Alcan).
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, C. Cournoyer, 2009 |
Lieu historique national du Canada l'Ancienne mine Lamaque et le village minier de Bourlamaque
Val-d'Or, Québec
Le lieu est situé dans la ville de Val-d'Or, dans la région
administrative de l'Abitibi-Témiscamingue de la province de Québec. Il
se trouve dans la partie sud-est de la ville, à la frontière des zones
résidentielles et minières. Il est constitué de deux sections liées et
physiquement adjacentes : l'ancienne mine Lamaque et le village minier
de Bourlamaque. Ces deux zones rappellent l'existence de Bourlamaque,
une ville créée de toutes pièces par la compagnie Teck-Hugues pour
servir les intérêts de la mine aurifère qui entra en production au
milieu des années 1930.
D'une superficie de 22 hectares, le village minier de Bourlamaque est un
exemple de ville industrielle planifiée, recelant encore les traces de
son passé de ville fermée (ville de compagnie). Planifié en 1935, le
village révèle un aménagement « optimisé, ordonné, hiérarchisé. Le plan
du village présente une trame plus ou moins orthogonale formée par deux
longues avenues est-ouest que croisent cinq rues perpendiculaires. Ce
système d'artères est complété par des ruelles qui circonscrivent les
aires de stationnement à l'arrière des maisons. Des érables en bordure
des rues agrémentent le paysage.
L'ancienne mine Lamaque et le village minier de Bourlamaque sont
d'importance historique en raison des motifs suivants :
ils forment un exemple rare et bien conservé d'une ville de compagnie de
type minier, un phénomène répandu qui a marqué le développement de
nombreuses communautés au pays;
ils forment un exemple d'une ville mono-industrielle planifiée de
l'époque de l'entre-deux-guerres, notamment par leur trame orthogonale,
la ségrégation des secteurs d'habitation selon la hiérarchie sociale,
ainsi que l'harmonie au sein d'un même secteur, ce qui est attribuable à
une architecture résidentielle où les demeures de la direction
contrastent avec les maisonnettes en pièce sur pièce de billots des
ouvriers;
ils illustrent l'appropriation communautaire qui soulève le mouvement de
conservation au Canada au cours des années 1960 et 1970.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |
Lieu historique national du Canada Apitipik
Gallichan, Québec
Le lieu historique national du Canada Apitipik est constitué d'un site
archéologique isolé de 272 hectares, situé dans la municipalité de
Gallichan, au Québec. Le site se trouve à l'extrémité est du lac
Abitibi, à l'embouchure de la rivière Duparquet, près de la frontière
entre l'Ontario et le Québec. Souvent appelé « Pointe Abitibi », le site
est un lieu traditionnel de rassemblement estival et un endroit sacré
pour les Algonquins de la région. Apitipik comprend quelque 30 sites
archéologiques qui témoignent de 6 000 ans d'occupation humaine. Le site
comprend également les vestiges de nombreux postes de traite qui furent
en opération dès le XVIIe siècle.
La valeur patrimoniale d'Apitipik réside dans ses associations
historiques et archéologiques avec les Algonquins de l'Abitibi, comme en
témoigne la terre elle-même, et dans les vestiges de l'occupation
humaine, sur le sol et sous sa surface. Apitipik est un endroit sacré et
un lieu traditionnel de rassemblement estival pour les Apitipi8innik et
leurs ancêtres. Il y subsiste des traces de diverses périodes
d'occupation pouvant remonter jusqu'à 6 000 ans avant notre ère. Par
exemple, on y trouve des sites paléohistoriques particuliers qui datent
de 4 000 ans avant notre ère à 1 100 ans de notre ère, y compris les
sites Ki8ack8e matcite8eia, Bérubé, Margot et Réal, qui ont déjà fait
l'objet de fouilles archéologiques. Apitipik comprend également de
nombreux postes de traite liés à la Compagnie du Nord-Ouest et à la
Compagnie de la Baie d'Hudson, lesquelles y ont fait du commerce dès le
XVIIe siècle. Apitipik revêt également une importance spirituelle et
culturelle pour les communautés de Pikogan et de Wahgoshig.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, HRS 319, 1992 |
Lieu historique national du Canada Appartements Marlborough
Montréal, Québec
Le lieu historique national Appartements-Marlborough est un immeuble
résidentiel de quatre étages, en brique rouge, de style néo-Queen Anne;
il est situé au 570, rue Milton, à Montréal.
L'édifice des appartements Marlborough a été désigné lieu historique
national en 1991 à titre d'exemple typique du style néo-Queen Anne et de
la conception d'appartements au tournant du siècle.
La valeur patrimoniale de ce lieu tient à son illustration du style
néo-Queen Anne tel qu'il était employé pour la conception d'immeubles
d'appartements au tournant du vingtième siècle au Canada.
Les appartements Marlborough ont été dessinés par les architectes Taylor
et Gordon et construits en 1900. Le style néo-Queen Anne était en vogue
pour l'architecture domestique de luxe (tant pour les maisons que pour
les appartements) partout au Canada pendant la période de 1870 à 1914.
La clé de la réussite pour la création d'un immeuble d'appartements de
style néo-Queen Anne tient à la conception de l'édifice comme un
ensemble unifié, ressemblant à une grande maison. Les appartements
Marlborough constituent l'un des rares immeubles d'appartements de style
néo-Queen Anne qui existent encore au Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Geneviève Charrois, 2005 |
Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Historique-de-La Malbaie
La Malbaie, Québec
Le lieu historique national du Canada de
l'Arrondissement-Historique-de-La Malbaie est niché à flanc de montagne
sur une étroite bande de terre longue de 8 kilomètres, donnant sur le
fleuve Saint-Laurent, dans la région de Charlevoix, au Québec. Un des
plus anciens lieux de villégiature au pays, le lieu désigné comprend
plus de deux cents bâtiments principaux et secondaires datant
principalement de l'âge d'or de la villégiature, c'est-à-dire de 1880 à
1930, ainsi que des composantes plus récentes. Les bâtiments principaux
sont pour la plupart associés directement à la villégiature par leur
usage, tel que les hôtels/restaurants, les résidences, et les lieux
associés aux loisirs. L'arrondissement historique de La Malbaie se
caractérise également par la présence de très nombreux panoramas sur le
fleuve et de chemins, parfois sinueux, où s'implantent des cottages de
bois.
La valeur historique de l'arrondissement historique de La Malbaie repose
notamment sur sa fonction de lieu de villégiature. Son utilisation et
ses liens historiques sont tributaires de ce phénomène qui a marqué le
Canada du milieu du XIXe siècle jusque vers 1930. La Malbaie est l'une
des premières contrées à avoir accueillies des estivants. Avec
l'importance du transport maritime, ce phénomène s'est rapidement ancré
au point d'en transformer sa nature jusqu'alors rurale et isolée. La
Malbaie était alors devenu un lieu de villégiature très exclusif,
offrant toutes les caractéristiques essentielles à sa renommée, un cadre
et un emplacement incomparables, ainsi que de nombreuses ressources
mises à la disponibilité des estivants.
À ses débuts, la villégiature coïncide avec l'apparition d'une
bourgeoisie née de la révolution industrielle et des changements
socio-économiques qui s'en suivent. À cette période, les bains de mer et
l'air pur de la campagne sont devenus une solution à l'insalubrité des
villes, des espaces naturels préservés de l'industrialisation rapide.
Les estivants occupaient de belles résidences sur le chemin des Falaises
et allaient régulièrement au Manoir Richelieu pour y tenir de grandes
réceptions. Encore aujourd'hui, de nombreuses ressources permettent de
témoigner de l'importance de La Malbaie durant toute la période de l'âge
d'or de la villégiature au Canada. Avec son patrimoine bâti et paysager,
l'arrondissement historique de La Malbaie est toujours représentatif des
hauts lieux de villégiature canadiens.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Michel Pelletier, 2001

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Michel Pelletier, 2001 |
Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Historique-de-Senneville
Senneville, Québec
Lieu historique national du Canada de
l'Arrondissement-Historique-de-Senneville provient d'un village
touristique de la fin du XIXe siècle situé sur les rives du lac des
Deux-Montagnes, à l'extrémité ouest de l'île de Montréal. Sa superficie
dépasse 1 400 acres, et il comprend au moins 82 bâtiments qui,
construits entre 1860 et 1930, sont répartis sur une douzaine de
propriétés. L'artère principale de l'arrondissement est le chemin
Senneville, une route rurale parallèle à la rive du lac. Les édifices de
l'arrondissement, notamment les grands manoirs, les petites résidences
secondaires, les dépendances agricoles et les éléments paysagers, sont
construits bien en retrait de la route, sur de grands domaines boisés
dont plusieurs bordent le lac. L'arrondissement regorge de toute une
gamme de paysages pittoresques et d'architecture inspirée du mouvement «
Arts and Crafts ». On y trouve également les ruines du Fort Senneville,
et du moulin de Senneville, le Morgan Arboretum, un parc naturel
(l'Anse-à l'Orme) et un parc agricole (Bois-de-la-Roche), ainsi que
Braeside, un parcours de golf de la fin du XIXe siècle. Les quatre
derniers éléments forment une large ceinture verte qui borde les côtés
sud et est de l'arrondissement et le sépare des aménagements industriels
et résidentiels adjacents.
Les propriétaires successifs des domaines de Senneville étaient
présidents, fondateurs ou directeurs de certaines entreprises
commerciales les plus importantes de l'époque, y compris la Banque de
Montréal et la Compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique. Parmi
ces derniers, citons : Sir John Joseph Caldwell Abbott (1821-1893),
maire de Montréal et troisième Premier ministre du Canada; John Lancelot
Todd, professeur de parasitologie à l'Université McGill; Louis Joseph
Forget (1853-1911), courtier en valeurs mobilières et sénateur
conservateur, et les banquiers montréalais Sir Edward Seaborne Clouston
(1849-1912) et Richard Bladworth Angus (1831-1922).
L'Arrondissement historique de Senneville comprend plus de trente
bâtiments importants conçus par un petit groupe d'éminents architectes,
paysagistes et planificateurs urbains montréalais, qui ont souvent
travaillé de concert avec des collègues américains. Ce groupe comprenait
plusieurs des meilleurs architectes et concepteurs canadiens de l'époque
qui avaient en commun une approche pittoresque de l'aménagement paysager
et une affinité avec le mouvement « Arts and Crafts ». Les chefs de file
de ce groupe, les deux frères Edward Maxwell (1867-1923) et William
Sutherland Maxwell (1874-1952), ont conçu de nombreux édifices à
Senneville, dont certains en partenariat avec l'architecte montréalais
George Cutler Shattuck (1864-1923). Les vingt édifices préservés
construits par les frères Maxwell à Senneville sont un exemple unique de
leurs œuvres. L'architecte et professeur montréalais Percy Erskine Nobbs
(1875-1964) a conçu, en collaboration avec George Taylor Hyde
(1879-1944), les édifices et le parc du domaine J.L. Todd. L'architecte
paysager et planificateur urbain Frederick G. Todd (1876-1948) a conçu
le parc du domaine Abbott/Clouston, en collaboration avec le paysagiste
américain Frederick Law Olmsted, concepteur du parc du domaine Forget.
Parmi les autres architectes éminents ayant travaillé à Senneville,
notons : James & H. Charles Nelson, Kenneth Rea (1878-1941), Harold
Edgar Shorey (1886-1971), Samuel Douglas Ritchie (1887-1959), J.R. Hind,
Robert Findlay (1859-1951), Frank R. Findlay et David Shennan.
Les domaines de Senneville et leurs édifices, construits entre 1860 et
1926, témoignent de l'émergence du mouvement « Arts and Crafts » et de
l'aménagement paysager pittoresque au Canada. Ces édifices et éléments
paysagers ont une ressemblance marquée sur les plans de la forme et du
style, car ils ont été conçus par un petit nombre de propriétaires ayant
eu recours à un petit groupe d'architectes et de paysagistes pendant une
courte période.
L'Arrondissement historique de Senneville contient plusieurs
chefs-d'œuvre qui font partie de l'histoire de l'architecture et de
l'aménagement de paysage au Canada, notamment « Bois-de-la-Roche », la
résidence de style Château construite par le sénateur Louis Joseph
Forget, et le domaine J.L. Todd.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |
Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Historique-du-Vieux-Wendake
Wendake, Québec
Le lieu historique national du Canada de
l'Arrondissement-Historique-du-Vieux-Wendake est situé à 12 kilomètres
au nord-ouest de la Ville de Québec. Sur la rive sud de la rivière
Saint-Charles et près de la chute Kabir-Kouba, le lieu est
principalement composé de bâtiments résidentiels et commerciaux, dont la
plupart des façades sont orientées vers le sud, qui illustrent un plan
de village huron traditionnel. Le lieu se distingue particulièrement par
la présence d'un quartier résidentiel dense constitué de maisons
unifamiliales et multifamiliales, du lieu historique national du Canada
de l'Église-de-Notre-Dame-de-Lorette, de deux cimetières, ainsi que
d'une multitude de bâtiments commerciaux et administratifs.
La valeur patrimoniale du lieu réside dans la topographie et les modes
de peuplement de l'arrondissement, notamment les modèles d'utilisation
des terres et l'architecture qui témoignent des 300 ans d'histoire de la
colonisation dans cette région. Durant la première moitié du XVIIe
siècle, les Hurons-Wendats, qui habitaient et vivaient de l'agriculture
au sud de la baie Georgienne en Ontario, sont devenus d'importants
partenaires commerciaux des Français, dans la traite des fourrures.
Décimés par la famine, les guerres et les maladies contagieuses en
provenance d'Europe, ils ont quitté leurs terres en 1650 et se sont
établi en permanence à Jeune-Lorette. L'arrondissement est rebaptisé
Vieux-Wendake en 1697.
L'Arrondissement historique du Vieux-Wendake est un bon exemple de la
coexistence de différentes influences culturelles. Plutôt que de suivre
un plan géométrique, l'arrondissement est construit autour d'éléments
naturels. Par exemple, les entrées principales des bâtiments font
généralement face au sud-est, peu importe le côté de la parcelle de
terrain qui donne sur la rue. Bien que le style de construction de très
nombreux bâtiments soit d'inspiration européenne et postérieure à 1730,
ce plan est similaire aux villages hurons traditionnels. En outre, les
îlots sont densément construits pour permettre le passage piétonnier
entre les maisons, accentuant ainsi le sentiment d'appartenance à la
communauté et les espaces publics tout en favorisant un système
économique fondé sur l'industrie artisanale. La coutume qui consiste à
nommer les rues en l'honneur d'anciens chefs révèle la relation que les
Hurons-Wendats entretiennent encore aujourd'hui avec ce lieu qui
témoigne de leur mémoire collective, subsistance et histoire.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Geneviève Charrois, 2008

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Geneviève Charrois, 2008 |
Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-de-Westmount
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-de-Westmount
est situé sur le flanc sud-ouest du mont Royal, principalement au
nord-ouest de la rue Sherbrooke, et il fait partie de la ville de
Westmount. L'arrondissement est un modèle typique de banlieue des
époques prospères victorienne et post-victorienne au Canada, et il se
distingue par un patrimoine bâti et paysager représentatif de la période
entre 1890 et 1930. Un conseil responsable de l'architecture et de la
planification locale réglemente le développement immobilier depuis 1914.
L'arrondissement se démarque par ses immeubles résidentiels de grande
qualité, ses édifices publics notables, ses écoles, ses lieux de culte,
ainsi que ses rues formant un quadrillage et son réseau d'espaces verts
paysagés publics et privés.
La valeur patrimoniale de l'arrondissement de Westmount réside, par
exemple, dans les facteurs suivants : ses liens avec le développement de
la vie sociale et intellectuelle au sein de la communauté anglophone
montréalaise bourgeoise du début du XXe siècle; la construction
réglementée de bâtiments résidentiels et publics dessinés et érigés par
des architectes et des constructeurs réputés de Montréal, et dont les
styles architecturaux sont très variés; ses éléments paysagers, comme
des parcs et des jardins, le belvédère, et l'escalier qui grimpe sur le
mont. La cohérence de l'arrondissement sur le plan visuel a été
maintenue grâce à un conseil responsable de l'architecture et de la
planification locale qui réglemente le développement immobilier dans le
secteur à partir de 1914. Dans son ensemble, Westmount est un
environnement équilibré pour la vie urbaine, avec ses vastes espaces
verts et ses bâtiments publics de belle apparence favorisant le
développement harmonieux d'une vie communautaire saine.
|

©Pierre Lahoud, 2010 |
Lieu historique national d'Arvida
Arvida, Québec
Les limites retenues pour cet arrondissement historique correspondent
grosso modo aux limites historiques de la ville d'Arvida conçue à partir
de 1925 et dont les phases de développement considérées se sont étalées
jusqu'au début des années 1950. Nous considérerons ici uniquement la
partie située au nord de la voie ferrée, ce qui exclut les quartiers
situés au sud de cette dernière, tels les quartiers Saint-Jacques,
Saint-Philippe et Saint-Mathias. Sont également exclus du périmètre
proposé : la zone commerciale, située entre la partie nord et la partie
sud, les installations industrielles de Rio Tinto Alcan de même que les
résidences dont la construction date d'après les années 1950 et qui sont
pour la majorité regroupées au nord-est de l'arrondissement proposé.
L'arrondissement d'Arvida est d'importance historique pour les raisons
suivantes :
conçue à partir de 1925 selon les plans des architectes Brainerd et
Skougor, la ville d'Arvida est réalisée en trois phases successives,
jusqu'en 1950, et constitue une excellente synthèse des concepts
urbanistiques de l'époque, tels les mouvements City Beautiful et
cité-jardin, qui se traduit par un tracé organique épousant la
topographie du sol, par des voies de circulation hiérarchisées, par la
présence de parcs, d'espaces verts et de nombreux arbres;
exemple fort bien conservé de ville mono-industrielle canadienne, Arvida
constitue un projet singulier de logement ouvrier de qualité où
l'édification rapide d'un paysage urbain diversifié s'est faite au moyen
d'une grande variété de modèles de résidences, dont certaines
constituent une manifestation particulièrement réussie d'architecture
d'inspiration régionaliste;
associée au premier complexe aluminier au Canada, l'expansion d'Arvida
témoigne de l'essor et du développement lié à l'industrie de l'aluminium
au pays.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national du Canada de l'Auberge-Symmes
Gatineau, Québec
Érigée au début du XIXe siècle, le lieu historique national du Canada de
l'Auberge-Symmes est un bâtiment en pierre de deux étages et demi situé
sur la rue principale d'Aylmer (maintenant un secteur de la ville de
Gatineau) au Québec et jouxtant la rive nord de l'Outaouais. Ce charmant
bâtiment se distingue par ses longues galeries qui ornent chacune des
façades, son élégant toit en larmier et ses cheminées doubles.
Aujourd'hui, elle sert de centre culturel à la communauté locale.
L'auberge Symmes a été désignée lieu historique national du Canada en
1976 parce qu'elle a longtemps occupé un emplacement privilégié sur la
route entre Hull (maintenant un secteur de la ville de Gatineau) et le
lac Témiscamingue.
Charles Symmes, le fondateur de la ville d'Aylmer fit construire cette
auberge en 1831. Pendant plusieurs années, les voyageurs faisaient halte
à l'auberge, alors appelée Hôtel Aylmer, puis se rendaient à l'extrémité
du lac Deschênes, en bateau à vapeur l'été et en traîneau l'hiver, et
poursuivaient leur voyage vers les postes de traite du Nord-Ouest du
Québec. En 1973, le bâtiment est sauvé de la ruine et rénové par la
Société d'aménagement de l'Outaouais.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de
l'Auberge-Symmes tient à ses liens historiques attribuables à sa
vocation d'auberge et de halte construite sur une des premières voies de
transport achalandées de la région. Elle porte également sur sa forme et
caractéristiques particulières, ses matériaux, sa composition, son
emplacement et sa situation.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac
Paspébiac, Québec
Le lieu historique national du Canada du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac est
un élément de paysage de la pêche côtière comprenant dix bâtiments sur
la soixantaine autrefois érigés sur un banc de sable entourant un
barachois (lagune) à Paspébiac, dans la péninsule gaspésienne, au
Québec. Les bâtiments témoignent d'un langage simple et connu dérivé de
la tradition de la Nouvelle-Angleterre. Le lieu est associé à la pêche
côtière telle que pratiquée dans la région pendant plus de 150 ans.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du
Banc-de-Pêche-de-Paspébiac réside dans son association avec la pêche
côtière, comme en témoignent son emplacement, les structures et
bâtiments qui le composent. La plupart des bâtiments qui ont survécu
datent du XIXe siècle et sont associés aux ensembles architecturaux de
deux entreprises qui ont été les acteurs les plus puissants d'une
industrie fortement monopolisée. Le complexe de plus grande envergure a
été construit par la Charles Robin and Co. fondée en 1766, aussi appelée
Robin, Pipon and Co., ou C. Robin and Co. Ltd., et dont les activités se
sont poursuivies au XXe siècle sous la raison sociale Charles
Robin-Collas Co. Ltd. Le deuxième complexe, de moindre envergure, était
le siège de l'entreprise Le Boutillier Brothers, établie en 1838. En
1964, un incendie a détruit la plupart des bâtiments qui formaient les
ensembles architecturaux originaux, n'épargnant que la poudrière et sept
des bâtiments érigés par Charles Robin and Co. et trois des bâtiments
construits par Le Boutillier Brothers. Quatre des bâtiments font
d'ailleurs l'objet d'une commémoration distincte à titre de lieu
historique national du Canada des Bâtiments-de-Paspébiac.
|
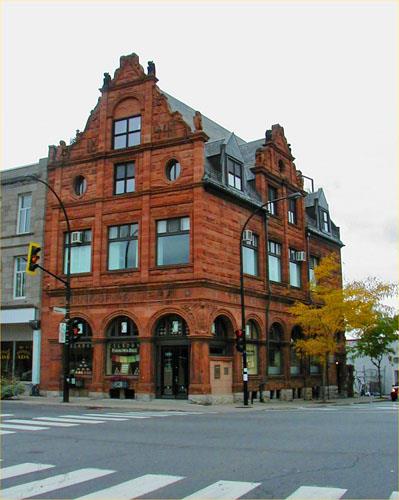
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2004 |
Lieu historique national du Canada de la Banque-de-Montréal
Montréal, Québec
De style néo-Queen Anne, l'édifice de la Banque de Montréal date de la
fin du XIXe siècle. Il est situé à l'angle des rues Notre-Dame et Des
Seigneurs, à Montréal.
L'édifice de la Banque de Montréal a été désigné lieu historique
national en 1990 parce qu'il s'agit d'un très bel exemple du style
néo-Queen Anne appliqué à l'architecture commerciale.
Érigé pour la Banque de Montréal, l'édifice du même nom est un des rares
exemples toujours existants d'édifices commerciaux de style néo-Queen
Anne intégrant des caractéristiques des édifices publics flamands de la
Renaissance.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, P. St. Jacques, 1995 |
Lieu historique national du Canada de la Basilique-St. Patrick
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Basilique-St. Patrick est
une vaste église de pierre construite entre 1843 et 1847 dans le style
néo-gothique d'inspiration française. Elle s'élève sur un grand terrain
occupant la moitié d'un îlot près du coin sud de l'intersection du
boulevard René-Lévesque et de la rue Saint-Alexandre, dans un secteur
commercial très fréquenté du centre-ville de Montréal, au Québec. La
basilique imposante illustre des caractéristiques du style néo-gothique
d'inspiration française comme par exemple, la grande tour centrale et la
rosace proéminente.
Construite entre 1843 et 1847, la basilique St. Patrick servait d'église
paroissiale à la population irlandaise grandissante de Montréal. Dès la
fin des travaux, son clergé a porté secours aux immigrants victimes
d'une épidémie de fièvre typhoïde. Maintenant ses vocations religieuse,
charitable et éducative, l'église est devenue le cœur de la communauté
irlandaise de la ville. Le fait d'avoir été choisie comme lieu de
célébration des funérailles de Thomas D'Arcy McGee en 1868 illustre son
rôle concret et symbolique.
La basilique St. Patrick est un exemple remarquable de l'architecture
néo-gothique d'inspiration française et une des premières réalisations
de ce genre. Ce style repose sur les études approfondies de
l'architecture française du XIIIe siècle menées par des spécialistes
français. Ces derniers et leurs disciples appréciaient le traitement
rationnel, typique de l'époque, de la relation entre les éléments
architecturaux et structuraux. La basilique St. Patrick illustre cette
approche par la clarté de ses éléments structuraux, sa symétrie, sa
verticalité ainsi que l'utilisation de décorations « archéologiquement »
appropriées.
Le style néo-gothique français a été adapté par les concepteurs de la
basilique, l'architecte Pierre-Louis Morin et le prêtre jésuite Félix
Martin. Tous deux s'intéressaient à l'architecture médiévale française
et en possédaient une solide connaissance grâce à des études sur le
terrain et, dans le cas du père Martin, aux relations étroites que sa
famille entretenait avec des promoteurs de ce style. L'intérieur de la
basilique St. Patrick comporte des exemples remarquables du savoir faire
et de l'art religieux du Québec. Des ajouts ont été faits à deux
reprises au cours de ce siècle sur les décorations d'origine datant de
1845 à 1851. La première décoration a été supervisée par Victor
Bourgeau. Antoine Plamondon a réalisé les peintures des stations du
chemin de croix. L'autel principal et les deux autels latéraux,
richement sculptés, sont l'œuvre de Perrault, Paré et Ouellet.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2011 |
Lieu historique national du Canada de la Bataille-des-Cèdres
Les Cèdres, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Bataille-des-Cèdres est
situé dans la municipalité de Les Cèdres, à 52 km au sud-ouest de
Montréal, au Québec, sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Il n'existe
aucun vestige visible de la bataille, au terme de laquelle les forces
britanniques et canadiennes ont vaincu le contingent américain posté aux
Cèdres, les 19 et 20 mai 1776, en plus de vaincre, le 21 mai 1776, les
troupes américaines venues en renfort. Une plaque de la Commission des
lieux et monuments historiques du Canada a été installée en 1980 pour
commémorer la bataille qui a eu lieu à cet endroit. Ceinturée d'une
petite clôture, elle est située au bord du chemin du Fleuve, sur un
petit terrain gazonné entouré de terres agricoles et d'arbres.
En 1776, durant la guerre de l'Indépendance (1775-1783), des soldats
américains envahissent le Canada et occupent la ville de Montréal. Afin
de protéger le flanc ouest des attaques des Britanniques, les troupes
américaines érigent un petit avant-poste aux Cèdres, au Québec. La
bataille des Cèdres éclate lorsque les troupes britanniques, parties de
la région du Niagara, croisent l'avant-poste américain. Le capitaine
britannique George Forster, qui commande un détachement du 8e Régiment,
est appuyé par les Cayugas, les Sénécas et les Mississaugas, sous les
ordres du capitaine Guillaume de Lorimier. Durant la bataille, un groupe
de 30 Canadiens, avec à sa tête le capitaine J.B. Testard de Montigny,
vient prêter main-forte aux troupes de Forster.
Les troupes du capitaine Forster attaquent l'avant-poste des Américains,
qui capitulent après un court siège. Le lendemain, les troupes
américaines arrivées en renfort se voient également obligées de se
rendre après leur escarmouche avec les troupes de Forster. Malgré sa
victoire lors de la bataille des Cèdres, le capitaine Forster n'a pas
les ressources nécessaires pour se rendre jusqu'à Montréal, qui sera
occupée par les Américains jusqu'en juin 1776.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1920 |
Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-la-Châteauguay
Allans Corners, Québec
Bataille ayant eu lieu en 1813 pour défendre le Bas-Canada; guerre de 1812.
Le lieu historique national du Canada de la Bataille-de-la-Châteauguay
est un terrain plat situé presque au centre du champ de bataille de la
guerre de 1812 situé sur les berges de la rivière Châteauguay à Allans's
Corners, dans la municipalité de Howick, près d'Ormstown, à quelques
kilomètres au sud-ouest de Montréal.
Le site de la Bataille-de-la-Châteauguay a été déclaré lieu historique
national parce qu'il s'agit du lieu où les Canadiens ont remporté une
victoire le 26 octobre 1813 et c'est aussi en raison de l'importance du
rôle que l'armée canadienne française a joué pour la défense du Canada
contre l'invasion américaine de la guerre de 1812.
La valeur patrimoniale du lieu historique national de la
Bataille-de-la-Châteauguay réside dans son identification à un vestige
commémoratif au coeur du paysage culturel net et relativement inchangé
du champ de bataille qui s'étendait de la fourche des rivières
Châteauguay et des Outardes jusqu'à celle des rivières Châteauguay et
des Anglais, et couvrait une superficie d'environ 500 acres. Le centre
de la bataille était situé entre le gué Morrison et Pointe Ronde.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |
Lieu historique national du Canada de la Bataille-d'Eccles-Hill
Frelighsburg, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Bataille-d'Eccles-Hill est
situé sur une colline à proximité de la frontière du Canada et des
États-Unis entre le Vermont et le Québec, près de Frelighsburg (Québec).
Il surplomb le champ de bataille où eut lieu la bataille D'Eccles Hill
en 1870. Le terrain de plus de 3000 mètres carrés est encadré d'une
clôture sur trois côtés et de la route sur le quatrième et comprend un
canon de trois livres, vestiges de l'affrontement, et un monument
commémoratif en granit datant de 1902.
La valeur historique du site repose sur son association avec les
événements de la bataille d'Eccles Hill. En 1870, les Fenians
franchirent la frontière canadienne-américaine à la hauteur d'Eccles
Hill et se heurtèrent aux territoriaux et aux volontaires canadiens. Cet
affrontement a été provoqué par le groupe de patriotes irlandais exilés
aux États-Unis afin d'entreprendre une action révolutionnaire en faveur
de l'indépendance de l'Irlande. Ils voulaient affaiblir l'Angleterre en
s'attaquant au Canada, ce qui s'est révélé être un échec.
Le lieu et le monument en granit commémorant l'événement sont situés à
une relative proximité du champ de bataille et des positions
canadiennes, mais l'engagement armé eut lieu près de la frontière du
Canada et des États-Unis, plus au sud.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |
Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Lacolle
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Lacolle est
situé dans une banlieue de la ville de Lacolle, au Québec, tout juste au
nord de la frontière entre le Canada et les États-Unis. En mars 1814,
une petite troupe composée de soldats du 13e Régiment de Fantassins de
la garnison britannique, de Royal Marines, de Canadian Fencibles, de
Voltigeurs et de guerriers autochtones repousse une attaque menée par 4
000 soldats américains. La résistance aux forces américaines est
concentrée au moulin local, situé sur la rive sud de la rivière Lacolle
et au blockhaus, situé 200 mètres plus loin, sur la rive nord.
L'emplacement du moulin sur la rivière Lacolle est marqué d'un cairn de
la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC),
installé près de la route.
La bataille de Lacolle, dernier affrontement visant à contrer l'invasion
américaine au Bas Canada durant la guerre de 1812, est importante en
raison de son lien avec la protection du Canada. Après avoir tenté de
capturer Montréal en 1812, sans succès, le major-général américain James
Wilkinson planifie une nouvelle invasion du Bas-Canada en mars 1814. Il
traverse la frontière avec son armée de 4 000 hommes et se dirige vers
la rivière Lacolle, où il a déjà subi une défaite en 1812. Le 30 mars
1814, les Américains ouvrent le feu sur le moulin situé près de la
rivière Lacolle, où le major R. B. Handcock dirige une petite troupe
d'environ 500 hommes. Le groupe est formé d'une petite partie du 13e
Régiment de Fantassins de la garnison britannique, de Royal Marines, de
Canadians Fencibles, de Voltigeurs et de guerriers autochtones. La
troupe du major Handcock repousse l'attaque du moulin fortifié.
Déconcerté par la résistance des Canadiens-français, le major-général
Wilkinson cesse le combat et se retire à la frontière américaine, ce qui
met fin à la dernière tentative d'invasion des Américains au Bas-Canada
durant la guerre de 1812.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2006 |
Lieu historique national du Canada de la Bataille-du-Lac-des-Deux-Montagnes
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada de la
Bataille-du-Lac-des-Deux-Montagnes est situé à l'extrémité ouest de
l'île de Montréal, sur le lac des Deux Montagnes, au Québec. Le site, ne
présentant aucun vestiges visibles, est composé d'un carré de terre
centrée autour de la plaque de la Commission des lieux et monuments
historiques du Canada (CLMHC) commémorant la bataille.
Après le massacre de Lachine, en août 1689, les Iroquois qui étaient
restés dans la région constituaient une menace pour les habitants de
l'île de Montréal et des villages environnants. En octobre, le
gouverneur Denonville a forme un groupé d'éclaireurs, composé de
vingt-huit coureurs de bois sous le commandement des Sieurs Dulhut et
d'Ailleboust de Manthet. Au lac des Deux Montagnes, ils tombèrent sur
une bande de vingt-deux Iroquois ce qui mena à une escarmouche. Les
Français ont défirent les Iroquois et ne signalèrent aucune perte, ce
qui redonna confiance aux habitants de la région.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2007 |
Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-la-Ristigouche
Pointe-à-la-Croix, Québec
Lieu de dernier combat naval de la guerre de Sept Ans.
Pendant plus de 200 ans, l'épave du Machault, voilier de 26 canons
chargé de protéger des navires marchands contre les Anglais, est restée
sous l'eau. Il est aujourd'hui possible d'en admirerles vestiges et de
revivre le tout dernier affrontement naval entre la France et
l'Angleterre pour la possession du territoire américain au lieu
historique national de la Bataille-de-la-Ristigouche. Un voyage
extraordinaire qui vous entraînera… en 1760!
Le lieu historique national du Canada de la Bataille-de-la-Ristigouche
est situé au coeur de la baie des Chaleurs, dans l'estuaire de la
rivière Ristigouche, entre le Nouveau-Brunswick et le Québec. Le lieu
comprend des vestiges in situ de deux navires français coulés par les
Britanniques durant la bataille de la Ristigouche, entre le 22 juin et
le 8 juillet 1760. Le Bienfaisant, un navire de ravitaillement de 350
tonneaux, est demeuré repose à toutes fins pratiques intouché tandis
qu'une partie du Machault, une frégate armée de 550 tonneaux, est
toujours immergée. Une zone de délestage, qui comprend surtout des
objets en métal provenant des navires français, fait aussi partie de la
désignation.
En 1760, une modeste flotte française formée du Machault, du Bienfaisant
et du Marquis de Malauze, commandée par le sieur François Chenard de la
Giraudais, revint de France avec des renforts, des vivres et des
munitions. En atteignant le fleuve Saint-Laurent, la flotte découvrit
que les renforts britanniques l'avaient précédée et décida alors de
chercher refuge dans la baie des Chaleurs. Prévoyant l'arrivée des
Français, le capitaine Byron et le navire britannique Fame quittèrent
Louisbourg entourés d'une petite flotte et, le 22 juin, ils
rencontrèrent les navires français dans la rivière Ristigouche, lesquels
détenaient également à leur bord 300 Acadiens et 250 Micmacs. Pour
contrer l'attaque des Britanniques, les Français aménagèrent une
batterie à la Pointe-à-la-Batterie, sous le commandement de Donat de la
Garde.
Dans la soirée et la nuit du 28 au 29 juin, deux frégates britanniques,
le Repulse et le Scarborough, réussirent à se frayer un passage à
travers les bateaux coulés. Le 2 juillet, ils contournèrent les défenses
françaises et parvinrent à détruire la batterie française à la
Pointe-à-la-Batterie. Le 8 juillet, trois navires britanniques, le
Repulse, le Scarborough et une goélette contournèrent les deux chaînes
de bateaux coulés par les Français. Face au Machault et aux deux
batteries françaises de la pointe des Sauvages et de la pointe de la
Mission, le Repulse fût contraint à s'échouer. Toutefois, dépourvus de
renforts, les Français durent mettre le feu au Machault et au
Bienfaisant, gravement endommagés, pour éviter leur capture. Quant au
troisième navire français, le Marquis de Malauze, il fût incendié par
les prisonniers britanniques à bord, après leur libération par leurs
compatriotes. En 1939, l'épave du Marquis de Malauze fût retirée des
eaux par le ministère des Transports. Depuis les années 1960, les épaves
firent l'objet de nombreuses recherches archéologiques
subaquatiques.
|
|
Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Rivière-des-Prairies / Combat-de-la-Coulée-Grou
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Bataille de Rivière des
Prairies/Combat de la Coulée Grou se trouve sur un terrain vallonné et
partiellement boisé situé près de la rive de l'île de Montréal, au
Québec. Cet endroit a été le théâtre d'une bataille qui a opposé un
groupe d'Iroquois et de colons français en 1690. Il n'existe aucun
vestige de la bataille; toutefois, une plaque commémorative de la
Commission des lieux et monuments historiques du Canada a été apposée à
environ 60 mètres de la coulée, sur le boulevard Gouin.
Le 2 juillet 1690, le Sieur de Colombet, ancien lieutenant de l'armée
française, est alerté de la présence d'un groupe d'Iroquois naviguant en
canot sur la rivière des Prairies, le poussant à réunir 25 colons afin
d'enquêter. Ils se rendent sur la propriété de Jean Grou, près du
ruisseau qui porte son nom, et tirent sur les canots des Iroquois, en
tuant quatre. Les Iroquois, au nombre d'une centaine environ, mettent
pied à terre et engagent le combat avec les Français. Au terme de la
bataille, 15 Français et 30 Iroquois sont tués ou fait
prisonniers.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |
Lieu historique national du Canada de la Bataille-du-6-Septembre 1775
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Bataille-du-6-Septembre 1775
se trouve dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 43 km au sud-est de
Montréal, au Québec. Plus précisément, le site est situé près de la
rivière Bernier, autrefois appelé ruisseau Montgomery, à moins d'un
kilomètre de la rivière Richelieu et à 1,6 km du lieu historique
national du Canada du Fort-Saint-Jean. Il n'y a aucun vestige de la
bataille du 6 septembre 1775, durant laquelle une patrouille de
guerriers autochtones composée d'un grand nombre de Mohawks a repoussé,
sous la direction d'un grand chef et de deux capitaines européens, une
invasion américaine. Une plaque commémorative de la CLMHC a été
installée en 1929 sur le site, qui est aujourd'hui une aire gazonnée et
bordée d'érables située à côté d'un terrain de golf privé.
En 1775, durant la guerre de l'Indépendance, des forces armées
américaines dirigées par le major-général Philip Schuyler, le colonel
Benedict Arnold et le brigadier-général Richard Montgomery attaquent le
Canada britannique dans l'espoir de prendre le contrôle militaire de la
province de Québec. Le brigadier-général Montgomery conduit la moitié
des troupes, soit 1 500 soldats, de l'autre côté de la frontière. Les
combattants se regroupent à l'île aux Noix, sur la rivière Richelieu, au
nord du lac Champlain. Le 6 septembre 1775, Montgomery et le
major-général Schuyler descendent la rivière en bateau dans l'intention
d'attaquer le fort Saint-Jean. Ils débarquent à environ 1,6 km du fort,
sur la rive ouest, et se font accueillir par les salves d'une patrouille
composée d'environ 100 guerriers autochtones, dont un bon nombre de
Mohawks, menée par le grand chef Solsienhooane et les capitaines Gilbert
Tice et Guillaume de Lorimier. Durant la bataille, huit Américains sont
tués et neuf blessés. L'autre camp compte quatre morts et cinq blessés,
dont le capitaine Tice. Les Américains sont contraints de retraiter à
l'île aux Noix. Bien qu'elles soient repoussées la nuit du 6 septembre,
les forces américaines reviennent à la charge et assiègent le fort
Saint-Jean le 13 septembre. Le fort capitulera 45 jours plus tard, soit
le 3 novembre 1775. L'invasion américaine au Canada se poursuit jusqu'à
l'arrivée de renforts britanniques en 1776, qui aident à repousser
l'envahisseur de l'autre côté de la frontière.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, dossier 8400-153s |
Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Trois-Rivières
Trois-Rivières, Québec
Le 8 juin 1776, les troupes anglaises, retranchées sur le terrain bas,
près de cet endroit, sous les ordres du général Simon Fraser,
repoussèrent et infligèrent des pertes sérieuses à une colonne
américaine commandée par le général Thompson.
|

©Pointe-à-Callière Archaeological Field School / École de fouilles de Pointe-à-Callière, Alain Vandal, 2007 |
Lieu historique national du Canada du Berceau de Montréal
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada du Berceau-de-Montréal est situé
entre la rue de la Commune ouest et la place d'Youville dans le
Vieux-Port de Montréal, au Québec. Il s'agit de l'endroit où Paul de
Chomedey de Maisonneuve a fondé Montréal le 18 mai 1642. Le site est
composé de vestiges du fort Ville-Marie, également connu sous le nom de
fort Maisonneuve, construit en 1645 à la demande de Paul de Chomedey de
Maisonneuve. Il n'y a aucun vestiges visibles du site.
La valeur patrimoniale du berceau de Montréal repose sur son association
avec la fondation de la Ville de Montréal, puis qu'il s'agit du lieu de
débarquement des fondateurs de Montréal, le 18 mai 1642. Commandant
l'expédition, Paul de Chomedey de Maisonneuve, désigné personne
historique nationale, a choisi d'accoster à ce qui fût bientôt appelé
Ville-Marie, dans le but d'y fonder une ville. Ce lieu qui a vu naître
Montréal a aussi été témoin de sa transformation en l'une des grandes
métropoles du Canada.
La fondation a été marquée par la construction du fort Ville-Marie. Le
site avait été jugé un endroit idéal pour l'érection d'un fort défensif
en période d'hostilités entre les Français et les Iroquois, qui avaient
utilisé le lieu comme point de rencontre pendant des siècles. Construit
en 1645, par les pionniers français sous la direction de Paul de
Chomedey de Maisonneuve, le fort en pierre d'origine a occupé une
empreinte de 97,5 mètres carrés. Des fouilles archéologiques ont permis
de mettre au jour de vestiges du fort Ville-Marie.
|

©Mechanics' Institute of Montréal Archives/Archives du Mechanics' Institute of Montréal, 1920 |
Lieu historique national du Canada de la Bibliothèque-Atwater-du-Mechanics' Institute of Montreal
Montréal, Québec
La bibliothèque Atwater du Mechanics' Institute of Montreal est située
au 1200, avenue Atwater, à l'intersection de la rue Tupper, à Westmount.
Ce bâtiment en brique d'un étage a été construit dans le style
Beaux-Arts sur un lot paysager face au carré Cabot.
La bibliothèque Atwater a été construite par le Mechanics' Institute of
Montreal en 1918-1920, près d'un siècle après la création de
l'organisation. Le Mechanics' Institute, qui a représenté un important
mouvement social, culturel et pédagogique consacré à l'éducation
universelle et à la formation technique, possédait au XIXe siècle de
nombreuses subdivisions au Canada. Ce mouvement est ancré dans les
traditions britanniques d'éducation des adultes et de la communauté
datant des XVIIIe et XIXe siècles.
La valeur patrimoniale de la bibliothèque Atwater réside dans sa
représentation du rôle des instituts de mécanique au Canada et
particulièrement à Montréal : elle incarne les principes et les idéaux
de l'institut et continue de servir de bibliothèque et de lieu de
rencontre. Sa valeur réside également dans sa conception de style
Beaux-Arts (néo-baroque édouardien), sa composition, son emplacement et
son cadre.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 05440 |
Lieu historique national du Canada de la Bibliothèque-Publique-et-Salle-d'Opéra-Haskell
Stanstead, Québec
La bibliothèque publique et salle d'opéra Haskell forment un édifice
situé non seulement sur la rue Church, à Rock Island, au Québec, mais
également sur Derby Ligne, à Rock Island, dans le Vermont, puisqu'il
chevauche la frontière canado-américaine. Il s'agit d'un édifice paré de
pierres à deux étages, de style néo-Queen Anne, orné d'une tour à trois
étages et abritant à la fois une bibliothèque et une salle d'opéra.
C'est la partie située en territoire canadien qui est visée par la
désignation. La partie située en territoire américain est inscrite au
répertoire national des lieux patrimoniaux des États-Unis.
L'édifice de la bibliothèque publique et salle d'opéra Haskell a été
désigné lieu historique national en 1985 parce qu'il chevauche la
frontière canado-américaine et abrite à la fois une bibliothèque et une
salle d'opéra.
Il a été cédé aux résidents du Canada et des États-Unis par la famille
de Carlos Haskell, propriétaire d'un moulin à scie, et de son épouse
Martha Stewart Haskell, à la mémoire de ces derniers qui étaient tous
deux d'origine américaine et canadienne. Conçu par les architectes James
Ball et Gilbert H. Smith, et construit en 1901-1904, il témoigne du
courant de pensée qui, à la fin de l'époque victorienne, attribuait à
l'éducation et aux arts des bienfaits intellectuels et moraux. Son style
néo-Queen Anne est typique des bibliothèques publiques de l'époque. La
salle d'opéra, qui occupe le deuxième étage, présente un intérieur
décoré pouvant accueillir 500 personnes et respecte les principes
reconnus des plans de théâtre du XIXe siècle. L'édifice a conservé sa
double vocation d'origine.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la
Bibliothèque-Publique-et-Salle-d'Opéra-Haskell réside dans son
emplacement inusité, sa double fonction et l'esprit de collectivité et
d'ouverture qu'il symbolise depuis longtemps. Elle a trait également aux
éléments, composition et matériaux de l'imposante conception esthétique
et de l'aménagement intérieur fonctionnel de l'édifice, ainsi qu'à son
emplacement et à sa disposition.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Laura-Lee Bolger, 2005 |
Lieu historique national du Canada de Blanc-Sablon
Blanc-Sablon, Québec
Le lieu historique national du Canada de Blanc Sablon est situé sur la
rive ouest de la rivière Blanc Sablon, au confluent de ce cours d'eau et
du golfe du Saint Laurent, près du détroit de Belle Isle, au Québec. La
région est plutôt dépourvue de végétation, mais le lieu est en majeure
partie couvert de mousses et renferme quelques petits plans d'eau. On y
trouve plus d'une soixantaine de sites archéologiques liés à
l'exploitation des ressources par des groupes culturels successifs au
cours des neuf derniers millénaires, soit pendant la période l'archaïque
(9000-3500 avant l'ère chrétienne), le post arquaïque (3500-400 avant
l'ère chrétienne), le Dorset (500 avant l'ère chrétienne à 1500 apr. J.
C.), l'occupation par les Européens (1500-1900 apr. J. C.), puis par les
Canadiens français et anglais.
Les sites archéologiques de Blanc Sablon témoignent de l'occupation
continue de la péninsule Québec Labrador par les Inuits depuis plus de
9000 ans. Le lieu est situé sur les rives de la rivière Blanc Sablon,
nichée entre l'océan Atlantique et le golfe du Saint Laurent. Le port
abrité dans lequel coule la rivière bénéficie du courant froid du
Labrador, qui remue les sels nutritifs, contribue à la richesse des eaux
de la région et attire divers organismes marins. La quantité et la
diversité des restes fauniques trouvés dans le lieu — notamment des
phoques — sont révélateurs de l'importance des ressources côtières pour
le régime alimentaire des habitants de la région et permettent
d'expliquer pourquoi cette dernière a été occupée sans interruption
pendant des millénaires par de nombreux Autochtones, notamment pendant
la période archaïque, le post archaïque et le Dorset.
Au pied du morne Parent, une haute élévation rocheuse, le terrain
accidenté du lieu se compose d'une multitude de paléoplages marines,
formées par le retrait progressif de l'eau, qui descendent en escaliers
géants jusqu'à la mer. Vers 7000 avant l'ère chrétienne, les Autochtones
commencent à fréquenter la région, et des vestiges de leurs campements
ont été trouvés sur les terrasses. Les vestiges archéologiques trouvés
dans le lieu indiquent qu'il a toujours été occupé et de l'évolution de
la société autochtone. À proximité du rivage actuel, on trouve des
traces des premiers contacts entre les Autochtones et les Européens, et
de la présence des Européens et des Euro Canadiens depuis la première
moitié du XVIe siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1982 |
Lieu historique national du Canada du Bureau-de-Poste-de-Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe, Québec
Le lieu historique national du Canada du
Bureau-de-Poste-de-Saint-Hyacinthe est situé sur un terrain en pente au
cœur du centre-ville commercial de Saint-Hyacinthe (Québec). Il s'agit
d'un édifice élégant de deux étages et demi, en pierre rugueuse, avec
une façade principale symétrique et une tour d'angle imposante, terminé
en 1894. Sa conception énergique aux détails de style italianisant, est
appréciée comme bon exemple des œuvres de l'architecte fédéral Thomas
Fuller.
Le bureau de poste de Saint-Hyacinthe, construit entre 1889 et 1894 pour
abriter le bureau de poste, les douanes et d'autres services fédéraux, a
été conçu pour être un centre d'intérêt important et pour représenter la
présence fédérale dans la ville. Le bureau de poste faisait partie d'un
vaste programme fédéral de construction dans les petites villes et les
collectivités du Canada. Cet édifice d'apparence solide a été construit
sous la direction de Thomas Fuller, architecte en chef du ministère des
Services gouvernementaux de 1881 à 1896. La conception, constituée d'une
tour d'angle, d'une double entrée, et d'un pignon orné, ainsi que la
texture rugueuse des murs en pierre calcaire sont des éléments typiques
des bureaux de poste dessinés par Thomas Fuller et montrent la grande
qualité de dessin apportée à l'architecture fédérale.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Canal-de-Carillon
Carillon, Québec
Canal ouvert à la navigation; deux autres canaux l'ont précédé sur cet
emplacement (1826-33).
Le canal de Carillon, inauguré en 1833, a permis de contourner les
rapides de la rivière des Outaouais, plus particulièrement ceux du
Long-Sault. Construit à l'origine pour répondre à des impératifs
militaires, le canal a été utilisé à des fins commerciales dès son
ouverture.
Sa localisation sur la rivière des Outaouais le situe dans l'axe
intérieur de navigation Montréal-Ottawa-Kingston. Utilisé presque
exclusivement par la navigation de plaisance le canal actuel, qui ne
comprend qu'une seule écluse, fait franchir aux bateaux qui l'empruntent
une dénivellation de 20 mètres en une seule opération.
Le lieu historique national du Canada du Canal-de-Carillon est un canal
aujourd'hui utilisé à des fins récréatives, situé sur la rive est de la
rivière des Outaouais, à 40 kilomètres au nord-ouest de Montréal, près
du village de Carillon. Le territoire du canal historique de Carillon
comprend la voie d'eau associée aux premier, second et troisième canaux
ainsi que les terrains gérés par Parcs Canada à l'intérieur du parc du
canal historique de Carillon.
La valeur patrimoniale du canal de Carillon se reflète dans le paysage
culturel diversifié qui est directement associé à la construction et à
l'exploitation du canal, y compris dans les secteurs terrestres et
fluviaux modifiés et utilisés avant 1960. Le canal de Carillon a été
construit de 1829 à 1833 par le Royal Staff Corps de l'Armée britannique
à des fins d'immigration et de défense, élargi de 1873 à 1882 pour
faciliter la navigation commerciale, puis considérablement modifié par
la construction d'un barrage d'Hydro-Québec de 1960 à 1963. Il est
aujourd'hui utilisé à des fins récréatives.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Canal-de-Chambly
Chambly, Québec
Canal ouvert à la navigation; comporte neuf écluses et des ponts
tournants.
Ouvert en 1843, le canal de Chambly, situé le long du Richelieu, a joué
un rôle fondamental dans l'industrie des produits forestiers du Québec
et dans leur exportation vers les États-Unis, un marché alors en pleine
croissance.
Pendant plus d'un siècle, des barges lourdement chargées ont défilé sur
le canal, long de près de 20 kilomètres. Ses neuf écluses ont permis aux
bateaux de contourner les rapides et de franchir une dénivellation
importante entre le bassin de Chambly et le Haut-Richelieu.
Le lieu historique national du Canada du Canal-de-Chambly est situé sur
la rive ouest de la rivière Richelieu, au sud-est de Montréal, au
Québec. Long de vingt kilomètres, le canal de Chambly est un tronçon de
voie navigable aménagé entre Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu, qui
faisait partie de la voie de transport fluvial intérieur reliant
Montréal et New York au XIXe siècle. Le lieu comprend la voie d'eau
proprement dite, neuf écluses, cinq déversoirs, deux jetées, des
barrages, des digues et des ponts, ainsi que plusieurs autres éléments
et bâtiments associés à l'opération du canal.
La valeur patrimoniale du canal de Chambly réside dans les
interrelations qui se sont perpétuées jusqu'à nos jours entre les
composantes maîtresses de ce paysage, à savoir la rivière Richelieu, la
voie canalisée, le barrage de l'île Fryer et les bâtiments. Le canal de
Chambly a été construit à l'origine pour contourner les rapides de
Chambly, sur la rivière Richelieu. Selon les plans de l'ingénieur
William R. Hopkins, le canal longeait une des berges de la rivière sur
onze kilomètres et une berme ou un talus servait à maintenir le niveau
de l'eau; de plus, une tranchée de huit kilomètres avait été creusée
parallèlement à la rivière. Construit en 1831-1843 pour servir de voie
commerciale, il a été modifié en 1848-1860, 1869-1880 et 1880-1895, puis
restauré à des fins récréatives par Parcs Canada en 1977-1980 et
1990.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2007 |
Lieu historique national du Canada du Canal-de-Lachine
Montréal, Québec
Canal ouvert à la navigation; comportait 5 écluses ainsi que des ponts
ferroviaires et routiers.
Le lieu historique national du Canada du Canal-de-Lachine est un canal
de 14 kilomètres de longueur construit au début du XIXe siècle pour
contourner les rapides du fleuve Saint-Laurent, qui s'étalaient sur cinq
kilomètres entre Lachine et le vieux-Port de Montréal, sur l'île de
Montréal, à la hauteur de la rue McGill. Le canal sert maintenant à la
navigation de plaisance et traverse le centre-sud de Montréal. La
reconnaissance officielle fait référence au tracé le long des 14
kilomètres du canal et aux terrains en bordure qui sont administrés par
Parcs Canada.
La valeur patrimoniale du canal de Lachine réside dans son tracé et dans
la représentation du rôle historique qu'il a joué dans le développement
du pays et de la ville de Montréal. Le canal de Lachine a été construit
à des fins commerciales en 1821-1825, puis exploité et amélioré
continuellement comme route commerciale et corridor industriel jusqu'à
son transfert à Parcs Canada en 1978 à des fins de développement
touristique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Canal-de-Saint-Ours
Saint-Ours, Québec
Canal ouvert à la navigation; écluse de 1933 et vestiges de celle de
1849.
Inauguré en 1849, le canal de Saint-Ours contribue, de concert avec le
canal de Chambly, à franchir le dernier obstacle à la navigation entre
le fleuve Saint-Laurent et le lac Champlain.
Appelé la dixième écluse du Richelieu, le canal de Saint-Ours se situe
de part et d'autre de l'île Darvard et s'est avéré indispensable au
commerce international pendant plus d'un siècle.
Le lieu historique national du Canada du Canal-de-Saint-Ours se trouve
sur la rive est de la rivière Richelieu, à 52 km de Chambly et 23 km de
Sorel, Québec. Situé dans un parc de 5 hectares, il est constitué
principalement d'une écluse fermée entre la rive est de la rivière
Richelieu et l'île Darvard, ainsi qu'un barrage.
La valeur patrimoniale du canal de Saint-Ours réside dans les
interrelations qui se sont perpétuées jusqu'à nos jours entre les
composantes de ce paysage culturel constitué par la rivière Richelieu,
l'île Darvard, le tracé du canal, le barrage, les bâtiments et des
vestiges archéologiques associés à l'exploitation du canal. Le canal de
Saint-Ours a été construit à des fins commerciales par la Commission des
travaux du Canada-Uni dans les années 1844-1849, mais l'écluse actuelle
date des rénovations effectuées en 1930-1933. D'autres modifications ont
été faites en 1960-1969 et 1974.
|
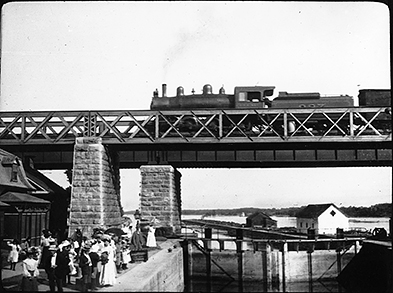
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2003 |
Lieu historique national du Canada du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue
Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec
Canal ouvert à la navigation; construit sur l'emplacement de l'ancien
canal, 1843.
Naviguer sur le canal de Sainte-Anne-de-Bellevue, c'est emprunter une
voie chargée de plus de 150 ans d'histoire. Situé à l'ouest de Montréal,
le canal relie le lac Saint-Louis au lac des Deux-Montagnes, à
l'embouchure de la rivière des Outaouais.
Utilisé dès son ouverture en 1843 à des fins commerciales, le canal
s'intégra rapidement dans l'axe navigable intérieur
Montréal-Ottawa-Kingston.
Situé sur la rivière des Outaouais, le lieu historique national du
Canada du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue comprend les parois du canal
et le quai fixe d'une voie navigable construite au milieu du XIXe siècle
pour contourner les rapides de Sainte-Anne dans le chenal est de la
rivière des Outaouais, en face du village de Sainte-Anne-de-Bellevue, au
bout de l'île de Montréal.
Sa valeur patrimoniale réside dans son tracé navigable passé et présent
et dans les vestiges du canal qui témoignent des matériaux, des formes
et de la technologie associés à sa construction et à son exploitation
commerciale.
Le canal de Sainte-Anne-de-Bellevue a été construit par la Commission
des travaux du Canada-Uni en 1840-1843, modifié en 1879-1883, puis
modernisé à de nombreuses reprises au XXe siècle. En 1963, il a perdu sa
vocation commerciale pour devenir un canal récréatif. Après
l'acquisition de la propriété de 1,6 hectares par Parcs Canada en 1972,
les espaces non essentiels au fonctionnement du canal et à son
interprétation historique ont été subdivisés et vendus.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Cartier-Brébeuf
Québec, Québec
Endroit où Jacques Cartier a passé l'hiver 1535-1536.
Le lieu historique national Cartier-Brébeuf commémore l'hivernage de
Jacques Cartier et de ses compagnons en 1535-1536, à proximité du
village iroquoien de Stadaconé. Il témoigne aussi de l'établissement, en
1625-1626, de la première résidence des missionnaires jésuites à Québec.
Situé sur la rive nord de la rivière Saint-Charles, au cœur de la ville
de Québec, le site constitue un magnifique parc urbain, il offre au
grand public un environnement propice aux loisirs et aux
découvertes.
Le lieu historique national du Canada Cartier-Brébeuf est un parc de 6,8
hectares situé sur la rive nord de la rivière Saint-Charles dans le
quartier Limoilou dans la Ville de Québec. Situé à l'origine près du
village iroquoien de Stadaconé, le lieu commémore le camp d'hiver de
Jacques Cartier et de ses compagnons en 1535-1536 ainsi que la première
résidence des missionnaires jésuites à Québec, construite en 1625-1626.
De nos jours, l'endroit est caractérisé par ses étendues d'herbe, ses
plantes choisies, ses arbres matures ainsi que ses sentiers pour piétons
et cyclistes. On y trouve également une exposition sur les trois voyages
de l'explorateur Jacques Cartier, un kiosque d'interprétation sur les
jésuites, une longue maison entourée d'une palissade de pieux et
plusieurs monuments commémoratifs, dont un qui représente Jacques
Cartier et le grand chef Donnacona de Stadaconé. La désignation
s'applique au parc en forme de fer à cheval qui entoure le bassin d'eau.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada
Cartier-Brébeuf réside dans le sentiment d'appartenance qu'évoquent son
emplacement et ses monuments historiques. Le parc patrimonial est créé
en 1889 lorsque la Société Saint-Jean-Baptiste inaugure un monument
érigé par le Cercle catholique de Québec afin de commémorer
l'emplacement du camp d'hiver de Jacques Cartier ainsi que
Notre-Dame-des-Anges, la première résidence jésuite à Québec. Puisque le
missionnaire Jean de Brébeuf a visité cette résidence, le parc est nommé
Cartier Brébeuf. Il est transféré au gouvernement fédéral en 1957-1958
et devient un lieu historique national du Canada. En 1971, un bassin
d'eau est créé dans le parc à des fins d'interprétation pour rappeler
l'emplacement de l'ancienne confluence de la rivière Saint-Charles et de
la Lairet, une rivière qui coule désormais dans un canal
souterrain.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Caserne-de-Carillon
Carillon, Québec
Bâtiment militaire en pierre construit au début du XIXe siècle.
Construite entre 1830 et 1837 dans le sillage du premier système de
canalisation de l'Outaouais, la « caserne » de Carillon profite du boom
économique engendré par ce projet. En effet, l'érection de cet édifice
est vraisemblablement entreprise pour pallier des problèmes
d'hébergement créés par la nouvelle vocation d'escale associée à ce
secteur de la rivière des Outaouais.
Lors des événements de 1837 et 1838, l'armée britannique réquisitionne
le bâtiment et y apporte ses premières modifications. Entre 1840 et
1936, celui-ci renoue avec sa vocation d'hébergement civil grâce au
retour de sa vocation hôtelière. Depuis, l'édifice accueille le Musée de
la Société historique du comté d'Argenteuil.
Le lieu historique national du Canada de la Caserne-de-Carillon se
compose d'un bâtiment en pierre de deux étages, version vernaculaire
d'un plan britannique classique, situé sur la rue principale du village
de Carillon, au Québec. Il est construit sur un terrain qui descend
doucement sur 61 mètres (200 pieds) environ jusqu'au rivage de la
rivière des Outaouais, au pied des rapides de Carillon. Il est
maintenant exploité en tant que musée.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la
Caserne-de-Carillon réside dans ses associations historiques et dans le
fait qu'il représente fort bien, de par son emplacement, son
implantation, sa conception et ses matériaux, les bâtiments de la
tradition classique britannique conçus pour loger à la fois des
officiers et des sous-officiers. La construction de la caserne de
Carillon a débuté en 1836, sous la direction de leur propriétaire,
l'ancien sous-commissaire général C.J. Forbes, qui s'était retiré à
Carillon. Avant même d'être terminée, la caserne a été louée par l'Armée
britannique pendant la rébellion de 1837. En ces temps de troubles
civils, le bâtiment a hébergé les troupes appelées à réprimer la
rébellion dans le comté de Deux-Montagnes. Il a aussi servi d'entrepôt
aux garnisons du front du Saint-Laurent. Pendant la construction des
canaux de Carillon et de Chute-à-Blondeau, il a été occupé un certain
temps par des officiers du Royal Staff Corps. Après le départ des
militaires, en 1840, le bâtiment a servi d'hôtel pendant de nombreuses
années. En 1938, il a retrouvé son apparence 1837 grâce à l'architecte
et conservationniste montréalais Percy Nobbs, puis il a accueilli le
musée de Carillon.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1980 |
Lieu historique national du Canada de la Cathédrale anglicane Holy Trinity
Québec, Québec
Cette église de pierre relativement petite et simple est sise au coeur
de la place d'Armes dans la vieille ville de Québec. Abritée derrière un
muret de pierre à l'intérieur d'un espace vert boisé, la cathédrale
contraste avec le tissu urbain environnant très serré. Son extérieur
néo-palladien simplifié et son intérieur élégant témoignent clairement
de ses racines britanniques.
La cathédrale anglicane Holy Trinity a été désignée lieu historique
national parce qu'elle est un très bel exemple d'église de type
auditorium bien située et peu modifiée et parce que sa construction a
signalé l'introduction du classicisme britannique à Québec.
Construite entre 1800 et 1804 par deux ingénieurs de la Royal Artillery,
le capitaine William Hall et le major William Robe, la cathédrale de
style néo-palladien raffiné est une adaptation de St.
Martin-in-the-Fields à Londres. Elle possède un plan rectangulaire et
une nef tripartite aux tribunes latérales et aux éléments décoratifs
inspirés du style palladien, ainsi qu'une façade à frontons à trois
baies divisée par une succession d'arcades aux pilastres ioniques. La
cathédrale n'a subi que des modifications mineures, notamment
l'embellissement de sa façade par l'architecte québécois François
Baillargé. Située sur l'ancienne propriété des Récollets, elle occupe
une place centrale dans la vieille ville, qui a été désignée site du
patrimoine mondial.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Cathédrale-Catholique-Notre-Dame
Québec, Québec
Le lieu historique national du Canada de la
Cathédrale-Catholique-Notre-Dame, se dresse au milieu d'autres bâtiments
historiques à vocation publique au cœur de l'arrondissement historique
du Vieux-Québec, à Québec. Magnifique édifice en pierre donnant sur la
Place de l'Hôtel de Ville, la cathédrale, coiffée d'un toit en cuivre,
présente une façade principale néoclassique richement décorée et
flanquée de deux tours dont l'âge et la conception diffèrent. Située sur
l'emplacement de l'église Notre-Dame-de-la-Paix, construite en 1647, la
cathédrale actuelle est le fruit de nombreuses reconstructions dont la
dernière remonte à 1922 et a permis de redonner à l'édifice l'apparence
qu'il avait au milieu du XIXe siècle.
Bâtie à l'origine en 1647 sous le régime français, la
Cathédrale-Catholique-Notre-Dame devient en 1664 la première église
paroissiale de la colonie de la Nouvelle-France sous les auspices de
François de Montmorency Laval. La cathédrale Notre-Dame a toujours été
au cœur de la vie catholique de Québec. Seule église paroissiale
jusqu'en 1829, elle desservit toutes les couches de la société. Lorsque
François de Montmorency Laval devint en 1674 le premier évêque de
Québec, l'édifice fût désigné cathédrale et agrandi par la suite.
Détruite pendant le Siège de Québec en 1759, la cathédrale fût
reconstruite entre 1766 et 1771 conformément aux plans de Gaspard-Joseph
Chaussegros de Léry (1743), à l'exception du clocher conçu par Jean
Baillairgé, qui supervisa aussi les travaux. En 1843-1844, l'architecte
Thomas Baillairgé conçut la remarquable façade principale néoclassique
et François Baillairgé dessina l'intérieur, dont la facture novatrice
influencera l'architecture religieuse au Québec. Ravagé par le feu en
1922, l'édifice est rebâti et l'extérieur retrouva son apparence
monumentale du milieu du XIXe siècle. Plusieurs architectes de renom
contribuèrent aux plans de l'extérieur et de l'intérieur de la
Cathédrale-Catholique-Notre-Dame. Agrandi et modifié à différentes
époques de son histoire, l'édifice aura eu une influence marquée sur
l'architecture religieuse de Québec et demeurera un élément central de
la vie catholique dans la ville.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, NHS-images, 1988 |
Lieu historique national du Canada de la Cathédrale-Christ Church
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Cathédrale-Christ Church est
un édifice pittoresque de style néo-gothique, situé bien en vue dans le
quartier commercial animé de Montréal (Québec). Avec son plan
cruciforme, l'édifice se compose de volumes géométriques simples,
surmontés d'un toit à deux versants fortement incliné, avec une tour
centrale et une flèche haute et élégante. La façade ouest se distingue
par une rosace au-dessus du portail saillant à trois portes. Un centre
commercial souterrain est maintenant situé sous la propriété.
L'architecture de cette cathédrale anglicane, qui a été construite entre
1857 et 1860, s'inspire de l'architecture anglaise du XIVe siècle et
associe une composition rationnelle et géométrique au traitement
pittoresque de la silhouette et de la masse. Le clocher original, trop
lourd pour la structure, a été remplacé, en 1940, par une charpente plus
légère en acier, doublée en aluminium. Les problèmes rencontrés avec la
pierre de Caen ont aussi requis une adaptation à la conception
originale. À cause de détériorations dues aux rigueurs du climat, de
grandes parties du parement de pierre, particulièrement à l'extrémité
ouest, ont été remplacées dans les années 1920 par du calcaire de
l'Indiana, qui à son tour n'a pas pu résister et a été restauré en
utilisant de la pierre artificielle.
Les architectes de la cathédrale Christ Church sont Frank Wills, dont
l'expérience et la maturité sont manifestes dans la volumétrie
pittoresque et l'espace intérieur harmonieux bien qu'il soit décédé
avant que la construction ne débute, et Thomas S. Scott qui a ensuite
été chargé de terminer l'œuvre de Wills.
L'intérieur a évolué avec le temps afin de tenir compte des changements
dans l'utilisation et dans la liturgie : une grande fenêtre a été
ajoutée à l'est à la fin du XIXe siècle et, au cours des ans, d'autres
vitraux ont été reçus en dons; en 1906, le toit en bois a été décoré et
un plancher de marbre a été installé; durant les années 1920, un nouvel
autel et un retable en marbre ont été ajoutés pour commémorer les
membres de la congrégation morts à la guerre. En 1938, le porche nord a
été converti en chapelle des enfants et, en 1940, le transept sud a été
transformé en une chapelle du souvenir. En 1985, le transept nord a été
redécoré en chapelle de fonts baptismaux. Récemment, une galerie de
chœur a été construite contre le mur ouest.
La conception et la décoration relativement élaborées de la cathédrale
reflètent, en partie, la congrégation dont les membres, par le passé,
étaient des personnes très en vue du milieu des affaires anglophone de
Montréal. La congrégation comprenait entre autres membres l'investisseur
George Moffat, David Kinnear, associé et éditeur principal du Herald
(Montréal), et Thomas Brown Anderson, qui devint président de la Banque
de Montréal.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2006 |
Lieu historique national du Canada de la Cathédrale-Marie-Reine-du-Monde
Montréal, Québec
La cathédrale Marie-Reine-du-Monde est un édifice imposant de style
néo-baroque de la seconde moitié du 19e siècle. La cathédrale adopte un
plan en croix latine couvrant près de 4700 mètres carrés. Elle se
caractérise entre autre par un narthex proéminent conçu en pierre de
taille, surmonté de treize statues et par un dôme monumental atteignant
77 mètres de hauteur dominant l'édifice à la croisée des transepts. Les
autres murs de la cathédrale sont de pierre calcaire dont la surface est
bosselée. La nef est coiffée d'une toiture à deux versants en cuivre. À
l'intérieur, s'élève un baldaquin en cuivre rouge orné de feuilles d'or.
La cathédrale fut érigée dans le «mille carré doré», quartier privilégié
de la haute bourgeoisie de Montréal qui émergea, dès le milieu du 19e
siècle. Aujourd'hui, la cathédrale est entourée de la place du Canada et
du carré Dorchester, deux espaces verts, en plus d'être voisine de lieux
connus tels que l'édifice de la Sun Life, l'hôtel Reine-Élizabeth, la
Gare centrale.
La cathédrale Marie-Reine-du-Monde a été construite graduellement, soit
de 1870 à 1878, et de 1885 à 1894. La mise en place du décor intérieur
se fit sur plusieurs années au cours desquelles entre autre des autels
de marbre, le grand orgue, le baldaquin, une série de tableaux
historiques seront ajoutés; le monument commémoratif de Mgr Bourget a
été érigé en 1903. L'édifice est construit à une période durant laquelle
s'entrechoquent les idées révolutionnaires libérales et le conservatisme
de l'Église. Le deuxième évêque du diocèse de Montréal et ardent
promoteur de l'ultramontanisme, Mgr Bourget initia le projet. Celui-ci
était mû par le vif intérêt de promouvoir la primauté de l'Église sur
les sphères sociales et étatiques. La construction de la cathédrale
évoque la matérialisation de cette volonté. Bâtie dans un quartier en
plein développement, la cathédrale démontre la volonté de l'Église de
s'imposer en plein milieu d'un centre urbain en devenir.
La cathédrale Marie-Reine-du-Monde, par son style, illustre une volonté
de calquer le modèle baroque de la basilique Saint-Pierre de Rome, le
symbole par excellence de la religion catholique. Elle présente une
interprétation, simplifiée et de plus petites dimensions, de son modèle
romain. Les architectes Victor Bourgeau et Joseph Michaud, ont été
envoyés l'un après l'autre à Saint-Pierre de Rome par Mgr Bourget afin
de dresser les plans de la cathédrale. Le style baroque de la cathédrale
rompt avec l'architecture de style néo-gothique très présent à la même
époque à Montréal pour les églises tant protestantes que
catholiques.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2002 |
Lieu historique national du Canada de la Centrale-Hydro-Électrique-de-Beauharnois
Beauharnois, Québec
Construite entre 1929 et 1932; important sur le plan tant économique que technique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |
Lieu historique national du Canada du Cercle-de-la-Garnison-de-Québec
Québec, Québec
Seul club militaire au Canada qui poursuit la tradition coloniale
britannique de rassembler des officiers militaires dans un milieu social
(1879).
Le Cercle de la Garrison de Québec se caractérise par un long bâtiment
de maçonnerie à deux étages, aux coins arrondis, situé à l'angle de la
rue Saint-Louis et de la côte de la Citadelle dans le Vieux-Québec. Ce
bâtiment dont l'architecture s'inspire du style château, abrite l'un des
plus vieux clubs privés de Québec et il possède un grand jardin.
La valeur patrimoniale du Cercle de la Garnison de Québec tient à ses
liens militaires, architecturaux et sociaux évidents avec la ville
fortifiée, et à sa vocation de club, illustrée par son emplacement, son
cadre, son club dont l'architecture s'inspire du style château, ses
annexes, son jardin et son boisé. Le Cercle de la Garnison de Québec a
été fondé en 1879 par des officiers de la milice canadienne qui avaient
obtenu la permission de créer un club social au 97, rue Saint-Louis.
D'abord construit par les ingénieurs royaux britanniques (1816) pour y
loger leurs bureaux, le bâtiment fut haussé d'un étage en 1893, allongé
en 1921 et en 1948 pour répondre aux besoins en espace des membres du
Cercle de la Garnison de Québec. Le Cercle est au coeur d'un paysage
culturel qui englobe aussi la maison du messager (1857), le pavillon du
puits (vers 1867), la remise (1871), le jardin et le boisé. Le feu a
détruit l'intérieur de l'édifice du Cercle de la Garnison de Québec en
1954 et 1955. Parcs Canada a restauré le bâtiment (1992-1993), mais une
explosion de gaz (1994) l'a partiellement endommagé. Le Cercle maintient
sa vocation de club privé.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Catherine Cournoyer, 2005 |
Lieu historique national du Canada du Champ-d'Honneur-National-du-Fonds-du-Souvenir
Pointe-Claire, Québec
Le lieu historique national du Canada du
Champ-d'Honneur-National-du-Fonds-du-Souvenir est situé dans l'ouest de
l'île de Montréal, à Pointe-Claire, au Québec. Inauguré en 1930, ce
cimetière militaire est créé pour assurer une sépulture aux anciens
combattants décédés dans un hôpital ou un établissement public après
leur service militaire. Marqué à l'entrée par la Porte du Souvenir
abritant notamment une chapelle, le cimetière est développé depuis un
plan axial d'inspiration Beaux-Arts et s'articule autour de
ronds-points. Il compte quelque 9500 pierres tombales en granit rose
disposées à plat sur le sol, côte à côte dans des rangées, et de
nombreux monuments commémoratifs dans un cadre paysager sobre accentuant
le caractère militaire et solennel du lieu.
Fondé en 1909, le Fond du souvenir était une organisation de
bienfaisance, devenue une agence en partenariat avec Anciens Combattants
Canada, s'occupant seul de l'enterrement des anciens combattants au
Canada. Il s'agit d'un pilier dans la communauté des anciens combattants
administrant un programme gouvernemental dont il a contribué à l'essor
d'une part, par son militantisme et d'autre part, en démontrant par
l'action le bien-fondé de sa cause d'honorer dignement les hommes et les
femmes ayant servi le Canada. Le Fond du souvenir a assuré une sépulture
honorable à plus de 100 000 anciens combattants et leur proche surtout à
travers le pays.
Le cimetière s'impose comme un exemple de tradition militaire tel
qu'attesté par le choix du plan d'aménagement de style Beaux-Arts
caractérisé par la symétrie, la simplicité et la régularité.
L'inhumation, généralement à raison de deux vétérans par fosse,
officiers et soldats reposant côte à côte, est marquée par des pierres
tombales en granit gravées d'inscriptions standards. Comme l'aménagement
paysager, les monuments commémoratifs contribuent également à établir le
caractère militaire et solennel du lieu, en évoquant notamment les
symboles associés à la tradition classique de la Commonwealth War Graves
Commission (CWGC).
Le Champs d'honneur national conçu comme un monument à la mémoire de
tous les soldats ayant honorablement servi la nation a été appelé à
évoluer. Des soldats de pratiquement tous les conflits y reposent, dont
les soldats de la garnison britannique en poste à Montréal au XIXe
siècle. La toponymie accentue le caractère commémoratif du site évoquant
des personnages, des événements et les lieux de bataille importantes
dans l'histoire militaire canadienne.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, HRS 0838 |
Lieu historique national du Canada du Chantier Davie
Lévis, Québec
Le lieu historique national du Canada du Chantier Davie est situé en
bordure du fleuve Saint-Laurent, non loin de la gare maritime de la
traverse Québec-Lévis. L'ancienne rue Commerciale, parallèle au fleuve
Saint-Laurent, divise le chantier en deux. Il y a un slip de carénage et
un quai flottant du côté du fleuve et trois bâtiments de l'autre côté de
la rue. Ces deux parties constituent le paysage culturel rare d'un
chantier de l'époque des bateaux à voile en bois.
Le chantier Davie était le plus ancien chantier du Canada encore en état
de fonctionner lorsqu'il a été commémoré en 1991. Établi par l'ancien
capitaine au long cours Allison Davie en 1829, il a été géré à la mort
de celui-ci par sa femme, Elizabeth Davie, et n'a cessé ses activités
qu'en 1998. Au cours de cette période, le chantier Davie a été à
l'origine de plusieurs innovations importantes pour la construction des
bateaux à voile. Le lieu comprend aujourd'hui une résidence et un bureau
de deux étages et demi (1832), une écurie en brique d'un étage (1872) et
deux entrepôts en brique de deux étages (1892) au pied de la falaise qui
domine la rue Commerciale et, du côté du fleuve, un un slip de carénage
(ou une cale de halage), un quai flottant et peut-être même des vestiges
archéologiques subaquatiques.
La valeur patrimoniale du chantier Davie réside dans sa représentation
unique d'un chantier de l'époque des bateaux à voile en bois et dans
l'intégrité de ses éléments, dans leur cadre et leur disposition
spatiale.
|
|
Lieu historique national du Canada du Chantier-Maritime-de-Saint-Joseph-de-la-Rive
Les Éboulements, Québec
Le lieu historique national du Canada du
Chantier-Maritime-de-Saint-Joseph-de-la-Rive surplombe le fleuve
Saint-Laurent dans le village de Saint-Joseph-de-la-Rive, Québec. Établi
parallèlement à la limite des eaux, au pied d'une colline abrupte, ce
petit chantier est dominé par un moulin à scie et un atelier abritant
les treuils. Ce lieu de forme triangulaire et nivelé est bordé par des
arbres et par la rivière Boudreault qui se jette dans le Saint-Laurent à
cet endroit.
Fondé en 1946, le chantier naval de Saint-Joseph-de-la-Rive, une des
rares installations encore existantes de cette époque, conserve
l'équipement utilisé pour les activités de réparation et d'hivernage de
navires côtiers de faible tonnage le long du fleuve Saint-Laurent.
Représentatif des nombreux chantiers navals qui prospéraient au Québec,
il fut le principal lieu de construction de goélettes. D'abord gréés de
voiles et plus tard motorisés, ces navires de bois, conçus pour la
navigation fluviale, ont joué un rôle crucial dans la navigation côtière
du fleuve Saint-Laurent et le développement économique de plusieurs
communautés le long de ses rivages. Avec seulement une population de 250
habitants en 1931, Saint-Joesph-de-la-Rive, autrefois connu sous le nom
d'Éboulement-en-bas, était un emplacement attrayant pour un chantier
naval dû à sa légère descente dans le fleuve Saint-Laurent et ses bornes
fortement couvertes de forêts, qui ont protégé la zone des vents
violents.
N'étant plus opérationnel, le chantier naval de Saint-Joseph-de-la-Rive
qui autrefois fonctionnait toute l'année pendant la plus grande partie
des activités de réparation et d'entretien qui avait lieu durant les
mois d'hiver. Le chantier était le moteur de l'économie de
Saint-Joseph-de-la-Rive et en tant que principal producteur de goélettes
au Québec, il a contribué considérablement à l'économie de l'ensemble de
la province. La disparition graduelle des goélettes, la concurrence des
autres moyens de transport et le coût prohibitif d'installations
d'infrastructures supplémentaires capables de supporter de plus grands
navires faits d'acier ont mené à la décision de fermer le chantier en
1972. Le chantier et ses équipements sont demeurés presque inchangés et
en 1986, le chantier est devenu un musée régional et un centre
d'interprétation connu sous le nom du Musée maritime de
Charlevoix.
|

©Library and Archives Canada/ Bibliothèque et Archives Canada, 1909-10 |
Lieu historique national du Canada de la Chapelle-du-Bon-Pasteur
Québec, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Chapelle-du-Bon-Pasteur fait
partie d'un ensemble d'édifices religieux de la ville de Québec. La
chapelle est un édifice en pierre rectangulaire de cinq étages, au toit
à deux versants, et fait partie intégrante de la maison mère des Sœurs
du Bon-Pasteur, au même titre que les bâtiments flanquant ses côtés.
Elle est appréciée en raison de son très bel intérieur conçu par Charles
Baillargé.
La chapelle du Bon-Pasteur a été classée lieu historique national du
Canada en 1975 parce qu'elle est un exemple remarquable de
l'architecture religieuse au Québec.
La chapelle du Bon-Pasteur, construite entre 1866 et 1868, est l'oeuvre
de Charles Baillairgé, célèbre architecte québécois, et fait partie d'un
groupe d'édifices qui forment la maison mère des Sœurs du Bon-Pasteur du
Québec. En 1909-1910, la chapelle a été agrandie et une nouvelle façade
a été dessinée par François-Xavier Berlinguet. Les lignes verticales
marquées, la double rangée de galeries et l'interaction des courbes de
son intérieur inchangé accentuent le calme et la spiritualité qui s'en
dégagent, comme le souhaitait l'architecte original. Ces qualités ainsi
que les exceptionnels autels sculptés de la fin du XVIIIe siècle,
dessinés par Pierre-François Baillairgé, font de l'édifice un exemple
remarquable de l'architecture des églises québécoises.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada 1999 |
Lieu historique national du Canada de la Chapelle-Sainte-Anne
Neuville, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Chapelle-Sainte-Anne est
situé en retrait de la route dans un cadre champêtre à Neuville au
Québec. Possédant des éléments vernaculaires et néoclassiques, cette
petite chapelle de procession en moellons datant du début du XIXe siècle
est ornée d'un toit à deux versants, d'ouvertures en plein cintre et
d'un haut clocheton.
La valeur patrimoniale du lieu tient à l'intégrité remarquable du
bâtiment et de son emplacement, à son plan, sa composition, ses détails
et ses matériaux ainsi qu'à sa vocation particulière.
La chapelle Sainte-Anne est représentative d'un type de bâtiment
étroitement associé aux traditions chrétiennes médiévales transposées en
Nouvelle-France pendant le régime seigneurial et conservées au Québec
jusqu'au milieu du XXe siècle. Pendant la Fête-Dieu, et surtout pendant
la neuvaine à Sainte-Anne, les fidèles s'y rendaient en procession à
partir de l'église paroissiale voisine. Cette chapelle, qui possède des
éléments vernaculaires ainsi que néoclassiques, a été érigée vers 1830
sur l'emplacement d'une autre chapelle datant de 1697. Avec sa forme,
ses murs, ses ouvertures, sa façade et son clocher d'origine, elle
rappelle avec éloquence l'importance de ces dévotions populaires, encore
pratiquées aujourd'hui.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique du Canada du Château-De-Ramezay / Maison-des-Indes
Montréal, Québec
Le lieu historique du Canada du Château-De-Ramezay / Maison-des-Indes
est un manoir privé situé sur la rue Notre-Dame Est, dans le Vieux-Port
de Montréal, au Québec. Construit en 1705, le bâtiment en pierre a été
reconstruit après un incendie en 1756. Entouré par un muret, le
Château-de-Ramezay / Maison-des-Indes, est un édifice d'un étage et demi
en pierre auquel a été ajouté, en 1903, une extension vers l'est dotée
en façade d'une tour à toit conique. Le site comprend également le
jardin du Gouverneur qui a été aménagé à l'arrière du bâtiment en 2000.
La reconnaissance officielle vise la propriété du Château de Ramezay.
La valeur historique du lieu réside dans ses associations politiques et
commerciales. Originalement, le Château De Ramezay / maison des Indes a
été construit à la demande de Claude de Ramezay, le gouverneur de
Montréal, de 1704 à 1724, et gouverneur général par intérim de la
Nouvelle-France pendant trois ans (1714-1716). La construction d'un tel
édifice reflète le statut et les moyens financiers des gouverneurs de
Montréal qui ont fait bâtir leur propre manoir privé puisque la Couronne
française refusait de leur en fournir.
De 1745 à 1763, le bâtiment était utilisé par la Compagnie des Indes
occidentales comme base des opérations, une période pendant laquelle il
a été reconstruit et agrandi après un feu, en 1756. La société
commerciale a joué un rôle important dans l'économie canadienne en
bénéficiant d'un monopole royal sur l'exportation des pelleteries de
castor et sur l'importation de certains textiles réclamés comme
marchandises de traite.
De 1773 à 1844, à l'époque du Bas-Canada, le Château De Ramezay fait
office de résidence officielle des gouverneurs généraux de l'Amérique du
Nord britannique excepté lors de l'occupation américaine de 1775 à 1776,
où il est devenu la résidence des commandants successifs américains.
L'importance du lieu se concrétise donc dans la continuité de son usage.
En 1839, il a abrité le Conseil exécutif et après 1849, le bâtiment a
servi de bureaux gouvernementaux, de palais de justice et d'écoles. En
1895, le manoir a été converti en siège social et en musée de la Société
d'archéologie et de numismatique de Montréal.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Château-Frontenac
Québec, Québec
De style château, le Château Frontenac est un hôtel imposant en brique
et en pierre formé de cinq ailes et d'une tour centrale érigées en sept
étapes, entre 1892 et 1993, sur la falaise surplombant le fleuve
Saint-Laurent, dans l'arrondissement historique de Québec.
Le Chateau Frontenac a été désigné lieu d'importance nationale parce
qu'il est un excellent exemple des hôtels de style château établis par
les compagnies ferroviaires au Canada.
Le Château Frontenac est le premier d'un ensemble d'hôtels de style
château construits par les compagnies ferroviaires du Canada à la fin
XIXe et au début du XXe siècles pour inciter les touristes à voyager en
train. Prisés du public voyageur en raison de leur décor raffiné et de
leur élégance tout confort, ces hôtels sont vite devenus des symboles
nationaux d'hébergement de qualité.
Le Château Frontenac a donné le ton aux hôtels de style château que les
compagnies ferroviaires ont érigés par la suite et il demeure celui qui
exprime le mieux ce style d'architecture. Sa conception inspirée des
châteaux de la Loire des XIVe et XVe siècles, en France, lui donne des
allures de château forteresse, une impression que vient renforcer son
emplacement au sommet de la falaise. Sa conception exprime l'image
romantique que les gens se faisaient alors de Québec, soit d'une ville
française médiévale. Le style pittoresque éclectique de l'hôtel et ses
riches surfaces polychromes reflètent les goûts de l'époque en matière
d'architecture victorienne.
Le Canadien Pacifique en a commencé la construction en 1892-1893, selon
les plans de Bruce Price. L'hôtel a été agrandi à plusieurs reprises en
1908-1909 (plans de W.S. Painter), 1919, 1920-1924 (plans de Edward et
W.S. Maxwell), et 1992-1993 (plans du Groupe Arcop).
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1973 |
Lieu historique national du Canada du Château-des-Gouverneurs
Sorel-Tracy, Québec
Le lieu historique national du Canada du Château-des-Gouverneurs est
situé en bordure de la rivière Richelieu à Sorel au Québec. Occupée à
l'origine comme résidence d'été par les premiers gouverneurs et
commandants militaires britanniques de Québec, la maison d'un étage et
demi est constituée d'un noyau rectangulaire de style québécois
traditionnel flanqué d'ailes, le tout coiffé de toits à pignons à forte
pente vers l'avant. À l'arrière, une véranda ouverte surplombe les
jardins qui ont déjà fait partie d'une plus grande seigneurie.
Le gouverneur sir Frederick Haldimand acquit la seigneurie de Sorel pour
le compte de la Couronne en 1781 pour les raisons de défense, suite à
l'invasion américaine en 1775, ainsi que pour créer un lieu
d'établissement pour les soldats, les Loyalistes et leurs familles.
Cette année-là, il fait construire une maison pour le général Riedesel,
ce qui constitue le corps principal du « château » actuel auquel les
ailes ont été ajoutées ultérieurement. En 1787, le prince William Henry,
plus tard le roi William IV du Royaume-Uni (r. 1830-1837) a séjourné
dans la résidence lors de sa visite de la colonie. Jusqu'en 1866 la
maison servait de résidence d'été aux gouverneurs généraux Dorchester,
Prescott, Dalhousie et Aylmer et aux commandants en chef St. Leger,
Brock, Colborne, Jackson, D'Urban et Eyre. Après une succession de
propriétaires, la maison a été achetée par la ville de Sorel en 1921. En
avril 1990, le centre d'exposition du Château des gouverneurs a été
inauguré comme centre d'artistes.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national du Canada du Cimetière-Beth-Israël
Québec, Québec
Le lieu historique national du Canada du Cimetière-Beth-Israël occupe
environ un acre de terrain dans un quartier marquant la transition entre
les parties commerciale et résidentielle de la ville et du campus de
l'Université Laval, dans l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery, à
Québec. Le cimetière est de forme rectangulaire et est protégé par un
mur de pierre bas surmonté d'une clôture de fer longeant le boulevard
René-Lévesque Ouest et par une clôture à neige le long de ses trois
autres côtés. Le cimetière est aménagé simplement avec des arbres et des
bosquets, deux sentiers le traversant et un funérarium. L'organisation
spatiale des quelque 300 pierres tombales, simples et discrètes avec des
caractères hébreux à la fois serrée et linéaire caractérise le
cimetière. Il présente aussi un ensemble distinctif de symboles
religieux reliés spécifiquement au judaïsme.
À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, la grande majorité des
membres de la communauté juive de Québec sont enterrés au cimetière Beth
Israël. Ce cimetière demeure l'un des seuls témoins d'une communauté qui
prit racine avec l'arrivée des « juifs fondateurs » lors de la seconde
moitié du XVIIIe siècle. Si la présence juive à Québec est très
ancienne, ce n'est pas avant la moitié du XIXe siècle que la communauté
atteint la taille nécessaire à la fondation d'une congrégation. Le
terrain pour le cimetière est, entre 1840 et 1858, acquis par un
marchand juif et consacré, puis cédé à la congrégation Beth Israël Ohev
Sholem en 1894.
Le cimetière contient environ 300 pierres tombales arrangées en ligne
droite avec peu d'espace entre chaque lot. Son organisation spatiale
serrée est caractéristique de tous les cimetières juifs connus et trouve
son origine dans la conviction religieuse que l'inhumation est le seul
moyen sanctionné pour disposer des morts. En conséquence, l'espace dans
un cimetière juif a toujours été très précieux et ne doit pas être
gaspillée. D'égale importance est la conviction profonde que dans la
mort tous les hommes sont égaux. Une fois à l'intérieur des murs du
cimetière, les distinctions sociales sont effacées et il n'existe aucun
site préféré, ni réservé. Les règles qui dirigent l'aménagement du
cimetière s'appliquent également à la conception des pierres tombales.
La majorité des sépultures juives sont marquées par une pierre tombale
simple et discrète et ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que des
monuments de style néogrec, tels que l'obélisque, la colonne et la
colonne brisée, ont été érigés. La plupart des sépultures dans le
cimetière Beth Israël sont protégées par des murs de retenue en
maçonnerie permettant d'élever les lots au-dessus du niveau du
sol.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, CIS-2003/EIC-2003 |
Lieu historique national du Canada du Cimetière-de-l'Hôpital-Général-de-Québec
Québec, Québec
Le lieu historique national du Canada du
Cimetière-de-l'Hôpital-Général-de-Québec est situé dans les quartiers
Saint-Roch et Saint-Sauveur, dans la basse-ville de Québec, sur le
terrain de l'Hôpital-Général de Québec. Ce paysage de cimetière a été
désigné afin de commémorer les soldats morts à la suite des batailles
des plaines d'Abraham et de Sainte-Foy.
Le lieu historique national du Canada du
Cimetière-de-l'Hôpital-Général-de-Québec forme la partie centrale d'un
cimetière beaucoup plus vaste, soit la portion qui était occupée en
1755-1760. Elle renferme les sépultures les plus anciennes, dont celles
d'environ 277 soldats morts lors des batailles des plaines d'Abraham et
de Sainte-Foy. Les 747 autres sépultures sont celles de soldats décédés
des suites de maladies contractées pendant la guerre de Sept ans, après
ces batailles. Le nom, le lieu de naissance et parfois l'âge des 1 058
soldats amérindiens, canadiens-français, français et britanniques sont
notés dans le tout premier registre de la paroisse Notre-Dame-des-Anges.
Le cimetière a été baptisé «Cimetière des Héros» par l'archiviste
Pierre-Georges Roy en 1940.
La valeur patrimoniale du lieu réside dans son rôle en tant que monument
commémorant la lutte que Français et Anglais se sont livrés pour la
suprématie de l'Amérique du Nord à l'époque coloniale. Cette valeur est
amplifiée du fait que l'on connaît l'identité et le profil
socio-culturel de ces soldats, grâce au tout premier registre de la
paroisse Notre-Dame-des-Anges, lui-même un manuscrit
exceptionnel.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Rhona Goodspeed, 2005 |
Lieu historique national du Canada du Cimetière-Mount Hermon
Québec, Québec
Le lieu historique national du Canada du Cimetière-Mount Hermon
constitue un exemple remarquable de petit cimetière rural ou de
cimetière parc. Se côtoient en ce lieu pittoresque des monuments
funéraires de styles variés et de nombreuses essences d'arbres entre
lesquels sillonnent des sentiers offrant des paysages incomparables. Le
cimetière Mount Hermon a été fondé en 1848 pour recevoir les dépouilles
des membres de diverses confessions protestantes de la ville de Québec,
dans ce qui est maintenant l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery.
Le cimetière Mount Hermon a été fondé au début du XIXe siècle, pendant
le mouvement des cimetières ruraux inspiré par la volonté de créer des
milieux champêtres en harmonie avec la nature. Le mariage de la nature
et de l'art y est particulièrement réussi : l'éventail de monuments
néoclassiques, les sentiers sinueux et la vue imprenable sur le fleuve
Saint-Laurent témoignent du style pittoresque. Lors de sa fondation, le
cimetière Mount Hermon fut le premier cimetière rural de la grande
région de Québec. L'aménagement d'un nouveau cimetière était devenu
nécessaire car il n'y avait plus de place dans le vieux cimetière
protestant situé au cœur de la ville.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2004 |
Lieu historique national du Canada du Cimetière-Mont-Royal
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada du Cimetière-Mont-Royal est situé
sur la pente nord du mont Royal, dans le quartier Outremont de Montréal,
au Québec. Ouvert en 1852, le cimetière de 67 hectares a été aménagé
dans un style pittoresque rappelant celui des cimetières ruraux de la
France et des États-Unis au début du XIXe siècle. Les terrains en
terrasse du cimetière sont aménagés d'îlots de fleurs et d'arbres
matures. L'endroit compte de nombreux monuments commémoratifs et stèles
funéraires sculptées de tailles et de styles variés. Le lieu comprend
également plusieurs bâtiments connexes, dont la maison de l'entrepreneur
de pompes funèbres et le crématorium.
Le cimetière Mont Royal a été constitué en société en 1847 et consacré
en 1852 comme cimetière protestant. Il a été conçu par l'architecte
James C. Sidney selon les principes d'aménagement pittoresque des
cimetières ruraux au début du XIXe siècle. L'endroit comprend des
éléments naturels, des chemins sinueux, des massifs de fleurs disposés
en îlots de manière irrégulière et des arbres matures intégrés aux
monuments funéraires pour créer une série de belvédères aménagés. Le
cimetière comprend aussi un large éventail de monuments funéraires, dont
12 mausolées (l'un d'entre eux appartenant à la famille Molson) et de
nombreux monuments funéraires de moins grande envergure, comme celui du
général sir Arthur Currie. Son aménagement rappelant celui d'un parc et
ses vues panoramiques accentuent l'omniprésence de la nature dans le
cimetière, qui est devenu un modèle pour d'autres cimetières ruraux au
Canada.
|


©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Cimetière-Notre-Dame-des-Neiges
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada du Cimetière-Notre-Dame-des-Neiges
est situé dans le parc du Mont-Royal au sein du lieu historique national
du Canada du Cimetière-Mont-Royal à Montréal. Fondé en 1854, cet espace
vert attrayant couvre une superficie de 113 hectares. Inspirés par les
traditions formelles et par le style pittoresque, les concepteurs ont su
allier la topographie naturelle remarquable de l'endroit, avec ses
arbres majestueux, ses pelouses et ses sentiers sinueux, aux zones plus
formelles du cimetière avec ses pierres tombales, ses monuments et ses
éléments commémoratifs de tailles et de styles variés. Le cimetière
Notre-Dame-des-Neiges rappelle les cimetières ruraux du XIXe siècle. En
raison des nombreuses personnes d'importance historique qui y sont
inhumées, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges témoigne de plusieurs
aspects de l'histoire de Montréal, du Québec et du Canada.
Située sur le chemin de la Côte-des-Neiges, l'entrée principale du
cimetière est agrémentée de deux des pavillons du portail d'origine. Le
lieu comprend différents bâtiments ayant une valeur historique, dont le
bâtiment administratif, la chapelle et le premier charnier, qui est
devenu un mausolée. Le cimetière compte aussi des serres, des
dépendances et huit mausolées. Plusieurs monuments et pierres tombales
revêtent une grande importance artistique, historique et symbolique qui
rend ce lieu exceptionnel propice à la contemplation et à l'évocation du
passé. Du côté nord-ouest du bâtiment administratif, le cimetière offre
une vue panoramique sur l'Université de Montréal, sur l'Oratoire
Saint-Joseph et sur les hauteurs de Westmount.
Adapté à une topographie diversifiée, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges
se caractérise par des chemins sinueux et romantiques tracés sur un plan
en damier conçu par Henri-Maurice Perrault et ses successeurs. Les
longues avenues bordées d'arbres rappellent la tradition française
tandis que les sentiers et les îlots boisés évoquent les cimetières
ruraux américains du XIXe siècle. Le terrain accidenté de la zone nord
du cimetière présente un réseau de sentiers sinueux, tandis que
l'abondance de monuments funéraires de grande qualité dans les zones
plus formelles du terrain crée une impression de jardin de pierres
taillées et sculptées. Le symbolisme religieux est omniprésent, tout
comme le sont les rappels de la mortalité. La diversité des monuments et
des caveaux de famille de ce vaste « jardin français » témoigne de
l'histoire sociale, économique et politique de la ville de Montréal. Le
cimetière, qui compte environ 65 000 monuments et 71 caveaux de famille,
est aussi le dernier repos de plus de 900 000 personnes. Avec ses 139
hectares et ses 55 kilomètres de chemins et de sentiers, le cimetière
Notre-Dame-des-Neiges est aujourd'hui l'un des plus grands cimetières au
Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, P. St. Jacques, 1984 |
Lieu historique national du Canada de la Citadelle-de-Québec
Côte de la Citadelle, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Citadelle-de-Québec est une
forteresse du XIXe siècle sise sur le cap Diamant au coeur de la ville
de Québec. Faisant dos à la falaise qui surplombe le fleuve Saint
Laurent, cette imposante forteresse de pierre fait face à la ville. De
nos jours, les fonctions de la Citadelle sont uniquement protocolaire,
patrimoniale et symbolique. La Citadelle sert de deuxième résidence
officielle au gouverneur général, depuis 1872, et de résidence
officielle au Royal 22e Régiment, depuis 1920.
Le lieu historique national du Canada de la Citadelle-de-Québec comprend
tout le côté sud des fortifications, allant de la Terrasse Dufferin à
l'extrémité sud est jusqu'au bout de la citadelle même. Elle a été
construite en grande partie durant les années 1820-1832, bien que les
bastions et le polygone aménagés sur le cap, lesquels sont intégrés à
l'ensemble du complexe, remontent à 1720 et 1745 respectivement. Il
s'agit d'un ouvrage militaire imposant et complexe conforme à la
stratégie définie par le duc de Richmond pour la défense de la colonie
au lendemain de la guerre de 1812.
La valeur patrimoniale de la Citadelle de Québec réside dans le
caractère exhaustif de son paysage culturel comme ouvrage défensif situé
à l'intérieur du grand ensemble de fortifications de la ville. Sa valeur
réside dans la clarté avec laquelle les principaux éléments de sa
conception militaire stratégique sont à la fois représentés et lisibles
: ceux d'un bastion défensif britannique du XIXe siècle (flanquement,
saillie et surplomb) ainsi que ceux d'une poudrière de la France du
XVIIIe siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2007 |
Lieu historique national du Canada de la Cité-Modèle-de-Mont-Royal
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Cité-Modèle-de-Mont-Royal
est une grande banlieue résidentielle située au nord-ouest du mont
Royal, au coeur de l'île de Montréal, au Québec. Le lieu actuel reflète
la conception d'origine du plan de l'arrondissement effectuée avant 1914
et réalisée progressivement jusqu'aux années 1970. Il regroupe
principalement des bâtiments résidentiels, du cottage unifamilial au
complexe d'habitations multiples, alors que des édifices commerciaux,
scolaires et religieux sont situés le long d'axes stratégiques.
L'arrondissement historique se caractérise également par ses axes
principaux et ses promenades, son tissu urbain et ses nombreux espaces
verts publics et privés.
La cité modèle du Mont-Royal a été planifié en un tout par l'architecte
paysagiste Frederick Gage Todd, dès 1914, et sa construction
s'échelonnera sur trois phases successives d'environ vingt ans, soit
jusqu'au milieu des années 1970. Ces périodes sont définies par
l'étalement géographique, la construction d'infrastructures et par le
type et le nombre de construction. L'arrondissement historique est
toutefois particulièrement homogène étant donné la planification à long
terme de ce projet urbain indépendant, depuis le plan d'origine, à la
réalisation et la supervision incombant à la ville.
La cité modèle de Mont-Royal a été réalisée en réaction à
l'industrialisation et aux problèmes urbains des métropoles de la fin du
XIXe et du début du XXe siècle, soit dans le cadre des mouvements de
revitalisation urbaine portés dans les grandes villes canadiennes par
les architectes paysagistes. La cité modèle de Mont-Royal correspond au
moment de maturité où les différents concepts issus des mouvements
parcs-urbains, City Beautiful et cité-jardin convergent en un seul
projet, tel qu'exprimé par la présence d'un chemin de fer, de grands
axes, de promenades sinueuses, et par son zonage et son aménagement.
L'établissement de la cité modèle est également associé aux activités
spéculatives et immobilières mises de l'avant par les compagnies de
chemin de fer. En confiant la conception des plans à Todd, les
spéculateurs ferroviaires avaient pour objectif de rentabiliser le
chemin de fer et le tunnel construit sous le mont Royal par le Chemin de
fer Canadien du Nord. En misant sur la création d'une banlieue
alléchante, ils s'assuraient d'y vendre les lots. Ce lien étroit entre
la compagnie ferroviaire, les spéculateurs et la création de la cité
modèle représente encore un important symbole de la ville, comme
l'indique notamment le plan simple en grille et la situation privilégiée
de la gare et de la voie ferrée.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine
Lachine, Québec
Entrepôt en pierre utilisé comme dépôt; construit en 1803; les
Compagnies de la Baie d'Hudson et du Nord-Ouest.
Situé à l'ouest de l'île de Montréal, en bordure du lac Saint-Louis, le
lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine témoigne
de l'apogée de l'industrie pelletière dans la région montréalaise au
XVIIIe et au début du XIXe siècle. Le vieux hangar en pierre date de
1803.
Alexander Gordon, ex-commis et actionnaire de la Compagnie du
Nord-Ouest, l'a fait construire pour entreposer marchandises de traite
et fourrures. En 1833, le hangar est devenu la propriété de la Compagnie
de la Baie d'Hudson.
Lachine occupe une position stratégique sur la route des fourrures, en
tant que point de départ et d'arrivée des expéditions de traite. C'est
par ailleurs un important centre d'entreposage de fourrures et de
marchandises de traite des marchands de Montréal. Aujourd'hui, ce hangar
unique abrite une exposition qui fait revivre l'épopée montréalaise de
la fourrure.
Le lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine est un
entrepôt en pierre rectangulaire d'un étage situé dans un environnement
paysagé attrayant en bordure du canal de Lachine, sur le boulevard
Saint-Joseph, en face du couvent des soeurs de Sainte-Anne à Lachine, à
l'extrémité ouest de l'île de Montréal.
La valeur patrimoniale du lieu historique national Canada du
Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine réside dans la forme et la structure
de l'entrepôt du XVIIIe siècle qui illustrent l'histoire du commerce de
la fourrure à Montréal.
Construit en 1803 par Alexander Gordon, de la Compagnie du Nord-Ouest,
cet entrepôt a été acheté en 1833 par la Compagnie de la Baie d'Hudson,
puis par les sœurs de Sainte-Anne qui en ont été les propriétaires de
1861 à 1977. Les travaux de modernisation réalisés au début du XXe
siècle ont fait disparaître la plupart des ouvertures et des surfaces
d'origine. Celles-ci ont été restaurées par Parcs Canada (1978-1984)
après qu'un incendie eut tout détruit sauf les murs de pierre et la
moitié de la structure du toit.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Complexe-Historique-de-Trois-Rivières
Trois-Rivières, Québec
Le lieu historique national du Canada du
Complexe-Historique-de-Trois-Rivières est situé dans l'arrondissement
historique de Trois Rivières, dans la région de la Mauricie, au Québec.
Le site comprend cinq bâtiments : la maison de Gannes, la maison Hertel
de La Fresnière, le couvent des Récollets, l'église des Récollets et le
couvent des Ursulines. Construites selon le style Régime français, les
structures en pierre d'un étage et demi à deux étages et demi sont
intégrées visuellement en raison de leurs toits à deux pignons hauts, de
leurs avant-toits, de leurs lucarnes, de leurs nombreuses cheminées, de
leurs fenêtres à croisillons organisées de façon régulière et de leurs
portes d'entrée disposées au centre de la façade.
La valeur patrimoniale du complexe historique de Trois-Rivières
s'explique par son architecture et sa conception qui constituent un
exemple unique de construction urbaine de style Régime français au
Canada. Située stratégiquement, au confluent de la rivière Saint-
Maurice et du fleuve Saint-Laurent, la ville de Trois-Rivières est bâtie
sous le Régime français pour servir de centre de transport et ainsi
répondre aux besoins du commerce de la fourrure durant le XVIIe siècle,
puis à ceux des forges avoisinantes de la colonie.
Durant cette période de croissance, plusieurs résidences et édifices
religieux sont construits sur la rue Notre-Dame, aujourd'hui nommée rue
des Ursulines. Les bâtiments qui subsistent et qui sont associés au lieu
sont tous érigés entre 1700 et 1829 selon le style Régime français de
l'époque. Le plus vieux est le couvent des Ursulines, qui date de 1700,
mais qui fait l'objet de divers modifications et ajouts entre 1714 et
1960. En conséquence des incendies de 1752 et de 1806, le mur de
fondation est le seul élément qui subsiste de la construction d'origine.
Le couvent des Récollets est construit en 1742, et l'église en 1754.
Entre 1760 et 1777, les Récollets et les anglicans se partagent ces deux
édifices qui serviront plus tard d'hôpital, de magasin, de palais de
justice, de prison, de refuge et de bâtiments administratifs entre 1779
et 1823. Les anglicans restaurent le couvent et l'église en 1823 et, en
1830, celle-ci est consacrée sous le nom de Saint-James. La maison du
major Georges de Gannes, officier de la marine française, est érigée en
1756, et celui-ci y réside jusqu'en 1760. Plus tard, les murs de la
maison de pierres seront recouverts de crépi. Enfin, entre 1824 et 1829,
François Lafontaine construit la maison Hertel-de-La-Fresnière qu'il
nomme ainsi en l'honneur de l'officier français, Joseph-François de La
Fresnière, un des premiers propriétaires du lot (en 1668). Propriété des
Ursulines de 1899 à 1981, la maison fait de nos jours office de centre
d'interprétation. Ayant survécu à un incendie qui a détruit la plus
grande partie de la vieille ville de Trois-Rivières en 1908, ces cinq
structures constituent un rappel visuel du paysage urbain du Canada
français du XVIIIe siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Corossol
Sept-Îles, Québec
Le lieu historique national du Canada du Corossol est un site sous-marin
situé au sud de l'île Manowin, près de l'île du Corossol près de
l'entrée l'entrée de la baie des Sept Îles, au Québec. Son nom évoque le
vaisseau du Roi français qui a fait naufrage en 1693, lors d'une
tempête, alors qu'il faisait route pour la France. Le site comprend un
certain nombre de canons, ainsi que de nombreux artéfacts associés.
La valeur scientifique de l'épave du Corossol repose sur sa rareté et
son ancienneté. Ses vestiges sont les seuls à cette date d'une épave
française du XVIIe siècle formellement identifiée au Canada. Elle se
révèle également être un apport précieux pour la commémoration du
patrimoine maritime national méconnu.
La valeur historique du lieu historique national du Canada du Corossol
repose sur le potentiel de l'épave à fournir des données inédites pour
étudier la culture matérielle de la Nouvelle-France au 17e siècle. Selon
les sources écrites, le vaisseau du roi arrivé au Québec en août 1693,
serait reparti en octobre de la même année, avec à son bord des
passagers pour la France et des pelleteries. Dans les jours suivants, le
naufrage survint dans les hauts-fond et la cargaison s'éparpilla le long
de la côte. Une expédition de sauvetage organisée en mai 1694 a connu un
certain succès. Bien que les anciens témoignages des survivants n'aient
pas permis de localiser l'épave avec exactitude, elle a été identifiée
en 1990 suite à la mise en commun de plusieurs éléments tels que des
textes d'époque et le récit du sauvetage. Son identification a en outre
été appuyé par la découverte d'objets significatifs, dont une pièce de
monnaie française de 1691 et l'arsenal militaire varié évoquant la
fonction de l'embarcation. La toponymie locale a également contribué à
l'identification de l'épave puisque ses vestiges sont situés entre les
îles Corossol et Manowin, précédemment connues respectivement sous les
noms de «Carroussel du Large» ou «Petit Carroussel» et «Carroussel de
terre» ou «Grand Carroussel».
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, F. Cattroll, 1982 |
Lieu historique national du Canada de Coteau-du-Lac
Coteau-du-Lac, Québec
Ouvrages de transport fluvial et de défense; XVIIIe siècle.
Le lieu historique national de Coteau-du-Lac, situé à près de 40
kilomètres au sud-ouest de Montréal aux abords du Saint-Laurent,
témoigne d'une histoire riche de plusieurs millénaires.
En raison de sa position stratégique sur le fleuve, principale voie de
pénétration du continent, le site tient un rôle majeur dans le
développement du transport fluvial au pays. Lieu de passage fréquenté
d'abord par les nomades amérindiens, Coteau-du-Lac devient une véritable
voie d'évitement pour les autres voyageurs, français et britanniques.
Dès la fin du XVIIIe siècle, on construit sur les lieux un canal à
écluses, premier ouvrage du genre en Amérique du Nord et ancêtre direct
de la Voie maritime du Saint-Laurent.
Situé dans la municipalité de Coteau-du-Lac, au Québec, en bordure du
fleuve Saint-Laurent, à environ 40 km au sud-ouest de Montréal, le lieu
historique national du Canada de Coteau-du-Lac comprend les vestiges du
canal, les fortifications, de nombreux vestiges archéologiques, la
réplique du blockhaus de 1813, ainsi que plusieurs aménagements destinés
à l'interprétation.
La valeur patrimoniale de Coteau-du-Lac réside dans le fait qu'il est le
premier canal à écluses en Amérique du Nord. Construit entre 1779 et
1781, la largeur du canal est doublée entre 1814 et 1817 pour faciliter
le passage des bateaux Durham. Les trois écluses qui le composent
originalement sont alors remplacées par deux autres mieux adaptées aux
besoins. Aujourd'hui, les principales modifications survenues dans le
paysage sont la baisse du niveau de l'eau d'environ 2,5 mètres apparus à
la suite de la construction, dans les années 1940, d'une digue et d'un
barrage en amont du site.
Coteau-du-Lac était, de 1778 jusqu'au milieu du XIXè siècle,
l'illustration d'un site de poste militaire britannique important dont
la fonction est d'assurer la protection du couloir navigable et de
faciliter le transport de marchandises. Au cours de cette période, le
site est doté de nouveaux bâtiments tels que : fortifications, blockhaus
octogonal, poudrière, corps de garde et divers autres bâtiments qui
renforcent sa vocation militaire.
La valeur patrimoniale du Coteau-du-Lac réside également dans
l'importance stratégique qu'il a joué à la fois pendant la Révolution
américaine et la guerre de 1812. Du fait de l'isolement et des
difficultés à approvisionner les postes militaires britanniques des
Grands-Lacs, Coteau-du-Lac devient alors un point stratégique de défense
du couloir navigable, facilitant aussi bien le ravitaillement que le
transport des troupes sur le fleuve Saint-Laurent, vers le Haut-Canada.
Enfin, sa position stratégique fait de ce canal un port d'entrée pour
les importations dans le Haut-Canada. En effet, de 1797 et jusqu'à 1840,
un bureau de douanes est instauré à Coteau-du-Lac. Des droits sont alors
perçus sur les vins, spiritueux et autres articles importés dans le
Haut-Canada. Le but étant de comptabiliser les articles importés, afin
de permettre d'évaluer la part des droits perçus au port de Québec qui
revient au Haut-Canada. L'installation d'un tel bureau fait de Coteau-du
Lac le principal port d'entrée pour le Haut-Canada.
|
|
Lieu historique national du Canada du Deuxième-Bataille-de-Laprairie
La Prairie, Québec
On August 11th, 1691, a few hours after the attack on Fort Laprairie. Le
major Peter Schuyler et ses sauvages furent défaits par les troupes
françaises et sauvages alliés que commandait le capitaine de Valrennes.
Les français perdirent les officiers suivants: lieutenants Le Varlet, Le
Ber, Duchesne, Denys de la Bruére et Depeiras.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, B. Violette, 2002 |
Lieu historique national du Canada du Dispensaire-de-La Corne
La Corne, Québec
Le lieu historique national du Canada du Dispensaire-de-La Corne est
situé à La Corne, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Construit en 1940, le dispensaire est formé de deux bâtiments en bois
peint en blanc, à savoir le dispensaire-résidence de deux étages, dont
la façade avant accueille une véranda, et le garage. Une cuisine d'été
est située dans le coin sud-ouest de la propriété. Le dispensaire est
doté d'une cour arrière, dont les arbres bornent la limite ouest de la
propriété. Le dispensaire a également conservé son mobilier et abrite
une collection ethnologique directement associée à l'histoire du lieu.
Le dispensaire de La Corne est l'un des mieux conservés du réseau de 174
dispensaires institués au Québec entre 1932 et 1975. Ce dispensaire a
été habité pendant 50 ans par la même infirmière, Gertrude Duchemin, de
1940 à 1990, bien qu'elle fût à la retraite dès 1976. Sa présence
continue a sans doute contribué à maintenir l'intégrité du lieu et a
permis de conserver le mobilier ainsi qu'une collection ethnologique
directement associée à l'histoire du lieu. Par son intégrité physique,
le dispensaire de La Corne constitue un excellent exemple de
dispensaire-résidence érigé au Québec et institué par le Service médical
aux colons (SMC) pour y desservir les populations établies dans les
zones nouvellement colonisées dans le contexte de la grande dépression.
Les dispensaires-résidences ont été construits selon trois modèles.
Celui de La Corne représente le premier modèle, soit le plus répandu. Ce
dispensaire type, érigé durant les années 1930 et 1940, est formé d'un
bâtiment en bois de deux étages auquel est annexé un garage et une
cuisine d'été.
Le dispensaire symbolise également la contribution du réseau de postes
de soins infirmiers, créé par le SMC, au développement des services de
soins de santé dans les régions éloignées du Québec. L'ensemble de ces
dispensaires a contribué à former la genèse de l'infrastructure
socio-sanitaire de plusieurs régions rurales du Québec où les
infirmières ont joué un rôle crucial. Le dispensaire constituait à la
fois le lieu de travail et la résidence de l'infirmière avec un cabinet
de l'infirmière, une salle d'attente, une salle de séjour, une cuisine,
une salle de bain et des chambres à l'étage. Les infirmières devaient
aussi se déplacer sur de grandes distances pour desservir les colons.
Elles assumaient de nombreuses responsabilités, dont la promotion des
principes d'hygiène publique, la surveillance de l'éclosion des maladies
contagieuses, les soins aux colons indigents, les accouchements, et les
extractions dentaires.
Le dispensaire de La Corne illustre le rôle fondamental que les
dispensaires ont joué au développement des communautés. Il s'est aussi
avéré un outil important du processus de colonisation dans cette région
de l'Abitibi. Les infirmières, comme Gertrude Duchemin, jouèrent un rôle
essentiel dans le développement des régions du Québec et tout
particulièrement en Abitibi-Témiscamingue.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2002 |
Lieu historique national du Canada du Domaine-Joly-de-Lotbinière
Sainte-Croix, Québec
Le lieu historique national du Canada du Domaine-Joly-de-Lotbinière
occupe la pointe Platon, une grande péninsule située sur la rive sud du
fleuve Saint-Laurent, au Québec. Fondé en 1851 par Sir Henri-Gustave
Joly de Lotbinière, un influent politicien canadien qui fut aussi
lieutenant-gouverneur, ce domaine estival de style manoir d'une
superficie de 337 acres consiste en une vaste demeure dans un parc
aménagé, avec jardins spécialisés et structures de soutien. Conçu de
façon pittoresque, ce domaine est aménagé en insistant sur l'informel et
le naturel. Des promenades mènent vers une succession de jardins
contenant des espèces indigènes et exotiques agrémentés de pelouses, de
bassins et d'arbres soigneusement disposés.
La famille Joly de Lotbinière a joué un rôle important pendant et après
la période seigneuriale. Henri-Gustave Joly de Lotbinière, qui a hérité
de la propriété en 1860, est devenu un des politiciens les plus
marquants du 19e siècle, tout en étant un remarquable botaniste et
scientifique de cette période. L'aménagement des terrains permettait d'y
cultiver de nombreux spécimens et d'y planter des espèces exotiques.
Henri-Gustave fut également un pionnier de la foresterie et avait bâti
une collection d'arbres. La résidence principale affiche plusieurs
caractéristiques des résidences d'été, dont de grandes fenêtres
destinées à maximiser la vue sur l'environnement naturel et de vastes
galeries offrant une agréable transition vers l'extérieur. Son
petit-fils a hérité du domaine et y a développé les jardins après 1908.
Leur style est en partie anglais et en partie français. La maison et le
jardin sont devenus propriété publique en 1984 et le domaine est
maintenant ouvert au public.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Michel Gagné, 2006 |
Lieu historique national du Canada du Droulers-Tsiionhiakwatha
Saint-Anicet, Québec
Le lieu historique national du Canada du Droulers Tsiionhiakwatha
représente un village qui, à l'apogée de la civilisation iroquoienne de
la vallée du Saint Laurent, constituait le noyau d'une région qui
livrera plus tard un nombre impressionnant de sites archéologiques.
Situé dans le sud-ouest du Québec, à quelque huit kilomètres du fleuve
Saint Laurent, il constitue l'un des villages iroquoiens les plus en
retrait à l'intérieur des terres de la province. Cet important site
archéologique, découvert en 1994, a fait l'objet de six campagnes de
fouilles intensives qui ont permis de découvrir plus de 150 000
vestiges, laissant croire qu'il s'y trouvait autrefois un ensemble de
longues maisons. La reconnaissance officielle du lieu englobe les deux
secteurs situés de part et d'autre du chemin Leahy : le premier, borné
au nord par les vestiges de l'ancienne palissade qui entourait le
village et au sud par le chemin Leahy, et le second, formant un espace
présentant une superficie de 557 mètres carrés, délimité au sud, à
l'ouest et à l'est par la pente de la terrasse.
Droulers Tsiionhiakwatha est le plus important village paléohistorique
découvert à ce jour sur l'ensemble du territoire québécois. Il a été
occupé vers le milieu du XVe siècle par un groupe aujourd'hui identifié
comme les Iroquoiens du Saint Laurent. Les conditions exceptionnelles du
sol ont permis la conservation des structures du village, notamment des
foyers, des fosses et des tranchées, qui indiquent l'emplacement d'une
quinzaine d'habitations datant des trois siècles précédant l'arrivée des
Européens.
En outre, Droulers Tsiionhiakwatha se place parmi les plus importants
sites archéologiques permettant de documenter la vie dans les villages
iroquoiens. L'emplacement unique du lieu permet de bien documenter
l'importance des végétaux dans le régime alimentaire quotidien des
Iroquoiens. En effet, on y a trouvé une quantité appréciable d'objets en
os utilisés pour la cuisine et de restes d'os dans un état de
conservation remarquable. Droulers Tsiionhiakwatha renferme l'un des
plus importants ensembles de plantes cultivées et sauvages retrouvées
dans un site iroquoien de l'Est du Canada. Ces vestiges indiquent que
les villageois qui habitaient jadis à cet endroit exploitaient les
nombreux écosystèmes sur le territoire. Ils montrent également que la
population dépendait grandement de la culture de certaines plantes et
qu'elle s'adonnait à d'autres activités, comme l'agriculture, la pêche
et la cueillette de petits fruits sauvages.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Édifice-Wilson-Chambers
Montréal, Québec
Le lieu historique national de l'Édifice-Wilson-Chambers, situé sur un
terrain d'angle dans le centre-ville de Montréal, est un bâtiment
commercial de style néo-gothique tempéré par les styles italianisant et
Second Empire. Le bâtiment se distingue par sa volumétrie en pierre de
quatre étages et demi, ses nombreuses fenêtres en arc tiers-point, ses
vastes surfaces de verres lisses et sa toiture à la Mansart.
En vogue pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, le style
néo-gothique de la grande époque victorienne fait son apparition au
Canada dans les années précédant la Confédération, période qui coïncide
avec la mise en place de nombreuses et importantes institutions
religieuses, civiques et d'enseignement. Bien que bon nombre d'églises
et de bâtiments institutionnels aient été érigés dans ce style, les
édifices commerciaux néo-gothique étaient d'une rareté.
Dessiné par l'architecte R.C. Windeyer et construit en 1868, l'édifice
Wilson Chambers est l'un des rares bâtiments commerciaux de style
néo-gothique à subsister. Bel exemple du style néo-gothique de la grande
époque victorienne, il se caractérise par sa verticalité imposante,
l'emploi de pierres contrastantes et ses nombreuses fenêtres en arc
tiers point. Afin de réaliser la conception éclectique du bâtiment,
l'architecte a puisé dans de nombreux styles architecturaux : le style
italianisant pour les fenêtres en plein cintre, le style Second Empire
pour le toit à la Mansart et le style classique pour l'entablement.
L'édifice a été rénové de fond en comble à la fin des années 1990, dans
le souci de la conservation de son style initial.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, P. St. Jacques, 1995 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. George
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. George
est un édifice en pierre de style néo-gothique, situé entre des
immeubles de bureaux au centre de Montréal, au Québec. Surmontée d'un
toit à pignon à forte pente, l'église est un assemblage pittoresque de
formes asymétriques construit selon un plan cruciforme. La couverture en
charpente apparente constitue un élément intérieur original.
Construite en 1869-1870 selon les plans de l'architecte renommé William
Tutin Thomas, cette église anglicane est une habile composition de
formes asymétriques qui offre une variété d'effets visuels pittoresques.
Le revêtement de pierre bossagée, caractéristique du style néo-gothique
de l'apogée victorien, ajoute à la somptuosité de l'extérieur en
apportant de la texture et en accentuant les détails sculptés tels que
les moulures des fenêtres. Les éléments intérieurs comprennent le chœur
absidial, le transept en forme de polygone avec porte, et l'entrée
principale située à l'extrémité ouest plutôt que sous un porche au
nord.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1992. |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. Stephen
Chambly, Québec
Le lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. Stephen
est une petite église en pierre combinant des éléments de la tradition
architecturale québécoise à des influences palladiennes. Située dans la
ville de Chambly, au sud-est de Montréal, dans la Vallée du Richelieu,
l'église entourée d'arbres et d'un cimetière très ancien s'élève dans un
décor pittoresque, à proximité du lieu historique national du Canada du
fort Chambly et de la rivière Richelieu.
L'Église anglicane St. Stephen a été construite en 1820 pour desservir
la garnison du fort, situé à proximité, de même que la petite population
anglicane de Chambly. Les galeries latérales et les stalles aménagées
dans les années 1830 ont agrandi l'espace pour accommoder la garnison.
De conception simple, l'église présente une combinaison harmonieuse
d'éléments associés à deux traditions architecturales. Ses matériaux,
ses proportions et ses dimensions modestes la rattachent aux églises
traditionnelles québécoises. Par contre l'organisation et
l'ornementation de l'extérieur, de même que d'autres éléments comme la
flèche étagée, le porche et le fenêtrage, témoignent de l'influence du
style palladien introduit au Québec par les immigrants anglais.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1994 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Catholique-Notre-Dame / Basilique-Notre-Dame
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada de l'Église-Catholique-Notre-Dame
/ Basilique-Notre-Dame est une immense église en pierre, de style
néogothique romantique, construite entre 1824 et 1829. Elle se
caractérise par ses tours jumelles massives et son portique à arche
gothique en retrait. L'intérieur est décoré dans le style plus élaboré
du néogothique tardif. L'église donne sur la rue Notre-Dame et fait face
à la Place d'Armes, au cœur du Vieux-Montréal.
Construite entre 1824 et 1829, l'église catholique Notre-Dame /
Basilique Notre-Dame est le premier exemple significatif du style
néogothique au Canada. Durant les années 1820, la paroisse de Notre-Dame
était dirigée par un groupe de commerçants influents de Montréal et par
les Sulpiciens, un puissant ordre religieux catholique qui avait joué un
rôle marquant dans l'histoire de l'île de Montréal en tant que clercs et
seigneurs des lieux. Les Sulpiciens voulaient construire une nouvelle
église paroissiale qui serait plus imposante que les églises catholiques
et anglicanes récemment érigées à Montréal. Ils ont fait appel aux
services de James O'Donnell, un architecte américain de confession
protestante, pour faire construire une église dans le style
architectural le plus récent et qui pourrait accueillir une congrégation
comptant plus de 8 000 fidèles. L'église de style néogothique qui en a
résulté, désignée Notre-Dame, servait la ville entière. Notre-Dame fut
pendant une cinquantaine d'années la plus grande église qui soit au
Canada et aux États-Unis. Ses éléments néogothiques, notamment le plan
simple de sa nef, ses tribunes et ses tours jumelles, sont
représentatifs du début de ce style dans l'architecture des églises au
Canada. Elle atteste l'approche romantique et non formelle du style
néogothique, et cadre avec plusieurs grandes cathédrales anglicanes et
catholiques de style néogothique religieux construites au Canada, depuis
le milieu jusqu'à la fin du XIXe siècle.
Au cours des XIXe et XXe siècles, la paroisse a fait appel à nombreux
architectes et artisans québécois réputés pour aider à compléter
l'ornementation de l'église. L'architecte John Ostell, suite au décès de
M. O'Donnell, termina en 1843 les tours jumelles de Notre-Dame,
conformément au plan original. De 1872 à 1880, l'aménagement intérieur
conçu par O'Donnell a été remplacé par une décoration néogothique plus
élaborée de l'architecte bien connu Victor Bourgeau. Ce dernier a confié
au sculpteur français Henri Bouriché le mandat de réaliser les statues
et reliefs du maître-autel ainsi que le retable massif du côté est du
chœur. Le sculpteur montréalais Louis-Philippe Hébert a ajouté, entre
1883 et 1887, une chaire conforme aux plans conçus par Bouriché. Enfin,
en 1926, l'ornementation des voûtes, des murs, des entrées de porte et
des vitraux a été confiée à l'artiste québécois Ozias Leduc.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, R. Goodspeed, 1997 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Erskine and American (Temple-de-l'Église Unie)
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada de l'Église-Erskine and American
(Temple-de-l'Église Unie) est situé dans le Mille carré doré (Golden
Square Mile) de Montréal. Construite entre 1893 et 1894, cette église de
style néo-roman contient des vitraux de Louis Comfort Tiffany. La
façade, couronnée d'un pignon, comporte une grande demi-rosace
surplombant de plus petites fenêtres encadrées par un arc central
massif. De petites tours viennent équilibrer la grande tour qui domine
la composition. La maçonnerie en pierre est fortement bossagée.
Construite entre 1893 et 1894 selon les plans de l'architecte
montréalais Alexander Cowper Hutchinson en tant qu'église presbytérienne
Erskine, l'église qui présente un extérieur richement texturé, est un
exemple splendide de style néo-roman ayant subi l'influence de
Richardson. L'intérieur est un magnifique exemple exécuté avec brio d'un
plan d'amphithéâtre du XIXe siècle modifié en 1938-1939 par l'architecte
Percy Nobbs pour tenir compte des nouvelles valeurs de l'Église Unie.
Les fenêtres Tiffany du sanctuaire et de la chapelle datent de 1903 et
furent installées en 1938-1939 pour former le plus important groupe
connu au Canada jusqu'à date de vitraux religieux faits par
Tiffany.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2008 |
Lieu historique national du Canada de l'Église Notre-Dame-de-Lorette
Wendake, Québec
Le lieu historique national du Canada de l'Église Notre-Dame-de-Lorette
est une petite église en pierre, située sur un lot gazonné au centre du
lieu historique national du Canada de
l'Arrondissement-Historique-du-Vieux-Wendake, au Québec. Le bâtiment,
coiffé d'un toit à deux versants surmonté d'un clocher, a été construit
en 1865 sur les ruines d'une église datant du début du XVIIIe siècle.
Une chapelle latérale et une sacristie en bois datent du début du XXe
siècle. Certains aménagements intérieurs et objets remontent au XVIIe
siècle.
Sous le Régime français du XVIIe siècle, les peuples des premières
nations Huronnes constituaient les principaux intermédiaires de la
traite de la fourrure et les meilleurs alliés des Français. Face aux
menaces de maladie et d'invasions iroquoises, plusieurs Hurons ont fui
vers des missions comme celle située à Jeune-Lorette. En 1722, une
première chapelle en pierre est élevée à cet endroit, mais elle est
endommagée par un incendie en 1862. L'église actuelle de Notre-Dame de
Lorette est le produit d'une reconstruction de 1865 sur le site et selon
le modèle de l'église précédente. L'église actuelle a des murs de pierre
des champs d'un demi-mètre d'épaisseur. La très grande simplicité de son
plan, de son ornementation extérieure et de son aménagement intérieur,
rappellent les églises de mission, les petites chapelles et les églises
paroissiales du XVIIIe et XIXe siècle. Le plan initial de l'église était
rectangulaire et se terminait par un chevet plat.
L'austère façade principale de l'église offre une fenêtre circulaire
placée au-dessus de la porte centrale voûtée. Rebâtie sur le modèle de
l'église précédente qui datait du début du XVIIIe siècle, l'église
actuelle est un exemple inusité d'architecture religieuse
traditionnelle, dans sa forme la plus simple. L'intérieur de l'église
reste simple suite à des modifications au décor et à la toiture à la fin
du 19ème siècle. Les objets contenus à l'église marquent une époque de
transition dans les arts religieux, alors que graduellement vers la fin
du XVIIe siècle les artistes et les artisans d'ici commencent à
s'éloigner des modèles européens.
|

©Historic Services Branch / Direction des services historiques, 2003 |
Lieu historique national de l'Église Notre-Dame-de-la-Présentation
Shawinigan, Québec
Le lieu historique national du Canada de
l'Église-Notre-Dame-de-la-Présentation est un vaste bâtiment construit
en 1924 dans le style néo-roman. Les murs et le plafond intérieurs sont
décorés de quinze grandes peintures ainsi que de symboles et de motifs
variés créés par l'artiste québécois Ozias Leduc et son assistante,
Gabrielle Messier, entre 1942 et 1955. Neuf peintures représentent des
scènes bibliques et six autres illustrent l'histoire religieuse et
sociale de la région. L'église est située sur un vaste terrain
surplombant la rivière Saint-Maurice dans la ville de Shawinigan-Sud.
L'intérieur a été peint par Ozias Leduc (1864-1955), célèbre artiste
québécois, et par son assistante, Gabrielle Messier (1904-2003). Le
programme décoratif de Notre-Dame-de-la-Présentation, que l'artiste
réalisa pendant les treize dernières années de sa vie, représente le
sommet de son art et reflète l'influence du mouvement symboliste sur la
thématique et l'approche de l'artiste. Ce programme marque également la
fin de la grande époque de la peinture murale religieuse au Québec.
L'intérieur est remarquable par l'originalité et la qualité des œuvres
qui s'y trouvent et par l'unité iconographique de l'ensemble du
programme décoratif. Ozias Leduc a cherché à mettre en évidence la vie
quotidienne et le cadre régional dans ses œuvres d'inspiration
religieuse. Dans ses peintures, les expériences humaine et religieuse
sont visuellement et symboliquement unies. Neufs peintures au fond du
chœur et de la nef illustrent des thèmes religieux tirés de récits
bibliques. Six autres, situées plus près des fidèles, représentent des
thèmes historiques et sociaux liés à l'histoire religieuse et
industrielle de la région de la Mauricie. Les peintures sont entourées
et unies visuellement par des bandes ornementales, des inscriptions et
des motifs géométriques, symboliques et emblématiques peints directement
sur les murs et le plafond. Le programme décoratif a été exécuté dans le
style symboliste, très populaire au début du XXe siècle, et il incorpore
des objets concrets dépeignant des vérités allégoriques. Les lignes
flottantes, la lumière filtrée et les couleurs douces confèrent aux
œuvres une qualité mystique appropriée au domaine religieux.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Architectural History Branch, 1988 |
Lieu historique national du Canada de l'Église Notre-Dame-des-Victoires
Québec, Québec
Le lieu historique national du Canada de l'Église
Notre-Dame-des-Victoires est situé bien en vue à Place-Royale dans la
basse-ville de Québec. Construit sur le site du premier établissement
français en Amérique du Nord, le lieu est associé à la croissance de la
ville de Québec et de ses habitants. L'église en pierre de style
vernaculaire québécois, bâtie pour la première fois en 1688, est encore
un symbole de la présence française en Amérique du Nord. Démontrant des
influences néo-classiques et Palladiennes, le bâtiment a une façade
symétrique, un fronton d'écart large et des pilastres en pierre de
taille.
Construite à titre d'annexe de l'église Notre-Dame-de-Québec, l'église
Notre-Dame-des-Victoires, érigée en 1688, occupe le site du premier
établissement permanent français en Amérique du Nord, à l'endroit même
où Champlain construisit son Habitation en 1608. Son nom rappelle la
victoire française de 1690 et celle de 1711 sur la flotte anglaise.
L'église a subi plusieurs transformations, débutant avec la construction
des premiers murs en 1688 et de la première façade permanente en 1723.
Elle fut détruite pendant le siège de 1759, mais l'intérêt populaire
pour cet établissement de culte permit de la faire renaître de ses
cendres.
L'église illustre l'évolution de l'architecture religieuse québécoise.
Elle retient son plan datant du 17e siècle et la construction
traditionnelle en pierre, éléments qui s'identifient avec l'architecture
des églises de la Nouvelle-France et établissent un lien avec les
oeuvres des architectes les plus connus du Régime français, c'est-à-dire
Claude Baillif, Jean-Baptiste Maillou et Thomas Baillairgé. En outre, sa
façade représente une période importante dans le développement
architectural des églises du Québec, lorsque le style néo-classique
commençait à remplacer le style traditionnel. L'église est aussi l'une
des rares œuvres de François Baillairgé à subsister. |

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Église orthodoxe antiochoise St. George
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada de l'Église orthodoxe antiochoise
St. George, situé dans le quartier Villeray de Montréal, est une belle
église en brique conçue dans un style à prédominance byzantine.
Surmontée d'un fronton et flanquée par deux clochers de trois étages, la
façade se distingue par un groupe de trois fenêtres en arc au-dessus
d'une porte d'entrée en arc. L'intérieur reflète un mariage d'influences
byzantine et occidentale, grâce à sa nef centrale à larges arcades
décorées par un magnifique ensemble de fresques et de verrières.
Desservant la communauté syrienne orthodoxe la plus grande et ancienne
du Canada, l'église orthodoxe antiochoise St. George constitue la plus
ancienne église construite spécifiquement pour cette communauté
culturelle toujours en activité. Conçue par l'architecte Raoul Gariépy,
l'église conjugue les styles occidental et byzantin. Grâce à sa
remarquable architecture et à sa décoration intérieure signée Emmanuel
Briffa, et à titre de lieu de convergence pour plusieurs organismes
communautaires engagés dans des activités humanitaires, elle illustre
avec force la continuité de traditions culturelles diverses dans un
contexte canadien. L'église orthodoxe antiochoise St. George, créée par
la communauté orthodoxe syrienne comme une représentation physique de
l'aptitude de ce groupe de contribuer à la vie canadienne tout en
préservant et adaptant ses valeurs et traditions culturelles, est un
lieu fortement significatif du paysage canadien.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Église-de-Saint-André-de-Kamouraska
Saint-André, Québec
Le lieu historique national du Canada de
l'Église-de-Saint-André-de-Kamouraska est situé à Andréville (Québec).
Son plan rectangulaire simple et l'abside semi-circulaire en font un
exemple classique des petites églises du Québec construites selon le
plan récollet. L'extérieur modeste en pierre est égayé par un clocher
pointu à deux tours.
Construite entre 1805 et 1811 pour remplacer une chapelle datant de
1791, cette église s'inspire des églises paroissiales bâties durant le
régime français selon le plan récollet. Cette influence dans la
conception est visible dans la simplicité du plan avec une nef et une
abside semi-circulaire étroite, ainsi que dans la réalisation de la
porte centrale et du clocher de la façade. Sa décoration intérieure
raffinée, qui date des années de 1834 à 1836, offre un des exemples les
mieux conservés de l'œuvre du sculpteur Louis-Xavier Leprohon. L'annexe,
construite aux environs de 1822 et considérée comme l'une des premières
du Québec rural, servait de presbytère et de sacristie.
|
|
Lieu historique national du Canada de l'Église de Saint-Eustache
Saint-Eustache, Québec
L'église de Saint-Eustache est un lieu de culte de confession catholique
romaine situé au cœur de la ville de Saint-Eustache, au Québec, qui se
trouve au confluent des rivières des Mille-Îles et Du Chêne, au
nord-ouest de l'île de Montréal et de l'île Jésus. Elle a été au cœur de
la bataille de Saint-Eustache, le 14 décembre 1837, bataille qui a
marqué la fin de la rébellion de 1837 au Bas-Canada. Lors de ce conflit
colonial, les rebelles, ou Patriotes, se sont soulevés pour contester le
pouvoir du gouverneur britannique et de ses conseillers.
Au cours de cette bataille, qui éclate immédiatement après une victoire
des Britanniques à Saint-Charles, les forces britanniques et les
partisans du gouvernement, dirigés par sir John Colborne, affrontent les
patriotes. Par sa silhouette, son emplacement et les traces d'artillerie
que porte la maçonnerie de sa façade, l'église de Saint-Eustache
témoigne encore aujourd'hui de cet évènement tragique.
L'architecture de l'église de Saint-Eustache reflète les tendances de
l'architecture religieuse vernaculaire au Québec aux XVIIIe, XIXe et XXe
siècles. La monumentale façade-écran est un bel exemple de l'influence
du néoclassicisme du début du XIXe siècle, avec ses deux flèches
latérales, chacune coiffée d'un clocher à doubles lanternes. Derrière
cette façade se dresse une église maintes fois modifiée depuis sa
construction.
Le bâtiment, dont l'édification dure de 1780 à 1783, suit un plan en
croix latine avec abside en hémicycle. L'édifice gagne 8,5 mètres (28
pieds) en façade lors de l'agrandissement réalisé de 1831 à 1833 qui lui
donne son aspect actuel. Lourdement endommagée par le feu en 1837, son
enveloppe est reconstruite à quelques reprises, la dernière fois au
cours d'importants travaux de 1905 à 1907. Les bas-côtés sont alors
prolongés, la sacristie est remodelée et une chapelle est construite
derrière l'église; on en profite aussi pour refaire la couverture au
complet. En façade, les clochers sont remplacés et le pignon du nouveau
toit est dissimulé derrière un petit fronton triangulaire sur lequel se
dresse une statue de saint Eustache.
L'église de Saint-Eustache devient un puissant symbole de l'histoire des
patriotes et de la rébellion de 1837 et occupe maintenant une place
particulière dans l'imaginaire collectif.
|

©Archithème, 1998 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-de-Saint-Joachim
Châteauguay, Québec
Le lieu historique national du Canada de
l'Église-Saint-Joachim-de-Châteauguay se trouve à Châteauguay, au
Québec, près de Montréal. Cette église en petites pierres, dont la
construction a débuté en 1775, présente une composition équilibrée grâce
à son plan rectangulaire et à son abside semi-circulaire. L'extérieur se
caractérise par une charmante façade de style néobaroque flanquée de
deux tours de trois étages munies de clochers à flèche. L'église se
situe sur un lot plat et triangulaire et son entrée principale, qui fait
face à l'est, surplombe la rivière Châteauguay.
La valeur patrimoniale de l'église Saint-Joachim de Cháteauguay réside
dans ses qualités matérielles, par exemple sa façade néobaroque, et dans
ses associations historiques. Les travaux effectués au fil des ans ont
été habilement exécutés par des maîtres d'oeuvre favorables au concept
d'origine du bâtiment. L'église Saint-Joachim de Châteauguay, construite
entre 1774 et 1797 pour remplacer une église datant de 1735, constitue
une caractéristique dominante dans l'un des rares paysages types encore
existants des villes bâties sous le régime français, soit la place,
aussi appelée « carré ». Ce carré est d'une cohérence exceptionnelle et
rare, entouré du presbytère, du couvent et de maisons bâties sous le
régime français. L'église est associée à plusieurs évènements
historiques d'importance, dont la bataille de Châteauguay. La décoration
intérieure, à laquelle ont contribué divers artistes, contient aussi des
exemples du travail du sculpteur Philippe Liébert.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Rhona Goodspeed, 1996 |
Lieu historique national du Canada de l'Église Saint-Léon-de-Westmount
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada de l'église
Saint-Léon-de-Westmount est situé à Westmount sur l'île de Montréal.
L'église possède un programme de décoration remarquable incluant des
fresques, des vitraux, des ouvrages en pierre, des sculptures sur bois
et des oeuvres de bronze, le tout conçu par l'artiste Guido Nincheri.
Basée sur un plan de croix latine, cette église de style néo-roman
comporte une façade avec clocher d'inspiration italienne.
L'Église Saint-Léon-de-Westmount comporte un intérieur splendide conçu
par l'artiste canadien prolifique et talentueux Guido Nincheri
(1885-1973). Ses peintures murales sont un exemple exceptionnel de
décoration murale. À compter de 1928, il a exécuté ces oeuvres selon la
technique traditionnelle de la fresque sur plâtre humide, une manière de
peindre directement sur le plâtre frais rarement utilisée au Canada,
mais maîtrisée par Nincheri en Italie où il est né et a reçu sa
formation. Dans cette église, Nincheri a combiné l'architecture, le
vitrail, la peinture et la sculpture pour créer un de ses chefs-d'oeuvre
les plus remarquables.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Dufresne, 2004
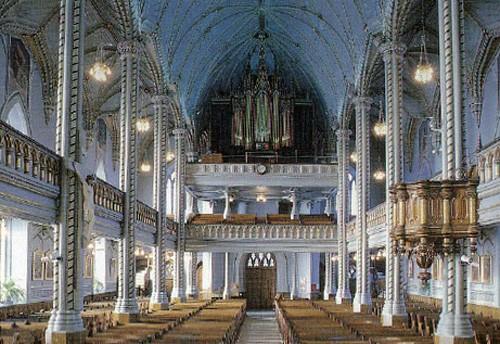
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Dufresne, 2004 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Sainte-Marie
Sainte-Marie, Québec
Le lieu historique national du Canada de l'Église-Sainte-Marie est situé
au coeur de la ville de Sainte-Marie (Québec.) L'église, dont la façade
principale donne sur l'avenue Marguerite-Bourgeois, est bordée à l'ouest
par la rue Notre-Dame, à l'est par une aire de stationnement et au sud,
par le presbytère. L'église Sainte-Marie est un bâtiment de style
néogothique à caractère romantique construit au XIXe siècle qui reprend
la forme d'une croix latine avec un chevet en hémicycle relié à une
sacristie de forme irrégulière.
La valeur patrimoniale de l'église Sainte-Marie réside dans le fait
qu'elle constitue un bel exemple d'église néogothique à caractère
romantique, ce qui est exprimé par son ordonnance extérieure
relativement simple ainsi que par ses composantes gothiques simplement
appliquées à la surface du bâtiment plutôt qu'intégrées à
l'architecture. Contrastant avec la sobriété extérieure de l'église,
l'intérieur est doté d'un impressionnant décor réalisé essentiellement
par Charles Baillairgé et François-Édouard Meloche.
Inspirée de modèles britanniques d'églises gothiques du XIVe siècle,
l'église s'ouvre sur un intérieur élancé, bleu et or, avec quadrilobes
audacieusement sculptés, voûtes nervées et colonnes fasciculées. De nos
jours, l'intérieur est presque identique à celui que Baillairgé exécuta
à l'époque, à l'exception du décor peint qui a remplacé le blanc et l'or
d'origine. Ce décor peint, réalisé par François-Édouard Meloche de
Montréal est l'aspect le plus frappant lorsque l'on pénètre à
l'intérieur de l'église. Excellant dans la peinture en trompe-l'oeil, ce
dernier a ainsi créé l'illusion d'une ornementation tridimensionnelle
sur une surface purement bidimensionnelle. C'est également Meloche qui a
peint les magnifiques petits tableaux en grisaille représentant des
patriarches de l'Ancien Testament qui surplombent les fenêtres des
tribunes ainsi que les quatre tableaux en couleurs représentant des
scènes de la vie de la Vierge au niveau du choeur.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, C. Turnel |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Unie-St. James
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada de l'Église-Unie-St. James est
situé sur la rue Sainte-Catherine Ouest dans un quartier commercial du
centre-ville de Montréal, au Québec. Il s'agit d'un vaste bâtiment de
pierre construit à la fin du XIXe siècle dans le style néo-gothique de
la grande époque victorienne distingué par deux grandes tours sur la
façade principale, avec une rosace proéminente qui surplombe l'entrée
principale à triple portail.
Lieu de culte méthodiste érigé entre 1887 et 1888, l'église unie St.
James est représentative de la phase tardive du méthodisme, mouvement
protestant évangélique fondé au milieu du XVIIIe siècle. À la fin du
XIXe siècle, les congrégations méthodistes comptaient de nombreux
membres prospères occupant une place en vue dans la société. D'abord axé
sur des rencontres de renouvellement de la foi et de conversions
religieuses, le méthodisme mettait désormais l'accent sur la modération
et le gradualisme, ainsi que sur la place centrale des institutions de
l'Église dans la vie religieuse des fidèles. Comme l'église unie St.
James l'illustre si bien, l'école du dimanche faisait partie de ces
institutions qui favorisaient l'éducation et le développement spirituel
des gens de tous âges.
L'église unie St. James reflète la conception des églises méthodistes de
la fin de la période victorienne par sa grande échelle, son emplacement
central, son extérieur néo-gothique éclectique, son plan intérieur
inspiré d'un amphithéâtre et les installations sophistiquées de son
école du dimanche. La grande échelle et la conception élaborée de
l'église témoignent de l'importance sociale, politique et économique de
ses membres. La nef et le transept, construits selon le plan d'un
amphithéâtre, sont révélateurs du rôle central que jouait le prêcheur
méthodiste. Les installations de l'école du dimanche et leur emplacement
dans le jubé illustrent l'importance de l'éducation et du développement
spirituel dans l'église. Inspirée du plan Akron, une innovation dans la
conception des écoles du dimanche datant du milieu du XIXe siècle, la
salle présente un plan semi-circulaire et des murs mobiles permettant
d'accueillir de petits groupes d'élèves et de grandes assemblées.
L'église unie St. James illustre l'architecture néo-gothique de la
grande période victorienne par l'utilisation éclectique de références
historiques et l'inspiration de l'architecture gothique française et
italienne. À l'extérieur, un haut toit à pignon couvert d'ardoise
agrémente les façades polychromes du bâtiment. À l'intérieur, les
nombreux détails architecturaux en plâtre, qui prennent la forme
d'arches et de nervures moulurées et sculptées fixées uniquement aux
fermes et ne reposant sur aucune colonne, donnent à l'église une
élégance typique du style néo-gothique de la grande époque victorienne.
La lumière naturelle pénètre à l'intérieur par des vitraux ornés d'un
remplage de bois et de motifs gothiques, comme des quadrilobes, répartis
le long des murs du rez de chaussée et du jubé.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Dufresne, 2004

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Dufresne, 2004

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Dufresne, 2004 |
Lieu historique national du Canada de l'Ensemble-Institutionnel-de-Saint-Joseph-de-Beauce
Saint-Joseph-de-Beauce, Québec
Le lieu historique national du Canada de
l'Ensemble-Institutionnel-de-Saint-Joseph-de-Beauce est situé au cœur de
la municipalité de Saint-Joseph-de-Beauce, dans la région de la Beauce,
au Québec. Cet ensemble institutionnel de cinq bâtiments construit entre
1865 et 1911, comprend une église, un couvent, un presbytère, un
orphelinat et l'école Lambert. Quelques bâtiments secondaires font
également partie de l'ensemble, de même que les éléments paysagers du
cimetière et une partie de l'avenue du Palais, des rues Sainte-Christine
et Martel.
Situé au centre ville de Saint-Joseph-de-Beauce, l'ensemble
institutionnel symbolise le rôle important qu'ont joué les institutions
catholiques dans le développement et l'organisation sociale des
municipalités rurales du Canada au XIXe siècle et au début du XXe
siècle. L'ensemble, composé d'une église, d'un presbytère, d'un couvent,
d'un orphelinat et d'une école, a contribué à définir l'identité même de
la municipalité de Saint-Joseph-de-Beauce. Centre régional des activités
religieuses, communautaires et éducatives, l'ensemble institutionnel
forme une précinction distincte qui rappelle la volonté du clergé, des
communautés religieuses et des paroissiens de structurer la vie des
villages autour des institutions catholiques.
Inspirés par les styles architecturaux en vogue aux XIXe et XXe siècles
et conçus par des architectes et des artisans québécois de renom, ces
bâtiments, harmonieux dans leurs dimensions, formes et matériaux,
illustrent bien les goûts stylistiques de ces périodes : l'église
Saint-Joseph par son style néoclassique, le couvent et l'orphelinat par
leur style Second Empire, l'école par son style classique d'inspiration
néocoloniale espagnole, et le presbytère par son style éclectique. Tous
ces styles architecturaux représentent une synthèse de trois grandes
influences, à savoir le style Second Empire, le style château et le
style traditionnel du Québec. Érigés entre 1865 et 1911, ces cinq
édifices d'une grande intégrité se distinguent aussi par leur situation
exceptionnelle face à la rivière Chaudière, où ils s'intègrent bien à
l'environnement naturel. Unis par leur histoire, leur fonction et leur
architecture, ils forment l'un des ensembles institutionnels les plus
impressionnants au Québec.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, M.-A. Bernier, 1997 |
Lieu historique national du Canada de l'Épave-du-Navire-Elizabeth and Mary
Anse aux Bouleaux, Québec
Le lieu historique national du Canada de l'Épave-du-Navire-Elizabeth and
Mary est un site archéologique sous-marin situé au fond de l'Anse aux
Bouleaux, non loin de Baie-Trinité, dans la région de la Côte-Nord, au
Québec. Il est constitué d'une section de la coque du Elizabeth and Mary
au-dessus et autour de laquelle se trouvaient plus de 4000 artefacts
engloutis au moment du naufrage du navire en 1690. Ces derniers, témoins
de la tentative de la prise de Québec par sir William Phips en 1690, ont
été déplacés du lieu et sont aujourd'hui conservés par le Centre de
conservation du Québec.
La valeur patrimoniale de ce lieu réside dans la survie des vestiges du
navire trouvés à son emplacement initial. L'épave du navire Elizabeth
and Mary est une découverte importante pour l'histoire du Canada car
elle est l'un des rares témoins de l'expédition infortunée menée par sir
William Phips, au Québec, en 1690.
En 1689, dans le contexte d'une guerre entre la France et l'Angleterre,
la Nouvelle-France a envisagé un plan de conquête de New York dans le
but de contrôler le commerce des fourrures et les territoires de pêche
en Amérique du Nord. Les différents raids entrepris ont semé la panique
chez les habitants de ces colonies et les ont incités à organiser une
expédition pour s'emparer de la Nouvelle-France. En août 1690, une
flotte composée de 32 navires a quitté Nantasket, située à l'entrée sud
de la baie de Boston, afin d'attaquer Québec. Cette expédition a été un
échec et la flotte a renoncé à son projet de prendre la Ville de Québec.
À son retour, elle a du affronter à la fois la petite vérole et les
tempêtes successives. Quatre navires ont été perdus, et deux compagnies
complètement anéanties lors des naufrages.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Peter Waddell, 2000 |
Lieu historique national du Canada de l'Épave-du-RMS-Empress of Ireland
Saint Lawrence River, Québec
Le lieu historique national du Canada de l'Épave-du-RMS-Empress of
Ireland se trouve sur le lit du fleuve Saint-Laurent, près de Rimouski,
au Québec. Situé à 8.3 kilomètres des côtes, ce navire autrefois opulent
repose sur son flanc droit, à 45 mètres de profondeur, dans un angle de
65 degrés. Exploité par le Chemin de fer Canadien Pacifique, cet
imposant paquebot à vapeur des plus élégants fait naufrage en mai 1914,
entraînant de nombreuses pertes de vie.
L'épave du RMS Empress of Ireland constitue un exemple rare et
relativement intact d'un navire de ligne datant de « l'âge d'or » du
transport de passagers dans l'Atlantique Nord, au début du XXe siècle.
Navigant entre le Canada et le Royaume-Uni, le majestueux navire de
ligne peut accueillir, en plus de sa cargaison principale, la Poste
royale, 1 580 passagers répartis en trois classes. Le Royal Mail Steamer
(RMS) Empress of Ireland et son navire frère l'Empress of Britain sont
les premiers paquebots de ligne construits spécialement pour la Canadian
Pacific Line, qui assure le transport international d'un nombre
croissant d'émigrants européens en partance pour le Canada. À partir de
mai et juin 1906, les deux grands navires Empress offrent un service
hebdomadaire rapide et confortable au départ de Liverpool et deviennent
des paquebots très prisés sur cette route. Bien qu'il ne soit pas le
plus gros navire de ligne de l'Atlantique Nord ni le plus rapide, le RMS
Empress of Ireland parvient tout de même à rivaliser avec les navires de
croisière des autres pays. Ses installations de première classe sont
presque aussi luxueuses que celles offertes par des paquebots tels que
l'Olympia et le Titanic. L' aménagement pour passagers des deuxième et
troisième classes de l'Empress répondent aux besoins des voyageurs qui
veulent se déplacer rapidement et présentent l'avantage d'être
abordables, pratiques et confortables. La carrière du RMS Empress of
Ireland prend fin aux petites heures du matin le 29 mai 1914 lorsqu'il
entre en collision avec le charbonnier norvégien SS Storstad. L'ancien
brise glace enfonce le flanc droit du navire, qui commence alors à
donner de la bande avant de disparaître sous l'eau, 14 minutes plus
tard. Le naufrage du RMS Empress of Ireland coûte la vie à 1 012 des 1
477 passagers.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada des Forges-du-Saint-Maurice
Trois-Rivières, Québec
Vestiges du premier village industriel au Canada.
Première industrie sidérurgique au Canada. Mais aussi premier village
industriel du pays. Voilà l'essence même du lieu historique national des
Forges-du-Saint-Maurice.
Sillonné d'un ruisseau et bordant la rivière Saint-Maurice, le site des
Forges marie beauté naturelle et trésors culturels. La Grande Maison
permet d'entrer dans l'univers particulier de cette communauté
industrielle originale. Le haut fourneau révèle les mystères de la
fabrication de la fonte et du fer. Les vestiges archéologiques
témoignent de cette époque où la vie de toute une communauté battait au
rythme d'une production intensive.
Le lieu historique national du Canada des Forges-du-Saint-Maurice est
situé à quinze kilomètres au nord de Trois-Rivières, Québec, sur le bord
d'un ruisseau qui se jette dans la rivière Saint-Maurice. Il s'agit d'un
élément de paysage comprenant des vestiges de la première communauté
industrielle du Canada. Le lieu a été reconstitué à des fins
d'interprétation historique par l'Agence Parcs Canada.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada des
Forges-du-Saint-Maurice réside dans les vestiges que recèle ce paysage
culturel, qui témoignent de l'activité industrielle et du mode de vie
connexe remontant aux débuts de la colonie. Les Forges du Saint-Maurice
ont été établies par le sieur François Poulin de Francheville, seigneur
de Saint-Maurice, en 1730. Les 252 vestiges que recèle ce lieu
témoignent d'une exploitation de minerai de fer et d'une occupation du
territoire s'étendant sur plus de 150 ans (1732-1883), période pendant
laquelle les forges du Saint-Maurice ont été un important fournisseur de
biens matériels nécessaires au développement et à la défense de la
colonie. Les vestiges du site des forges du Saint-Maurice sont l'exemple
à la fois le plus ancien et le plus complet de l'utilisation d'une
technologie de fonderie typique de celle qu'on retrouvait en Europe à la
fin du XVe siècle. À partir de 1973, le lieu a fait l'objet d'un
ambitieux programme de recherches et d'interprétation dirigée par
l'Agence Parcs Canada.
|


©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Fort-Chambly
Chambly, Québec
Fort en pierre construit en 1709; ouvrage restauré et stabilisé.
Le fort Chambly se dresse sur le bord de la rivière Richelieu, au pied
des rapides de Chambly. Construite en 1711, cette imposante
fortification de pierre protégeait la Nouvelle-France d'une éventuelle
invasion britannique.
Durant la guerre de 1812, l'armée anglaise établit un important complexe
militaire sur le site. Le fort a résisté aux bouleversements de
l'histoire et demeure un précieux témoin de la présence française en
Amérique du Nord.
Restauré par Parcs Canada, le fort Chambly renferme aujourd'hui des
expositions relatant les moments clés de l'histoire de la
Nouvelle-France.
Le lieu historique national du Canada du Fort-Chambly est une forteresse
de pierre de forme carrée érigée stratégiquement sur la rivière
Richelieu, à Chambly, au Québec. La structure actuelle est le quatrième
fort construit sur le même emplacement. Quatre proéminents bastions de
coin ainsi que de hautes murailles protègent les installations
d'hébergement et d'entreposage disposé autour d'une cour centrale.
Solidement construit en pierre, le fort comprend aussi des échauguettes,
des embrasures et des meurtrières. Le fort se situe dans un grand parc
riverain.
En 1665, un officier de l'armée française, le Capitaine Jacques de
Chambly, a dirigé la construction du premier fort de bois destiné à
contrôler la route d'invasion et à soutenir les troupes françaises
contre les Iroquois. Le fort de pierre actuel, construit entre 1709 et
1711 afin de protéger la Nouvelle-France contre l'envahisseur
britannique, s'inspire des fortifications européennes classiques
adaptées au contexte géographique de l'Amérique du Nord. Cédé aux
Britanniques en 1760, le fort fut temporairement occupé durant
l'invasion américaine de 1775 avant d'être repris par les Britanniques.
Ce fort a aussi joué un rôle important au cours de la Guerre de 1812 et
des rébellions de 1837-1838. Le fort fut ensuite négligé, puis laissé à
l'abandon au milieu du 19e siècle. L'intervention d'un résident de
Chambly, Joseph-Octave Dion, a été cruciale pour sauvegarder le fort
entre 1875 et 1916. Désigné lieu historique national du Canada en 1920,
le fort Chambly fut restauré par Parcs Canada en 1983 et abrite
maintenant un petit musée et un centre d'interprétation.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Fort-Charlesbourg-Royal
Cap-Rouge, Québec
Le lieu historique national du Canada Fort-Charlesbourg-Royal est situé
à Cap-Rouge, une banlieue résidentielle dans la ville de Québec. Il
comprend des vestiges mis au jour de deux forts du seizième siècle : un
fort en contre-haut situé sur un promontoire boisé au confluent de la
rivière du Cap Rouge et du fleuve Saint-Laurent, ainsi qu'un fort en
contrebas situé à environ 500 mètres au nord-ouest, sur les rives de la
rivière du Cap-Rouge. Établis en 1541 par Jacques Cartier, les forts ont
servi d'assise à la première colonie française en Amérique du Nord
jusqu'à leur abandon en 1543.
Établi en 1541, par Jacques Cartier, lors de son troisième et dernier
voyage dans le territoire français sur les rives du fleuve
Saint-Laurent, le fort Charlesbourg-Royal a été composé d'un fort en
contrebas et d'un autre en contre-haut situés près de l'embouchure de la
rivière du Cap-Rouge. Construit à une élévation de 40 mètres, le fort en
contre-haut offrait une position stratégique de défense, tandis que le
fort en contrebas, étant protégé des forts vents venant du fleuve,
servait de lieu possible de mouillage pour les navires. Les deux forts
comportaient un total de trois tours et celui en contre-haut avait été
construit en grumes équarries. Nommé d'après Charles, duc d'Orléans et
troisième fils du roi François Ier de France, Charlesbourg-Royal a servi
de lieu de résidence à Cartier et à un groupe de quelque 400 colons
durant l'hiver 1541-1542. Durant cette période d'occupation, les
relations avec les populations autochtones de la région ont été
difficiles et bon nombre de colons ont souffert du scorbut.
En juin 1542, Jean-François de la Rocque de Roberval, nommé
«Lieutenant-général au pays de Canada» l'année précédente, est arrivé au
fort. Le même mois, Cartier a décidé de retourner en France, et Roberval
a pris possession du fort, puis en change le nom à France-Roi. Les
preuves archéologiques démontrent que Roberval a modifié certains
aspects du fort afin de mieux l'adapter aux armements plus récents à sa
disposition. Roberval et son groupe de 200 colons ont passé l'hiver au
Canada, souffrant du froid, de la famine et de la maladie. Même si un
navire est dépêché en France pour demander l'aide du roi, le fort a été
abandonné à l'été 1543. Il faudra attendre plus de 60 ans avant de voir
une autre tentative de colonisation dans la région du
Saint-Laurent.
|
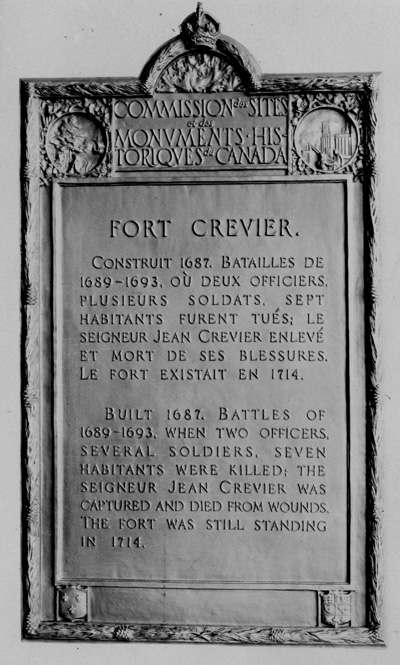
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1924 |
Lieu historique national du Canada Fort-Crevier
Pierreville, Québec
Un fort fut construit près d'ici en 1687, pour protéger les Français
contre le attaques iroquoises que les Anglais encouragaient. Bâti par
Jean Crevier eut sa seigneurie de Saint-François-du-Lac, ce fort du
bois, appelé à l'origine fort Saint-François, fut plus tard connu sous
le nom de fort Crevier. Des escarmouches rutent souvent lieu à cet
endroit entre Français et Iroquois de 1689 à 1693. Après la signature
des traites de paix avec le Anglais en 1697 et les Iroquois en 1700 et
1701, le fort ne fut plus utiliser.
|

©Google, 2010 |
Lieu historique national du Canada Fort-Laprairie
La Prairie, Québec
Le lieu historique national du Canada Fort-Laprairie est situé sur la
rive ouest du fleuve Saint-Laurent, à La Prairie, au Québec. Le site
consiste en un fort du XVIIe siècle lié au régime français duquel aucun
vestige n'est apparent. Construit en 1687, Fort Laprairie et sa
palissade, qui ceinturait une partie des bâtiments du village, a servi
d'avant-poste défensif et de refuge aux colons jusqu'en 1713. La forme
trapézoïdale du fort a influencé la création et le plan d'implantation
des parcelles de terre et des routes qui constituent aujourd'hui une
zone résidentielle.
Fort Laprairie fut conçu en 1687 par Robert de Villeneuve et construit
la même année par Gédéon de Catalogne, tous deux ingénieurs officiels
des troupes coloniales françaises. Le fort servit d'avant-poste défensif
aux troupes françaises établies à Montréal pendant la guerre de la ligue
d'Augsbourg et la guerre de Succession d'Espagne. De 1687 jusqu'aux
traités d'Utrecht en 1713, le fort fut continuellement occupé par une
garnison et la zone ceinte par la palissade servit de refuge aux colons
en de nombreuses occasions. Par exemple, en août 1691, lors de la
Première Bataille de Laprairie, les troupes françaises défendirent le
fort lors d'une attaque par des miliciens de la Nouvelle-Angleterre. Le
fort est réputé pour avoir sauvé la vie de ses occupants durant cet
affrontement. Après avoir résisté de nombreuses attaques infligées par
les troupes britanniques et les Iroquois, Fort Laprairie a été en grande
partie détruit lorsque les Américains se retirèrent après l'invasion du
Canada en 1775.
|


©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Fort-Lennox
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Québec
Exemple remarquable de fortifications datant du début du XIXe
siècle.
Ce vieux fort britannique est situé sur l'île aux Noix, au milieu de la
rivière Richelieu. Aucun pont ne mène à cette île au fabuleux destin.
Vous n'avez pas le choix, il faut garer votre véhicule. C'est en bateau
que vous vous y rendrez! Les enfants adoreront… La traversée dure cinq
minutes. Juste le temps qu'il faut pour franchir la barrière du temps et
fouler le sol d'un site exceptionnel.
Situé à quelques kilomètres de la frontière canado-américaine, ce fort a
été construit de 1819 à 1829. Il est composé d'ouvrages défensifs et de
plusieurs bâtiments de maçonnerie d'une beauté exceptionnelle.
L'ensemble avait pour but de protéger la colonie contre une éventuelle
invasion américaine par la rivière Richelieu.
Le lieu historique national du Canada du Fort-Lennox est à la fois une
fortification et un paysage militaire qui occupe la totalité de l'île
aux Noix sur la rivière Richelieu, près de la ville de
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix (Québec). Pendant une période critique,
soit de la fin du régime français jusqu'aux années 1870, les forces
françaises, américaines et britanniques ont exploité la valeur
stratégique du lieu. Les remparts de cette fortification sont entourés
de douves remplies d'eau. À l'intérieur, on trouve un ensemble de
bâtiments élégants, au plan classique, magnifiquement exécutés en
pierres.
Le fort Lennox a joué un rôle important dans l'histoire militaire du
Canada en raison de son emplacement stratégique sur la voie de
navigation Hudson-Champlain-Richelieu. La topographie de l'île, avec ses
chenaux étroits et une élévation au sud, offrait une défense naturelle
améliorée par des ouvrages militaires défensifs. Les Français ont
d'abord fortifié l'île en 1759 pour faire obstacle aux Britanniques sur
la rivière Richelieu. En 1760, l'île passe aux mains des Britanniques,
juste avant la chute de la Nouvelle-France. En 1775, les forces
révolutionnaires américaines utilisent l'île comme base d'une offensive
sur le Canada. Après leur retrait en 1776, les Britanniques commencent à
fortifier l'île pour prévenir d'autres invasions. Pendant la guerre de
1812, le fort permet de défendre la frontière avec les États-Unis et de
protéger la base de la Royal Navy à Saint-Jean. Construit de 1819 à
1828, l'actuel fort Lennox représente le troisième ensemble d'ouvrages
défensifs de l'île. Une garnison y a été affectée jusqu'à 1870. Pendant
le soulèvement des Patriotes, les raids des Fenians et la guerre de
Sécession, les forces britanniques sont basées à l'île aux Noix, mais
n'apportent aucune modification aux fortifications. Après le départ de
la garnison britannique en 1870, le lieu sert de camp de formation
estival de la milice canadienne jusqu'en 1921 et de camp pour les
réfugiés juifs européens de 1940 à 1943.
Le lieu historique renferme des ressources archéologiques et bâties
associées aux périodes suivantes d'occupation militaire : fortifications
françaises (1759 à 1760); occupation américaine (1775 à 1776); première
occupation et installations britanniques (avant 1778); premières
fortifications britanniques (1778 à 1812); réaménagement des
fortifications britanniques (1812 à 1819); établissement naval (1812 à
1834); établissement et opération du fort actuel (1819 à nos
jours).
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |
Lieu historique national du Canada Fort Longueuil
Longueuil, Québec
Le lieu historique national du Canada du Fort-Longueuil est un site
archéologique situé en milieu urbain à Longueuil, au Québec. Le fort a
été démoli en 1810, et une église a été érigée à l'endroit où il était.
Le lieu se trouve sous l'actuelle cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue,
construite en 1887, ainsi que sous la rue Saint-Charles, le chemin de
Chambly et les immeubles adjacents. La cathédrale
Saint-Antoine-de-Padoue a été construite en partie avec des pierres et
d'autres matériaux récupérés du fort et de la première église bâtie sur
place après sa démolition.
Le fort Longueuil est érigé de 1685 à 1690 en tant que résidence
fortifiée du baron Charles Le Moyne II, seul Canadien de naissance à se
voir conférer le titre de baron par un monarque français. La résidence
comprend une grande cours entourée d'une enceinte et de tours dans les
coins. Elle est conçue pour repousser les attaques des Iroquois, les
relations entre ces derniers et les Français s'étant détériorées vers la
fin du XVIIe siècle.
Le fort Longueuil est alors l'une des nombreuses résidences fortifiées,
aussi appelés châteaux-forts, appartenant aux seigneurs locaux qui
protègent les établissements français dans la région de Montréal vers la
fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe. Bien que le fort Longueuil
soit alors le seul château fort de pierre construit sur la partie
continentale, il est conçu pour complémenter les ouvrages défensifs
situés sur l'île de Montréal. Le fort Longueuil est également le plus
vieux château-fort de pierre sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent
dans la région de Montréal.
On croit que le fort fut par la suite occupé par les troupes américaines
en 1775, puis par les troupes britanniques. Il fut démoli en 1810 en
raison de son état délabré. Les pierres du fort sont alors réutilisées
pour construire une église au même endroit de 1811 à 1814. Cette église
est démolie en 1884 et, les matériaux de construction étant de nouveau
récupérés dans la mesure du possible, l'actuelle cathédrale
Saint-Antoine-de-Padoue est achevée en 1887.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Catherine Cournoyer, 2009 |
Lieu historique national du Canada Fort-Richelieu
Sorel-Tracy, Québec
Le lieu historique national du Canada du Fort-Richelieu se trouve à
l'intérieur des limites de la ville de Sorel-Tracy, à 91 kilomètres au
nord-est de la ville de Montréal (Québec). Situé sur la rive est de la
rivière Richelieu, près de l'endroit où celle-ci rejoint le fleuve
Saint-Laurent, le lieu marque l'emplacement de deux forts dont il ne
subsiste aucun vestige. Le premier, soit le fort Richelieu, a été
construit par les Français, en 1642, en tant que symbole de puissance
leur permettant d'occuper une position stratégique face aux Iroquois
contre qui ils étaient de nouveau en guerre. Le deuxième, soit le fort
Sorel, a été construit au même endroit en 1665 par le capitaine Pierre
de Saurel. Une plaque de la Commission des lieux et monuments
historiques du Canada a été installée en 1980 pour marquer l'endroit.
Érigé en 1642 à l'embouchure de la rivière Richelieu par le gouverneur
de la Nouvelle-France, Mgr de Montmagny, le fort Richelieu est l'un des
premiers forts qui ont été construits en Nouvelle-France. Le fort est
établi dans un endroit stratégique depuis lequel les Français peuvent
contrer les attaques des maraudeurs iroquois qui utilisent la rivière
Richelieu pour exercer une forte pression militaire sur la
Nouvelle-France. Il vise à bloquer cette voie d'accès. Depuis sa
construction en 1642 jusqu'à son abandon quatre ans plus tard, le fort
Richelieu sert aussi de base aux missionnaires qui œuvrent auprès de la
population locale. Le fort est abandonné en 1646, et les Iroquois y
mettent le feu au cours de l'hiver 1647. En 1665, un deuxième fort, qui
sera plus tard nommé fort Sorel, est construit au même endroit par le
capitaine Pierre de Saurel.
|

©Library and Archives Canada / Bibliothèque et Archives Canada, C-001507, 1779 |
Lieu historique national du Canada Fort-Saint-Jean
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec
Le lieu historique national du Canada Fort-Saint-Jean est situé au bord
de la rivière Richelieu, à environ 40 kilomètres au sud-est de Montréal,
à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Construit au XVIIIe siècle, les
vestiges des remparts du fort subsistent encore, y compris des
fondations en maçonnerie, les empreintes des pieux, ainsi que les fosses
de palissade. De plus, les vestiges du fort de 1776 sont bien visibles
aujourd'hui sur le terrain, particulièrement les deux bastions. Les
limites du lieu correspondent aux contours au sol des forts construits
en 1748 et en 1775-1776.
Entre 1665 et 1666, les Français érigent un ensemble de cinq forts le
long de la rivière Richelieu, afin de contrer les attaques des Iroquois.
Construit en 1666 et abandonné en 1672, l'emplacement du premier fort
Saint-Jean est encore à ce jour inconnu. Ce fort intéresse à nouveau les
Français suite à la fin de la Guerre de Succession d'Autriche en 1748.
Au cours de cette même année, la construction d'un nouveau fort à
Saint-Jean est entreprise par l'ingénieur Gaspard-Joseph Chaussegros de
Léry fils. Le fort est constitué d'une palissade en pieux d'une hauteur
moyenne de 3,5 à 4 mètres (12 à 13 pieds), flanquée d'un bastion à
chaque angle où se trouvent quelques embrasures à canons. À l'exception
des fondations qui sont en maçonnerie, toutes les composantes du fort
sont alors en bois.
En 1760, les Français abandonnent le fort en le brûlant, mais la
banlieue du fort reste prisée en raison de son emplacement stratégique
sur la route vers Montréal. Lors de la Révolution américaine en été
1775, le fort est reconstruit à nouveau pour faire face aux tirs de
canons de l'invasion américaine. Conçu d'après le modèle de Sébastien Le
Prestre, marquis de Vauban, le fort soutint un siège de 45 jours dirigé
par le général américain Richard Montgomery. À la suite du soulèvement
de 1837, de nouvelles fortifications furent établies sur l'emplacement
du fort. Ces bâtiments constituent le cœur du Collège militaire royal de
Saint-Jean depuis 1952.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1969 |
Lieu historique national du Canada Fort-St-Louis
Kahnawake, Québec
Le lieu historique national du Canada du Fort-St-Louis est situé sur le
chemin River Front à Kahnawake, au Québec, à l'intérieur de la réserve
Mohawk de Kahnawake. Le lieu est délimité par trois sections de mur
exposées des fortifications d'origine datant du début du XVIIIe siècle
qui sont d'environ trois mètres de haut et agrémentés de deux bastions
orientés nord-ouest et sud-ouest. Le mur d'origine est des
fortifications n'est désormais plus visible. Les lieux historiques
nationaux du Canada de la Mission-de-Caughnawaga / Mission-Saint
François-Xavier et du Presbytère-de-la-Mission-de-Caughnawaga sont
situés dans la section nord-est du fort.
Des missionnaires jésuites fondent la Mission de Caughnawaga dans la
colonie française de La Prairie pour les Iroquois chrétiens en 1667.
Cependant, la mission est déplacée plusieurs fois avant de se fixer à
Kahnawake, et ce, pour des raisons économiques : les méthodes agricoles
des Iroquois entraînant l'appauvrissement des sols, ceux-ci doivent
déplacer leur village tous les 10 à 15 ans.
La présence d'un village iroquois rend encore plus importante la
construction de fortifications à Kahnawake. Bien qu'on ait proposé la
construction d'un fort à cet endroit depuis 1720, ce n'est qu'en 1725
qu'une palissade de bois est érigée pour servir à la défense du village
et de la mission. En 1747, une guerre semblant imminente, la palissade
de bois est partiellement remplacée par une fortification en
pierre.
|
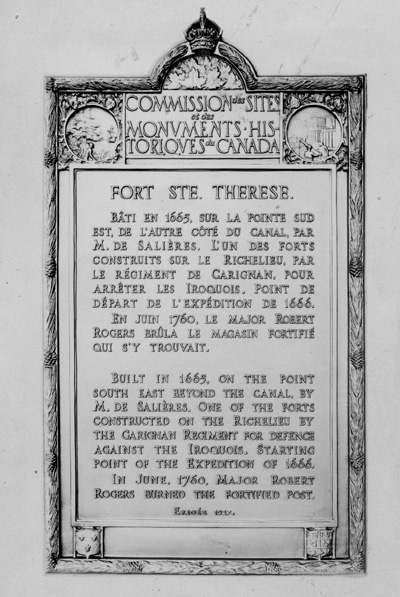
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Fort Ste-Thérèse
Chambly, Québec
Emplacement d'un fort français construit pour défendre la population
contre les Iroquois, 1665.
Bâti en 1665, sur la pointe sud-est, de l'autre côté du canal, par M. de
Salières. L'un des forts construit sur le Richelieu, par le régiment de
Carignan, pour arreter les Iroquois. Point de départ de l'expédition de
1666. En juin 1760, le major Robert Rogers brule le magasin fortifié qui
s'y trouvait.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2009 |
Lieu historique national du Canada Fort-Trois-Rivières
Trois-Rivières, Québec
Le lieu historique national du Canada du Fort-Trois-Rivières est situé
sur la rue des Casernes à Trois-Rivières, dans le sud du Québec, près
des trois embouchures de la rivière Saint-Maurice. Il ne subsiste aucun
vestige de ce fort construit en 1634 sous le Régime français, à un
endroit qui surplombe le fleuve Saint-Laurent. Ce fort en bois était un
point central de la traite des fourrures avec les Premières Nations de
la région et s'est transformé au fil des ans pour devenir
Trois-Rivières. Le lieu est désormais un grand espace public gazonné et
boisé marqué d'un cairn de la Commission des lieux et monuments
historiques du Canada (CLMHC) et encadré par une route, un stationnement
et un ancien bureau de poste.
Le fort Trois-Rivières, construit durant le Régime français, sur la rive
nord du fleuve Saint-Laurent, à Trois-Rivières, au Québec, est établi en
1634 par le Sieur de Laviolette au nom de Samuel de Champlain. Le lieu
est choisi pour l'avantage stratégique qu'il offre sur les plans
militaire et économique. Le fort est situé plus à l'est que les forts
construits précédemment, en plus de surplomber le fleuve, ce qui lui
offre une protection naturelle ainsi que la possibilité de contrôler la
voie maritime. À l'origine, le fort est constitué de deux bâtiments
entourés d'une palissade. Le premier fort est détruit par un incendie en
décembre 1635, puis reconstruit. Le nouveau bâtiment est plus grand que
le précédent et muni d'un pont-levis qui en améliore l'accès. En 1653,
le gouverneur Lauzon déclare que le fort est en ruines et il le fait
complètement raser. Le lieu abrite aussi une mission jésuite et certains
des premiers bâtiments de la ville de Trois-Rivières.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, R. Lavoie, 1999

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, P. St. Jacques, 1984

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J.P. Jérôme, 1995 |
Lieu historique national du Canada des Fortifications-de-Québec
Québec, Québec
Réseau de murs, de portes et de places qui s'étendait sur 4,6
km.
Le lieu historique national des Fortifications-de-Québec commémore le
système défensif mis en place entre 1608 et 1871 à Québec, principale
place forte du Canada à l'époque coloniale.
Le lieu historique national du Canada des Fortifications-de-Québec se
compose de plusieurs lieux associés aux systèmes de défense historiques
de la ville de Québec. Ces composantes sont situées dans la Haute-Ville
et la Basse-Ville de Québec, le long de la rive nord du fleuve Saint
Laurent jusqu'à la rivière Montmorency, à Beauport, et sur la rive sud,
à Lévis. Le lieu comprend les fortifications à proprement parler ainsi
que certaines composantes telles que des portes, des postes de garde,
des poudrières, des entrepôts, des casernes et des espaces militaires,
tous aménagés entre 1608 et 1871 en tant qu'éléments du système de
défense de la ville. La désignation fait référence à toutes les
ressources physiques, bâties, archéologiques et de paysage associées à
l'intérieur des périmètres définis et qui sont liées au système de
défense, notamment la redoute du moulin et le parc du Mont-Carmel, la
poudrière de l'Esplanade et la poudrière située sur la propriété de
l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, les casernes de l'Artillerie, les sections du
site patrimonial du Parc-de-l'Artillerie déclarées excédentaires par les
Arsenaux du dominion, les quartiers du capitaine dans le site
patrimonial du Parc-de-l'Artillerie, le dépôt du service du matériel
dans le bastion Saint-Jean, les casernes Dauphine, ainsi que les lieux
historiques nationaux du Canada (LHNC) des Tours-Martello-de-Québec, du
Cercle-de-la-Garnison-de-Québec, de la Citadelle-de-Québec et des
Forts-de-Lévis.
Situées sur un plateau qui surplombe la confluence du fleuve
Saint-Laurent et de la rivière Saint Charles, les fortifications de
Québec voient le jour en même temps que la ville, fondée en 1608 par
Samuel de Champlain. Les fortifications d'origine sont composées
d'ouvrages improvisés, construits pour répondre aux besoins les plus
pressants de la colonie. Ressemblant à un château médiéval, le premier
fort de Champlain (l'Habitation) comprend une résidence, un magasin de
produits et de fournitures, ainsi qu'une redoute aux murs élevés. Au
cours du XVIIe siècle, la première Habitation est remplacée par une
succession d'ouvrages militaires rudimentaires, notamment le fort
Saint-Louis et la deuxième Habitation de Champlain. En 1690, la chute de
Port Royal en Acadie pousse les Français à munir la ville de
fortifications appropriées en y construisant la première enceinte,
formée de 11 redoutes reliées par des palissades. Même si les falaises
abruptes de la Haute-Ville font office de remparts naturels sur deux des
trois côtés, la limite ouest, qui s'ouvre sur les Plaines d'Abraham, est
vulnérable et constitue la priorité du programme des fortifications de
Québec. L'enceinte initiale subit de nombreux ajouts et modifications
jusqu'en 1745, date à laquelle un nouvelle enceinte de pierre est
constuite pour fermer la limite ouest de façon permanente puisque la
prise de Louisbourg par les Britanniques a semé un vent de panique chez
les habitants de Québec.
Peu après la conquête du Canada en 1759, les vainqueurs britanniques
doivent revoir leurs besoins en matière de défense. Même s'ils craignent
une reprise de la ville par les Français et un soulèvement de la
population francophone, les Britanniques sont incapables d'amasser tout
de suite les fonds nécessaires au renforcement des ouvrages défensifs de
la ville. La Révolution américaine les incite enfin à construire de
nouvelles fortifications. Les Britanniques entreprennent un plan visant
à solidifier et à étendre l'enceinte de 1745 à tout le périmètre de la
ville, à construire des ouvrages à l'extérieur de cette enceinte pour
gêner l'approche de l'ennemi ainsi que des ouvrages de défense sur les
hauteurs des Plaines d'Abraham, et enfin, à ériger une citadelle de
maçonnerie sur le Cap Diamant. Cette dernière étape du plan se termine
entre 1819 et 1832. Puisqu'on incorpore à la citadelle les éléments déjà
existants du système de défense du XVIIIe siècle, on ne doit construire
que les murs faisant face à la ville, ce qui laisse croire que l'ouvrage
avait au départ été construit, en partie, pour servir de refuge aux
Britanniques en cas de révolte des Francophones. L'achèvement de la
citadelle marque l'apogée du rôle de forteresse de Québec.
En 1865, la construction de forts indépendants sur la rive sud, à Lévis,
est suivie par le départ de la garnison britannique, en 1871. Même si
plusieurs structures des fortifications ont été endommagées ou démolies
depuis, les principaux ouvrages de défense de la ville ont été
préservés, grâce à l'intervention, à la fin du XIXe siècle, de Lord
Dufferin, Gouverneur général du Canada de 1872 à 1878. La ville de
Québec est, à ce jour, la seule ville fortifiée en Amérique du
Nord.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada des Forts-et-Châteaux-Saint-Louis
Québec, Québec
Partie intégrante du système de défense de Québec; siège de l'autorité
coloniale pour plus de 200 ans.
Le lieu historique national du Canada des Forts-et-Châteaux-Saint-Louis
est situé sur un escarpement qui domine le basse-ville du Vieux-Québec.
Le site comprend des vestiges archéologiques datant d'importantes
campagnes de construction menées entre 1620 et 1838, incluent ceux des
quatre forts Saint-Louis, des deux châteaux Saint-Louis et du château
Haldimand, de même que des bâtiments secondaires, des éléments de
paysage et des services, comme des cours, des systèmes de drainage et
des ouvrages militaires. Le site archéologique, compris dans le secteur
délimité par le jardin des Gouverneurs actuels, la batterie de Wolfe,
l'hôtel Château Frontenac actuel et la terrasse Dufferin associée, fait
également partie du lieu historique national du Canada des
Fortifications-de-Québec.
Les Forts et Châteaux Saint-Louis occupe une partie du secteur le plus
important à l'époque où Québec était une colonie. Il constitue un site
archéologique comprenant des vestiges des bâtiments et des structures
érigés sur le lieu entre 1620 et 1838, dont les forts Saint-Louis (1620,
1626, 1636, 1692), les châteaux Saint-Louis (1648, 1694) et le château
Haldimand (1784). La valeur patrimoniale du lieu tient principalement à
ses associations historiques, comme le démontrent sa situation
stratégique et les diverses couches de vestiges archéologiques qu'il
recèle. Chacune des couches témoignant d'une période d'utilisation
distincte, incluant les régimes français et anglais. Les tracés, les
formes, les matériaux, la technologie et les relations spatiales et
fonctionnelles qu'entretiennent entre eux les vestiges constituent une
preuve essentielle de l'activité historique dont le lieu a fait
l'objet.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, P. St. Jacques, 1984

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J.P.Jérôme, 1985 |
Lieu historique national du Canada des Forts-de-Lévis
Lévis, Québec
Ouvrage faisant partie des fortifications de Québec.
Érigés sur la Rive-Sud du Saint-Laurent par les Britanniques entre 1865
et 1872, les forts de Lévis devaient protéger Québec contre une invasion
américaine à la suite de la guerre de Sécession.
Dernier d'une série de trois forts détachés et magnifiquement restauré
par Parcs Canada, le fort Numéro-Un témoigne d'innovations
technologiques remarquables pour l'époque.
Le lieu historique national du Canada des Forts-de-Lévis est composé des
vestiges en surface et enfouis de trois ouvrages défensifs en pierre
datant du XIXe siècle situés sur une éminence de la rive sud du fleuve
Saint-Laurent à Lévis, au Québec. Les trois forts ont été construits
selon un agencement linéaire à environ 1 800 mètres d'intervalle. Le
lieu comprend les fortifications subsistantes du fort no 1, les vestiges
archéologiques des forts no 2 et no 3 ainsi que les vestiges des chemins
qui reliaient les forts et des camps utilisés par les équipes de
construction.
La décision de construire trois forts à Lévis pour compléter le réseau
d'ouvrages défensifs de Québec a été prise lors de la guerre de
Sécession par les Britanniques, qui craignaient une invasion par les
soldats de l'Union. William Drummond Jervois s'est rendu à Québec pour
déterminer les améliorations à apporter aux fortifications défensives de
Lévis afin de protéger les soldats qui y sont postés. La construction
des trois forts a commencé en 1865 sous la direction des Royal
Engineers, et le fort no 1 fut achevé en 1872. En plus des forts, les
travaux prévoyaient l'installation d'un camp de construction composé
d'une vingtaine de bâtiments, d'un bassin et d'un réseau de
communication le long du fleuve Saint-Laurent. Des méthodes novatrices
furent mises à l'épreuve dans la conception, l'arpentage et la
construction des forts de Lévis. En effet, de l'équipement actionné à la
vapeur a été utilisé pour construire des éléments en béton revêtus de
pierre, et les murs du fossé du fort no 1 furent construits à l'aide de
deux nouveaux types de béton coulé dans des moules de pierre. Toutefois,
aucune garnison n'a occupé les forts, car la signature du traité de
Washington en 1871 a mis fin à la menace d'affrontements entre les
Britanniques et les Américains.
|

©Library and Archives Canada, PA129603, from the National Film Board, Phototèque Collection / Bibliothèque et Archives Canada, PA129603, Office national du film du Canada, Collection Phototèque, 1947

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Dana Johnson, 1997 |
Lieu historique national du Canada Forum-de-Montréal
Montréal, Québec
Le Forum de Montréal est un vaste lieu de rassemblement intérieur voué
au hockey sur glace professionnel. Il est situé au coin des rues
Sainte-Catherine et Atwater à Montréal.
Le Forum de Montréal a été désigné lieu historique national du Canada en
1997 parce qu'il était sans contredit le site sportif le plus connu du
pays. En raison de son association étroite avec l'une des concessions
les plus rentables en Amérique du Nord, celle des Canadiens de Montréal,
il est également un endroit culturel populaire au Canada illustrant le
rôle du hockey. En outre, le Forum est le plus ancien des grands arénas
du pays et, tout au long de son histoire, il a été un lieu marquant où
se sont déroulés d'importants événements culturels, politiques et
religieux.
La valeur patrimoniale du lieu réside dans son association avec le
hockey sur glace professionnel et, particulièrement, avec son rôle
d'ancien port d'attache des Canadiens de Montréal. Construit en 1924
pour accueillir les parties de hockey professionnel, le Forum de
Montréal a été pendant 71 ans le port d'attache des Canadiens de
Montréal, l'une des plus anciennes équipes professionnelles du Canada et
la plus vieille concession encore en exploitation du pays. Fondée en
1909, l'équipe des Canadiens a établi des records inégalés dans
l'ensemble du sport professionnel en Amérique du Nord, ayant à son
crédit le plus grand nombre de participations aux séries éliminatoires
et aux séries finales de la Coupe Stanley. En raison de son association
étroite avec les Canadiens, le Forum est considéré comme le « temple
sacré » du hockey sur glace.
Le Forum est un des premiers et rares exemples de lieu de présentation
intérieur d'événements nationaux et internationaux, et a accueilli un
large éventail d'événements sociaux, politiques et religieux dont des
concerts pop et rock, des concerts classiques et des opéras; des
spectacles non musicaux de tous genres; des événements sportifs autres
que le hockey, notamment la boxe, la lutte, le tennis et la compétition
de gymnastique des Jeux olympiques de 1976; des rassemblements
politiques et religieux, des congrès, des rencontres et des cérémonies.
Le bâtiment a été reconstruit dans sa presque totalité en 1968. Il a été
officiellement fermé et converti à d'autres usages en 1996.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Gare-du-Canadien-Pacifique-à-Berthier
Sainte-Geneviève-de-Berthier, Québec
La gare du Canadien Pacifique à Berthier se trouve à plusieurs
kilomètres à l'extérieur de la ville de Sainte-Geneviève-de-Berthier,
sur la ligne de chemin de fer du Canadien Pacifique. Il s'agit d'un
charmant bâtiment d'un étage et demi en bois construit à la fin du XIXe
siècle.
La gare du Canadien Pacifique à Berthier a été désignée lieu historique
national en 1976 parce qu'elle témoigne de l'expansion du Canadien
Pacifique.
Érigée en 1877, cette gare fait partie d'une série de petites gares
locales construites par le Quebec, Montreal, Ottawa and Occidental
(OMO&O) Railroad sur sa ligne de chemin de fer dans la vallée du
Saint-Laurent entre Montréal et Québec. Le Canadien Pacifique se porte
acquéreur de cette ligne en 1885 afin d'améliorer son service vers
l'Atlantique; la gare conserve sa vocation première pendant plus d'un
siècle. Le bâtiment n'a pas été désigné gare ferroviaire patrimoniale
parce qu'il n'est pas conforme aux critères de désignation. La valeur
patrimoniale de la gare du Canadien Pacifique de Berthier tient à sa
vocation, à son emplacement ainsi qu'à son plan et à sa composition
standard.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2002 |
Lieu historique national du Canada de la Gare-du-Grand-Tronc-à-Acton Vale
Acton Vale, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Gare-du-Grand-Tronc-à-Acton
Vale est un petit terminal pour passagers situé dans la municipalité
d'Acton Vale, au Québec. Ce bâtiment de bois pittoresque comprend une
variété de formes et de détails structurels, comme une tourelle, des
fenêtres à carreaux, des lucarnes et un toit à pignon à forte pente. De
grandes consoles soutiennent les corniches en surplomb du toit en forme
de cloche.
La gare du Grand Tronc à Acton Vale exprime le développement du chemin
de fer de la Compagnie du Grand Tronc au Québec. La conception de ce
bâtiment est inspirée des plans normalisés utilisés par la Compagnie du
Grand Tronc pour la construction de plusieurs gares entre 1895 et 1905
sur la ligne reliant Montréal à Portland, dans le Maine. Fondée en 1853,
la Compagnie du Grand Tronc fut englobée par la Compagnie des chemins de
fer nationaux du Canada après sa création en 1919. La valeur
patrimoniale de ce lieu historique réside dans les éléments encore
existants de sa conception, de ses matériaux et de sa décoration
d'origine. Le bâtiment abrite maintenant l'office du tourisme de la
municipalité ainsi qu'un centre d'exposition.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1992 |
Lieu historique national du Canada de la Gare du Grand Tronc à Saint-Jean-d'Iberville
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Gare du Grand Tronc à
Saint-Jean-d'Iberville est une ancienne gare de voyageurs située dans la
ville de Saint-Jean-d'Iberville (Québec). Il s'agit d'un édifice en
brique rectangulaire de plain-pied, d'apparence solide, construit en
1890, qui comporte des éléments de style Château. Les avant-toits en
surplomb forment une marquise saillante qui court le long de l'édifice
côté quai et sur les élévations côté rue.
Si la gare du Grand Tronc à Saint-Jean-d'Iberville a été désignée lieu
historique national du Canada en 1976, c'est parce qu'elle illustre
l'expansion du chemin de fer du Grand Tronc (Grand Trunk Railway).
La gare du Grand Tronc à Saint-Jean-d'Iberville symbolise la présence de
la Grand Trunk Railway au Québec avant sa fusion, en 1923, avec la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. La société a été
constituée en 1853 afin de servir toute la province du Canada jusqu'à la
côte est. Elle a été créée en associant de nouvelles lignes à des lignes
existantes, pour finalement s'étendre de Sarnia (Ontario) à Portland
(Maine). Cette construction de plain-pied est typique des petites gares
de l'époque, avec la salle d'attente, le bureau du chef de gare et la
consigne sous le même toit. Sont à noter des éléments tels que les
larges consoles qui soutiennent la marquise saillante et les portes et
les fenêtres élégantes avec leurs proportions allongées. La valeur
patrimoniale de ce lieu tient à ses associations historiques
qu'illustrent sa conception, ses matériaux et sa décoration d'origine.
Il sert, à présent, d'office de tourisme à la ville.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1990 |
Lieu historique national du Canada de la Gare-de-l'Intercolonial-à-Lévis
Lévis, Québec
Le lieu historique national du Canada de la
Gare-de-l'Intercolonial-à-Lévis est une gare en pierre à deux étages
située du côté est (ville) de l'ancienne voie ferrée du CN qui, à
travers son histoire, a longé la rive droite du fleuve Saint-Laurent à
Lévis. La gare est située au pied de la côte du Passage, près de
l'intersection avec la rue Saint-Laurent.
La Gare de l'Intercolonial à Lévis a été commémorée en 1976 à titre de
terminus effectif de l'Intercolonial depuis Halifax.
La valeur patrimoniale de ce lieu réside dans son association avec le
chemin de fer Intercolonial (CFI) historique et dans la survie de
l'édifice depuis l'époque où il servait de terminus du CFI, au XIXe
siècle.
Le chemin de fer Intercolonial, construit à l'origine entre Halifax et
Rivière-du-Loup (1867), a étendu sa ligne principale jusqu'à Lévis en
1879 par l'achat du segment Charny/Rivière-du-Loup construit par le
chemin de fer du Grand Tronc entre 1854 et 1860. En 1884, le chemin de
fer Intercolonial a largement remodelé l'édifice abritant l'hôtel de
ville et le marché de Lauzon à Lévis pour en faire une gare. Dans les
années qui ont suivi, le chemin de fer du Grand Tronc et la Compagnie du
chemin de fer du Québec central ont également utilisé les installations
terminales de l'édifice. Le chemin de fer du Grand Tronc et
l'Intercolonial ont tous deux été fusionnés avec les Chemins de fer
nationaux du Canada (CNC) après 1919, et l'édifice est alors devenu une
gare des CNC. La gare a été rénovée et modernisée en 1986 pour desservir
les passagers de VIA Rail, mais elle a été fermée en 1993 lorsque le
service de cette ligne de chemin de fer a pris fin.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, CIHB/IBHC, 1990 |
Lieu historique national du Canada de la Gare-Windsor-du-Canadien-Pacifique
Montréal, Québec
La gare Windsor, un bâtiment en pierre construit à la fin du XIXe siècle
dans le style néoroman, est une gare terminus et le siège social du
Canadien Pacifique (CP). Elle est située bien en évidence à l'angle de
la place du Canada, à Montréal.
La gare Windsor a été désignée lieu historique national en 1975, parce
qu'elle est un excellent exemple de l'architecture de style néoroman.
Construite pour le CP en 1888-1889 selon les plans de l'architecte
étasunien Bruce Price, la gare est l'un des premiers bâtiments
importants érigés dans le courant 'Richardsonian' du style néoroman au
Canada. La partie originale conçue par Price a donné le ton à la
structure et aux principaux agrandissements de 1900-1906 (selon les
plans d'Edward Maxwell) et de 1909-1914 (selon les plans de W.S.
Painter). Les agrandissements sont compatibles avec le dessin original,
renforcent le caractère néoroman et font le lien entre le style néoroman
et le style Château caractéristique des bâtiments ultérieurs du
CP.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais
Grosse-Île, Québec
Station de quarantaine pour tous les nouveaux immigrants de
1832-1937.
Située au milieu du fleuve Saint-Laurent, la Grosse Île sert de station
de quarantaine de 1832 à 1937 pour le port de Québec. Il s'agit, à
l'époque, de la principale porte d'entrée des immigrants au
Canada.
Le lieu historique national de la
Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais est situé sur la Grosse-Île dans
le fleuve Saint-Laurent. Ce lieu était un station de quarantaine au XIXe
siècle et au début du XXe siècle. Aujourd'hui, il comprend des
bâtiments, des ressources archéologiques et ethnologiques, des ouvrages
de génie, des cimetières et autres paysages culturels, ainsi que des
monuments (un votif; deux commémoratifs). Cette désignation comprend
toutes les ressources historiques contributives situées sur l'île.
La valeur patrimoniale du lieu réside dans son paysage culturel et les
composantes qui illustrent le processus de mise en quarantaine pour les
immigrants arrivant au Canada par le port de Québec entre 1832 et 1937,
notamment pour l'immigration irlandaise particulièrement importante
durant la première moitié du XIXe siècle.
Parmi les résidents du lieu, le docteur Frederick Montizambert,
surintendant de l'île de 1869-1899. Sa foi dans la médecine préventive
moderne (microbiologie, épidémiologie, désinfection et vaccination) l'a
amené à concevoir une nouvelle génération de postes de quarantaine, afin
de protéger la population canadienne des épidémies.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Hangar-d'Alerte
La Baie, Québec
Le lieu historique national du Canada du Hangar-d'Alerte est situé à
l'extrémité est de la Base des Forces canadiennes (CFB) Bagotville, au
Québec. Il s'agit d'un ensemble de quatre larges hangars en acier,
regroupés deux par deux, et disposés de part et d'autre d'un bâtiment
rectangulaire plus modeste, le centre domestique, situé dans la zone
dite «d'alerte», à l'extrémité de la piste d'atterrissage. Chaque hangar
est coiffé d'un toit à deux versants en acier et comporte deux larges
portes à trois panneaux qui se déplace verticalement à l'avant et à
l'arrière. Les hangars sont reliés au centre domestique par deux longs
passages couverts.
Durant la guerre froide, le hangar d'alerte de Bagotville faisait partie
d'un réseau de cinq bases de chasseurs en tout temps destiné à contrer
les attaques surprises des bombardiers soviétiques. L'aménagement du
bâtiment témoigne du mode de vie auquel devaient s'astreindre ses
occupants pendant la guerre froide, alors que des pilotes et des membres
du personnel opérationnel et du personnel au sol y étaient parfois
confinés jusqu'à une semaine. À chaque extrémité, des portes
coulissantes permettaient aux pilotes de faire décoller leurs appareils
rapidement, en cas d'alerte. La salle à manger et les dortoirs situés à
l'intérieur du centre domestique, se trouvaient à quelques mètres à
peine des chasseurs armés et prêts à décoller. Comme leurs homologues de
la Deuxième Guerre mondiale, les pilotes de Bagotville devaient être
prêts à sauter dans leur cockpit à tout moment. Les pilotes de la guerre
froide vivront cet état d'alerte permanent pendant plus de trente ans
dans des structures reflétant la permanence anticipée de nouvelles
guerres. Le hangar d'alerte, construit selon le premier modèle conçu par
l'Aviation royale du Canada (ARC) durant les années 1950, est parmi les
derniers exemples de ce type de construction au Canada à subsister.
D'apparence austère, il se démarque par ses dimensions imposantes ainsi
que par son architecture très fonctionnelle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, ca. 2005 |
Lieu historique national du Canada Hochelaga
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada Hochelaga est un paysage culturel
évoquant un ancien village iroquoien qui consiste en un espace gazonné
d'une superficie d'environ 79 mètres carrés. Le lieu est situé à gauche
de l'entrée principale de l'Université McGill, sur la rue Sherbrooke à
Montréal.
Le lieu historique national du Canada Hochelaga rappelle l'ancien
village iroquoien d'Hochelaga. Des documents écrits tels que le carnet
de voyage de Jacques Cartier, écrit lors de son second voyage dans la
région du fleuve Saint-Laurent, en 1535, témoignent de l'existence du
village dans les environs. Il s'agit aujourd'hui d'un lieu disparu dont
l'emplacement exact est inconnu.
La valeur historique du lieu historique national du Canada Hochelaga
repose sur son association avec le village iroquoien d'Hochelaga. Selon
les notes de Cartier datant d'octobre 1535, le village entouré d'une
palissade abritait environ 1500 Iroquoiens dans une cinquantaine de
longues maisons d'environ huit mètres de hauteur et aux longueurs
variables, logeant des familles réunies sous la lignée matriarcale. Vers
1600, des Français de retour en Nouvelle-France remarqueront la
disparition du village Hochelaga. Cette absence coïncide avec le moment
où l'ensemble des Iroquoiens quittèrent la vallée du Saint-Laurent après
la formation d'alliances commerciales, desquelles ils étaient exclus,
entre les Français et les Montagnais, les Algonquins et les Hurons. Afin
de consolider les alliances concernant la traite de la fourrure, les
Français se montrèrent hostiles envers les Iroquoiens, causant ainsi
leur départ.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2004 |
Lieu historique national du Canada de l'Hôpital-des-Sœurs-Grises
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada de l'Hôpital-des-Sœurs-Grises est
situé dans le Vieux-Montréal. Construit en 1765, ce bâtiment de trois
étages et demi est un exemple d'architecture canadienne-française
ancienne et un des bâtiments encore existants du complexe hospitalier
des Sœurs Grises. Bâtiment attrayant construit en solide maçonnerie, il
est d'apparence austère et arbore un toit à pignon, de hautes fenêtres
encastrées, un sous-sol complet, des ajouts latéraux et une aile
centrale à l'arrière. L'intérieur est vide et il reste peu de finition.
À l'arrière, on retrouve les vestiges du mur de l'ancienne chapelle.
Le bâtiment principal a été construit en 1765 sur l'emplacement
précédent de l'hôpital des Frères hospitaliers. En 1747, l'hôpital
actuel a été cédé aux soins de Sainte-Marie-Marguerite d'Youville et de
l'Ordre des Sœurs Grises de façon à poursuivre les soins prodigués aux
malades. Endommagé par le feu en 1765, le bâtiment a été reconstruit et
deux ailes y ont été ajoutées au 19e siècle pour répondre au besoin
d'espace additionnel. En 1871, les Sœurs Grises se sont relocalisées
dans une nouvelle résidence et en 1900, la section nord du complexe
ainsi que la moitié de la chapelle ont été démolies afin de rallonger la
rue Saint-Pierre. De 1900 à 1973, l'édifice vacant fut utilisé de façon
intermittente comme entrepôt.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Michel Pelletier, 2004 |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-Dieu-de-Québec
Québec, Québec
Le lieu historique national du Canada de l'Hôtel-Dieu-de-Québec est un
vaste complexe religieux et hospitalier situé au cœur du Vieux-Québec,
au Québec. Fondé en 1637, il est maintenant un des plus importants
hôpitaux de la ville. Le site comprend des structures inter-reliées dont
la construction remonte de 1695 à 2001. Les voûtes du sous-sol qui
soutiennent les ailes hautes de trois étages ont été construites en
1695. Des murs de pierre entourent le cimetière, le monastère, le jardin
et le cloître adjacent des Augustines. Inaugurée en 1803, la chapelle de
l'hôpital a vu son intérieur et sa façade remodelés au cours des années
subséquentes par Thomas Baillairgé.
L'Hôtel-Dieu de Québec a été fondé par la duchesse d'Aiguillon le 16
août 1637. Les Augustines, la communauté religieuse de l'Hôtel-Dieu de
Québec, sont arrivées dans la Ville de Québec en 1639 afin de fonder un
hôpital destiné à apporter un réconfort physique et spirituel aux
personnes dans le besoin. En 1644, elles ont emménagé sur les lieux
actuels de l'Hôtel-Dieu de Québec , qui est rapidement devenu le
principal hôpital civil et militaire de la Nouvelle-France. Le complexe
a graduellement évolué en incorporant de nouveaux ajouts et en 1855, fut
désigné hôpital universitaire. En 1995, l'Hôtel-Dieu de Québec a
fusionné avec deux autres hôpitaux pour devenir le Centre hospitalier
universitaire de Québec. Les sœurs Augustines hospitalières occupent
encore le monastère de l'Hôtel-Dieu.
|
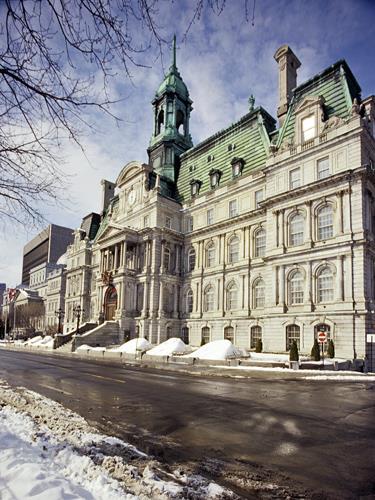
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, P St. Jacques, 1994 |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Montréal
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Montréal
est un majestueux édifice de cinq étages de style Second Empire
construit entre 1872 et 1878. À son extérieur grandiose correspond un
intérieur tout aussi impressionnant où plus de la moitié de l'espace
d'origine était voué à des fonctions cérémonielles. Après un incendie
dévastateur, en 1922, l'intérieur a été en grande partie reconstruit, un
cinquième étage a été ajouté et la tour centrale a été redessinée. En
1932, un ajout a été construit à l'arrière de l'édifice. Il occupe un
site bien en vue, en hauteur, du côté nord de la place Jacques-Cartier.
Premier grand hôtel de ville du Canada voué uniquement à des fins
administratives, l'hôtel de ville de Montréal témoignait de
l'augmentation de la population à la fin du XIXe siècle et de la
complexité croissante de l'administration municipale. Sa situation,
place Jacques-Cartier, au coeur d'un district des finances en pleine
expansion, témoigne de l'évolution de l'économie de la ville et de la
perte d'importance du secteur portuaire, où le premier hôtel de ville
avait été construit.
L'échelle monumentale de l'édifice et le choix du style Second Empire
permettaient à la ville de manifester son importance au sein des
circuits commerciaux d'Amérique du Nord, de mettre en valeur le
savoir-faire des artisans locaux et de célébrer son héritage français.
Au Canada, l'hôtel de ville de Montréal a été le premier grand édifice
public à adopter ce style, dont il reste l'un des plus beaux exemples.
Les rénovations qui ont été faites, notamment à la suite de l'incendie
de 1922, ont respecté le vocabulaire architectural d'origine.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Québec
Québec, Québec
L'hôtel de ville de Québec est un majestueux édifice en pierre construit
en 1895-1896 dans un style éclectique typique de la fin de l'époque
victorienne. Le bâtiment occupe tout un quadrilatère dans un secteur en
pente de la Haute-Ville de Québec à l'intérieur des limites du site du
patrimoine mondial de l'UNESCO. Le bâtiment a été agrandi par l'ajout de
deux étages en 1929.
L'hôtel de ville de Québec a été désigné lieu historique national du
Canada en 1984 en raison de son extérieur monumental élégant et de son
intérieur richement décoré, qui en font l'un des hôtels de ville les
plus majestueux du Canada.
L'hôtel de ville de Québec reflète l'opulence éclectique de la fin de
l'époque victorienne par son style Second Empire, tandis que son
caractère solennel indéniable témoigne du talent des artisans et des
constructeurs locaux. Le bâtiment a une forme classique, ancrée dans la
philosophie des Beaux-Arts français, et son vocabulaire évoque bon
nombre d'autres sources, dont les styles néo-roman et château. Le faste
de l'extérieur est reproduit dans la décoration splendide de
l'intérieur, comme le démontrent les somptueuses salles du
conseil.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Rivière-du-Loup
Rivière-du-Loup, Québec
Le lieu historique national du Canada de
l'Hôtel-de-Ville-de-Rivière-du-Loup, situé sur un site proéminent au
centre-ville de Rivière-du-Loup, Québec, est un bâtiment éclectique de
deux étages en brique rouge, qui a été construit en 1916. Le bâtiment a
fait l'objet de travaux de rénovation et d'agrandissement de 1972 à
1973.
La décision d'ériger un nouveau bâtiment municipal pendant la Première
Guerre mondiale symbolise la détermination de la ville à moderniser ses
services municipaux et à faire sentir sa présence dans la région du
Bas-Saint-Laurent. Le style éclectique de cet élégant hôtel de ville,
aux décorations inspirées du mouvement Arts and Crafts, le distingue des
bâtiments commerciaux de Rivière-du-Loup.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2009 |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Roberval
Roberval, Québec
Le lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Roberval
est situé près de la rive du lac Saint-Jean, dans le centre de la ville
actuelle de Roberval (Québec). Le lieu comprend un vaste bâtiment de
trois étages en brique de style Second Empire tardif aux toits de métal
à forte pente. Il a été construit en 1928-1929 pour montrer l'importance
croissante de la ville comme centre administratif et capitale régionale
du Lac Saint- Jean.
La valeur patrimoniale de ce lieu réside dans ses liens historiques avec
la ville de Roberval, tels qu'illustrés par sa conception monumentale,
sa forme et ses matériaux. Construit selon le plan de l'architecte
Charles Lafond en 1928-1929, l'hôtel de ville de Roberval reflétait la
prospérité et l'importance de la communauté. Conçu selon la tradition
des bâtiments publics de style Second Empire, très répandus au Québec;
la conception, la forme et la construction du bâtiment sont conformes
aux principes des Beaux-Arts. Le bâtiment présente des tours couronnés
de pavillons, d'une décoration classique et un escalier central.
L'allure monumentale de l'édifice proclamait l'importance croissante de
la ville comme centre administratif et capitale régionale du Lac Saint-
Jean. L'hôtel de ville jouait, au départ, un rôle multifonctionnel,
servant de caserne de pompiers, de théâtre, d'immeuble d'habitation de
même que de bureau pour l'administration municipale, son rôle
premier.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Daniel Laroche |
Lieu historique national du Canada de l'Île aux Basques
Trois-Pistoles, Québec
Le lieu historique national du Canada de l'Île aux Basques est une
longue île étroite située à environ cinq kilomètres au nord de
Trois-Pistoles, sur le fleuve Saint-Laurent, au Québec. Mesurant deux
kilomètres de long par 400 mètres de large, cette île abrite un mélange
de forêt, de prairie et de marais et ses rives présentent des baies
abritées et des plages sablonneuses. Des vestiges archéologiques à
quatre endroits y indiquent une activité autochtone à la fois antérieure
et postérieure aux premiers contacts. Trois autres sites montrent des
traces d'occupation par des pêcheurs basques venus de France entre 1584
et 1637.
Occupée successivement par des groupes autochtones, des marins basques,
des missionnaires Jésuites et des colons, l'Île aux Basques témoigne de
nombreux siècles d'activité humaine. On y a découvert des vestiges
archéologiques à sept endroits dans le sud de l'île. La présence des
Autochtones peut avoir consisté en de petits groupes installés pour un
temps limité, sur une base saisonnière, pour la chasse, la pêche et la
cueillette. Les conditions climatiques difficiles pourraient y avoir
limité l'occupation des Basques français à des visites sporadiques et
saisonnières au cours des mois les plus cléments. L'île représente la
limite est de la présence des Iroquois dans le sud de la région du
Saint-Laurent et comporte la plus forte concentration de sites basques
de tout l'estuaire du Saint-Laurent. L'île a été occupée par les Basques
venus de France, contrairement au lieu historique national du Canada de
Red Bay, qui fut occupée par les Basques venus d'Espagne. L'île est le
seul établissement basque de tout l'estuaire où le contact entre
Européens et Autochtones est documenté par des preuves archéologiques.
L'île est maintenant une aire protégée désignée servant de sanctuaire et
de refuge aux oiseaux migrateurs.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Nathalie Clerk, 2006 |
Lieu historique national du Canada du Jardin-Botanique-de-Montréal
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada du Jardin-Botanique-de-Montréal
est un jardin botanique aménagé au cours du XXe siècle qui s'étend
aujourd'hui sur un quadrilatère de 75 hectares dans l'est de Montréal,
au Québec. Il s'agit d'un paysage culturel ayant un caractère tant
formel que pittoresque et qui est notamment constitué d'une trentaine de
jardins thématiques, une dizaine de serres, un arboretum et un pavillon
administratif de style Beaux-Arts et Art déco ayant la forme d'un « H ».
La valeur historique du jardin botanique de Montréal repose sur son
association avec l'instigateur du projet, le frère Marie-Victorin,
désigné personne historique nationale. Le jardin est l'une de ses
nombreuses réalisations s'insérant dans le mouvement scientifique
canadien de son époque, et pour lequel il incarne une figure marquante
pour son approche novatrice en botanique. Son oeuvre a été réalisé en
collaboration avec Henri Teuscher, l'horticulteur, botaniste et
architecte paysagiste qui a conçu les plans d'origine du jardin. Bon
nombre des éléments d'origine du jardin ont été conservés; il a évolué
de façon très harmonieuse au fil du temps dans la continuité des
intentions du concepteur.
Les fonctions principales des jardins botaniques modernes sont la
recherche, la conservation, la présentation et l'éducation, auxquels le
jardin botanique de Montréal adhère depuis sa création en 1931, et son
ouverture au public en 1936. En 1938, le frère Marie-Victorin a
notamment fondé l'École d'apprentissage horticole et réservé une partie
du jardin botanique de Montréal pour les étudiants et les chercheurs. En
plus de sa pérennité, les valeurs scientifique et esthétique du lieu
reposent sur l'ampleur, l'intégralité, la complexité et la qualité des
installations du jardin, et la rareté, puisqu'il constitue l'un des
principaux jardins botaniques au monde. L'expérience esthétique repose
entre autres sur la beauté de l'ensemble du lieu, la végétation aux
coloris, aux agencements et aux formes des plus diversifiées, ainsi que
sur les contrastes, le dépaysement, la variété ou l'harmonie existant
d'un jardin à l'autre.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada des Jardins-de-Métis
Grand-Métis, Québec
Le lieu historique national du Canada des Jardins-de-Métis comprend un
jardin d'inspiration anglaise, dont la création par Elsie Reford remonte
à la période comprise entre 1926 et 1958. La propriété d'environ 18
hectares (45 acres) est située au confluent du fleuve Saint-Laurent et
de la rivière Métis, entre les villes de Mont-Joli et de Matane, près de
Sainte-Flavie, au Québec. Le lieu comprend une villa et six jardins
distincts mettant en valeur plus de 500 espèces florales.
Les Jardins de Métis constituent un excellent exemple canadien des
jardins d'inspiration anglaise du XXe siècle. De 1926 à 1958, Elsie
Reford dessina et aménagea les nombreux jardins sur les terres de la
résidence d'été que lui offra son oncle George Stephen, fondateur du
Chemin de fer Canadien Pacifique et éminent homme d'affaires du Canada
au XIXe siècle. À l'origine le terrain d'un chalet de pêche, Mme Reford
conçut des jardins dans un paysage rustique en tenant compte du
microclimat favorable du lieu et de ses magnifiques points de vue. Le
lieu comprend maintenant des jardins spécialisés, des sentiers sinueux,
une allée royale et une multitude de plates-bandes disposées de manière
informelle.
|

©Québec City / Ville du Québec, 1997 |
Lieu historique national du Canada La Fabrique
Québec, Québec
Le lieu historique national du Canada La Fabrique est situé dans le
quartier Saint-Roch de la ville de Québec. Anciennement un bâtiment à
vocation industrielle, La Fabrique abrite aujourd'hui les bureaux du
Service de l'aménagement du territoire et du Service du développement
économique de la ville de Québec, de même que l'École des arts visuels
de l'Université Laval. Cet édifice à l'allure frappante est situé sur le
boulevard Charest Est et est fait de briques rouges. Il comprend des
éléments de finition ornementaux en briques blanches, et il est doté de
tours carrées d'inspiration médiévale ainsi que d'une riche
ornementation.
La valeur de La Fabrique réside dans son rôle important dans l'industrie
canadienne du vêtement. Son histoire commence avec l'Argenteuil Paper
Manufactory, construite en 1804 par deux papetiers américains, Walter
Ware et Benjamin Wales. Cette usine produit, à partir de chiffons, du
papier d'emballage et du papier journal qu'elle vend essentiellement sur
le marché montréalais, de 1805 à 1834. Pendant une bonne partie de cette
période, l'usine est dirigée par James Brown, papetier montréalais et
fondateur de la Montreal Gazette. L'usine, située dans la municipalité
de Saint-André-Est (maintenant Saint-André-d'Argenteuil), au Québec, est
la première et pendant de nombreuses années la seule usine de papier sur
le territoire formant aujourd'hui le Canada. Les origines de l'industrie
canadienne des pâtes et papiers remonteraient donc à son établissement.
La période pendant laquelle elle héberge la Dominion Corset ne fera que
consolider sa place dans l'histoire industrielle canadienne. En 1964,
une annexe moderne de style international est construite. Restauré et
partiellement reconstruit en 1992-1993, le bâtiment comprend maintenant
un atrium, et l'intérieur a été rénové et subdivisé.
|
|
Lieu historique national du Canada de La Main
Montréal, Québec
La « Main » est un arrondissement de six kilomètres de longueur longeant
le boulevard Saint-Laurent à Montréal, qui va de la rue de la Commune
dans le sud jusqu'à la rue Jean-Talon dans le nord, et où des immigrants
se sont installés, par vagues successives en y établissant leurs
commerces et résidences. L'arrondissement se caractérise par un mélange
de petites usines, de boutiques, de théâtres et de restaurants que des
gens d'origines ethniques diverses ont établis et développés au fil du
temps.
La valeur patrimoniale de l'arrondissement réside dans son association
avec les vagues successives d'immigrants et leurs efforts pour s'établir
au Canada. L'arrondissement se caractérise par la diversité des types
d'édifices fonctionnels, habituellement d'échelle modeste, et leur
réaménagement successif par des gens d'origines ethniques diverses,
conférant à l'arrondissement un caractère cosmopolite
particulier.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Louis-Joseph-Papineau
Montréal, Québec
Maison en pierre construite en 1785, habitée de façon intermittente par
Louis-Joseph Papineau.
Situé dans le quartier du Vieux-Montréal, sur la rue Bonsecours, le lieu
historique national du Canada de Louis-Joseph-Papineau constitue un
modèle architectural typique de la région montréalaise des confins des
XVIIIe et XIXe siècles. Cette résidence a été habitée par quatre
générations de la famille Papineau, soit Joseph Papineau père, Joseph
Papineau fils, Louis-Joseph Papineau ainsi que sa descendance. Ce lieu
historique national du Canada est fermé au public.
Le lieu historique national du Canada Louis-Joseph-Papineau était la
demeure de la famille Papineau à Montréal. Dotée d'un toit abrupt, la
maison en pierre de deux étages et demi donne directement sur la rue
Bonsecours. Un passage cocher voûté permet l'accès aux véhicules à la
cour arrière.
La valeur du lieu historique national du Canada Louis-Joseph-Papineau
réside dans son lien avec Papineau pendant ses années les plus actives
sur la scène politique. L'architecture originale de la maison, associée
au régime français, témoigne des racines de Papineau, tout comme le fait
que sa famille a longtemps été propriétaire des lieux. Les modifications
que Papineau a apportées à la maison en 1831-1832 donnent un aperçu de
ses goûts et des idées en vogue qu'il a adoptés.
La maison a été la propriété de la famille Papineau de 1748 à 1779, puis
de 1809 à 1920. Elle a été considérablement rénovée par Louis-Joseph
Papineau en 1831-1832. Les modifications apportées comprenaient la
construction d'un passage cocher voûté en brique donnant accès à la cour
arrière, le déplacement de la porte d'entrée principale du centre vers
une des extrémités de la façade et l'aménagement d'un nouveau vestibule
intérieur et d'un grand escalier. La maison a été vendue au gouvernement
du Canada en 1982. Sous l'administration de Parcs Canada, son toit et sa
façade ont été en grande partie refaits.
|


©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Louis-S.-St-Laurent
Compton, Québec
Maison d'enfance de Louis S. St-Laurent, premier ministre du Canada
(1948-1957).
Situé à Compton dans les Cantons-de-l'Est, à 20 kilomètres de
Sherbrooke, le lieu historique national du Canada Louis-S.-St-Laurent
rappelle la vie et l'œuvre de l'ancien premier ministre du Canada.
La visite des lieux vous mène au cœur d'une autre époque, alliant les
charmes de la maison natale de Louis S. St-Laurent et du magasin général
à l'atmosphère champêtre du village. Découvrez le destin singulier d'un
grand homme et laissez-vous envoûter par les attraits de la vie
d'autrefois.
Situé en Estrie, au coeur du village de Compton, au Québec, le lieu
historique national du Canada Louis-S.-St-Laurent comprend, au sein d'un
aménagement paysager gardant les traces de son évolution, la maison, un
magasin général et son entrepôt, une petite remise et un kiosque, le
tout étant associé à Louis S. St.-Laurent, ancien premier ministre du
Canada. On y trouve également deux constructions récentes dont l'une
rappelle, par sa localisation et son volume, l'ancienne grange-étable de
la propriété.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada
Louis-S.-St-Laurent réside dans le fait que le paysage culturel renferme
des éléments qui sont associés à la vie de Louis S. St-Laurent
(1882-1973) et permet d'évoquer la vie dans un village des Cantons de
l'Est sur une durée d'un siècle.
Louis S. St-Laurent est né sur cette propriété dont il a hérité, en
partie, en 1933 et dont il est resté propriétaire jusqu'en 1971. Le lieu
historique comprend trois lots acquis par ses parents en 1881 et 1908,
et renferme quatre bâtiments d'époque. Deux bâtiments déjà en place -
une maison et un magasin général - ont été achetés par les St-Laurent en
1881, et agrandis par la suite. Deux constructions ont été ajoutées par
la famille, soit une petite remise (entre 1885 et 1900) et un abri où se
trouve la balance à poids (1936). Le lieu recèle également les vestiges
archéologiques de bâtiments datant de l'époque de St-Laurent et deux
bâtiments plus récents. Parcs Canada gère le lieu depuis 1975.
|

©Library and Archives Canada / Bibliothèque et Archives Canada, PA-056837, C. M. Johnson, 1934 |
Lieu historique nationale du Canada Madeleine-de-Verchères
Verchères, Québec
Le lieu historique national du Canada Madeleine-de-Verchères est situé
dans un petit parc paysager sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent à
Verchères, au Québec. Le site comprend une statue de bronze représentant
Madeleine de Verchères, d'une hauteur de 7,2 mètres, fixée au sommet
d'une tour conique avec une base de forme carrée, se dressant telle une
sentinelle face au fleuve. Le site comprend également la surface
gazonnée minutieusement entretenue ainsi que la clôture entourant le
monument.
En 1692, un groupe d'Iroquois attaqua le Fort de Verchères dans ce qui
était alors la Nouvelle-France. Au moment de l'attaque, Madeleine de
Verchères (1678-1747), alors âgée de 14 ans, ses deux jeunes frères, un
vieux domestique et deux soldats tenaient le fort. La jeune Madeleine en
dirigea alors la défense, ce qui mena, après huit jours de résistance, à
une victoire.
Au début du XXe siècle, le gouverneur général du Canada, Lord Grey,
suggéra un projet de commémoration pour honorer le rôle joué par
Madeleine de Verchères dans la défense du Fort de Verchères. Après avoir
vu la statuette de Madeleine de Verchères réalisée par Louis-Philippe
Hébert en 1910, le gouverneur général suggéra de la faire reproduire à
grande échelle et de la placer sur le promontoire de Verchères, face au
fleuve Saint-Laurent. Le monument a été érigé en 1913, et en 1927, une
plaque y a été apposée par la Commission des lieux et monuments
historiques du Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Mairie-du-Canton-de-Bolton-Est
East Bolton, Québec
Le lieu historique national du Canada de la
Mairie-du-Canton-de-Bolton-Est consiste en un hôtel de ville de deux
étages au parement de planches à clin, situé dans la municipalité de
Bolton-Est, au Québec. Bien qu'elle date de la deuxième moitié du XIXe
siècle et qu'elle soit d'échelle modeste, la mairie du canton de
Bolton-Est présente une conception architecturale très sophistiquée.
Conçue pour remplir plusieurs fonctions, elle abrite des installations
destinées à l'administration et à la cour municipale.
Durant la seconde moitié du XIXe siècle, de nombreux édifices publics
furent construits par les anglophones des régions rurales du Québec par
suite de l'adoption de la Loi des municipalités et chemins du
Bas-Canada, en 1855. Par souci d'économie, la mairie du canton de
Bolton-Est a été construit en bois obtenus localement, au moyen d'une
corvée tenue vers 1867 grâce à l'effort communautaire d'une main
d'oeuvre volontaire. L'édifice a été conçu pour servir plusieurs
fonctions. L'édifice abrita une salle de conseil et un lieu de rencontre
sociale, mais c'est la présence d'une salle de cours qui la distingue
des anciennes mairies du Canada. La mairie du canton de Bolton-Est est
aussi un exemple rare d'une mairie construit en bois qui a conservé
certaines de ses fonctions, son apparence d'origine et son architecture
sophistiquée. Cet élégant édifice rappelle l'avènement des
administrations locales et témoigne de l'esprit qui animait ses
constructeurs au Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Mairie-de-Havelock
Havelock, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Mairie-de-Havelock, un
bâtiment en pierre abritant une salle unique s'élevant sur deux étages
servant de mairie, a été construit en 1868. Il se trouve sur un lot
isolé, sur une route rurale du canton de Havelock, au Québec.
Dans la vallée du Saint-Laurent, les habitants de Havelock furent parmi
les premiers à se prévaloir du statut de municipalité rurale lorsque la
loi le permit en 1855. En 1868, MM. Sanders et Kirkland érigèrent cet
édifice suivant les plans de Charles Gordon, pour abriter les réunions
du conseil et diverses assemblées publiques. Bien que son aménagement,
composé d'une salle unique s'élevant sur deux étages, soit commun à
beaucoup de mairies bâties au Canada au XIXe siècle, sa construction en
pierre, aux détails raffinés et aux proportions classiques, est
exceptionnelle et témoigne de la fierté civique de ses
bâtisseurs.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1970 |
Lieu historique national du Canada de la Maison Bélanger-Girardin
Beauport, Québec
La Maison Bélanger-Girardin est un bâtiment de pierre d'un étage et demi
au toit à forte inclinaison construit au début du XVIIIe siècle dans la
tradition architecturale québécoise. Une remise contiguë a été
construite au début du XIXe siècle. La maison est située dans le Vieux
Beauport, près de la ville de Québec dans la vallée du Saint Laurent.
Elle est entourée de vastes pelouses et avoisine un couvent, ce qui lui
confère une allure quelque peu campagnarde.
La Maison Bélanger-Girardin été désignée lieu historique national en
1982 car elle est représentative des habitations du début du régime
français construites en campagne près de la ville de Québec, tant par sa
conception que son évolution structurale.
La Maison Bélanger-Girardin constitue l'un des rares exemples qui
subsiste aujourd'hui d'une maison de pierre datant du début du régime
français. Elle est située à Beauport, l'une des premières seigneuries
créées en Nouvelle France.
Bâtie en deux étapes (vers 1722-1727 puis vers 1735), la maison actuelle
a d'abord constitué un ajout à une maison en bois construite (vers 1673)
par Nicholas Bellanger, son premier occupant, puis a complètement
remplacé cette dernière. Les travaux de 1735 ont été effectués par Jean
Marcou, propriétaire ultérieur et maçon. Les vestiges de la structure
originale de bois ne sont apparents qu'à l'intérieur et sur le mur
ouest. Cléophas Girardin a aussi habité la maison, mais à une période
ultérieure.
La forme, les matériaux, les proportions, les ouvertures et
l'aménagement intérieur de la Maison Bélanger-Girardin en font un bel
exemple de l'architecture domestique rurale québécoise du début du
XVIIIe siècle. Elle représente la transposition dans la vallée du Saint
Laurent des formes architecturales résidentielles et des méthodes de
construction traditionnelles du nord de la France. L'utilisation de
crépi pour recouvrir la pierre représente une adaptation des formes et
des méthodes connues au climat et à la géographie de la Nouvelle
France.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1982 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Cartier
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Cartier est situé sur
le côté est de la place Jacques-Cartier dans le secteur du
Vieux-Montréal, au Québec. Construit entre 1812 et 1813, il s'agit d'un
bâtiment en pierre de taille de deux étages et demi, surmonté d'un toit
à deux versants revêtu de fer blanc. La propriété compte également une
cour arrière et une adjonction en bloc de pierre. Associée durant la
majeure partie de son existence au commerce de l'hébergement, la maison
est l'une des dernières petites auberges existant encore au pays.
En 1808, une parcelle fut cédée à la ville de Montréal afin d'y établir
un marché public, le « Marché Neuf », sur ce qui est aujourd'hui connue
comme la place Jacques-Cartier. Devant cette effervescence, Augustin
Perrault et Louis Parthenay s'engagèrent dans la spéculation foncière.
Ces deux associés achetèrent un terrain au Marché Neuf, puis conclurent,
le 10 mars 1812, une entente avec Amable Amiot, qui s'engageait à leur
construire deux ou trois maisons à cet endroit. Le premier bâtiment
terminé fut la maison Cartier. Aussitôt qu'il fut complété, cet immeuble
fut mis en location. Un de ses premiers occupants fut le tavernier
Joseph Sicard Carufel. Aujourd'hui, la maison Cartier est un restaurant
et aussi, l'une des dernières petites auberges existant encore au pays.
La Maison Cartier représente un exemple de bâtiments ayant servi
d'auberge du début du XIXe siècle, une catégorie d'immeuble très
populaire à une époque où les voyageurs devaient faire de fréquents
arrêts. Maintenant revêtue de pierres de taille, elle est pourvue d'une
galerie au niveau de la rue. Le rez-de-chaussée est marqué par de larges
fenêtres et une double porte du côté gauche. Six fenêtres, disposées de
façon ordonnée, ornent le premier étage et trois lucarnes ponctuent le
toit à deux versants. Couverte de fer-blanc, la toiture est fermée par
des murs coupe-feu qui prolongent les murs pignons.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2008 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Chapais
Saint-Denis-De La Bouteillerie, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Chapais se trouve sur
un lot étroit situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, dans le
village de St-Denis, au Québec. La maison rectangulaire de deux étages
et demi recouverte de clins, dotée d'une aile arrière et surmontée de
lucarnes et d'un toit en forme de cloche, a appartenu pendant plusieurs
années à Jean-Charles Chapais, l'un des pères de la Confédération, puis
à son fils, l'historien Thomas Chapais. De nombreux éléments font d'elle
un excellent exemple de l'architecture québécoise du XIXe siècle,
notamment son revêtement à clins, ses galeries ceinturant le premier
étage et flanquées de vastes balcons, ses escaliers tournants et son
aménagement et sa décoration intérieurs soignés.
La maison a été construite de 1832 à 1834 par Jean-Charles Chapais, qui
est associé avec l'histoire et l'architecture du bâtiment. Pendant qu'il
habitait la maison, Chapais a contribué activement au développement
économique et culturel de la région de Kamouraska. Délégué à la
Conférence de Québec et père de la Confédération, il a été nommé au
Sénat en 1868 et il a occupé les postes de ministre de l'Agriculture et
de receveur général dans les cabinets Macdonald. Quant à son fils, Sir
Thomas Chapais, il a été nommé chevalier en 1935 pour ses travaux en
qualité d'historien canadien. Il a aussi été avocat, journaliste, membre
du conseil législatif de Québec, ainsi que membre du Sénat canadien.
Thomas Chapais naquit et mourut dans cette maison.
La valeur patrimoniale de la maison Chapais réside aussi dans son
caractère architectural, y compris son toit en forme de cloche
légèrement incurvé, ses grands balcons qui ceinturent le premier étage,
ses terrasses qui reçoivent les escaliers tournants, et ses portiques
d'une sculpture sobre. Elle inclut les boiseries, la menuiserie, le
savoir-faire précis, les finis raffinés ainsi que les détails intérieurs
qui sont exceptionnels pour une maison de ce genre.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Maison Cormier
Montréal, Québec
Située au 1418, avenue des Pins Ouest, Montréal, la Maison Cormier est un
exemple remarquable de maison de style Art déco. Elle se distingue par la
composition de sa façade principale ainsi que la qualité et la richesse de
son décor intérieur, de ses matériaux et de son mobilier qui en font un
ensemble architectural tout à fait unique au Canada. Elle témoigne des idées
esthétiques des années 1930 et des goûts de l'architecte et ingénieur Ernest
Cormier qui l'a entièrement conçue en 1930-1931 et l'a habitée jusqu'en 1975.
Elle est également étroitement associée à l'ancien premier ministre du
Canada, le très honorable Pierre Elliott Trudeau, qui a acheté la maison en
1979 et qui, après avoir quitté la scène politique, en a fait sa résidence
personnelle de 1984 à 2000.
La propriété est située dans le Mille carré doré, un quartier résidentiel
aisé dans le secteur ouest du centre-ville de Montréal. Ce quartier perd
progressivement de son importance après 1930 puisque moins d'espace y est
disponible pour se bâtir, que d'autres secteurs de la ville se développent et
que le quartier subit les séquelles de la crise économique. Dans ce contexte
social et économique, Ernest Cormier entreprend la construction de sa
résidence en 1930-1931.
Le terrain, long, étroit et à flanc de montagne, mène à un aménagement non
traditionnel. Les pièces privées se trouvent sous le niveau du
rez-de-chaussée, et non aux étages supérieurs. La façade principale, avenue
des Pins, présente toutes les caractéristiques du style Art déco par ses deux
volumes rectangulaires bien découpés qui sont de proportions différentes et
qui sont dotés de toits plats, par la verticalité de ses lignes et par son
ornementation stylisée. Le décor de la maison se distingue également par son
utilisation de matériaux précieux et raffinés, où se côtoient également les
matériaux nobles, modernes et traditionnels — par exemple, le marbre, le
terrazzo et le liège pour les planchers.
Le site choisi par Cormier se situe à mi-chemin entre son bureau et
l'Université de Montréal. Au cours de sa longue carrière, il réalise
essentiellement des édifices publics, surtout au Québec et en Ontario, sa
résidence étant la seule exception connue. Pour sa conception, il s'inspire
d'idées esthétiques contemporaines, principalement d'origine européenne, mais
lui donne un caractère personnel et original par son aménagement, son
mobilier et les œuvres d'arts. Quelques meubles de l'atelier/salon
proviennent de son ancien atelier rue Saint-Urbain, d'autres sont achetés par
Cormier à Montréal ou à Paris. Il reçoit d'ailleurs la médaille d'or du Royal
Architectural Institut of Canada pour ce projet.
En 1979, le très honorable Pierre Elliott Trudeau fait l'acquisition de la
Maison Cormier. Il réalise des travaux de rénovations en 1981, fait l'ajout
d'une piscine intérieure à l'extrémité du terrain en 1983, puis y emménage en
1984 lorsqu'il quitte la vie politique active. Il s'y concentre sur sa
carrière d'avocat et sa famille, habitant les lieux jusqu'à son décès en
2000. Cette maison est ainsi étroitement associée à une étape plus
personnelle et privée de la vie de cet ancien premier ministre.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2002 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-de-Salaberry
Chambly, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Maison-de-Salaberry est
situé en face des rapides de Chambly à Chambly, au Québec. Le lieu
comprend une large maison en pierre de trois étages construite dans le
style vernaculaire des villas de Montréal du début du XIXe siècle. La
maison comprend un toit en croupe bas, coiffé de deux lucarnes à deux
versants, deux cheminées latérales, et un imposant portique à colonnes.
Elle a été construite sous les ordres du lieutenant-colonel
Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry de 1814 à 1815. De Salaberry a
vécu dans cette maison jusqu'à sa mort en 1829.
La maison de Salaberry a été construite sous les ordres du
lieutenant-colonel Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry entre 1814 et
1815. De Salaberry était surnommé le « héros de Châteauguay » pour son
rôle dans le repoussement des troupes du major-général Wade Hampton à
Châteauguay, le 26 octobre 1813. Il a vécu dans cette maison avec son
épouse jusqu'à sa mort en 1829.
La maison de Salaberry est représentative du style vernaculaire des
villas de Montréal du premier quart du XIXe siècle. Il s'agit d'une
large maison en pierre de trois étages qui dispose de deux cheminées
latérales en parapet, et de fenêtres à battants. Le bâtiment est de
forme rectangulaire et est harmonieusement proportionnée, il dispose
d'une maçonnerie en pierre taillée et présente les éléments communs des
maisons du début du XIXe siècle, y compris les fenêtres à battants avec
des boiseries simples et les contours de fenêtre à lucarne. Il dispose
aussi d'un fronton classique soutenu par des colonnes.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Étienne-Paschal-Taché
Montmagny, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Maison Étienne-Paschal-Taché
est situé dans la ville de Montmagny (Québec). Cette attrayante maison
en bois d'un étage et demi a abrité pendant de nombreuses années
Étienne-Paschal Taché, un des pères de la Confédération. Présentant des
éléments de l'architecture traditionnelle du Québec, la maison avec ses
remarquables tours jumelles offre une apparence imposante. Cette maison
originale se dresse dans un quartier résidentiel, entourée d'édifices
plus récents. La reconnaissance officielle concerne l'édifice sur son
lot visé par le droit de propriété. La maison a aussi été classée site
historique par le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine.
La maison a été construite pour Étienne-Paschal Taché, médecin
praticien, avant de devenir un personnage important de l'histoire
politique du Canada, du milieu des années 1830 jusqu'à sa mort, en 1865.
En tant que Premier ministre du Canada-Uni, Étienne-Paschal Taché a
présidé la Conférence de Québec de 1864 et, même s'il est mort avant la
naissance de la Confédération, il est considéré comme étant l'un des
pères de la Confédération. Étienne-Paschal Taché a vécu dans cette
maison pendant 35 ans et y a élevé 15 enfants.
La maison comprend des éléments typiques des maisons traditionnelles
québécoises, y compris le plan rectangulaire, le toit moyennement
incliné vers l'avant, le soubassement dégagé et la construction en gros
bois d'œuvre. La maison, construite à la fin des années 1820 et agrandie
en 1855 d'une annexe à l'est et d'une tour au nord-est, a été complétée
par la construction d'une deuxième tour dans les années 1880. On peut
voir l'influence du classicisme britannique dans les éléments
architecturaux intérieurs. La maison, qui a subi de nombreuses
modifications au fil des ans, a été restaurée en partie à la fin du XXe
siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, HRS 0521 |
Lieu historique national du Canada de la Maison George-Stephen
Montréal, Québec
La Maison George-Stephen est une grande demeure en pierre d'époque
victorienne qui occupe la majeure partie d'un lot urbain dans le
centre-ville de Montréal. La maison est actuellement connue comme le
Mount Stephen Club.
La Maison George-Stephen a été désignée parce qu'elle constitue l'un des
meilleurs exemples du style néo-Renaissance au Canada, et a été la
résidence de George Stephen, président de la Banque de Montréal et du
Canadien Pacifique.
Le style néo-Renaissance, les matériaux luxueux et la grande qualité
d'exécution de cette résidence somptueuse reflètent l'aisance financière
et la position sociale de George Stephen, éminent homme d'affaires
canadien de la seconde moitié du XIXe siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, C. Desmeules |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Henry-Stuart
Québec, Québec
Construite au milieu d'un jardin pittoresque au 82, de la Grande-Allée
Ouest, à Québec, la maison Henry-Stuart est un petit cottage romantique
en brique datant du XIXe siècle. Situé dans un secteur résidentiel
urbain de prestige, le terrain irrégulier de 1 528,3 mètres carrés
constitue à la fois une oasis et un rappel du passé.
La valeur patrimoniale de la maison Henry-Stuart réside dans son
illustration des goûts et du mode de vie de la bourgeoisie québécoise
urbaine aux XIXe et XXe siècles. En l'occurrence, ces goûts sont le
reflet du mouvement pittoresque cher aux colons britanniques. La valeur
patrimoniale est illustrée par des éléments précis du terrain, de la
maison et de l'ameublement qui subsistent du XIXe siècle. La maison
Henry-Stuart a été construite par un entrepreneur de Québec pour sa
fille Mary (ou Maria) Curry Henry en 1849. En 1918, elle a été acquise
par les soeurs Adèle-Maud et Mary-Lauretta Stuart qui en sont demeurées
propriétaires pendant près de 70 ans, soit jusqu'au décès d'Adèle en
1987. Durant toute cette période, les soeurs Stuart ont restauré la
maison en lui conservant son caractère pittoresque du XIXe siècle. En
1997, le Conseil des monuments et sites du Québec a acheté la propriété
pour la préserver à titre de bien public.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2001 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-LeBer-LeMoyne
Lachine, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Maison-LeBer-LeMoyne, un
ancien poste de traite des fourrures datant du XVIIe siècle, est situé
sur un petit promontoire bordant le canal de Lachine sur le terrain du
Musée de Lachine, à Montréal. Tant le bâtiment principal que l'annexe
sont de modestes structures de pierre au toit à deux versants et à forte
inclinaison.
La maison LeBer LeMoyne a été construite comme poste de traite des
fourrures en 1669-1671 pour Jacques Le Ber et Charles Le Moyne, qui
l'ont exploité jusqu'en 1685. En 1689 la maison a été endommagée par le
feu et le poste de traite a été abandonné en 1695. Entre 1695 et 1946,
la maison LeBer LeMoyne a fait l'objet d'une série de rénovations visant
à la convertir en résidence. Elle a ensuite été acquise par la ville de
Lachine en 1946, qui en a fait un musée. Aujourd'hui, la propriété
comprend, outre la maison proprement dite, l'annexe arrière et la
dépendance, un bâtiment utilitaire construit en même temps que la
maison.
La valeur patrimoniale de la maison LeBer LeMoyne tient au fait qu'elle
témoigne d'une période d'activités historiques et qu'elle est la seule
structure entière qui puisse être associée à Charles Le Moyne. Le site a
joué un rôle dans le commerce des fourrures sous le Régime français,
comme le démontrent la forme et la composition des bâtiments, le lieu et
l'implantation de la maison et de la dépendance.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1999 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Louis-Bertrand
L'Isle-Verte, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Louis-Bertrand est
situé dans le village de L'Isle-Verte dans la région du
Bas-Saint-Laurent au Québec. Construite pour Louis Bertrand, commerçant
bien établi et homme politique actif, il s'agit d'une maison
rectangulaire à deux étages complets et d'un grenier à deux niveaux. La
maison est de style «maison québécoise» ce qui se reflète dans ses
hautes fondations, sa longue galerie, la forte inclinaison du toit et
des détails architecturaux ou décoratifs tels que les fenêtres à
battants à plusieurs panneaux. À ce style de base, s'ajoutent des
influences néoclassiques, traduites par la symétrie d'ensemble du volume
et des façades, et des détails décoratifs tels que le bardage de
feuilles de bois imitant la pierre de taille. L'intérieur conserve ses
planchers d'origine, ses moulures et bon nombre de ses meubles et
accessoires d'origine.
Cette maison fut édifiée en 1853 pour le marchand et notable Louis
Bertrand qui devint par la suite le premier maire du village, fondateur
de la Société d'agriculture et député du comté de Rimouski. Mesurant
15,85 mètres sur 10,66 mètres, la maison est construite selon un plan
rectangulaire et coiffée d'un toit en pignon assez incliné, typique de
l'architecture québécoise, cependant que certains détails révèlent une
influence néoclassique. L'intérieur conserve les meubles et accessoires
typiques d'une résidence de famille de la classe moyenne de l'époque.
Les descendants de Louis Bertrand habitèrent la maison durant quatre
générations. En 2005, la maison et son contenu, une collection
exceptionnelle d'articles ayant appartenu à la famille, furent donnés à
l'Université du Québec à Rimouski (UQAR).
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canadada, 1988 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Loyola / Édifice-de-l'École-Nationale
Québec, Québec
Situé à l'intérieur des remparts du Vieux-Québec, au Québec, le lieu
historique national du Canada de la Maison-Loyola /
Édifice-de-l'École-Nationale est un édifice public imposant de style
néo-gothique primitif. Situé dans une rue en pente, cet édifice en
pierre de deux étages et demie conçu selon les règles classiques
présente un fenêtrage régulier, un grand portique à pignon ainsi qu'un
belvédère. Les détails de style néogothique accentuent la structure.
Construite entre 1822 et 1823, suivant les plans du marchand de pierre
Benjamin Tremaine, la Maison Loyola / Édifice de l'École nationale est
l'un des plus anciens exemples de l'architecture de style néo-gothique
au Canada, particulièrement par l'utilisation de son style sur un
immeuble public. Les fenêtres gothiques en ogive, les moulures
distinctives des larmiers et les proportions classiques du bâtiment
rappellent le mouvement romantique, qui a inspiré l'architecture
néogothique. En 1842, l'architecte Henry Musgrave Blaiklock ajoute un
étage ainsi qu'une annexe au bâtiment, prenant bien soin de reproduire
le même type de fenêtrage dans les parties ajoutées. D'autres
modifications sont apportées au fil des années en fonction des diverses
vocations de l'immeuble, qui sert successivement d'école, de résidence
pour les orphelins et les démunis ainsi que de centre social et
culturel.
s
À l'instigation de l'institution anglicane Society for Promoting
Christian Knowledge, l'école nationale, qui assure l'éducation des
orphelins, est érigée dans le cadre de la création des National Schools
britanniques. L'édifice héberge par la suite plusieurs institutions à
vocation religieuse, caritative ou pédagogique. Propriété des jésuites
de 1904 à 1969, il est rebaptisé « Maison Loyola » et utilisé comme
centre social et culturel.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2003 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Maillou
Québec, Québec
Bel exemple de l'architecture de Québec au XVIIIe siècle (1736).
La maison Maillou est un pittoresque bâtiment en pierre de deux étages
situé dans l'arrondissement historique de Québec. Sa forme vernaculaire
simple, avec son toit pentu à deux versants et ses hautes cheminées,
témoigne de ses origines françaises. Posée directement en bordure de la
voie publique et dotée de dépendances logées dans une cour fermée par un
mur en pierre, elle est un bel exemple de demeure urbaine du XVIIIe
siècle.
Construite vers 1737 par Jean-Baptiste Maillou, la maison n'avait à
l'origine qu'un seul étage. Elle a été haussée d'un étage en 1767,
allongée au niveau du rez-de-chaussée en 1799, haussée d'un étage au
niveau de l'allonge en 1805 et dotée d'une annexe postérieure entre 1828
et 1831, ce qui lui donna sa forme actuelle. La maison Maillou est
typique de l'architecture domestique traditionnelle du régime français,
un style qui est demeuré présent jusqu'au début du XIXe siècle, et elle
est un bon exemple de résidence urbaine cossue du Bas-Canada. En 1830,
alors que la maison était propriété de l'Armée britannique, les Royal
Engineers ont construit deux dépendances, soit une écurie et un hangar
ainsi qu'un mur de pierre. Disposées à l'intérieur d'une cour fermée, la
maison et ses dépendances représentent un des rares exemples encore
existants d'un groupe urbain typique des premières décennies du XIXe
siècle.
La maison a été construite par Jean-Baptiste Maillou dit Desmoulins
(1688-1753), qui l'a habitée jusqu'à sa mort. Sous le régime français,
Maillou a été l'un des plus importants propriétaires fonciers de Québec
et l'un des entrepreneurs en construction les plus prospères de
l'époque. L'officier Louis Liénard de Beaujeu de Villemonde,
propriétaire de la maison de 1754 à 1766, louait les lieux à d'autres
officiers. Après la conquête par les Britanniques, le gouverneur
militaire fit de la maison le lieu de rencontre du conseil militaire
chargé de gouverner le territoire jusqu'à ce qu'un gouvernement civil
puisse être mis en place. Le Conseil s'est réuni dans la maison de 1760
à 1764. Antoine Juchereau Duchesnay (1740-1806), qui a vécu dans la
maison de 1766 à 1785 et qui lui a ajouté un étage, l'avait acquise de
son beau-père Villemonde. Politicien et homme d'affaires prospère et
influent, Duchesnay était également officier de l'armée et de la milice,
membre du Conseil exécutif du Bas-Canada et seigneur de Beauport,
Fossambault, Gaudarville et Saint-Roch-des-Aulnaies. John Mervin Nooth,
qui a vécu dans la maison de 1785 à 1799, était surintendant des
hôpitaux militaires de l'Amérique du Nord britannique. John Hale
(1765-1838), qui a vécu dans la maison de 1799 à 1815, était paye-maître
général adjoint des troupes britanniques, inspecteur général des comptes
publics, membre du Conseil législatif de Québec, commandant de la
milice, juge de paix pour Québec, Montréal et Trois-Rivières, et
seigneur de Saint-Anne-de-la-Pérade. Il a construit un ajout d'un étage
destiné à servir de bureau pour la Trésorerie de l'Armée britannique.
La Couronne a acquis la propriété en 1815 et y a installé les bureaux de
l'Intendance, de la solde et des billets militaires de 1815 à 1871. La
maison a accueilli les bureaux de l'administrateur en chef de l'Armée
britannique et de la Trésorerie militaire, et après 1843, elle a servi
de logement à des agents d'administration supérieurs. Après le départ
des troupes britanniques du Canada en 1871, la maison a été le quartier
général de la milice locale pendant près de soixante ans. Depuis, elle a
abrité les forces de la réserve locale et la Chambre de commerce de
Québec.
|

©CUM, reproduite de : Les Chemins de la mémoire,tome II, Québec, Les publications du Québec, 1991, p. 113 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Mère-des-Sœurs -Grises-de- Montréal
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada de la
Maison-Mère-des-Sœurs-Grises-de-Montréal est un grand édifice de pierre
austère situé dans le centre-ville de Montréal, au Québec. La partie
centrale rectangulaire de l'édifice comporte une chapelle élégante et
distinctive chapeautée d'une tour octogonale et d'une flèche. Les
fenêtres et les lucarnes placées à intervalles réguliers confèrent à
l'édifice un aspect ordonné. La partie principale compte quatre étages,
à l'exception de l'aile ouest, qui en compte cinq. L'édifice repose sur
un tracé en forme de « H », et ses entrées se trouvent sur les rues
Saint-Mathieu et Guy. L'entrée de la rue Guy s'ouvre sur une aire de
réception. Une clôture de fer ornementale et un mur de pierre entourent
la cour, qui abrite des jardins arborés, des sentiers, des bancs et des
statues.
La construction de la maison mère des Sœurs Grises a débuté en 1869.
Pendant 130 ans, l'édifice a été le point central du considérable
travail de charité de l'ordre. La valeur patrimoniale de l'édifice
réside dans son rôle de demeure de l'ordre et de facilitateur du travail
accompli au fil des ans grâce à des espaces fonctionnels comme un
hôpital et un orphelinat. La valeur patrimoniale découle également de
l'architecture de l'édifice — un mélange de style néo-classique et
néo-roman — qui en fait un excellent exemple d'architecture des couvents
du XIXe siècle. Ces styles sont représentés par des éléments de design
comme l'extérieur austère en pierre et l'élégante chapelle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1969 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Pagé-Rinfret / Maison Beaudry
Cap-Santé, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Pagé-Rinfret / Maison
Beaudry, situé sur une légère élévation dominant le fleuve
Saint-Laurent, dans le village de Cap-Santé, Québec, est un bâtiment
d'un étage et demi en bois, construit pendant le XVIIIe siècle. Il est
posé au ras du sol et doté d'un toit à pignon très pentu avec de
nombreuses lucarnes et deux cheminées.
La maison Pagé-Rinfret / maison Beaudry est un bel exemple de la maison
traditionnelle d'inspiration française, un style architecturale au début
du XIXe siècle, qu'illustre bien les racines des constructeurs
québécois. Ayant évolué a partir des style architecturaux antérieurs du
Régime Français, la maison Pagé-Rinfret / maison Beaudry présente un
toit plus haut et plus pentu que ceux des maisons traditionnelles
québécoises antérieures, ainsi qu'un deuxième étage éclairé par des
lucarnes posées dans la pente du toit. Sa seconde cheminée est
emblématique de la taille croissante des maisons traditionnelles
québécoises du XVIIIe siècle et l'utilisation de la tôle pour couvrir le
toit pentu indique la disponibilité relative de ce matériau à l'époque.
Le large avant-toit incurvé et la galerie surélevée, deux des éléments
les plus aisément reconnaissables de la maison traditionnelle
d'inspiration française, ont fait leur apparition vers le début du XIXe
siècle.
La technique de construction de la maison Pagé-Rinfret / maison Beaudry
témoigne de l'adaptation des méthodes européennes aux conditions du
Canada et s'est répandue partout au Québec et dans l'Ouest canadien aux
XVIIIe et XIXe siècles. Connue sous diverses appellations selon les
endroits et les matériaux employés, elle implique d'abord la fabrication
d'une charpente de bois équarri remplie de bois de brin, de pierres ou
de planches épaisses. Dans la maison Pagé-Rinfret, le remplissage est
fait de planches.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, N. Clerk, 2005 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Saint-Gabriel
Montréal, Québec
Situé dans la partie sud de Pointe-Saint-Charles à Montréal, à
l'extrémité de la place Dublin, le lieu historique national du Canada de
la Maison-Saint-Gabriel occupe le centre d'une propriété de forme
irrégulière, qui compte également une grange en pierre des champs, un
puits et une croix de bois. La maison Saint-Gabriel constitue un exemple
d'architecture canadienne-française de l'époque du Régime français. La
propriété constitue un îlot de verdure de caractère champêtre au sein
d'un vaste quartier résidentiel.
La valeur patrimoniale de la maison Saint-Gabriel réside dans le fait
qu'elle offre un exemple exceptionnel d'architecture rurale de la
Nouvelle-France et qu'elle est associée à l'œuvre de Marguerite
Bourgeoys, et de la communauté religieuse qu'elle fonda, la Congrégation
de Notre-Dame.
La maison Saint-Gabriel est un bâtiment remarquable, dont l'histoire et
l'architecture évoquent la Nouvelle-France du XVIIe siècle. De plan
rectangulaire, l'impressionnante maison de moellons est constituée d'un
corps central flanqué de deux ailes de petites dimensions et est coiffée
d'un toit incliné, dont les deux versants sont percés de petites
lucarnes, de cheminées doubles et d'un clocheton. Sa composition
extérieure, son aménagement intérieur et ses techniques de construction
en font un exemple exceptionnel d'architecture rurale de la
Nouvelle-France.
Elle se révèle aussi un témoin exceptionnel de l'œuvre de Marguerite
Bourgeoys et de la Congrégation de Notre-Dame. La maison Saint-Gabriel
fut le lieu d'accueil d'un petit groupe de filles du roi, servit de
petite école pour les jeunes enfants et d'école d'art ménager pour les
jeunes filles, et fut l'habitation de religieuses qui exploitaient une
métairie.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1969 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Sewell
Québec, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Sewell se trouve sur
un vaste terrain qui donne sur la rue Saint-Louis, en contrebas de la
citadelle de Québec. Exemple simplifié des maisons du début du XIXe
siècle inspirées du classicisme britannique, cette maison a servi de
résidence au juge en chef Jonathan Sewell. Ce bâtiment de deux étages et
demi à façade en pierre de cinq baies fait partie d'un important
panorama urbain du XIXe siècle dans la Haute-Ville de Québec. Le lieu
désigné comprend trois groupes de bâtiments, soit la maison Sewell en
devanture, la caserne Saint-Louis à l'arrière et d'autres bâtiments,
dont le ‘Squash Ball Court,' l'ancien atelier de menuiserie, les garages
et l'entrepôt, bâtis à différentes époques sur l'alignement ouest du
terrain.
Construite en 1803-1804, la maison Sewell illustre le développement de
la Haute-Ville de Québec au début du XIXe siècle. Son premier
propriétaire, Jonathan Sewell, a peut-être participé à sa conception qui
plaçait le bâtiment au milieu d'un vaste terrain hérité de son
beau-père, l'ancien juge en chef du Bas-Canada, William Smith. Avocat de
profession, Jonathan Sewell a été nommé solliciteur général et procureur
général du Bas-Canada avant d'être élu à la législature provinciale en
1796. En 1808, il est devenu juge en chef et président du Conseil
exécutif. La succession Sewell vend la propriété à la Couronne en 1854.
La maison sert par la suite de résidences pour les officiers de la
garnison de Québec, de bureaux aux lieutenants gouverneurs et au
ministère des Postes et également d'école.
La maison Sewell fait partie intégrante du quartier de la classe moyenne
supérieure de la Haute-Ville, typique des débuts de l'administration
britannique. Les maisons de la rue Saint-Louis et des rues avoisinantes
forment un panorama urbain constitué de rues étroites et de maisons
contiguës en pierre à un, deux ou trois étages, et alignées en bordure
du trottoir. Dans les premières décennies du XIXe siècle, la
construction de résidences pour les élites anglophones introduit un
nouveau vocabulaire architectural d'éléments néoclassiques, telles la
symétrie des ouvertures, la faible pente des toitures et l'allure sobre.
La maison Sewell fait écho au penchant pour le classicisme britannique
dont les bâtiments militaires voisins témoignent également, tout comme
sa construction soignée en maçonnerie de pierre de taille.
|

©Paolo Porzio |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Têtu
Québec, Québec
La maison Têtu, construite de 1852 à 1854, est une élégante maison en
pierre de trois étages, de style néo-classique, ornée, à l'intérieur
comme à l'extérieur, de motifs néo-grecs. Elle est sise sur un lot
urbain étroit dans l'arrondissement historique de la Haute Ville de
Québec.
Conçue par Charles Baillairgé en 1852, la maison Têtu a été désignée
lieu historique national en 1973 parce qu'elle est l'un des exemples les
plus remarquables des résidences urbaines néo-classiques bâties au
milieu du XIXe siècle.
La maison Têtu est représentative des grandes maisons urbaines qui
furent construites durant les années 1850 pour les commerçants canadiens
prospères. C'est le commerçant local Circe Têtu qui la fit construire
selon les plans de l'éminent architecte québécois Charles Baillairgé.
Elle illustre l'utilisation par Baillairgé de motifs néo-grecs.
Construite selon une approche typique de Baillargé et d'autres
architectes canadiens du milieu du XIXe siècle, la résidence conserve
par sa forme, sa composition et le traitement de ses matériaux, un style
néo-classique, et présente une ornementation néo-grecque.
Charles Baillairgé, l'un des principaux architectes de Québec durant la
seconde moitié du XIXe siècle, fut pendant 37 ans l'ingénieur de la
ville. On lui doit la conception de plusieurs résidences privées,
bâtiments publics et édifices religieux de Québec. Membre de la réputée
famille d'architectes Baillairgé, il a reçu sa formation auprès de son
oncle, Thomas Baillairgé, et de l'abbé Jérôme Demers. Baillairgé a bâti
la Maison Têtu avec l'assistance d'Isaac Dorion, maître menuisier et
entrepreneur général; de Pierre Chateauvert, maître maçon; des maîtres
plâtriers Thomas Murphy et John O'Leary, et des maîtres peintres William
et James McKay.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Trestler
Vaudreuil-Dorion, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Trestler est situé
sur une pointe de terre qui s'avance dans une courbe de la rivière des
Outaouais, au centre de Vaudreuil-Dorion, Québec, près de la limite qui
séparait auparavant ces deux communautés. Un bel exemple d'architecture
québécoise traditionnelle, la maison est une demeure en moellons d'un
étage et demi sous un toit à deux versants datant de la fin du XVIIIe
siècle.
La valeur patrimoniale de la maison Trestler tient au fait qu'elle
illustre les qualités de la maison québécoise traditionnelle,
c'est-à-dire de l'architecture domestique québécoise vernaculaire de la
fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. John Joseph Trestler a
construit cette maison en trois étapes : le corps central en 1798,
l'aile ouest en 1805 et l'aile est en 1806. Marchand ambitieux, Trestler
était déterminé à faire fortune en élargissant ses activités
commerciales basées à Montréal. Il a bâti cette demeure prestigieuse au
bord de la rivière des Outaouais, principale artère fluviale vers le
Haut-Canada et l'Ouest. Les descendants de Trestler ont occupé la maison
sans trop la modifier jusqu'en 1927. En 1984, elle est devenue la
propriété de la fondation Trestler, une fiducie privée créée pour
assurer sa préservation et son accès au public en tant qu'édifice
patrimonial.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2000 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Van-Horne / Shaughnessy
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Van-Horne /
Shaughnessy est situé dans le centre-ville de Montréal, au Québec. La
composition symétrique est formée de deux maisons jumelées de style
Second Empire, qui seront plus tard fusionnées en une seule grande
demeure bourgeoise. Avec ses pavillons, ses baies et sa crête décorative
en fer forgé ornant la ligne de toit, cet élégant édifice est maintenant
entouré sur trois de ses flancs par les édifices et jardins du Centre
Canadien d'Architecture.
Conçues et construites par William T. Thomas en 1874, la
Maison-Van-Horne / Shaughnessy commémore l'époque où le Boulevard
René-Lévesque (autrefois la rue Dorchester) était bordé de grandes
résidences cossues entourées de jardins paysagers. Le toit mansardé, les
fenêtres en baie à deux étages, les façades symétriques et les murs en
pierre de textures variées rappellent les influences architecturales de
l'époque, le style Second Empire et l'usage traditionnel de la pierre
grise de Montréal. La maison ouest fût originellement construite pour
Duncan McIntyre tandis que celle à l'est fût d'abord occupée par William
Van Horne puis par T.G. Shaughnessy, des hommes liés aux travaux de
construction et de consolidation du Chemin de fer Canadien Pacifique.
Au fil des années, plusieurs modifications touchant les intérieurs ont
été apportées. L'édifice historique menacé de démolition dans les années
1980, fût réhabilité et intégré au nouveau bâtiment du Centre Canadien
d'Architecture suivant les dessins de l'architecte Peter Rose. La
Maison-Van-Horne / Shaughnessy abrite depuis les salles de réception et
les bureaux du musée du Centre Canadien d'Architecture.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, N. Clerk, 1999 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Wilfrid-Laurier
Victoriaville, Québec
Situé dans l'ancienne municipalité d'Arthabaska (maintenant fusionnée à
Victoriaville), au Québec, le lieu historique national du Canada de la
Maison-Wilfrid-Laurier est un bâtiment à deux étages de style
«italianisant». Cette élégante résidence de brique rouge, autrefois
celle du Premier ministre Sir Wilfrid Laurier, se trouve sur un terrain
attrayant, derrière une entrée en demi-cercle bordée d'érables matures.c
La maison Wilfrid Laurier fut désignée lieu historique national du
Canada en 1999 en raison de son lien direct avec un personnage
historique d'importance nationale, soit l'ancien Premier ministre du
Canada, Sir Wilfrid Laurier.c
Construit entre 1876 et 1877 selon les exigences de Laurier, le bâtiment
lui a servi de résidence principale pendant 20 ans et illustre sa
réussite en tant qu'avocat dans la région d'Arthabaska. Cette maison fut
sa principale résidence jusqu'à son élection au poste de Premier
ministre en 1896, après laquelle il continua de la visiter régulièrement
et d'y habiter l'été jusqu'à sa mort en 1919. La maison fut
éventuellement léguée au gouvernement du Québec qui y créa un musée à la
mémoire de Sir Wilfrid Laurier. Après l'ouverture du musée en 1929,
certaines modifications ont été apportées à la résidence afin de mieux
remplir ses fonctions muséologiques.
|

©Regimental Museum |
Lieu historique national du Canada du Manège-Militaire-du-Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada
Montréal, Québec
Lieu historique national du Canada du Manège-Militaire-du-Black Watch
(Royal Highland Regiment) of Canada est situé sur une artère très
fréquentée du centre-ville de Montréal, au Québec. Le manège est un
bâtiment au plan irrégulier, composé, à l'avant et à l'arrière, de deux
blocs de deux étages au toit plat entre lesquels s'intercale la vaste
salle d'exercice au toit en pignon. Ornée de motifs rappelant les
châteaux seigneuriaux écossais, la façade principale symétrique est
parée de pierre calcaire de Montréal, rustiquée et texturée, de couleur
grise. Les noms, passé et actuel, du régiment figurent en lettres de
métal au-dessus de l'entrée. Les autres façades sont revêtues de brique.
Depuis 1906, le manège militaire abrite le Black Watch, l'un des
premiers régiments du Canada. Le régiment, alors appelé le Royal Light
Infantry, est levé en 1862 par des hommes d'affaires écossais de
Montréal en même temps que cinq autres régiments d'infanterie, durant la
période d'expansion rapide de la milice active volontaire du Canada. Le
régiment Black Watch of Canada participe, avec son pendant écossais, à
la Guerre des Boers et aux deux guerres mondiales. Après la Seconde
Guerre mondiale, il prend part à diverses opérations militaires et
missions de paix jusqu'en 1970, année de son retrait de la Force
régulière, et du maintien de son statut de milice active.
Afin de souligner les origines écossaises du régiment, la façade
principale du manège militaire arbore le style des châteaux seigneuriaux
écossais, comme en témoignent les tours, les tourelles et la fausse
herse. Le manège militaire Black Watch est l'un des six construits à
Montréal. Conçus pour l'entreposage et l'entraînement, ces manèges, avec
leur salle d'exercices, leur salle de classe et leurs installations
récréatives, ont joué un rôle important dans la modernisation de la
milice.
Le manège militaire et le régiment Black Watch occupent encore une place
de choix dans la communauté, notamment en accueillant de nombreuses
activités très prisées du public. Le régiment est particulièrement bien
connu pour son défilé annuel religieux, ainsi que pour sa participation
à divers défilés durant l'année. Il s'occupe aussi de nombreuses oeuvres
caritatives qui viennent en aide aux anciens combattants et à d'autres
organismes connexes. Le manège militaire est régulièrement utilisé pour
des activités locales et des campagnes de financement, à l'appui de la
communauté gaélique de Montréal et des environs.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Andrew Waldron, 2014 |
Lieu historique national du Canada du Manège-militaire-Voltigeurs-de-Québec
Québec, Québec
Le Manège militaire Voltigeurs de Québec à Québec est un vaste bâtiment
de style château sis au 805, av. Wilfrid-Laurier à Québec. Érigé juste à
l'extérieur des murs de la vieille ville, en bordure des plaines
d'Abraham, le manège domine le terrain d'exercice d'origine avec lequel
il a un lien indissociable. La conception fantaisiste du bâtiment, avec
son haut toit pentu, ses murs de pierre et ses tourelles à pinacle, en a
fait un véritable symbole de l'architecture canadienne.
Le Manège militaire Voltigeurs de Québec a été désigné lieu historique
national en 1986 en raison de son rôle de précurseur du style château au
Canada.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du Manège
militaire Voltigeurs de Québec à Québec réside dans le fait qu'il
exprime des éléments de conception qui ont fini par être considérés
comme typiques du style château au Canada. Conçu par l'architecte
québécois Eugène-Étienne Taché pour le ministère des Travaux publics du
Canada et terminé en 1887, le Manège militaire Voltigeurs de Québec
évoque les châteaux français de la Renaissance. Seul en son genre au
Canada, il souligne les racines françaises de Québec. Le manège a été
agrandi en 1913.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Jocelyne Cossette, 1997 |
Lieu historique national du Canada du Manoir-le-Boutillier
Gaspé, Québec
Le lieu historique national du Canada du Manoir-le-Boutillier se dresse
fièrement en direction de l'Anse-au-Griffon, dans la région de Gaspé, au
Québec. Le manoir est un bel exemple de l'architecture domestique du
XIXe siècle au Québec, qui se distingue par ses formes et son style,
ainsi que par ses matériaux de construction et ses techniques
d'assemblage. Il s'agit d'une maison à composition symétrique avec un
toit à deux versants, un larmier retroussé et un cintre à courbure
élégante qui projette une agréable impression d'harmonie et d'unité.
Construite entre 1850 et 1860, le manoir le Boutillier se distingue
nettement des modestes maisons de pêcheurs construites le long du
littoral gaspésien. Elle a servi de résidence secondaire à John Le
Boutillier, commerçant, homme politique et juge de paix, ainsi que de
bureau pour les gérants de son comptoir de pêche de l'Anse-au-Griffon.
Maison à larmier cintré, sa conception néoclassique s'exprime dans ses
formes élégantes, sa façade symétriquement agencée ainsi que par son
décor intérieur dépouillé. À la fois harmonieuse et insolite, la
configuration de son larmier la range dans une catégorie particulière de
l'architecture québécoise, dont il ne subsiste que peu d'exemples de nos
jours.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Manoir-Mauvide-Genest
Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, Québec
Le lieu historique national du Canada du Manoir-Mauvide-Genest est situé
sur la rive sud de l'Île d'Orléans, au 1451, chemin Royal, dans la
municipalité de Saint-Jean. Le chemin Royal, qui fait le tour de l'île,
traverse le site qui est donc divisé en deux : un petit lot au sud, près
du fleuve Saint-Laurent et un grand lot compris entre la route et une
petite colline boisée sur laquelle s'élève un imposant manoir en pierre
du XVIIIe siècle. Les deux lots renferment plusieurs dépendances plus
récentes.
La valeur patrimoniale du manoir Mauvide-Genest tient à la forme, aux
matériaux et au cadre rural de sa résidence, associés au XVIIIe siècle,
et à son illustration de la subdivision des terres sous le régime
seigneurial français. De par sa taille, la proximité du fleuve
Saint-Laurent et d'un ruisseau, ainsi que l'accès à un lot boisé, la
propriété possède toutes les caractéristiques d'une seigneurie rurale le
long du Saint-Laurent.
Faisant à l'origine partie de la seigneurie de l'Île d'Orléans, la
propriété du manoir Mauvide-Genest a été créée à partir d'un domaine
appartenant à Charles Genest. Le petit-fils de ce dernier, Jean Mauvide,
a acheté une partie de la propriété en 1734 et a ajouté la portion
sud-ouest de la propriété actuelle en 1752. Au moment de la
construction, la façade de la résidence, orientée vers le sud, dominait
un jardin et le fleuve. L'embourgeoisement du terrain et du manoir au
XVIIIe siècle semble cependant attribuable à un propriétaire ultérieur.
Bien qu'il ne soit pas isolé de la route par une grande étable comme
c'est généralement l'usage, le manoir Mauvide-Genest est une résidence
imposante qui contribue beaucoup à l'atmosphère historique de l'Île
d'Orléans.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2004 |
Lieu historique national du Canada du Manoir-Papineau
Montebello, Québec
Manoir du XIXe siècle, résidence du chef des Patriotes Louis-Joseph
Papineau.
Situé à Montebello, à mi-chemin entre Hull/Ottawa et Montréal, le lieu
historique national du Manoir-Papineau constitue l'un des joyaux
patrimoniaux de la région de la Petite-Nation et de la grande région de
l'Outaouais.
La mise en valeur du site rend d'abord hommage à Louis-Joseph Papineau,
personnage historique dont le rôle majeur sur la scène politique
nationale du pays au XIXe siècle est largement reconnu. Elle met aussi
en relief une imposante œuvre architecturale, conçue et réalisée par
Louis-Joseph Papineau, soit l'ensemble du manoir et du domaine de «
Monte-Bello ».
Le manoir Papineau est une vaste résidence élégante construite sur un
terrain paysager, au sommet d'un cap donnant sur la rive nord de la
rivière des Outaouais à Montebello au Québec, à mi-chemin entre Ottawa
et Montréal. Le bâtiment est à quelque distance de l'hôtel Château
Montebello.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Manoir-Papineau a
trait au manoir qui est en quelque sorte le reflet des goûts et des
connaissances (incluant ses habitudes de lecture, ses connaissances en
agriculture, ses goûts pour l'éclectisme en architecture et son intérêt
pour la généalogie) de l'avocat, seigneur et homme politique,
Louis-Joseph Papineau. Louis-Joseph Papineau a quitté la scène politique
canadienne en 1854 mais il s'était déjà établi dans son domaine en 1845.
La plupart des bâtiments du domaine ont été construits avant sa mort, en
1871. La famille a continué d'occuper la propriété jusqu'en 1929, date à
laquelle celle-ci a été vendue à une société de placement, renommé le «
Seigniory Club » en 1933, puis au Canadien Pacifique en 1949. Parcs
Canada a depuis restauré le domaine qui est ouvert au public.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Marché-Bonsecours
Montréal, Québec
De style néoclassique, le marché Bonsecours est un édifice monumental en
maçonnerie, coiffé d'un dôme, qui couvre tout un pâté de maisons du «
Vieux-Montréal ». Érigé tout près du vieux port, il est l'un des
symboles de la ville. À l'origine, il abritait le premier hôtel de Ville
de Montréal, un marché public, des salles de réunion et d'exposition, et
une salle de concert. Réhabilité au milieu du XXe siècle, il accueille
maintenant des expositions, des boutiques et des restaurants.
Imposant édifice de style néoclassique et le plus vaste Hôtel de Ville
construit au Canada au milieu du XIXe siècle, le marché Bonsecours a été
désigné lieu historique national en 1984 parce qu'il témoigne de
l'accession de Montréal au rang de métropole et parce qu'il a abrité un
marché et des salles publiques, en plus d'être pendant quelques années
l'Hôtel de Ville de Montréal.
La valeur patrimoniale du lieu réside dans le rôle qu'il a joué dans
l'histoire de la ville de Montréal ainsi que dans sa conception et sa
réalisation imposantes. L'édifice a été construit de 1844 à 1847 selon
les plans de l'architecte William Footner, et une salle de concert a été
ajoutée en 1852 par l'architecte George Browne. Inauguré en 1847 comme
marché public, l'édifice a brièvement accueilli le Parlement des deux
Canada en 1849, et il a été l'Hôtel de Ville de Montréal de 1852 à 1878.
Le marché Bonsecours a été le principal marché public de Montréal
pendant plus d'un siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, A. Waldron, 2000. |
Lieu historique national du Canada Masonic Memorial Temple
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada Masonic Memorial Temple est un
bâtiment en pierre monumental et élégant de style néo-classique
construit en 1929 et 1930. Conçu dans la tradition des Beaux-Arts, il
rappelle un temple grec et occupe la plus grande partie d'un terrain
d'angle situé en plein cœur de Montréal. Sa façade principale,
imposante, présente une base de calcaire rustiqué, quatre ouvertures et
une entrée centrale flanquée de deux colonnes autoportantes coiffées
l'une d'une sphère terrestre, l'autre d'une sphère céleste. La double
porte principale est faite de bronze. Des sculptures ornementales ainsi
que des mots en relief agrémentent la ceinture décorative qui sépare la
base de la partie supérieure du bâtiment. La propriété suit la pente du
centre-ville.
L'édifice, érigé à la mémoire des francs-maçons ayant combattu et péri
durant la Première Guerre mondiale, sert aujourd'hui de lieu de
rassemblement et de centre administratif à la Grande loge du Québec.
Conçu par l'éminent architecte montréalais John Smith Archibald en
1929-1930, le Masonic Memorial Temple fait appel à une forme de
classicisme privilégiée par le mouvement Beaux-Arts durant les premières
décennies du XXe siècle. Avec son portique bien en vue, son entrée
rappelant celle d'un temple et ses vastes surfaces aveugles, le bâtiment
rappelle un temple grec traditionnel. Le plan intérieur complexe suit
les principes Beaux-Arts de symétrie rationnelle pour évoquer le temple
de Salomon.
Le classicisme associé au mouvement Beaux-Arts convenait fort bien à
l'expression de la moralité de la franc-maçonnerie, une organisation
fraternelle qui cherchait son identité dans le passé et qui était
convaincue de la supériorité de l'Antiquité et de l'architecture
classique. Les rituels maçonniques mettaient l'accent sur la droiture
morale et faisaient appel au langage scientifique et mathématique, ainsi
qu'à la mécanique du bâtiment. Les convictions morales des francs-maçons
sont symbolisées par la conception et par les détails du temple,
d'expression classique.
|

©Canadian Inventory of Historic Buildings / Inventaire des bâtiments historiques du Canada, 1966 |
Lieu historique national du Canada de la Mission-de-Caughnawaga / Mission-Saint-François-Xavier
Kahnawake, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Mission-de-Caughnawaga /
Mission-Saint-François-Xavier est situé sur les rives de la voie
maritime du Saint-Laurent, dans le territoire des Mohawks de Kahnawake,
au Québec. Des missionnaires jésuites ont établi la mission en
1716-1718. Le lieu compte quatre éléments: l'église
Saint-François-Xavier (1845), le vieux presbytère (1716-1719) y compris
son aile Ouest et son corridor, la sacristie (1831-1832) et le musée
(1914). La mission se dresse dans l'enceinte du lieu historique national
du Canada Fort-St-Louis.
La mission Saint-François-Xavier a été fondée par les Jésuites en 1667 à
La Prairie pour y desservir les Iroquois chrétiens. Des difficultés
économiques la forcent à changer d'endroit à plusieurs reprises jusqu'à
son établissement définitif à Kahnawake en 1716.
Le vieux presbytère, érigé entre 1716 et 1719, est le plus ancien
bâtiment qui subsiste en ce lieu. L'aile Ouest, qui jouxte le
presbytère, et la vieille église est construite peu après, en 1720. Les
Mohawks de Caughnawaga sont les alliés des Français jusqu'à la chute de
la Nouvelle-France. En 1725, cette alliance amène les Français à
construire une palissade en bois, qui sera par la suite remplacée par un
ouvrage de maçonnerie, afin de protéger la mission. Les vestiges de
cette palissade délimitent l'enceinte du lieu historique national
Fort-St-Louis dont fait partie la mission. En 1831, l'église
Saint-François-Xavier, vouée à l'éducation des Iroquois convertis, se
voit dotée d'un nouveau clocher et d'une sacristie.
|
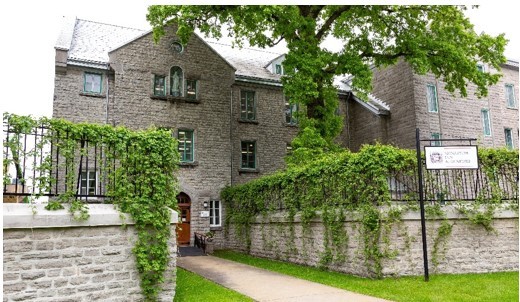
©Étienne Richard / Monastère de l'Hôpital général de Québec |
Lieu historique national du Monastère-de-l’Hôpital-général-de-Québec
Québec, Quebec
Le monastère de l’Hôpital général de Québec, situé à Québec à la
jonction des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur, est un vaste
ensemble conventuel datant du XVIIe siècle, aménagé sur l’ancienne
propriété des Récollets. Situé sur le territoire traditionnel de
plusieurs Premières Nations, cet ensemble conventuel occupé de façon
continue par les Augustines depuis 1693 constitue un éloquent témoin de
leur œuvre hospitalière. Plus ancien établissement conventuel au pays,
il revêt une importance capitale pour l’histoire hospitalière,
religieuse et sociale du Canada. S’inspirant de la tradition européenne,
les bâtiments du monastère des Augustines illustrent de façon
remarquable l’évolution de l’architecture et des techniques de
construction au pays depuis la seconde moitié du XVIIe siècle. Hors de
portée des bombardements pendant le siège de Québec de 1759 et n’ayant
jamais subi d’incendie majeur, les bâtiments témoignent d’une grande
authenticité. L’ensemble constitue un lieu de préservation d’un
patrimoine architectural et artistique de première importance, lequel
est dans un état de conservation remarquable.
Le monastère de l’Hôpital général de Québec s’est développé sur l’ancien
domaine des Récollets. Arrivés en Nouvelle-France en 1615, les Récollets
établissent leur couvent en bordure de la rivière Saint-Charles à partir
de 1620. Après un exil forcé par la prise de Québec par les frères Kirke
à la solde de l’Angleterre, les Récollets reprennent possession de leur
domaine en 1670 puis construisent une église (1671-1673) et un nouveau
monastère en pierre (1680-1684). En 1692, l’évêque Jean-Baptiste de La
Croix de Chevrières de Saint-Vallier (1653-1727) acquiert le couvent des
Récollets et y fonde un hôpital général, ouvert aux pauvres, aux
malades, aux invalides ainsi qu’aux vieillards. En 1693, il confie la
direction de cet hospice aux Augustines de la Miséricorde de Jésus, une
communauté de sœurs hospitalières cloîtrées qui sont déjà responsables
de l’Hôtel-Dieu de Québec. Le monastère de l’Hôpital général de Québec
sert d’hôpital militaire pendant la guerre de Sept Ans et
particulièrement pendant le siège de Québec (1759) et la bataille de
Sainte-Foy (1760), accueillant sans distinction les soldats blessés,
alliés ou ennemis. En 1775, le monastère est occupé par les
révolutionnaires de la Nouvelle-Angleterre. Il est le lieu de refuge de
la population victime des grands incendies dans les quartiers adjacents
de Saint-Roch (1845) et de Saint-Sauveur (1866).
L’ensemble conventuel comprend les onze ailes du monastère construites
entre 1671 et 2002 en plus de la maison du jardinier (1840) et sa
dépendance. Outre ces bâtiments, il comprend plusieurs grands espaces
paysagers, un jardin et trois cimetières. Le complexe architectural, de
plan irrégulier, est formé de plusieurs ailes correspondant à l’ancien
hôpital général et au monastère des Augustines : seule la partie
correspondant au monastère, toujours propriété des Augustines, fait
l’objet de la désignation. Certaines parties de l’ensemble conventuel
témoignent de l’aspect original du décor du monastère, dont le
réfectoire du bâtiment des Récollets, avec ses lambris en pin, et la
chapelle Notre-Dame-des-Anges, avec sa voûte cintrée en bois, son
retable (derrière lequel on retrouve les vestiges d’un mur en colombage
pierroté, très rare illustration de l’arrangement des églises
récollettes), son lambris décoré de paysages peints et ses œuvres d’art.
En 1999, les religieuses se départissent de la section du bâtiment qui
servait d’hôpital général. L’endroit devient un Centre d’hébergement de
soins de longue durée (CHSLD) géré par le gouvernement du Québec.
|

©Ursulines Monastery, Giovanni Variottinelli, August, 2008. |
Lieu historique national du Canada du Monastère-des-Ursulines
Québec, Québec
Le Lieu historique national du Canada du Monastère-des-Ursulines est un
ensemble impressionnant de bâtiments en pierre des XVIIe, XVIIIe et XIXe
siècles, situé au 18, rue Donnacona, au sommet de la colline, dans la
Haute-Ville de Québec. L'autel de la chapelle, qui date de 1730, est un
des chefs-d'oeuvre de la sculpture sur bois au Canada français.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du
Monastère-des-Ursulines tient à son architecture et notamment aux
vestiges du XVIIe siècle qui reflètent ses racines historiques, à son
excellence architecturale en tant qu'ensemble de bâtiments construit
avant 1880, et à l'exécution remarquable de l'autel de la chapelle. Un
premier monastère a été construit sur les lieux en 1641-1642, deux ans à
peine avant que sa fondatrice, Marie de l'Incarnation, n'arrive au
Canada avec ses compagnes. Le couvent d'origine est détruit par le feu
en 1650, tout comme son successeur. Ce deuxième couvent, incendié en
1686, n'en a pas moins établi le tracé de l'ensemble actuel qui comprend
15 bâtiments construits en six vagues successives entre 1687 et 1850.
Des vestiges de chacune de ces vagues subsistent. L'ensemble renferme
des oeuvres de grande qualité réalisées par des artisans de renom comme
Charles Baillargé et Noël et Pierre-Noël Levasseur, de Québec.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1998 |
Lieu historique national du Canada de Monklands / couvent Villa Maria
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada de Monklands / Couvent-Villa Maria
est situé sur le boulevard Décarie à Montréal, Québec. Monklands est une
demeure en pierre de deux étages qui constitue de nos jours une partie
de l'école privée Villa Maria. Son corps central de style néo-palladien,
partie la plus ancienne du couvent, a été la résidence officielle des
gouverneurs généraux du Canada de 1844 à 1849, lorsque Montréal était la
capitale de la Province unie du Canada.
Cette demeure de style néo-palladien qui constitue aujourd'hui le corps
central et la partie la plus ancienne de l'école privée, a été
construite en 1804 sur un domaine ayant appartenu à la famille Décarie
et ensuite acquis par le juge en chef James Monk en 1794. Elle a été
louée en 1844, par la nièce de Monk, à la Couronne qui en fait la
résidence officielle du gouverneur général du Canada et l'a modifiée en
conséquence. De 1844 à 1849, elle a été la résidence de trois
gouverneurs généraux à Montréal, soit Sir Charles Metcalfe, lord
Cathcart et lord Elgin. Après 1849, la demeure fut transformée en hôtel
par ses nouveaux locataires, puis achetée en 1854 par la Congrégation de
Notre-Dame pour y abriter un couvent et un pensionnat appelé Villa
Maria.
La valeur patrimoniale de Monklands / Couvent-Villa Maria se limite à la
partie la plus ancienne du bâtiment, qui a été la résidence des
gouverneurs généraux du Canada de 1844 à 1849; aux éléments de style,
aux matériaux, au plan, à la qualité d'exécution, au mobilier et aux
installations de la demeure qui datent de la période de 1844 à 1849.
Elle est également liée à son emplacement et aux vestiges témoignant de
sa situation.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |
Lieu historique national du Canada du Monument-national
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada du Monument-national, situé sur le
boulevard Saint Laurent, à Montréal (Québec), est un imposant bâtiment
de quatre étages de style renaissance et d'inspiration éclectique
abritant un théâtre et un centre culturel. Sa façade, recouverte d'un
parement en pierre de taille grise, s'articule clairement sur quatre
étages et est caractérisée par un fenestrage varié, des cordons et des
corniches. La façade arrière, recouverte de brique rouge, est dominée
par six arcades partiellement aveugles et comporte deux oriels à deux
étages coiffant deux fenêtres carrées.
En 1884, l'association Saint-Jean-Baptiste de Montréal annonce la
construction d'un centre culturel polyvalent sur le boulevard Saint
Laurent, à Montréal. Ce bâtiment, appelé le Monument national, devint le
centre administratif de la Société et sert également à promouvoir la
culture canadienne-française. La construction du bâtiment débute en 1891
et se termine en 1894. Le théâtre principal est, quant à lui, inauguré
le 25 juin 1893. Considéré comme le « cœur de l'Amérique française », le
Monument national a été un symbole du nationalisme québécois. La Société
canadienne d'opérette y est fondée par Honoré Vaillancourt en 1921.
Parmi les nombreuses vedettes ayant foulé les planches du Monument
national, mentionnons Emma Albani, La Bolduc et Alys Robi.
Le Monument national sert également d'espace de discussion politique à
Montréal et accueille des politiciens comme Honoré Mercier, Wilfrid
Laurier et Henri Bourrassa. Par ailleurs, des militantes bien connues en
faveur des droits de la femme, notamment Idola Saint-Jean et Marie Gérin
Lajoie, dirigent le mouvement féministe québécois à partir de cet
endroit, exigeant que le Code civil du Québec soit passé en revue et
réclamant, au nom des femmes, le droit de vote ainsi que le droit de
fréquenter des établissements d'enseignement postsecondaire. De plus,
des locaux sont aménagés au sein du Monument national, souvent appelé «
l'université du peuple », afin de favoriser l'égalité d'accès à
l'éducation pour les hommes et les femmes.
Au fil du temps, le Monument national accueille également les
collectivités juives, chinoises et anglaises de Montréal. De 1903 à
1935, on y célébre des offices religieux. En 1919, c'est au Monument
national que se tient la première réunion du Congrès juif canadien. En
outre, jusqu'en 1950, des productions yiddish y sont présentées, suivies
par des productions chinoises et anglaises. Le Monument national a par
ailleurs été l'un des premiers endroits en Amérique du Nord où l'on a
présenté des projections cinématographiques.
En 1978, l'École nationale de théâtre du Canada s'est portée acquéreur
du Monument national, et elle a procédé à sa rénovation entre 1991 et
1993.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Andrew Waldron, 2014 |
Lieu historique national du Canada de Morrin College — Ancienne-Prison-de-Québec
Québec, Québec
Lieu historique national du Canada de Morrin College /
Ancienne-Prison-de-Québec est un imposant bâtiment public en pierre de
quatre étages situé à Québec. Il a été construit au cours de la période
1808-1814 pour servir de prison. Converti en collège en 1868, il abrite
depuis lors la bibliothèque et les archives de la Société littéraire et
historique de Québec.
Suivant les principes de Howard, le plan intérieur de la prison
prévoyait la séparation des détenus dans des blocs cellulaires selon le
type et la gravité de leur crime. Chaque bloc comprenait une aire
commune réservée aux activités de réadaptation et donnant accès à des
latrines. La prison fut également l'un des premiers édifices carcéraux
totalement séparés d'un palais de justice.
Conçu par l'architecte québécois François Baillairgé (1759-1830), le
bâtiment reflète les traditions de l'architecture palladienne, telle que
pratiquée en Angleterre, et de l'architecture française. Importé par des
administrateurs et des ecclésiastiques britanniques après la conquête,
le style néopalladien est devenu populaire au Canada au début du XIXe
siècle pour l'architecture domestique et religieuse. Baillairgé a été
l'un des premiers architectes québécois à construire un bâtiment
administratif inspiré de ce style. Il a donné au bâtiment une apparence
originale en faisant appel à des dimensions et à des ornements
inhabituels et en disposant les diverses composantes selon un
arrangement français du XVIe siècle fondé sur un rapport mathématique.
Les menuisiers Charles Marié et Pierre Fauché, le charpentier
J.-Baptiste Bédard, les maçons Édouard Cannon et fils, le verrier Pierre
Romain et le ferronier Pierre le François font partie des artisans qui
ont participé à la construction de la prison. Le bâtiment a été converti
en collège anglophone en 1868 suite aux travaux de l'architecte
Joseph-Ferdinand Peachy. Depuis lors, il est devenu le siège de la
Société littéraire et historique de Québec, elle-même une institution
désignée d'importance historique nationale.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1999 |
Lieu historique national du Canada du Moulin-Légaré
Saint-Eustache, Québec
Le lieu historique national du Canada du Moulin-Légaré se trouve entre
la falaise de la rive nord de la rivière du Chêne et la rue principale
du village de Saint-Eustache au Québec. Situé devant l'hôtel de ville,
le moulin n'a jamais cessé de fonctionner depuis sa mise en service
pendant le régime français. L'ensemble industriel comprend la maison du
meunier, un moulin à farine, un moulin à scie, une digue et un bassin de
retenue, qui sont tous visés par la désignation officielle.
La valeur patrimoniale du moulin Légaré tient à sa continuité physique
et fonctionnelle, à la cohésion de son ensemble, à ses formes
utilitaires et aux diverses traditions vernaculaires de ses bâtiments
ainsi qu'aux traces d'une évolution technique constante. Le moulin
Légaré a été construit en 1762-1763 par François Maisonneuve sur une
terre que le seigneur des Milles-Isles lui avait cédée à la condition
qu'il y bâtisse un moulin. De nos jours, cet ensemble compte un moulin à
farine (1762-1763), un moulin à scie (1880), une maison de meunier
(1902-1903), une digue et un bassin de retenue (1762-1763). Ces
ressources sont le reflet de diverses époques de construction
vernaculaire ainsi que de l'évolution des techniques de mouture. Le lieu
tient son nom de la famille Légaré, propriétaire du moulin au XXe
siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2004 |
Lieu historique national du Canada du Moulin-Rond-en-Pierre-et-Maison
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Québec
Le lieu historique national du Canada du
Moulin-Rond-en-Pierre-et-Maison, aussi connu sous le nom du parc
historique de la Pointe-du-Moulin, est situé près du lac Saint-Louis sur
un site plat de la pointe est de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Québec. Le
site est composé d'un moulin à vent en pierre qui est extrêmement rare
et la maison du meunier qui date du régime seigneurial du XVIIIe siècle.
Cet ensemble est l'un des derniers à subsister. Les deux bâtiments sont
construits en mur plein et moellons avec des petites fenêtres et des
portes basses.
Le moulin rond en pierre et la maison a existé comme un ensemble des
bâtiments interdépendant depuis au moins la fin du XVIIIe siècle. Le
moulin à vent, a été conçu par Stephen Starenky pour Joseph Trottier
Desruisseaux, qui a fait construire le moulin à vent en 1712 à l'usage
des habitants afin de meuler le blé en farine. La maison du meunier date
de la période 1712-1791, mais a probablement été bâtie en même temps que
le moulin. Leur valeur patrimoniale tient au fait qu'ils ont subsisté en
tant qu'ensemble et que chaque structure est un exemple des premières
méthodes de construction.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1982 |
Lieu historique national du Canada du Nouvel-Édifice-de-la-Douane-de-Québec
Québec, Québec
De style néo-classique, le nouvel édifice de la douane de Québec est un
immeuble de pierre doté d'un portique à fronton et d'un dôme central.
Les détails de l'extérieur révèlent une forte influence du style à
l'Italienne. Le nouvel édifice de la douane est situé dans le Vieux-Port
de Québec. Ce quartier, bien visible à partir du fleuve, possède
maintenant une vocation résidentielle et récréative et occupe une grande
étendue plate, la Pointe-à-Carcy, au bas de la vieille ville de Québec.
Le nouvel édifice de la douane de Québec a été désigné lieu historique
national en raison de son style à l'Italienne et parce qu'il reflète
l'essor remarquable de Québec lorsque la ville était le principal centre
du commerce du bois d'œuvre et de la construction de navires en bois
dans la vallée du Saint-Laurent.
Le nouvel édifice de la douane de Québec est un exemple remarquable
d'édifice public de style néo-classique orné d'une profusion de détails
à l'Italienne. Il est l'un des nombreux édifices publics conçus au
milieu du XIXe siècle par le célèbre architecte torontois William
Thomas, dont il porte d'ailleurs les touches décoratives personnelles :
pierres fortement vermiculées et clefs de voûte anthropomorphiques
sculptées. Bien que des parties de l'extérieur de l'édifice aient été
modifiées à la suite d'incendies majeurs en 1864 et en 1909 et que
l'intérieur ait été complètement refait en 1910, l'édifice de la douane
a conservé sa forme et ses éléments néo-classiques de base de même que
le style à l'Italienne qui caractérise cette époque et cet architecte.
L'intérieur de style Beaux-Arts datant du début du XXe siècle est
soigneusement intégré à l'extérieur de style néo-classique.
Le nouvel édifice de la douane de Québec a été construit dans le cadre
de l'expansion du réseau des douanes au milieu du XIXe siècle. C'est le
plus grand exemple encore existant des nombreuses installations
construites pendant les années 1850 au cours de la réorganisation de la
fonction des douanes. Sa taille et son emplacement reflètent
l'importance constante des douanes en tant que principale source de
recettes publiques pour le gouvernement au XIXe siècle.
Le nouvel édifice de la douane de Québec témoigne de la prospérité de
Québec dans les années 1850, de sa position en tant qu'une des deux
capitales par alternance du Canada et de son importance constante comme
port sur le fleuve Saint-Laurent. En dépit de la concurrence croissante
exercée par Montréal, Québec est demeuré le principal port canadien pour
le commerce du bois d'œuvre au XIXe siècle et la construction navale, le
fondement de son économie. La construction d'un nouvel édifice de grande
qualité pour la douane était justifiée par l'importance du trafic
portuaire à Québec.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2009 |
Lieu historique national d’Obadjiwan–Fort-Témiscamingue
Ville-Marie, Québec
Vestiges d'un poste français de traite des fourrures.
Les Français bâtirent un fort sur les rives de ce lac vers 1685 pour
concurrencer les marchands anglais de la baie d'Hudson. Abandonné vers
1690, le fort fut remis en service en 1720 et affermé à des marchands
jusqu'à la capitulation de la Nouvelle-France. Après la Conquête, des
marchands indépendants s'établirent autour du lac. Dans les années 1790,
la Compagnie du Nord-Ouest y avait pratiquement obtenu le monopole de la
traite grâce à l'habile gestion d'Aeneas Cameron. Les descendants de
Cameron administrèrent le fort après la fusion des compagnies de la Baie
d'Hudson et du Nord-Ouest en 1821.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, N. Clerk, 2002 |
Lieu historique national du Canada de l'Oratoire-Saint-Joseph-du-Mont-Royal
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada de
l'Oratoire-Saint-Joseph-du-Mont-Royal est un vaste lieu de pèlerinage de
l'Église catholique romaine situé sur le flanc nord du mont Royal, dans
la ville de Montréal au Québec. Dominé par l'immense dôme de la
basilique, l'endroit est un repère visible à des kilomètres à la ronde.
Les pèlerins pénètrent sur les lieux en franchissant les portes de
l'enceinte et en suivant l'axe sacré et le chemin de Croix qui traverse
un jardin du côté est, jusqu'à un ensemble de bâtiments dont la
basilique est le point central.
La valeur patrimoniale du lieu réside dans sa signification spirituelle
et son histoire, comme l'illustre le paysage culturel formé par les
jardins et les bâtiments, la basilique en étant le point d'axe. La
valeur réside aussi dans l'intégration de ses caractéristiques bâties,
situées dans le paysage naturel du mont Royal.
L'oratoire Saint-Joseph du mont Royal tire ses origines de la
construction d'une petite chapelle conçue par le frère André et érigée
par le frère Abundius de 1904 et 1912. Cette première construction
modeste a été agrandie dans la première moitié du XXe siècle grâce à la
participation de nombreux architectes et artistes importants, dont le
jardinier paysager Frederick G. Todd (jardin, 1943-1946), les
architectes Lucien Parent, avec Dom Paul Bellot et Ernest Cormier (dôme
de la basilique, 1937 et chapelle votive, 1946-1949 respectivement),
Louis Parent et Ercolo Barbiere (chemin de Croix, 1943-1953 et 1952-1958
respectivement). Aujourd'hui, il s'agit d'un paysage complexe aux
multiples composantes, dominé par la basilique (1924-1966) conçue par
les architectes Dalbé Viau et Alphonse Venne, et décorée par les
artistes Gérard Notebaert et Jean-Claude Leclerc.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2008. |
Lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-de-l'Isle-Verte
L'Isle-Verte, Québec
Le lieu historique national du Canada du
Palais-de-Justice-de-l'Isle-Verte se trouve dans la petite municipalité
de L'Isle-Verte, située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Ce
palais de justice, petit mais élégant, est situé sur la rue
St-Jean-Baptiste, qui traverse toute la communauté, reliant ainsi les
résidences et les établissements principaux. Il s'agit d'un élégant
bâtiment symétrique à ossature de bois d'un étage et demi, de style
Regency ou « cottage anglais », dont les ouvertures sont réparties
régulièrement et le toit en pavillon au sommet tronqué est coiffé d'un
belvédère.
Construit en 1859-1860, le palais de justice de l'Isle-Verte est un
exemple rare d'un bâtiment érigé expressément pour accueillir une cour
de circuit. Avant la Confédération, la province de Québec était divisée
en 21 districts judiciaires comptant des tribunaux dits supérieurs et
inférieurs. Les cours de circuit, qui se déplaçaient d'une localité à
l'autre selon un calendrier fixe, permettaient aux petites communautés
d'avoir accès au système judiciaire de la province.
Le palais de justice de l'Isle-Verte a été conçu dans le style Regency,
qui s'inscrit dans le mouvement pittoresque de la première moitié du
XIXe siècle. Surtout réservé aux résidences, ce style est plus rarement
utilisé pour des bâtiments publics au Québec. Conçu par Benjamin Dionne
dans la tradition de l'architecture résidentielle locale, le modeste
palais de justice de la ville de L'Isle-Verte abritait, sur un même
étage, les bureaux des juges, des avocats et du greffier. Un lanternon
et une terrasse faîtière rappellant les dômes des bâtiments publics plus
imposants confère à ce palais de justice un air solennel. Sa conception
simple et élégante convient parfaitement à sa vocation d'origine, qui
était de servir tantôt de tribunal, tantôt de salle communautaire. Le
palais de justice constitue un excellent exemple d'architecture
vernaculaire adaptée à un édifice public.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1982 |
Lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-de-Joliette
Joliette, Québec
Le lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-de-Joliette
est un imposant édifice en pierre de deux étages de style néo-classique,
construit de 1860 à 1862 pour servir tout à la fois de palais de
justice, de bureau d'enregistrement et de prison. Le bâtiment se compose
du corps central symétrique d'origine doté d'une aile arrière logeant la
prison, d'un agréable ajout de deux étages datant de 1916, et de deux
annexes bâties en 1960-1961.
Le palais de justice de Joliette est un excellent exemple, bien
préservé, d'édifice public de style néo-classique. Construit de 1860 à
1862 par le gouvernement du Canada-Uni pour ce qui était appelé à
l'époque le village de l'Industrie, il est l'un des quelques 28 palais
de justice ainsi érigés au Bas-Canada. Le palais de justice de Joliette
est conforme au plan normalisé de l'architecte du ministère des Travaux
publics du Canada-Uni, F. P. Rubidge, plan qui a servi pour 14 palais du
justice du Bas-Canada construits entre 1859 et 1863. On y trouve une
salle d'audience, au centre du rez-de-chaussée, flanquée d'une salle des
jurés d'un côté et de pièces pour les juges, les avocats et les petits
jurys de l'autre. À l'étage du corps central, on avait aménagé des
bureaux. L'aile arrière, servant de prison, était divisée en
cellules.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |
Lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-de-Québec
Québec, Québec
Le lieu historique national du Palais-de-Justice-de-Québec est un
édifice public massif de style Second Empire, bâti à la fin du XIXe
siècle. Il occupe un coin bien en vue de l'arrondissement historique de
la haute-ville, en face de la place d'Armes et tout près d'autres
bâtiments administratifs majeurs, d'époque et d'architecture similaires.
Adapté au terrain en pente, l'édifice s'élève sur quatre étages le long
de la rue Saint-Louis et sur cinq étages le long de la rue du Trésor.
La valeur patrimoniale du lieu réside dans son architecture et dans le
fait qu'il symbolise le système de justice québécois. Le palais de
justice de Québec a été construit de 1883 à 1887 pour accueillir tous
les tribunaux du district judiciaire de Québec. De par son échelle
grandiose, son traitement architectural complexe, son iconographie et
ses matériaux locaux, le palais de justice témoignait de l'attachement
de la province aux principes de la justice, de son assurance
nouvellement acquise et de sa fierté à l'endroit de son héritage
français. L'édifice a servi de palais de justice de 1887 à 1983.
Bel exemple du style Second Empire français, le palais de justice de
Québec se distingue par sa riche maçonnerie de pierre, son toit en
mansarde, sa décoration classique et sa silhouette animée. Ses plans ont
été dessinés par Eugène-Étienne Taché, architecte renommé à l'emploi du
ministère des Travaux publics de la province. Sa conception fait écho au
succès remporté par les édifices du Parlement de Québec (1877-1886),
également réalisés par Taché dans le style Second Empire.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Parc-Montmorency
Québec, Québec
Emplacement de l'évêché, parlement du Canada-Uni de 1851 à 1855.
Situé au cœur de la Ville de Québec, en haut de la Côte de la Montagne,
le lieu historique national du Canada du Parc-Montmorency est un parc
urbain formant une partie du lieu historique national du Canada des
Fortifications-de-Québec. Aucun vestige en surface ne témoigne de son
rôle comme emplacement du Parlement de la province du Canada; au lieu de
quoi, des vestiges de sa fonction dans l'histoire militaire, incluant la
vue sur le fleuve, la batterie et les murs de défense révèlent son rôle
au sein du système défensif de la cité. Le parc Montmorency compte
plusieurs monuments commémoratifs et plusieurs arbres à maturité.
En 1688, Monseigneur de Saint-Vallier fit l'acquisition de cette
propriété dans le but d'y édifier son palais épiscopal, lequel fut érigé
entre 1693 et 1695 selon les plans tracés par l'architecte Claude
Baillif. La structure fut lourdement endommagée durant le bombardement
de Québec en 1759; après réfection, l'édifice connut plusieurs usages,
jusqu'à ce qu'il soit loué par le gouvernement, à compter de 1777 pour
servir de bureau du Gouverneur. C'est ici que se réunit, à partir de
1792, l'assemblée législative du Bas-Canada. Finalement, en 1831,
l'édifice fut vendu au gouvernement et subit dès lors des modifications
et reconstructions importantes. À peine l'édifice terminé, en 1854,
qu'il fut rasé par un incendie. Un nouvel édifice érigé plus tard sur
les lieux abrita brièvement le Parlement de l'Union des Canadas. Après
la Confédération, l'édifice servit brièvement d'assemblée législative du
Québec, jusqu'à la construction de l'actuelle assemblée nationale. Il
fut, une fois de plus, détruit par le feu. En 1908, après des années
d'abandon, l'emplacement fut rasé et aplani pour donner naissance au
parc Montmorency.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Pavillon Hersey
Montréal, Québec
Situé sur le campus de l'hôpital Royal Victoria de Montréal, le lieu
historique national du Canada du Pavillon Hersey est un splendide
exemple encore existant du type de résidence construit expressément pour
les infirmières à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Il
s'agit d'une grande construction institutionnelle inspirée des châteaux
en calcaire montréalais affichant des détails historiques pittoresques
de l'époque comme les fenêtres regroupées, le toit escarpé muni de
lucarnes et les moulures élaborées.
Le pavillon Hersey de l'hôpital Royal Victoria fut la première résidence
construite expressément pour les infirmières au Canada. Il offrait des
installations pour l'étude et l'apprentissage et de l'hébergement sous
forme de chambres, de salons et une salle à manger. Ce bâtiment, ainsi
que les autres résidences destinées aux infirmières érigées dans
l'ensemble du pays, reflétaient le professionnalisme croissant des soins
infirmiers.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1997 |
Lieu historique national du Canada du Pavillon-Mailloux
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada du Pavillon-Mailloux est une
résidence d'infirmières de cinq étages, en brique, sur le campus de
l'hôpital Notre-Dame, à Montréal, au 1560, rue Sherbrooke Est, qui fait
maintenant partie du Centre hospitalier universitaire de l'Université de
Montréal. Très semblable de l'extérieur au reste de l'ensemble
hospitalier, il est situé derrière le pavillon est du bâtiment principal
auquel il est à présent relié. Comme les autres bâtiments de l'ensemble
hospitalier, il présente une volumétrie symétrique et rectangulaire, des
fenêtres régulièrement disposées et un toit plat.
La valeur patrimoniale du Pavillon Mailloux tient au rôle qu'il a joué
dans le développement de la profession infirmière et dans le témoignage
qu'il porte sur les soins de santé dispensés, la formation, la
communauté et le mode de vie de générations d'infirmières
professionnelles. Cette valeur est illustrée par l'emplacement,
l'implantation, la conception, la forme et la composition du bâtiment,
et notamment par l'intégrité de son plan intérieur fonctionnel qui
reflète les générations d'infirmières qui y ont été formées.
Le Pavillon Mailloux a été construit en 1931 pour servir de résidence
aux élèves de l'école d'infirmières de l'hôpital Notre-Dame. Fondée en
1897 par Mère Élodie Mailloux, de la communauté des Sœurs Grises, cette
école d'infirmières a été l'une des premières de langue française. La
construction de cette résidence confirmait les changements majeurs
survenus dans la reconnaissance du rôle des femmes, notamment au sein de
la profession d'infirmière. L'école possédait déjà une résidence
d'infirmières, aménagée dans une maison privée, depuis 1898, mais le
Pavillon Mailloux a été conçu sur mesure et renferme des chambres à
coucher et des espaces récréatifs. Une salle de cours et d'autres
installations pédagogiques étaient en outre situées tout près dans le
bâtiment Deschênes.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada le Pavillon Roger Gaudry, Université de Montréal
Montréal, Québec
Situé au cœur du campus de l'Université de Montréal, le pavillon Roger Gaudry
est un emblème montréalais important. Construit entre 1928 et 1943, il a été
conçu par l'architecte-ingénieur Ernest Cormier. La grande envergure et
l'aménagement fonctionnel du pavillon, conçu à l'origine pour accueillir des
laboratoires et un hôpital universitaire, témoignent de la nouvelle
appréciation du Canada français pour les disciplines scientifiques et la
recherche au cours de l'entre-deux-guerres ainsi que de l'émergence d'une
élite académique et scientifique francophone déterminée à soutenir
l'enseignement supérieur.
Cette vaste structure tentaculaire possède une tour centrale imposante de 82
mètres de hauteur. Sa conception combine la disposition symétrique et
hiérarchique de la tradition française des Beaux-Arts avec des
caractéristiques types de l'architecture moderne du XXe siècle, comme une
ossature en béton, des façades de maçonnerie éparses et des motifs
géométriques stylisés. L'envergure monumentale, les finitions de qualité et
l'attention à la couleur, à l'éclairage et à la texture des principaux lieux
de cérémonie — en particulier le hall d'honneur et l'amphithéâtre principal —
offrent une succession rare et remarquable d'intérieurs inspirés de l'Art
déco.
Le bâtiment fut conçu pour accueillir sous un même toit toutes les facultés
et les écoles de l'université, ainsi qu'un hôpital universitaire. À l'époque,
il s'agissait d'un aménagement novateur, appelé « plan compact ». Cette
disposition complexe a été conçue selon une conception symétrique et
hautement hiérarchique, reflétant un attachement profond à la tradition des
Beaux-Arts. Le bâtiment possède un long axe principal, dominé par la tour de
22 étages, de laquelle rayonnent symétriquement les ailes horizontales et les
éléments verticaux. L'extrémité ouest du pavillon est dominée par un pignon
surmonté d'un petit clocher, tandis que l'extrémité est dispose d'une petite
tour à paliers, marquant l'emplacement des amphithéâtres superposés. Le
traitement de la tour centrale et des façades extérieures est marqué par de
fortes lignes verticales et la présence d'éléments en saillie et en retrait
ainsi que par quelques motifs géométriques stylisés, attestant l'influence
des idées esthétiques associées à la modernité, notamment l'Art déco.
Le bâtiment Roger Gaudry fut le premier édifice construit par l'Université de
Montréal après avoir acquis son autonomie de l'Université Laval en 1920. La
nouvelle institution s'est développée de façon spectaculaire au cours des
années 1920 avec la création d'une faculté de sciences et d'une école de
sciences sociales, économiques et politiques. Aujourd'hui, le pavillon Roger
Gaudry est entouré de nombreux bâtiments universitaires érigés au fil des ans
pour répondre aux besoins de l'institution grandissante. Ce premier bâtiment,
cependant, a fait sa marque sur le campus autour de lui et demeure l'élément
le plus considérable. Sa présence imposante sur la montagne témoigne de la
vie académique québécoise dynamique durant la période de l'entre-deux-guerres.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Pénitencier-de-Saint-Vincent-de-Paul
Laval, Québec
Le lieu historique national du Canada du
Pénitencier-de-Saint-Vincent-de-Paul est une prison en pierre
monumentale, d'aspect sévère et peu invitant situé à Laval (Québec).
Ouvert en 1873 dans une installation destinée à servir de maison de
correction, ce pénitencier était le deuxième pénitencier fédéral au
Canada et le seul établissement de correction francophone au pays
jusqu'à sa fermeture en 1989.
Construit à l'origine en 1873, la plupart des bâtiments de
l'établissement actuel datent des années 1930 et 1940. L'architecture de
l'établissement original, qui prévoyait uniquement un bâtiment
d'administration et un bloc cellulaire, était très banale, et le
pénitencier a été tellement modifié que le bloc cellulaire a perdu sa
configuration d'origine en forme de croix grecque.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du
Pénitencier-de-Saint-Vincent-de-Paul réside dans le fait qu'il a été le
témoin de plus d'un siècle d'histoire judiciaire au Canada en général et
au Québec en particulier. Elle tient également à l'apparence, à
l'emplacement et à l'implantation de l'établissement, que le public
reconnaît immédiatement, de même qu'aux récits et aux vestiges associés
à la vie menée à l'intérieur de ses murs.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Dufresne

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Dufresne |
Lieu historique national du Canada la Petite-Ferme du cap Tourmente
Saint-Joachim, Québec
La Petite-Ferme est située dans un paysage d'une beauté remarquable, là où le
fleuve Saint-Laurent rencontre le grand marais côtier et la plaine
intertidale. C'est en raison de ces conditions uniques que, dès ses débuts,
le site a été considéré comme particulièrement favorable à la colonisation.
La présence autochtone dans ce secteur remonte à plus de 2 000 ans. La
Petite-Ferme fait partie du vaste réseau de sites paléo-historiques connus
des plaines du cap Tourmente. C'est à cet endroit stratégique que Samuel de
Champlain a fait construire une ferme en 1626 pour l'élevage du bétail devant
servir à l'alimentation de la petite communauté de la ville naissante de
Québec. Les vestiges qui ont été découverts sur le site ou qui y sont encore
enfouis figurent parmi les rares traces tangibles de l'œuvre de Champlain
dans la vallée du Saint-Laurent. Acquise par Mgr François de Montmorency
Laval en 1664, la Petite-Ferme témoigne de l'évolution singulière du
Séminaire de Québec, qui l'a exploitée continuellement pendant 300 ans et
qui, par sa présence continue, a contribué à sa conservation. Uni par leur
histoire, leurs fonctions, leur architecture et leurs liens avec le paysage
environnant, le groupe de bâtiments de ferme reflète près de 400 ans
d'occupation agricole, ce qui en fait un lieu grandement symbolique.
Champlain nomme le site « cap de Tourmente » (« cap de tempêtes ») parce que
les eaux du fleuve s'y élèvent au moindre vent. La ferme construite par
Champlain a servi de réserve alimentaire aux premiers colons installés à
l'Habitation de Québec. Elle est devenue la première ferme d'élevage de la
vallée du Saint-Laurent et l'une des premières exploitations agricoles de la
Nouvelle-France.
La Petite-Ferme a été au cœur de l'action du Séminaire de Québec, et elle a
contribué à son œuvre éducative et, par les revenus issus de son
exploitation, au maintien de l'œuvre du Séminaire pendant plus de 300 ans. En
1664, Monseigneur de Laval a acheté la presque totalité des terres de la côte
de Beaupré dans le but de garantir la fondation et l'existence de son
Séminaire de Québec. Il est probable qu'il ait entrepris la construction de
la maison dès cette année-là, bien que son existence n'ait été confirmée que
trois ans plus tard. Au XVIIIe siècle, la Petite-Ferme est devenue l'une des
plus importantes exploitations agricoles de la Nouvelle-France, mais ses
activités sont perturbées par la menace d'une invasion britannique. En 1759,
huit vaisseaux anglais jettent l'ancre au pied de la Traverse du cap
Tourmente. La Petite-Ferme a été incendiée en entier, à l'exception de la
maison d'habitation qui a résisté au feu et à la destruction. Le Séminaire a
continué d'exploiter ses fermes jusqu'au XXe siècle. Dès les années 1920,
l'agriculture au Québec est en perte de vitesse en raison de
l'industrialisation, du développement des villes et de l'avancement des
technologies agricoles. Durant la seconde moitié du XXe siècle, le Séminaire
a commencé à vendre une partie de ses terres. C'est ainsi qu'à partir de
1969, le gouvernement du Canada a commencé à acquérir des fermes, dont celle
de la Petite-Ferme, afin d'établir la réserve nationale de faune du
Cap-Tourmente.
La maison est le seul édifice conservé datant du Régime français à
Cap-Tourmente ainsi que le plus ancien témoignage de la présence du Séminaire
de Québec. Elle est un beau spécimen de résidence du Régime français, auquel
se sont ajoutés des traits pittoresques d'influence néo-classique au XIXe
siècle. Le site comprend des vestiges de la ferme de Champlain et des
bâtiments construits au début du XXe siècle, comme le lavoir-forge, la
grange-étable et la remise à grains, ainsi qu'un atelier-toilette érigé en
1964.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Phare-du-Cap-des-Rosiers
Gaspé, Québec
Haut de trente-sept mètres, ce phare en pierre est perché au sommet
d'une falaise escarpée, près du village de Cap-des-Rosiers, au Québec.
Cet endroit exposé se trouve à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, à
l'endroit où celui-ci se jette dans le golfe du Saint-Laurent. Témoin de
nombreux naufrages, le phare continue de guider les navires à travers
ces eaux traîtresses.
La valeur patrimoniale du phare de Cap-des-Rosiers réside dans son
emplacement, sa conception, sa construction et ses matériaux. Sa hauteur
impressionnante et son profil effilé en font un archétype. Le phare de
Cap-des-Rosiers a été conçu par John Page, ingénieur en chef au
ministère des Travaux publics du Canada-Uni et construit par
l'entrepreneur Charles François-Xavier Baby de 1853 à 1858. Il a
conservé depuis 1858 son équipement d'origine, malgré l'évolution de la
technologie relative au feu lui-même : feu catadioptrique fixe à lumière
blanche (1858-1903), feu incandescent à vapeur d'essence (1903-1921),
lampe à brûleur de fabrication canadienne (1921-1950), lampe électrique
actionnée à la main (1950-1972), feu en partie automatisé (1972-1981),
puis feu entièrement automatisé (1981-2004). Sa tour a été revêtue de
crépi en 1861, 1881 et 1897, et réparée en 1929-1930, 1954 et 1984. Les
fenêtres ont été remplacées en 1884 et la maçonnerie réparée en
1993.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Phare-de-l'Île-Verte
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Québec
Le lieu historique national du Canada du Phare-de-l'Île-Verte est un
élégant phare cylindrique en pierre de 12 mètres équipé d'une lanterne
octogonale peinte érigé sur une île du fleuve Saint-Laurent, devant
l'embouchure de la rivière Saguenay. Outre la tour, ce site isolé inclut
aussi une résidence de gardien, un bâtiment abritant la corne de brume,
un hangar à pétrole et une petite poudrière.
La valeur patrimoniale du phare de l'île-Verte réside dans son
ancienneté et dans son état de conservation architecturale remarquable.
La construction du phare de l'île-Verte a été approuvée en 1806 et
terminée en 1809. La tour a été conçue et réalisée par Edward Cannon,
maître maçon de Québec, dans le but de guider les navires à travers les
eaux et les courants dangereux du fleuve Saint-Laurent, à l'embouchure
de la rivière Saguenay. Quatre générations d'une même famille, les
Lindsay, ont assuré la bonne marche du phare pendant 137 ans, soit de
1827 à 1964. Les seules modifications apportées au bâtiment ont été la
pose d'un revêtement de bois sur les murs de moellons (d'abord sous
forme de clin durant la période 1850-1870, puis sous forme de planche
verticale), le remplacement du feu d'origine par un feu automatisé en
1969, et le remplacement des fenêtres d'origine, de la porte intérieure
du rez-de-chaussée, du bardage et des cercles métalliques par la Garde
côtière canadienne lors de la restauration de 1983.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |
Lieu historique national du Canada du Phare-de-Pointe-au-Père
Pointe-au-Père, Québec
Phare ancien en béton armé situé en un point stratégique.
La station d'aide à la navigation de Pointe-au-Père est l'une des plus
importantes au Canada. Du haut du phare, le Saint-Laurent apparaît
encore plus grandiose. Considéré comme l'un des plus difficiles à
naviguer, le fleuve a vu les meilleurs pilotes se relayer sur les
bateaux des compagnies qui effectuaient les voyages entre l'Amérique et
l'Europe. C'est au large de Pointe-au-Père que l'Empress of Ireland a
fait naufrage en 1914.
Le lieu historique national du Canada du Phare-de-Pointe-au-Père est un
centre d'aide à la navigation situé sur une pointe de terre s'avançant
sur le fleuve Saint-Laurent, à la limite des eaux intérieures et de la
mer ouverte. La station se caractérise par des bâtiments aux toits
rouges et aux murs blancs, lesquels sont dominés par un phare en béton
de 24 mètres de hauteur. La reconnaissance officielle inclut le
troisième et le quatrième phare et les vestiges présumés des deux
premiers, y compris les éléments paysagers, édifices et structures
connexes tels que la maison du gardien et celle de l'assistant gardien,
le bâtiment du criard de brume, un garage, le réservoir, la génératrice,
le criard électronique et de nombreux vestiges évoquant la présence de
la station depuis 1859.
Par sa situation géographique stratégique, le phare de Pointe-au-Père
s'est révélé être un lieu privilégié pour les pilotes du Saint-Laurent
dès les premières années du XIXe siècle. La station connue, sur plus
d'un siècle d'opération, une évolution constante qui débuta avec la
construction du premier phare en 1859, remplacé peu de temps après,
suite à un incendie. En 1909, le troisième phare est construit dans un
effort de modernisation avant que le Ministère des transports entame,
dans les années 1960, une opération d'automatisation des phares, ce à
quoi la station de Pointe-au-Père n'échappe pas. Par ailleurs, plusieurs
infrastructures s'ajoutèrent, en fonction des nouvelles tâches déléguées
au Phare de Pointe-au-Père au cours des différentes phases
d'exploitation. Il abrita une station des relevés des marées et des
courants, de 1894 à 1985, devint l'hôte de la station de pilotage
pendant une cinquantaine d'années, durant lesquelles il prit à sa charge
une partie des activités reliées à la station de quarantaine de
Grosse-Île, soit de 1923 à 1937.
La station de phare mit aussi à l'essai plusieurs moyens de
communication favorisant l'aide à la navigation. Quelques années après
l'élaboration du code international de drapeau, celui-ci était mis en
application à Pointe-au-Père, plus tard on y implanta une station
Marconi. La station de Pointe-au-Père a eu recours au simple canon, au
signal à bombes explosives, puis en 1903, à l'édifice du signal de
brume. Son implantation mena à l'expérimentation de deux types de
signaux soit la sirène d'Écosse et sa version canadienne adaptée, le
diaphone, et à l'essai des lampes à gaz acétylène. Au terme des
observations, l'usage de celles-ci a été recommandé dans les phares et
le diaphone fut le modèle adopté dans la plupart des phares au Canada
dès 1904. Après 1972, c'est un signal sonore électronique qui a pris la
relève au diaphone. En 1997, le poste d'aide à la navigation a été
délaissé par Pêche et Océans Canada. La station fait aujourd'hui partie
d'un ensemble patrimonial sous le nom de «Site historique maritime de la
Pointe-au-Père».
|

©Government of Quebec / Gouvernement du Québec |
Lieu historique national du Canada Pointe-du-Buisson
Beauharnois, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Pointe-du-Buisson comprend
plusieurs sites archéologiques dispersés sur un plateau boisé, le long
du fleuve Saint-Laurent, à Melocheville, 30 kilomètres au sud de
Montréal. Le lieu, situé à une altitude moyenne de 34 mètres au-dessus
du niveau de la mer, est découpé en trois parties inégales par deux
ravins d'écoulement aux pentes abruptes. L'espace, incluant 15 sites
archéologiques présente des vestiges archéologiques qui fournissent des
renseignements importants sur la vie des Autochtones dans la région au
cours des cinq derniers millénaires. La désignation s'applique aux
vestiges archéologiques et au terrain de 21 hectares dans lequel ils ont
été trouvés.
Située sur le rivage d'une voie de transport majeure, la pointe du
Buisson est depuis longtemps un lieu de portage et d'établissements
autochtones. La partie ouest renferme neuf sites archéologiques (Hector
Trudel, Station 2, Station 3 avant, Station 3 arrière,
Plateau-des-portageurs, Pascal Mercier, Camp McKenzie, Jane Ellice et
Passerelle). Ce vaste secteur a été utilisé de façon continue depuis
5000 BP. La partie centrale contient trois sites (Station 4, Trois
Buttes and Pointe-à-Jonathan) qui ont été occupés principalement durant
le Sylvicole moyen tardif (1500-1000 BP). La partie est contient deux
sites (Station 5 et André Napoléon Montpetit) qui fournissent une
documentation exceptionnelle sur un épisode de l'occupation durant le
Sylvicole inférieur (3000-2400 BP).
La valeur patrimoniale du lieu historique national de la
Pointe-du-Buisson tient au fait qu'il est un témoin rare et exceptionnel
d'une longue période de l'histoire ancienne des Autochtones. Sa valeur
réside dans les sites qui s'y trouvent, dans leur emplacement et dans
l'abondance des artefacts et des connaissances qu'ils recèlent.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Pont-Couvert-de-Powerscourt
Hinchinbrooke, Québec
Le lieu historique national du Canada du Pont Couvert de Powerscourt est
un long pont couvert en bois qui repose encore sur ses fondations de
pierre originales, dans le canton d'Elgin, comté d'Huntingdon, Québec.
Toujours en service, il permet encore à la circulation routière du
chemin de la Première concession de franchir la rivière Châteauguay. Ce
pont se distingue par ses trois piliers de maçonnerie à pierre taillée,
sa ligne de toiture irrégulière et ses deux travées autoporteur. Il
s'agit maintenant du seul exemple au monde de pont à membrure
intermédiaire en forme d'arc construit selon la technique de McCallum.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Pont Couvert de
Powerscourt découle de son âge et de l'utilisation de la technique de la
membrure intermédiaire en forme d'arc pour sa construction. Cette
technique fut inventée par le constructeur de pont new-yorkais Daniel
McCallum en 1851 et fut surtout réservés aux ponts ferroviaires.
Également connu localement sous le nom de pont Percy, il a été érigé en
1861 pour permettre à la circulation routière du chemin de la Première
concession de franchir la rivière Châteauguay.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, S. Desjardins, 1998 |
Lieu historique national du Canada du Pont-de-Québec
Québec, Québec
Le lieu historique national du Canada du Pont-de-Québec est un pont
cantilever en acier qui relie la rive de Québec et celle de Lévis
au-dessus du fleuve Saint-Laurent à quelques kilomètres en amont de
Québec. Érigé en 1917, le pont est d'une longueur totale de 987 mètres
et d'une hauteur de 95 mètres, et se compose de travées d'approches nord
et sud, de piles d'ancrage, de deux piliers principaux reposant sur le
lit de rivière, de bras cantilever ainsi qu'une travée suspendue d'une
portée de 500 mètres.
Le pont de Québec, avec sa portée libre de 500 mètres d'un pilier
central à l'autre, est le plus long pont cantilever du genre au monde.
Construit selon le système de poutres en «K», qui se définit par deux
poutres en diagonale se rattachant à une troisième verticale (en forme
de «K»), le pont se distingue aussi par son emploi de l'acier au nickel.
Ce matériau se montrait plus fort et plus cher que l'acier de carbone,
mais il a permis aux constructeurs d'atteindre la longueur inédite du
pont, qui a battu tous les records.
Le point a été mis en œuvre par des sociétés principalement canadiennes
au titre de chef ingénieur H.E. Vautelet. Sa construction a été
facilitée par le système de poutres en «K» ainsi que par la méthode
d'installation de sa travée suspendue. Construite séparément, la travée
centrale a été flottée sur le fleuve jusque sous les bras cantilevers,
et ensuite levée et rivetée sur place. Le pont de Québec, de par ses
grandes dimensions et l'ingéniosité de sa conception, demeure l'un des
plus importants dans l'histoire du génie civil au Canada et est un
symbole important dans la Ville de Québec.
|

©Natural Resources Canada / Ressources naturelles Canada |
Lieu historique national du Canada de la Première-Station-Géodésique
Chelsea, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Première-Station-Géodésique
est situé sur le versant sud du mont King, dans le parc de la Gatineau
au Québec. Il s'agit du premier site géodésique établi au Canada, lequel
est composé d'un point, nommé «station excentrée», représenté par une
cheville d'arpentage en cuivre lettrée sur le dessus, plantée dans le
sol et retenue par du ciment. Le lieu est sur un terrain d'une
superficie de 2,3 mètres carrés, approximativement de la même dimension
que l'ancienne tour.
La géodésie est la science qui mesure et représente les dimensions et la
forme de la Terre. L'établissement d'un réseau de points géodésiques par
« triangulation » permet de définir la structure géométrique de la Terre
en effectuant la mesure des éléments de triangles. Ces points
géodésiques sont des médaillons de cuivre souvent situés en haut de
montagnes afin d'assurer leur intervisibilité sur des distances pouvant
aller jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres.
En 1888, l'Association des arpenteurs du Dominion multiplie ses actions
afin de mettre sur pied un service géodésique au Canada. Après des
années de recherches, effectuées notamment par le directeur William
Frederick King, les levés géodésiques connaissent leurs débuts au pays.
En juin 1905, les premiers sont effectués à Kingsmere, dans la région de
la capitale nationale. Le premier point géodésique (ou station
géodésique), nommé King MTN, est érigé à environ 14 kilomètres d'Ottawa.
Ce point a été choisi, car il est le plus visible depuis l'observatoire
fédéral situé au niveau de la Ferme expérimentale centrale. En fait, ce
point géodésique ne sera pas utilisé pour une longue période, puisque la
visibilité n'y est pas satisfaisante. Un second point, appelé «station
excentrée», est alors choisi en septembre 1909. Celui-ci est situé 64
mètres (211 pieds) plus bas que le précédent et devint le point de
référence. Ce point se trouve aux coordonnées 45º 29' 20,56787" N et 75º
51' 45,26354" O.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1966 |
Lieu historique national du Canada du Presbytère de la Mission de Caughnawaga
Kahnawake, Québec
Le lieu historique national du Canada du
Presbytère-de-la-Mission-de-Caughnawaga est situé sur la rive sud de la
voie maritime du Saint-Laurent dans le territoire des Mohawks de
Kahnawake, au Québec. Le presbytère, qui est érigé dans la mission de
Caughnawaga, se trouve à l'ouest de l'église et comprend deux bâtiments
en pierre, se jouxtant et disposés en forme de « L » : le presbytère
d'origine et l'aile ouest, aussi appelée l'ancien mess des officiers. Le
presbytère, relié à l'église par un corridor, est un bon exemple de
l'architecture québécoise de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe
siècles. L'ensemble se dresse dans les limites du lieu historique
national du Canada Fort-St-Louis.
En 1667, les missionnaires jésuites fondent la mission de Caughnawaga
dans la colonie française de La Prairie pour y desservir les Iroquois
chrétiens; la mission est cependant déplacée plusieurs fois avant d'être
définitivement établie à Kahnawake. Le presbytère est l'un des
principaux éléments de l'ensemble et constitue un exemple de
l'architecture québécoise de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe
siècles. L'importance du presbytère se reflète dans la qualité de son
exécution, comme en témoignent les détails intérieurs et extérieurs du
bâtiment. Le presbytère est formé de deux grands bâtiments en pierre
d'un étage et demi : le presbytère d'origine, dont le toit à deux
versants est recouvert de bardeaux et l'aile ouest attenante à
l'extrémité sud de la résidence. Les impostes cintrées des portes sont
caractéristiques des premières maisons canadiennes.
La façade nord du presbytère d'origine, le plus grand des deux
bâtiments, comporte une véranda vitrée avec des poteaux carrés simples
et de la dentelle de bois. Le tracé du presbytère d'origine forme un
rectangle simple percé de quatre baies et comporte une porte à chaque
extrémité avec, entre elles, deux fenêtres, dont chacune à deux battants
de douze carreaux. Il est coiffée d'un toit en croupe très pentu
recouvert de bardeaux. Il compte quatre lucarnes du côté nord, deux du
côté est, une du côté ouest et trois du côté sud. L'unique cheminée en
brique se trouve à l'extrémité ouest. L'aile ouest, aussi appelée le
mess des officiers, s'élève sur un étage et demi et jouxte le presbytère
d'origine par son mur sud. Le toit très pentu coiffe le mur de pignon en
pierre du côté nord, celui adjacent au presbytère d'origine.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Résidence-H.-Vincent-Meredith
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada de la
Résidence-H.-Vincent-Meredith est situé à Montréal (Québec). Cette belle
demeure de deux étages et demi, de style néo-Queen Anne, construite en
1896 en brique rouge avec éléments décoratifs de pierre, est de
composition asymétrique. La surface unie des murs contraste avec une
bande décorative en brique au niveau de l'avant-toit. Une proéminente
tour surmontée d'un toit conique attire l'attention et contraste avec la
masse du toit à quatre versants très incliné, ses lucarnes et ses très
hautes cheminées. Des marches mènent à l'entrée principale, qui est
surmontée d'un porche ouvert.
La résidence H. Vincent-Meredith a été désignée lieu historique national
du Canada en 1990 parce qu'il s'agit d'un exemple particulièrement
remarquable de l'utilisation du style néo-Queen Anne dans l'architecture
canadienne.
La maison, avec son style élégant et son terrain spacieux, était typique
de nombreuses demeures construites par l'élite financière montréalaise
de la fin du XIXe siècle dans le quartier appelé le « Mille carré doré »
(« Golden Square Mile »). Dans ce cas-ci, la résidence, avec ses briques
rouges chaudes, ses références stylistiques éclectiques et sa
composition fantaisiste recourant aux tourelles, aux tours et à une
ligne de toit vive, est un exemple exceptionnel du style néo-Queen Anne
en vogue à l'époque. La maison a été construite en 1897 par les
architectes montréalais Edward et William Maxwell, pour Andrew Allen,
associé dans la Allen Line Steamship Company. Sir Vincent Meredith,
président de la Banque de Montréal, et son épouse Isabella Allan, y ont
habité de 1906 à 1941. Sir H. Vincent Meredith est décédé en 1929 et, en
1941, Lady Meredith a légué la grande maison privée à l'Hôpital Royal
Victoria pour qu'elle serve de résidence à des infirmières. Plus tard,
l'Université McGill en a fait l'acquisition. En 1990, la demeure a été
endommagée par un incendie, mais elle a été restaurée par la suite et a
retrouvé son apparence originale. Elle est maintenant le Centre pour la
médecine, l'éthique et le droit de l'Université McGill.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2002 |
Lieu historique national du Canada de la Rotonde-Joffre (Canadien National)
Charny, Québec
Le lieu historique national du Canada de la Rotonde-Joffre (Canadien
National) est une vaste installation de réparation de locomotives située
dans la cour de triage de la Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada à Charny (Québec). Sa forme circulaire, creuse au centre,
témoigne de sa vocation de rotonde ferroviaire.
Partir intégrante du réseau des chemins de fer Intercolonial, un réseau
conçu afin de relier les colonies de Nouveau-Brunswick et de la
Nouvelle-Écosse au reste du Canada et mandaté afin d'assurer l'inclusion
des provinces maritimes dans la Confédération, la rotonde Joffre
(Canadien National) était la localité de limite divisionnaire la plus
achalandée du système. Construite en 1880 au dépôt de Charny, la rotonde
Joffre (Canadien National) comportait à l'origine 24 stalles et servait
à l'entretien des locomotives de l'Intercolonial. En 1920-1921, le
Canadien National agrandit la structure originale avec quinze stalles et
la rend complètement circulaire avec une seule ouverture. Les
installations comprennent aussi l'atelier d'usinage et la plaque
tournante, soit deux additions datant de 1920-1921. La rotonde Joffre
(Canadian National) a servi son rôle d'origine jusqu'en 1981, lorsque le
Canadien National a déplacé l'entretien provincial.
|
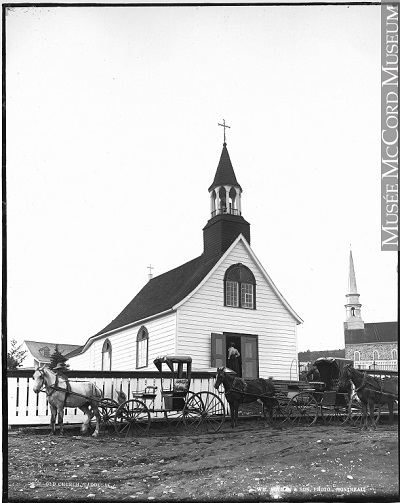
©Musée McCord Museum / Wm. Notman & Son / VIEW-2358 |
L'église de la mission de Sainte-Croix-de-Tadoussac
Tadoussac, Québec
L'église de la mission de Sainte-Croix-de-Tadoussac occupe une petite
partie du grand cimetière de la Fabrique de Sainte-Croix : la petite
église est au bas, dans la portion sud-ouest de l'enclos funéraire,
tandis que l'église paroissiale actuelle est au nord-est du cimetière.
L'église est aux couleurs de l'Hôtel Tadoussac, un établissement de
renommée auprès de la clientèle touristique. Elle regarde la baie de
Tadoussac; par delà le fleuve Saint-Laurent, la rive sud est
perceptible. L'ensemble du panorama est spectaculaire.
L'église de la mission de Sainte-Croix-de-Tadoussac, incluant son
contenu, est d'importance historique car :
par ses caractéristiques et ses techniques de construction, elle est une
exceptionnelle église de mission héritée de la Nouvelle-France, tout en
étant la plus ancienne érigée en bois à l'échelle du Québec et du
Canada;
construite à l'époque où Tadoussac était un centre actif de la traite
des fourrures, elle témoigne de la relation qui existait entre le
commerce des fourrures et les efforts déployées par les missionnaires
Jésuites, tout en étant intimement liée avec les peuples autochtones;
elle est un excellent exemple d'un poste de mission où se sont établis
au milieu du XIXe siècle les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, en
continuant à servir les besoins religieux de la population
autochtone.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Seigneurie-de-l'Île d'Orléans
L'Île-d'Orléans Regional County Municipality, Québec
Le lieu historique national du Canada Seigneurie-de-l'Île-d'Orléans
occupe l'ensemble du territoire de l'île et comprend tous les bâtiments,
le paysage et les ressources archéologiques liés à la seigneurie qui
existait sous le Régime français. Située tout près de la rive nord du
Saint-Laurent, à proximité de la ville de Québec, l'Île d'Orléans a été
l'un des premiers établissements en Nouvelle-France. Les terres
agricoles sont aménagées en parcelles longues et étroites partant du
fleuve, et les îlots de peuplement sont reliés par le chemin Royal qui
fait le tour de l'île. Les maisons, dépendances, moulins à vent, églises
et terres agricoles illustrent l'histoire de l'île, bien ancrée dans le
temps.
La seigneurie de l'île d'Orléans a été créée en 1636 et s'est développée
au XVIIe siècle avec la construction d'une route principale faisant le
tour de l'île et de plusieurs autres routes qui la croisent. Le relief
légèrement vallonneux et les nombreux ruisseaux assuraient de bonnes
terres agricoles. Les seigneurs qui ont administré l'île au fil des ans
ont été nombreux, et les fermiers travaillant pour eux encore plus, d'où
le grand nombre de fermes aménagées et de ressources bâties et
archéologiques. Les fermes sont établies sur des bandes de terres
longues et étroites, partant de la ligne des eaux et se rejoignant à un
point au centre de l'île. Les maisons et leurs dépendances s'élèvent
généralement du côté terre du chemin Royal, face au fleuve. Le fait que
l'île a été très tôt divisée en cinq paroisses (Saint-Pierre,
Sainte-Famille, Saint-Francois, Saint-Jean et Saint-Laurent) reflète la
diversité de ses caractéristiques géographiques et a donné lieu à la
construction d'une église dans chacune des paroisses et de chapelles de
procession entre elles.
|

©L'abbé Roberge, 2005 |
Lieu historique national du Canada du Séminaire-de-Québec
Québec, Québec
Le lieu historique national du Canada du Séminaire-de-Québec, situé dans
l'arrondissement historique du Vieux-Québec, est un établissement
d'enseignement comprenant deux sections : le Vieux Séminaire, fondé en
1663, et les bâtiments ajoutés au XIXe et XXe siècle qui l'entourent. Le
bâtiment du Vieux Séminaire comporte trois ailes qui bordent la cour des
Petits. Les bâtiments datant du XIXe et du XXe siècle, notamment
l'ancien pavillon central, le Grand Séminaire et le Pavillon, sont de
différents styles architecturaux, entre autres de style néogrec. Malgré
les différentes dates de construction, le complexe est visuellement
unifié en raison de sa configuration et des caractéristiques
stylistiques communes des nombreux bâtiments.
Le Séminaire de Québec a été désigné lieu historique national du Canada
en 1929 parce qu'il s'agit du plus ancien établissement d'enseignement
au Canada.
La société de prêtres du Séminaire de Québec a été fondée à Québec par
monseigneur François de Montmorency-Laval, premier évêque de la
Nouvelle-France. En 1663, le Grand Séminaire est créé et regroupe le
ministère paroissial, la mission et le clergé. Le « Petit Séminaire »
est quant à lui fondé en 1668 dans le but d'enseigner la langue et la
culture françaises aux jeunes Autochtones. À partir de 1674,
l'établissement n'accueille plus que de jeunes Français qui se destinent
à la prêtrise. Après la conquête, la vocation de l'école est à nouveau
modifiée, et le « Petit Séminaire » commence à accepter tous les jeunes
qui souhaitent faire des études, même s'ils ne désirent pas devenir
prêtres.
En 1852, le Séminaire poursuit sa mission d'éducation en fondant la
première université catholique francophone au pays, qui est baptisée
Université Laval en l'honneur de monseigneur de Laval. L'Université
Laval exercera une influence considérable sur les arts, les lettres et
les sciences au Canada, et déménagera à son emplacement actuel dans
l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery en 1970-1971. En dépit de
nombreux incendies survenus au fil des années, le Séminaire de Québec
demeure un établissement d'enseignement dirigé par la Société des
prêtres diocésains, qui enseigne la pastorale et la prêtrise à divers
niveaux. Le Séminaire héberge également le Centre de référence de
l'Amérique française du Musée de la civilisation ainsi qu'une école
secondaire privée, appelée le Petit Séminaire de Québec.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Séminaire-de-Saint-Sulpice-et-Son-Jardin
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada du
Séminaire-de-Saint-Sulpice-et-Son-Jardin, un séminaire religieux avec un
jardin attenant, est situé sur la rue Notre-Dame Ouest, au coeur du
Vieux-Montréal. Il se compose d'un édifice imposant et austère en forme
de fer à cheval, qui abrite un jardin classique privé et une petite
cour. Cet édifice en pierre, un exemple spectaculaire de l'architecture
de style classique du XVIIe siècle fut construit sous le régime
français. Aménagé selon un plan rectangulaire, son jardin se caractérise
par sa symétrie, ses îlots disposés de manière géométrique et ses
allées, qui s'entrecroisent et mènent à un point central. Le complexe
est séparé de la rue Notre-Dame par un mur de pierres que perce l'entrée
principale.
La valeur patrimoniale du séminaire de Saint-Sulpice et son jardin
réside dans ses associations historiques et dans son intégrité
architecturale en tant qu'exemple du classicisme sous le régime
français. À partir de 1687, le séminaire sert de résidence et de centre
administratif aux Messieurs de Saint-Sulpice, seigneurs de l'île de
Montréal jusqu'à la fin du régime seigneurial. L'édifice s'inspire du
style classique français du XVIIe siècle et, à l'origine, son jardin
respecte rigoureusement les principes d'aménagement des jardins des
monastères médiévaux. En effet, avec la colonisation de la
Nouvelle-France au XVIIe siècle, la tradition des jardins européens est
reprise en Amérique du Nord par les ordres religieux, notamment par les
Jésuites et les Sulpiciens. Aujourd'hui, le jardin existe toujours à son
emplacement d'origine et n'a pour ainsi dire pas changé. Le lien entre
le jardin et les murs ceinturant le séminaire illustre l'importance
qu'accordent ces communautés protégées à l'introspection, à
l'autosuffisance, au calme et à la croissance spirituelle.
L'ornementation et le jeu géométrique de ce petit mais structuré jardin
paysagé reflètent bien les goûts du XVIIe siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2004. |
Lieu historique national du Canada de Sir-George-Étienne-Cartier
Montréal, Québec
Maisons jumelées des années 1830, ayant servi de résidence à ce
brilliant politicien du XIXe siècle.
Situé à l'angle des rues Notre-Dame et Berri, au centre-ville de
Montréal, cet édifice en pierre occupe un peu plus de la moitié de son
lot urbain. Les deux maisons mitoyennes qui le composent faisaient jadis
partie d'une terrasse constituée d'au moins trois habitats occupant une
partie de ce qui avait été la citadelle de Montréal. Une partie de
l'édifice présente l'interprétation de la vie et de l'œuvre de Cartier,
bourgeois montréalais, politique et Père de la Confédération, alors
qu'une autre partie offre une reconstitution du milieu de vie de la
famille de Cartier au cours des années 1860.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de
Sir-George-Étienne-Cartier réside dans son association avec
George-Étienne Cartier, dont la carrière politique s'est échelonnée de
1848 à 1873, et dans le fait qu'il offre une illustration de la
résidence montréalaise bourgeoise au milieu du dix-neuvième siècle,
amalgamant des influences françaises et anglaises.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Christine Boucher, 2014 |
Le lieu historique national du Canada de la Résidence-d'Été-de-Sir-John-A.-Macdonald
Rivière-du-Loup, Québec
Le lieu historique national du Canada de la
Résidence-d'Été-de-Sir-John-A.-Macdonald est sis sur un cran rocheux
faisant office de promontoire entre le fleuve Saint-Laurent et le côté
nord de la rue Fraser à Rivière-du-Loup (Québec), lequel offre une vue
saisissante sur le fleuve et ses battures. La maison sur son lot gazonné
où dominent des conifères est typique des résidences d'été dans le
Bas-Saint-Laurent. Sir John A. Macdonald (1815-1891), premier chef du
gouvernment canadien sous la Confédération, y séjourna pendant plusieurs
étés de 1873 à 1890. Plus qu'une résidence d'été et un lieu de vacances,
cette maison a surtout représenté un lieu de travail à partir duquel il
continua de gouverner le pays.
Son architecture résulte de la jonction de deux corps de bâtiments de
plan rectangulaire issus de périodes et de styles architecturaux
différents. Le corps d'origine de la maison est constitué d'une ancienne
maison de ferme construite vers 1850. On y ajoute une imposante aile de
style Second Empire, plus grande en superficie que la première et
caractérisée par la présence d'un toit mansardé percé de lucarnes, à la
suite de son achat par les Macdonald en 1882. Par ailleurs, la lucarne
centrale triangulaire a probablement été rajoutée au corps initial peu
après l'agrandissement. Le bâtiment a subi très peu de modifications
depuis sa construction.
La valeur patrimoniale de la résidence repose sur son association avec
l'ancien premier ministre sir John A. Macdonald et sur son intérêt
historique. Ce fut vraisemblablement l'arrivée de Macdonald au début des
années 1870 dans le secteur qui marqua l'apogée de la popularité de
Saint-Patrice comme lieu de villégiature. Sa présence attire des amis et
des associés qui s'établissent à proximité, de nombreux hommes
d'affaires ayant principalement des intérêts dans des compagnies de
transport ferroviaire, de même que plusieurs hommes politiques et hauts
fonctionnaires. Au décès de Macdonald en 1891, la demeure devint la
propriété de Lord N. G. Shaughnessy, qui fut président de la Compagnie
du chemin de fer du Canadien Pacifique (CPR) de 1899 à 1918. La maison
fut ensuite achetée par Hebert J. Symington, premier président d'Air
Transat, en 1939. Elle demeura au sein de la famille Symington jusqu'en
1981, date à laquelle elle fut acquise par l'Héritage canadien du Québec
qui en assure sa conservation depuis lors. En 2003, la maison est
inscrite au site du patrimoine du Vieux-Saint-Patrice, ensemble reconnu
par la province de Québec regroupant une quarantaine de vieilles maisons
de ferme et de résidence associées à la villégiature de la fin du XIXe
siècle implantées dans la portion ouest de la rue Fraser.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de Sir-Wilfrid-Laurier
Laurentides, Québec
Maison dotée d'un programme d'interprétation sur la vie de sir Wilfrid
Laurier, premier ministre du Canada (1896-1911).
Situé à Saint-Lin-Laurentides dans Lanaudière, à environ 50 km au
nord-est de Montréal, le lieu historique national du Canada de
Sir-Wilfrid-Laurier rappelle la vie et l'œuvre de l'ancien premier
ministre du Canada.
Le lieu historique national du Canada de Sir-Wilfrid-Laurier commémore
le lieu de naissance de sir Wilfrid Laurier, ancien Premier ministre du
Canada. Situé sur la 12e avenue, à Saint-Lin-Laurentides (60 km au nord
de Montréal), le lieu a beaucoup changé depuis l'enfance de Laurier et
est aujourd'hui constitué d'une petite maison dans le style vernaculaire
du Québec, en brique rouge, bâtie sur un lot paysager.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de
Sir-Wilfrid-Laurier réside dans le fait qu'il donne l'esprit du lieu où
sir Wilfrid Laurier a passé son enfance. Laurier est né à
Saint-Lin-Laurentides en 1841, où il a élu domicile jusqu'en 1865. Cette
propriété a été achetée par le grand-père de Laurier, au début du XIXe
siècle et elle est restée dans la famille jusqu'en 1865. La maison qui
s'élève aujourd'hui à cet endroit a été construite en 1870. Le
gouvernement fédéral a acheté les deux lots qui formaient jadis la
propriété des Laurier en 1937-1938 et il a démoli tous les bâtiments
présents, sauf la maison actuelle que l'on croyait alors avoir été
habitée par Laurier. La maison a été installée au centre des deux lots
qui ont été aménagés par l'architecte paysager Frederick G. Todd.
L'ethnologue Marius Barbeau a pour sa part meublé les pièces de manière
à refléter la tradition rurale québécoise. Avec cette tentative
d'illustrer les humbles racines rurales de sir Wilfrid Laurier, Parcs
Canada créa un de ses premiers lieux d'interprétation à caractère civil,
qui demeure un exemple des méthodes de conservation du début du XXe
siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national du Canada du Théâtre-Capitole / l'Auditorium-de-Québec
Québec, Québec
Le lieu historique national du Canada du Théâtre-Capitole /
l'Auditorium-de-Québec est un remarquable bâtiment de style Beaux-Arts à
la façade bombée construit sur la rue Saint-Jean, à quelques pas de la
Porte-Saint-Jean à Québec.
La valeur patrimoniale du théâtre Capitole (auditorium de Québec) tient
à sa façade de style académique, au riche décor classique de son
intérieur et à son aménagement comme théâtre et salle de cinéma. Des
pièces de théâtre (dès 1903), puis des spectacles de variété ont été
présentés dans ce bâtiment conçu par William S. Painter et appelé à
l'origine Auditorium de Québec. En 1927, son intérieur est complètement
remodelé par les architectes Thomas W. Lamb et Hélidore Laberge qui y
aménagent une salle de cinéma avec un nouveau décor et un profond
balcon. Dans les années 1930, l'Auditorium change de nom et devient le
théâtre Capitole; on y présente des films et quelques spectacles
jusqu'aux années 1960, puis uniquement des films jusqu'en 1982. En 1992,
le théâtre Capitole (auditorium de Québec) est restauré et retrouve sa
vocation de théâtre.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, N. Clerk, November 1995 |
Lieu historique national du Canada du Théâtre Granada
Sherbrooke, Québec
Le lieu historique national du Canada du Théâtre-Granada est un bâtiment
de trois étages érigé en bordure du trottoir de la rue Wellington dans
le centre-ville de Sherbrooke, Québec. Le thème de la façade se poursuit
à l'intérieur dans un magnifique décor rappelant une cour intérieure la
nuit en Espagne.
Le théâtre Granada a été désigné lieu historique national du Canada en
1996 parce que c'est un magnifique exemple d'un théâtre d'ambiance au
Canada.
La valeur patrimoniale du théâtre Granada tient principalement à la
qualité et à la richesse du décor intérieur demeuré quasi inchangé
depuis la construction du bâtiment.
La plupart des cinémas d'ambiance possédaient un décor peint, mais celui
créé par le décorateur intérieur Emmanuel Briffa pour le théâtre Granada
est particulièrement spectaculaire. Le bâtiment a été dessiné par
l'architecte D.J. Crighton et construit par la United Amusement
Corporation en 1928-1929. Il a servi de salle de cinéma et de spectacles
jusqu'en 1980, puis la Ville de Sherbrooke l'a rénové en 1988 pour en
faire un auditorium multifonctionnel.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Nathalie Clerk, 1993 |
Lieu historique national du Canada du Théâtre Outremont
Montréal, Québec
Le théâtre Outremont est un vaste cinéma de style Art déco situé au coin
des avenues Bernard et Champagneur à Outremont, une banlieue de l'ouest
de l'île de Montréal datant du début du XXe siècle. Bâti dans un
quartier à la fois résidentiel et commercial, le bâtiment est entouré
d'immeubles d'habitation.
Le théâtre Outremont a été désigné lieu historique national en 1993 à
cause de son importance historique et architecturale nationale. Avec son
extérieur des débuts du mouvement Art déco et son riche intérieur
combinant des éléments propres aux théâtres d'atmosphère et des motifs
Art déco, il est un bel exemple des cinémas de luxe construits au Canada
à la fin des années 1920.
Conçu par l'architecte local René Charbonneau pour Confederation
Amusements, le théâtre Outremont est typique des nombreux cinémas de
luxe construits dans des quartiers de banlieue au Canada dans les années
1920. De taille moyenne, ces cinémas pouvaient accueillir entre 1000 et
2000 spectateurs. Construits expressément à des fins cinématographiques,
ils se voulaient attrayants et confortables, le cinéma étant devenu un
loisir populaire à la fin des années 1920. Les mesures prises pour
ignifuger le théâtre Outremont témoignent d'une préoccupation accrue
pour la sécurité des spectateurs suite à un incendie mortel survenu dans
un cinéma de Montréal en 1927.
L'un des tout premiers cinémas de style Art déco au Canada, le théâtre
Outremont est typique des premières manifestations de ce style en ce
sens qu'il fait appel à des formes classiques traditionnelles,
présentées de façon stylisée. La composition extérieure, avec ses deux
volumes distincts différenciés par les matériaux, la couleur et les
proportions qui correspondent aux principales fonctions du bâtiment,
témoigne de l'apparition de l'esthétisme architectural moderne. On
retrouve également des motifs Art déco partout à l'intérieur.
Le décor intérieur de l'auditorium est un exemple extravagant du style
Art déco présenté en combinaison avec des éléments propres à
l'architecture des théâtres d'atmosphère. Les cinémas d'atmosphère, dont
les murs et les plafonds proposaient des scènes exotiques et pastorales,
ont connu leur heure de gloire à la fin des années 1920. L'auditorium du
théâtre Outremont combine des motifs Art déco stylisés avec des scènes
pastorales peintes sur la partie supérieure des murs et un plafond
luminescent à caissons censé reproduire l'atmosphère d'une journée
ensoleillée.
Le décor intérieur onirique complexe du théâtre Outremont, typique des
cinémas des années 1920, est l'œuvre d'Emmanuel Briffa. Artiste de la
scène bien connu, Briffa habitait Outremont. On lui doit la décoration
intérieure de plus de soixante cinémas au Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Nathalie Clerk, 1993 |
Lieu historique national du Canada du Théâtre-Rialto
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada du Théâtre-Rialto est situé sur
l'avenue du Parc dans le quartier Outremont à Montréal. Il s'agit d'une
salle de spectacle du début du XXe siècle de style Beaux-Arts. Distingué
par une imposante façade munie de colonnes et inspiré par l'Opéra de
Paris, ce théâtre de cinq étages est aussi caractérisé par son intérieur
néo-baroque, conçu par Emmanuel Briffa, un concepteur de théâtre
célèbre.
Le théâtre Rialto est un édifice typique de l'architecture publique
canadienne du début du XXe siècle et est un bel exemple de
l'architecture du style Beaux-Arts, qui applique les principes du style
académique, notamment le respect de la symétrie et du caractère
grandiose de la composition, la clarté des élévations et la rationalité
du plan. Sa façade principale rappelle le programme décoratif de l'une
des sources du style Beaux-Arts : l'Opéra de Paris, son plan intérieur
et ses diverses fonctions le distinguent des cinémas de l'époque. Il
s'agit du premier cinéma à Montréal où l'axe de l'auditorium est
parallèle à la façade et où l'on trouve des salles destinées à d'autres
fonctions (salle de bal, salle de quilles, salle de billard et locaux
commerciaux). Le riche décor intérieur, la forte inclinaison du balcon
et les loges font partie des caractéristiques propres aux théâtres
traditionnels du tournant du siècle.
Le théâtre Rialto a été construit pour l'entreprise United Amusements
Corporation Limited selon les plans de Raoul Gariépy, architecte
prolifique de la région et concepteur de cinq autres cinémas
montréalais. La conception de la structure en béton est l'œuvre de la
firme d'ingénierie Forgues et Guay. C'est à Emmanuel Briffa, artiste de
Montréal qui a décoré plus de 200 intérieurs de cinéma en Amérique du
Nord, que l'on doit le riche décor intérieur d'influence néo-baroque. Ce
décor d'une qualité exceptionnelle a gardé un grand nombre de ses
caractéristiques originales, dont les peintures, les moulures, les
éléments décoratifs à relief en plâtre et les verrières.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2003 |
Lieu historique national du Canada des Tours-Martello-de-Québec
Québec, Québec
Le lieu historique national du Canada des Tours-Martello-de-Québec fait
partie du lieu historique national du Canada des
Fortifications-de-Québec, situé à Québec (Québec). Il comprend trois
tours Martello éloignées les unes des autres : la Tour n° 1 sur les
Plaines d'Abraham, la Tour n° 2 à l'angle des rues Laurier et Taché, et
la Tour n° 4 sur la rue Lavigueur. Construites entre 1808 et 1812, les
trois Tours Martello indépendantes s'élèvent sur deux étages et sont
surmontées d'un toit plat conçu pour servir de plate-forme pour un à
quatre canons. Elles surplombent le Saint-Laurent et la rivière Charles,
respectivement.
Les Tours Martello de Québec ont été désignées lieu historique national
du Canada en 1990 parce qu'elles font partie des fortifications de
Québec.
Les Tours Martello de Québec illustrent l'importance de Québec et de ses
fortifications dans les différents plans stratégiques pour la défense de
l'Amérique du Nord britannique. La citadelle de Québec jouait un rôle
clé dans le contrôle de l'intérieur de la partie septentrionale du
continent sous les dominations française et britannique. Les Tours
Martello ont été construites par les Britanniques pour former une
première ligne de défense à l'intérieur de l'ensemble des fortifications
de Québec et empêcher des attaquants de s'approcher suffisamment des
murs pour en faire le siège. Fonctionnelles et très solides pour leur
époque, ces tours étaient essentiellement des plates-formes à canons
surélevées. Les tours n° 1 et n° 2 abritent des expositions
didactiques.
|


©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada des Tours-des-Sulpiciens / Fort-de-la-Montagne
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada des Tours-des-Sulpiciens /
Fort-de-la-Montagne est situé sur la rue Sherbrooke Ouest au
centre-ville de Montréal, au Québec. Le site est constitué de deux
tours, construites en 1694, qui composaient à l'origine le fort de la
Montagne. Ces dernières, d'une hauteur de 13 mètres, sont constituées de
deux étages et d'une construction en pierre. Elles possèdent
respectivement une entrée et une porte à quatre carreaux vitrés du côté
nord, au-dessus de laquelle se trouve une fenêtre à multiples pans
vitrés. Chacun des toits, de forme conique hexagonal, est doté d'une
croix à son sommet. La tour ouest possède une girouette également fixée
à son sommet.
Vers 1676, les Sulpiciens, seigneurs de l'Île de Montréal, fondèrent une
mission, appelée la mission de la Montagne, afin d'y instruire les
Autochtones et de les convertir à la religion catholique. Pour ce faire,
ils construisirent un fort de charpente. En 1681, M. François Vachon de
Belmont fut nommé supérieur de la mission dénombrant plus de 200
Iroquois, Hurons et Algonquins vivant alors dans des cabanes dans le
fort.
Un fort en pierre, construit en 1694, protége cette nouvelle Mission.
Celui-ci est composé de quatre tours reliées entre elles par un mur
d'enceinte défensif en pierre. Même si les tours possèdent des
meurtrières, en raison de la fonction militaire initiale du fort,
celle-ci est uniquement dissuasive car les meurtrières n'auraient jamais
été utilisées à cette fin. En effet, les soeurs de la Congrégation de
Notre-Dame utilisaient la tour sud-ouest comme école et celle du sud-est
comme résidence pour les filles de la Congrégation. Avec le départ
progressif des Amérindiens entre 1692 et 1705, la tour sud-est est
transformée en chapelle (1824) et les tours nord-ouest et nord-est du
fort de la Montagne sont alors démolies.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2001 |
Lieu historique national du Canada Trafalgar Lodge
Montréal, Québec
Le lieu historique national du Canada Trafalgar Lodge est situé sur un
terrain d'angle boisé dans le quartier historique de Westmount à
Montréal au Québec. Construite au milieu du XIXe siècle, Trafalgar Lodge
est une villa pittoresque en brique d'un étage et demi de style néo
gothique. Cette maison au profil bas est surmontée d'un toit en croupe à
forte pente vers l'avant avec des pignons, des lucarnes et des mitres
décoratives.
Exemple rare au Québec de villa néo gothique, Trafalgar Lodge a été
conçu par l'architecte torontois John Howard comme le domaine champêtre
d'un riche homme d'affaires. La villa asymétrique, à la brique rouge et
à l'ornementation blanche, présente un profil audacieux formé de pignons
proéminents, de lucarnes et de hautes cheminées. Le mélange des éléments
gothiques, tant religieux que séculiers, crée une version unique du
style néo-gothique — les fenêtres en ogive et les fenêtres en rosace
sont plus fréquentes dans les bâtiments religieux, tandis que les
larmiers agrémentent souvent les résidences familiales. L'exécution très
sculpturale des détails en fait des éléments remarquables.
|
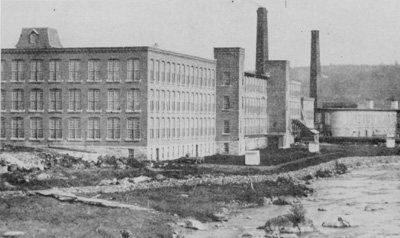
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Usine-de-Textile-de-Magog
Magog, Québec
Ayant été la seule usine textile du xixe siècle à réunir au même endroit
les opérations de filature, de tissage, de blanchiment et d'impression;
construite en 1883.
|

©La Pulperie de Chicoutimi - Musée régional | La Pulperie de Chicoutimi - Regional Museum, 2015. |
Lieu historique national du Canada de la Vieille-Pulperie-de-Chicoutimi
Chicoutimi, Québec
Le lieu historique national du Canada de la
Vieille-Pulperie-de-Chicoutimi est situé dans une vallée partiellement
boisée sur la rivière Chicoutimi, au Québec. Il s'agit d'un ensemble
industriel typique du début du XXe siècle constitué de 5 bâtiments, dont
la construction s'est échelonnée de 1898 à 1923. Les édifices spacieux
sont en maçonnerie de pierres avec une toiture en acier, et bien
éclairés par de nombreuses fenêtres.
La Vieille Pulperie de Chicoutimi fut fondée en 1896 par le maire de
Chicoutimi, Joseph-Dominique Guay et quelques partenaires, incluant
Julien-Édouard-Alfred Dubuc, qui est devenu président de la fondation de
la Compagnie de Pulpe de Chicoutimi. On y fabriquait de la pâte pour
papier journal, à l'époque où les papiers jouaient un rôle important
dans l'économie canadienne. Reconnue pour la qualité de son produit,
elle était le principal établissement de la Compagnie de pulpe de
Chicoutimi et la plus grande productrice de pâte mécanique au Canada
vers 1910.
La Vieille Pulperie de Chicoutimi est typique des ensembles industriels
existant à compter des années 1880 jusqu'au tournant du siècle au
Québec. Ses caractéristiques typiques incluent la maçonnerie en pierre
des édifices spacieux et bien éclairés par de nombreuses fenêtres, où
toutes les opérations du traitement du bois se retrouvaient sous une
même structure, ce qui constitue un trait commun aux pulperies de cette
époque. Plusieurs bâtiments de la pulperie subsistent de nos jours,
malgré sa fermeture définitive en 1930, et ce, dans un état de
préservation exceptionnel.
|
|
Lieu historique national du Canada Vieux-Poste-de-Traite-de-Chicoutimi
Chicoutimi, Québec
En 1676, la compagnie de Jean Oudiette et Charles Bazire érigea ici un
poste de traite. En raison de sa situation à la tête de la navigation du
Saguenay, il devint le principal poste de la région et le grand entrepôt
du commerce intérieur. Par la suite, à l'instar des autres comptoirs du
Domaine du roi, il fut affermé successivement à divers individus et
compagnies, dont François-Étienne Cugnet et les compagnies du
Noerd-Ouest et de la Baie d'Hudson. À compter des années 1840,
cependant, la venue de bûcherons et d'agriculteurs dans la région
entraîna le déclin de la traite des fourrures, et le comptoir fut
abandonné définitivement en 1876.
|

©Saint-Georges Street, Historic Village of Val-Jalbert, Chambord, Québec, Christine Boucher, Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2018.

©Historic Village of Val-Jalbert, Chambord, Québec, Christine Boucher, Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2018.

©Former Convent-School, Historic Village of Val-Jalbert, Chambord, Québec, Christine Boucher, Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2018.

©Historic Village of Val-Jalbert, Chambord, Québec, Christine Boucher, Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2018. |
Lieu historique national du Canada le village historique de Val-Jalbert
Chambord, Québec
Créé en 1901 autour d'une usine de production de pâtes et papiers et déserté
depuis 1927, le village de Val-Jalbert constitue un bel exemple de ville
industrielle associée à l'exploitation des pâtes et papiers du début du XXe
siècle, laquelle se distingue par son authenticité et par la préservation de son
environnement bâti. Conçu par phases successives selon un plan d'urbanisme qui
en guide sa croissance, le village de Val-Jalbert se caractérise par la présence
de deux secteurs distincts, la haute et la basse-ville, par un ensemble unique
d'équipements industriels, d'édifices institutionnels et commerciaux et par
quatre types de maisons d'ouvriers faites entièrement de bois réparties sur une
demi-douzaine de rues. La conservation et la mise en valeur de ce « village
fantôme » comme musée en plein air à partir du début des années 1960 en font un
exemple particulièrement éloquent de l'intérêt grandissant pour la sauvegarde du
patrimoine bâti qui a lieu au pays à partir de la seconde moitié du XXe
siècle.
Le village historique de Val-Jalbert, d'une superficie d'environ 1,7 kilomètre
carré, est situé dans la municipalité régionale de comté (MRC) du
Domaine-du-Roy, au sud-ouest du lac Saint-Jean. Les résultats d'études
archéologiques témoignent de l'occupation humaine dans cette région qui remonte
à au moins 6 000 ans. Dans les années 1840, lorsque la colonisation de la région
a débuté, cette région se situait dans le territoire des Innus. Le développement
de l'industrie forestière, par l'octroi de territoires de coupe de bois et
l'implantation d'usines de production de pâte de bois, a empiété sur le
territoire des Innus. Ces derniers ont demandé aux autorités une indemnisation
et la protection de leurs territoires. En 1856, la réserve Mastheuiatsh
(Pointe-Bleue) a été créée. C'est la seule communauté innue dans la région du
lac Saint-Jean.
Dès 1898, l'entrepreneur forestier Damase Jalbert entreprend le projet de
construire et d'exploiter une pulperie sur la rivière Ouiatchouan. La
construction de l'usine, inaugurée en 1902, et l'aménagement d'une première zone
d'habitations dans le village se font simultanément. Plusieurs éléments naturels
structurent l'espace, dont la rivière Ouiatchouan et ses chutes, le canyon de la
rivière, les espaces boisés, la topographie du site de même que le réseau de
rues et de sentiers. Au fil des ans, quatre différents types de maisons
ouvrières sont érigées au sein de deux principaux secteurs d'habitations, à
savoir la basse et la haute-ville. Dès 1924, la crise qui prévaut dans le marché
de la pâte de bois mène à mal l'usine, ce qui conduit à la mise à pied des
ouvriers qui chercheront du travail dans les localités avoisinantes. L'usine de
Val-Jalbert ferme officiellement ses portes le 13 août 1927 en raison de
difficultés financières.
En août 1949, le gouvernement du Québec se porte acquéreur des installations de
Val-Jalbert, mais ce n'est qu'à partir de 1960 que le site est ouvert aux
visiteurs. N'ayant subi que peu de transformations, le site conserve son
organisation spatiale d'origine. Une trentaine de maisons ont été restaurées au
fil des ans, à l'instar d'autres bâtiments majeurs qui occupent aujourd'hui
diverses fonctions pour les visiteurs, notamment l'usine, le magasin général,
l'ancienne boucherie, le couvent et une maison d'hébergement. Une dizaine
d'autres maisons ont été intentionnellement laissées à l'état de ruines,
laissant la végétation envahir leur fondation pour évoquer l'époque ancienne de
ce village fantôme. Le village historique de Val-Jalbert accueille maintenant
chaque année 60 000 visiteurs.
|

©Ministère des Loisirs
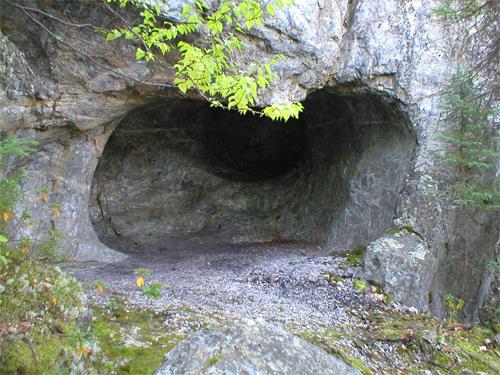
©Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, J. Gagnon, 2004 |
Lieu historique national du Canada de Waapushukamikw
Baie-James, Québec
Situé le long de la rivière Témiscamie dans une région campagnarde du
Nord du Québec, le lieu historique national du Canada de Waapushukamikw
est une colline de quartzite blanc qui domine une zone forestière
relativement plate. Aussi appelée Colline Blanche, cette montagne
culmine à environ 40 mètres de hauteur, fait 400 mètres en largeur et
s'étend dans un axe nord est, sud ouest sur 1200 mètres. Ses trois
crêtes, situées à environ 100 mètres les unes des autres, sont
relativement dénudées, ce qui lui donne son apparence blanchâtre. Le
sommet principal surplombe une carrière contenant des millions de
fragments de quartzite de Mistassini, tandis qu'à sa base se trouvent de
nombreuses cavités naturelles, dont la plus large est l'Antre de marbre,
une caverne aux murs de marbre lisse. Cette région est habitable
uniquement depuis 5 050 avant notre ère.
Situé dans une région habitable depuis la fonte des glaciers, environ 7
000 à 6 500 ans avant notre ère, Waapushukamikw est une source de
quartzite de Mistassini, une pierre blanche à grain fins et à
l'apparence cireuse, qui est translucide lorsqu'elle est mince. Les Cris
l'appellent Wiinwaapskw, ce qui signifie « graisse animale. » Le
quartzite de Mistassini réagit de façon prévisible aux coups des
artisans, ce qui en fait un matériau de choix pour les fabricants
d'outils. Les artisans autochtones étaient en mesure de fabriquer la
majorité des outils de pierre dont ils avaient besoin à partir de cette
matière, mais les sources de nourriture (les animaux) sont venues à
manquer dans la région, et c'est pourquoi elle n'a pas été occupée
longtemps. Selon les éléments archéologiques trouvés, les artisans et
leurs familles, après avoir fait provision de quartzite, préféraient se
rendre temporairement dans des régions plus accueillantes pour
transformer la pierre en outils. Les familles ou les groupes pouvaient
alors revenir à leurs lieux d'origine sans devoir transporter de grandes
quantités de pierre.
On croit que ces premiers tailleurs de pierre n'ont pas eu à creuser la
colline pour obtenir le matériau dont ils avaient besoin. Les fouilles
archéologiques ont démontré que les tailleurs ont pu récolter des blocs
qui se détachaient naturellement, particulièrement des talus d'éboulis
provenant de l'érosion du sommet principal, dont une partie attenante
est connue aujourd'hui sous le nom de carrière Rogers. Il est possible
que les outils aient même parfois été façonnés sur place, puisqu'on a
trouvé des grattoirs et des racloirs au pied de la colline, ce qui
laisse croire que les poignées ou manches dans lesquels seraient plus
tard insérés des couteaux ou des pointes étaient fabriqués sur place.
L'intérêt pour le quartzite de Mistassini est apparu tôt chez divers
peuples autochtones et s'est rapidement répandu dans presque tout le
Nord-Est de l'Amérique du Nord.
Située au pied de la colline, l'Antre de marbre est la plus grande
caverne de Waapushukamikw. À l'époque où les Européens ont redécouvert
l'endroit au XVIIIe siècle, les peuples autochtones de la région
l'appelaient Tchichémanitououitchouapi, ou maison du grand esprit. Pour
la communauté crie de Mistissini, cette caverne aux murs de marbre lisse
est un endroit d'importance spirituelle et un lieu de mémoire respecté.
L'ambiance qui se dégage de la grande Antre de marbre, qui servait aux
rites et rituels chamaniques, témoigne des croyances religieuses des
Algonquiens du Nord-Est en général et des Cris de Mistissini en
particulier.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc marin du Saguenay—Saint-Laurent
Siège social: Tadoussac, Québec and Rivière-Éternité, Québec
Une riche diversité de formes de vie marine : baleines, phoques, plantes
et oiseaux de toutes sortes.
Un territoire à découvrir en profondeur! Depuis sa création en 1998, le
parc marin œuvre à la protection et à la mise en valeur du milieu marin
d'une section de l'estuaire du Saint-Laurent et du fjord du Saguenay.
D'une superficie de 1 245 km2, ce vaste écosystème se
distingue par sa topographie sous-marine et par son fjord. La rencontre
des eaux de l'estuaire du Saint-Laurent avec celles du fjord du Saguenay
engendre des phénomènes océanographiques exceptionnels favorisant la
présence d'une grande biodiversité. Parmi les cétacés, cinq espèces
fréquentent régulièrement les eaux du parc marin, dont le béluga du
Saint-Laurent, une espèce protégée. Au total, plus de quinze espèces de
mammifères marins ont été rapportées, ce qui témoigne de l'importance
écologique du parc marin.
De plus, l'ancienneté de l'occupation humaine du territoire environnant
le parc marin du Saguenay—Saint-Laurent et l'impact déterminant produit
par la rencontre des civilisations amérindiennes et européennes en font
un haut lieu de l'histoire de l'Amérique du Nord.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada Forillon
Siège social: Gaspé, Québec
« Joyau de la Gaspésie », où la terre rencontre la mer.
Situé sur la pointe de la Gaspésie, le parc Forillon est une péninsule
montagneuse bordée par le golfe du Saint-Laurent et la baie de
Gaspé.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada de la Mauricie
Siège social: Shawinigan, Québec
Parcours de canot et portages sur les lacs serpentant à travers les
collines boisées.
Situé dans la chaîne de montagnes des Laurentides, le parc national de
la Mauricie est une aire naturelle de conservation de 536 km2 qui se
veut un échantillon représentatif de la région méridionale du Bouclier
canadien.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Réserve de parc national du Canada de l'Archipel-de-Mingan
Siège social: Havre-Saint-Pierre, Québec
Un chapelet d'îles sculptées par la mer.
Au-delà du 50e parallèle, frôlant la côte nord du golfe du Saint-Laurent
se trouvent une trentaine d'îles calcaires ainsi que plus de mille îles
et îlots granitiques disposés en un chapelet d'une rare beauté. On nomme
« archipel de Mingan » ce territoire devenu réserve de parc national en
1984.
Dans ce joyau sculpté à même le socle de pierre calcaire, on découvre de
spectaculaires monuments naturels, témoins du travail incessant de la
mer et du temps. Dans ce décor insolite et quasi irréel, la vie abonde.
Des plantes aux teintes et aux formes diverses, des oiseaux marins
rassemblés en colonie ainsi que des phoques, des dauphins et des
baleines qui viennent peupler l'immensité bleue enveloppant les
îles.
|
|