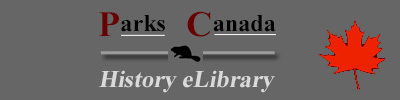|
Résumés parc
Colombie-Britannique
Tous les textes et photos sont la propriété de Parcs Canada ou le Répertoire canadien des lieux patrimoniaux
(Sauf indication contraire) et ont été extraites de l'une ou l'autre Parcs
Canada ou Lieux patrimoniaux du Canada. Les parcs avec un fond
gris sont gérés par Parcs Canada.

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Andrew Waldron, 2011 |
Lieu historique national du Canada 223, rue Robert
Victoria, Colombie-Britannique
Le 223, rue Robert est une résidence en bois d'un étage et demi, ornée
dans le style Queen Anne, construite en 1905. Le fait qu'elle soit
située dans une zone résidentielle concentrée contenant plusieurs
maisons de style, de dimensions et d'âge similaires, accentue encore
davantage son caractère pittoresque. La maison se trouve dans un
lotissement urbain près du bord de la mer, dans la partie ouest de
Victoria, en Colombie-Britannique.
Le 223, rue Robert a été désigné lieu historique national parce qu'il
constitue un exemple exceptionnel du style néo-Queen Anne exprimé à
travers son architecture domestique.
Sur la côte ouest, les traits caractéristiques de ce style
architectural, et notamment les tours cornières et les riches ornements
décoratifs, ont été de temps en temps appliqués, avec de très bons
résultats, à la conception de cottages de bois pittoresques. Cette
maison, construite en 1905 pour James McLearon Muirhead, en est un
exemple exceptionnel. Flanquée d'une tour cornière octogonale offrant
une vue sur l'océan, elle est richement pourvue à l'extérieur comme à
l'intérieur d'ornements de bois provenant de l'usine locale de rabotage
de la famille Muirhead.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1992 |
Lieu historique national du Canada de l'Académie-St. Ann
Victoria, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada de l'Académie-St. Ann se compose
d'un édifice monumental paré de brique et d'anciens jardins s'étendant
sur environ 6,25 acres. Il est situé dans le noyau urbain historique de
Victoria. Dans le jardin, on trouve une allée de procession bordée de
rangées d'arbres et de haies, un verger contenant une centaine d'arbres
fruitiers d'origine, le jardin du noviciat, une zone paysagée classique
contenant plusieurs arbres historiques, des vestiges, des jardins
réguliers, des haies, des allées et sentiers historiques, et des
plantations supplémentaires effectuées par les sœurs de Sainte-Anne
autour des bâtiments de l'Académie et le long des tronçons de
l'enceinte, ainsi qu'un mur périmétrique et un portail.
L'académie St. Ann a été désignée lieu historique national du Canada à
cause du rôle qu'elle a joué dans la vie culturelle et éducative de
l'Ouest du Canada pendant plus d'un siècle, et de son statut de point
d'intérêt de la communauté, vu ses dimensions et l'espace dégagé qui
l'entoure (les jardins).
Les Sœurs de Sainte-Anne, dont le siège est au Québec, sont arrivées à
Victoria en 1858. Elles ont répondu aux besoins éducatifs et infirmiers
sur la côte Ouest, en ouvrant une série de couvents, d'hôpitaux et
d'écoles de missionnaires partout en Colombie-Britannique, au Yukon et
en Alaska. Vu leur réussite à Victoria, elles avaient besoin
d'installations plus grandes. Ce fut fait lorsqu'on a construit en 1871
la première partie de l'édifice actuel, puis qu'on l'a agrandi par la
suite en 1886 et en 1910. De 1871 à sa fermeture en 1973, l'Académie St.
Ann a conservé son statut d'important établissement d'éducation. Il
symbolise encore la contribution des Sœurs à l'éducation et aux services
sociaux dans l'Ouest du Canada.
L'architecture caractéristique de l'académie St. Ann illustre la forte
influence des communautés religieuses canadiennes-françaises au cours de
cette période où s'est façonnée la Colombie-Britannique. En 1871, il
s'agissait du plus grand bâtiment de la province, et il est demeuré le
plus haut édifice en maçonnerie de Victoria pendant la plus grande
partie de son histoire. Même si les parties du bâtiment qui datent de
1871-1886 et de 1910 présentent des caractéristiques néo-baroques
propres à la conception des couvents du Québec au XIXe siècle, la
chapelle constitue un exemple unique de transplantation sur la côte
Ouest des conceptions religieuses traditionnelles québécoises aux XVIIe
et XVIIIe siècles. Ce bâtiment, bâti en 1858 par le frère Charles
Michaud, était la première cathédrale catholique romaine de Victoria. Il
avait à l'origine une charpente de bois. Il a été déplacé jusqu'à son
emplacement actuel et incorporé en 1886 dans le complexe de l'Académie.
La valeur patrimoniale de la chapelle a trait à son intérieur bien
préservé, et aux caractéristiques de sa masse et de sa conception.
L'emplacement de l'académie sur le terrain et ses éléments paysagers, et
notamment la voie d'accès officielle, les rangées d'arbres, les haies,
les jardins classiques, le verger et les murs d'enceinte, rehaussent son
caractère de point d'intérêt et ses dimensions monumentales. Ces
éléments confèrent une qualité renfermée au site, créent une atmosphère
de tranquillité symbolisant le caractère religieux et institutionnel de
l'académie, et la séparent de la ville. Le traitement cohérent de
l'édifice et des jardins illustre le fait que les Sœurs de Sainte-Anne
ont possédé et géré ce domaine sans interruption depuis plus d'un
siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Palais-de-Justice-de-Vancouver
Vancouver, Colombie-Britannique
L'ancien palais de justice de Vancouver est un imposant édifice de
pierre de style classique. Situé dans le quadrilatère délimité par les
rues Georgia, Howe, Hornby et Robson, il constitue un point de repère
remarquable au cœur du quartier des affaires de Vancouver, composé de
hautes tours de bureaux, d'hôtels et de complexes commerciaux. Il abrite
maintenant la Vancouver Art Gallery.
L'ancien palais de justice de Vancouver a été désigné lieu historique
national, car c'est un point de repère visuel et un symbole de justice
durable, ainsi qu'un exemple remarquable de ce type d'édifice
institutionnel.
Exemple de bâtiment permanent érigé pour l'application des lois en
Colombie-Britannique, cet édifice illustre l'importance que les
Canadiens accordent à un système judiciaire fort. Il reflète aussi la
croissance rapide de Vancouver, l'optimisme qui prévalait et la volonté
de doter la ville de services judiciaires complets en dehors du district
judiciaire de New Westminster. Le district judiciaire de Vancouver a été
créé en 1892. En 1906, il a fallu construire de nouveaux bâtiments, les
édifices précédents étant vite devenus obsolètes en raison de
l'accroissement rapide de la population de la ville.
L'ancien palais de justice est un bon exemple de style néo-classique
dans la tradition Beaux-Arts, représentatif des édifices publics
construits en Amérique du Nord à la fin du XIXe et au début du XXe
siècle. L'édifice consiste en une composition tripartite dont deux ailes
comportant des colonnes ioniques flanquant un fronton central saillant
et massif. Ce dernier présente un imposant portique soutenu par quatre
colonnes et surmonté d'un dôme recouvert de cuivre sur une base
surélevée. Il est l'œuvre de Francis Mawson Rattenbury (1867-1935), un
architecte renommé de Victoria, à qui l'on doit de nombreux édifices
publics importants de la Colombie-Britannique, notamment l'Édifice de
l'Assemblée législative à Victoria. Le palais de justice a ouvert à
l'automne 1911, et à l'époque, il était considéré comme le plus bel
édifice du genre au Canada.
En 1914, l'édifice étant devenu trop petit pour la population de la
ville, une nouvelle grande aile, reliée au bâtiment principal par un
corridor fermé de deux étages, a été ajoutée sur le côté ouest du
bâtiment, selon les plans de Thomas Hooper. À la même époque, une
récession économique a freiné la croissance démographique de Vancouver
et le projet d'ajouter une deuxième annexe ne s'est pas concrétisé.
Pendant près d'un demi-siècle, l'édifice a continué de répondre aux
besoins de la ville en matière de services judiciaires, jusque dans les
années 1970 où il a été décidé de construire de nouveaux bâtiments. On
siège dans les anciens locaux jusqu'en 1979, année où aura lieu la
réhabilitation de l'édifice. Arthur Erickson, un architecte de
Vancouver, a été chargé de dresser les plans du nouveau palais de
justice situé de l'autre côté de la rue, et de transformer l'ancien
palais de justice en musée, la Vancouver Art Gallery.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Andrew Waldron, 2011 |
Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Palais-de-Justice-de-Victoria
Victoria, Colombie-Britannique
Surplombant James Bay, à Victoria, en Colombie-Britannique, le lieu
historique national du Canada de l'Ancien-Palais-de-Justice-de-Victoria
est un bâtiment rectangulaire de trois étages, caractérisé par son
horizontalité, qui a été construit pour la Cour suprême de la
Colombie-Britannique. Sa conception éclectique qui date de la fin du
XIXe siècle offre une combinaison intéressante d'éléments stylistiques
variés. En raison de sa composition asymétrique, mais équilibrée, et de
son toit plat, le bâtiment représente une synthèse éloquente de
différents éléments comprenant entre autres deux fascinantes tours
circulaires de coins, de lourdes corniches, des cordons en saillie, des
fenêtres voûtées et des bossages au rez de chaussée. Surplombant le
secteur riverain, le bâtiment est un des points d'intérêt visuels de la
place Bastion. Les cours ayant été déménagées en 1962, le bâtiment a
depuis trouvé une nouvelle vocation et accueille maintenant le Maritime
Museum of British Columbia.
Terminée en 1889, la construction de l'ancien palais de justice de
Victoria marque une étape importante de l'évolution de l'organisation
judiciaire de la Colombie-Britannique. Il s'agit du premier édifice
public important construit après l'entrée de la Colombie-Britannique
dans la Confédération et du premier d'une série de palais de justice
bâtis en concertation dans toute la province. En effet, durant les sept
années suivantes, des palais de justice en brique ou en pierre seront
construits à Vancouver, à New Westminster, à Vernon et à Nanaimo. Celui
de Victoria demeure cependant unique en raison de son style
architectural éclectique intégrant des éléments stylistiques variés et
découlant de l'intention de Herman Otto Tiedeman de construire un
bâtiment fonctionnel où les considérations d'ordre pratique auraient
préséance sur l'aspect esthétique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2008 |
Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Historique-de-Gastown
Vancouver, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada de
l'Arrondissement-Historique-de-Gastown est situé sur la rive sud de
l'inlet Burrard, dans le centre-ville de Vancouver, en
Colombie-Britannique. L'arrondissement est implanté selon un quadrillage
qui suit les courbes de la baie. Le lieu compte 141 bâtiments érigés
principalement entre 1886 et 1914, notamment des tavernes, des hôtels,
des magasins ainsi que des entrepôts de brique et de pierre de trois à
six étages, réunis dans une zone commerciale homogène. De nombreuses
constructions en maçonnerie sont évidentes à travers le site, en mettant
l'accent sur les solides façades de brique et de pierre aux devantures
de magasin vitrées surmontées d'une fenestration régulière.
L'arrondissement historique de Gastown a commencé à se développer vers
la fin du XIXe siècle, sur la rive sud de l'inlet Burrard, dans le
centre-ville de Vancouver. Il est cadré selon un quadrillage suivant les
courbes de la baie et repose sur un terrain plat, près du niveau de la
mer. L'aménagement et l'emplacement de l'arrondissement témoignent du
développement précoce de Vancouver à titre de point de transbordement
important et prospère et de quartier de vente en gros de biens en
provenance des Prairies et le Pacific Rim. La construction du Chemin de
fer Canadien Pacifique (CFCP) à proximité favorise le développement
rapide du lotissement urbain et sa transformation en zone commerciale.
Les lignes électriques et téléphoniques courent le long des allées
plutôt que le long des rues, ce qui constitue un exemple typique du
développement urbain précoce de Vancouver.
Dans les années 1970, en réponse au mouvement de protection du
patrimoine qui voit le jour dans les centres urbains du Canada,
l'arrondissement bénéficie d'un processus d'embellissement. Les
organisations locales protègent son caractère historique en ajoutant
divers éléments aux zones urbaines, notamment des bornes le long de la
rue Water et autour de la place Maple Leaf, une statue de bronze
représentant « Gassy » Jack Deighton, l'aménagement paysager de Gaoler's
Mews, un pavage en briques rouges sur la rue Water et des lampadaires
ornés.
Après avoir été désigné aire patrimoniale par le gouvernement provincial
en 1971, l'arrondissement de Gastown se distingue peu à peu des
quartiers avoisinants de la péninsule du centre-ville. Il est
aujourd'hui caractérisé par des bâtiments réservés aux commerces et aux
bureaux (où sont parfois intercalés des espaces d'habitation et de
travail) comportant souvent des magasins et des restaurants au
rez-de-chaussée. Dans l'arrondissement, environ 141 bâtiments ont été
construits avant 1914. Ces bâtiments comptent souvent de deux à six
étages et affichent divers styles architecturaux, que ce soit le style
victorien italianisant caractéristique des bâtiments de la fin du XIXe
siècle, le style néo-roman victorien du début du XXe siècle ou le style
industriel et austère des bâtiments datant d'avant la Première Guerre
mondiale. Seulement six bâtiments ont été construits dans
l'arrondissement depuis 1914.
|

©PRA, neg. 14110, May 1956 |
Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Historique-de-Powell River
Powell River, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada de
l'Arrondissement-Historique-de-Powell River est une ville
mono-industrielle planifiée qui date du début du XXe siècle. Situé à
Powell River, en Colombie-Britannique, ce quartier résidentiel a un plan
standard composé de maisons à charpente de bois. Il s'étend sur une
courte distance sur le flanc d'une colline derrière l'énorme usine de
pâtes et papiers, puis s'étire vers le sud, empruntant légèrement une
forme de croissant le long d'une zone densément boisée. Le site est
limité par le détroit Malaspina, la rivière Powell et des montagnes très
boisées.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à sa représentation physique
d'une communauté planifiée et mono-industrielle datant du début du XXe
siècle. Conçu par la Powell River Company en 1911, son plan a été
réalisé par George F. Hardy, un ingénieur de New York, puis agrandi par
l'architecte John McIntyre.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2009 |
Lieu historique national du Canada de Barkerville
Barkerville, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada de Barkerville est situé près du
ruisseau Williams, dans l'est de la Colombie Britannique. La ville
historique est fondée en 1862 à la suite de la découverte d'importants
gisements d'or dans les champs aurifères de Cariboo, mais est ravagée
par un incendie en 1868. Une nouvelle ville est rapidement construite
sur les vestiges de l'ancienne mais son déclin se fait graduellement,
échappant à la disparition grâce à des opérations minières réduites et
la conservation de bureaux gouvernementaux. Vers la fin des années 1950,
on entreprend de reconstruire la ville et de remettre les bâtiments en
état pour que l'endroit retrouve son apparence des années 1869 à 1885.
Le lotissement urbain, entouré d'immenses fossés creusés par les
chercheurs d'or du XIXe siècle, représente le terminus de la route
d'accès carossable à la région de Cariboo, aussi connu sous le nom de «
Route Cariboo », et comprend le lieu historique national du Canada de
l'Édifice Chee Kung Tong.
La ville de Barkerville, érigée près du ruisseau Williams, commence à
prendre de l'ampleur vers 1862 à la suite de la découverte d'importants
gisements d'or dans les champs aurifères de Cariboo. Ceux-ci jouent un
rôle de premier plan dans le développement économique et politique de la
Colombie-Britannique. La prospérité de Barkerville résulte en partie de
la construction, entre 1862 et 1865, de la «Route Cariboo», par le
gouvernement de la Colombie-Britannique, alors une colonie anglaise. En
effet, ce chemin de 650 kilomètres facilite grandement l'accès aux
champs aurifères de Cariboo depuis la ville de Yale, un important port
pour bateaux à vapeur, jusqu'à la ville de Barkerville, située au coeur
des champs aurifères. L'aménagement de cette route d'accès fait partie
d'un plan de stimulation économique qui vise à éloigner les routes de
transport des intérêts américains, à réduire grandement les frais
d'expédition des marchandises vers les mines ainsi qu'à favoriser le
commerce et la colonisation à l'intérieur des terres. Malheureusement,
un incendie détruit presque entièrement la ville de Barkerville en 1868,
ne laissant que quatre bâtiments intacts. On entreprend immédiatement la
reconstruction de la ville sur les ruines de l'ancien établissement. La
découverte sporadique de nouveaux gisements et la nécessité d'entretenir
les édifices gouvernementaux permet à la communauté de survivre pendant
quelque temps, mais l'épuisement des mines amène la population à quitter
l'endroit. Les maisons abandonnées tombent en ruine et certaines doivent
être démolies.
À l'occasion du centenaire de la Colombie-Britannique, en 1958, le
gouvernement décide de remettre la ville en état et d'en faire un parc
historique provincial. On choisit de lui redonner son apparence des
années 1869 à 1885 en raison du rôle important qu'ont joué les champs
aurifères de Cariboo et le Route Cariboo à Barkerville dans le
développement économique et politique de la province à cette époque. Il
s'agit également d'une période marquante dans l'histoire de la
Colombie-Britannique, car c'est à ce moment qu'on a terminé le Chemin de
fer Canadien Pacifique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2008 |
Lieu historique national du Canada Begbie Hall
Victoria, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada Begbie Hall se trouve à
l'intérieur du complexe hospitalier Jubilee Hall de Victoria, en
Colombie-Britannique. Il s'agit d'un vaste bâtiment de brique de trois
étages à toit plat, construit afin de servir de résidence aux
infirmières. Ce site fait maintenant partie d'un grand ensemble
institutionnel.
Construit en 1926, Begbie Hall représente la reconnaissance et le
développement de la profession des soins infirmiers. Cette ancienne
résidence de femmes était construite spécialement pour héberger les
étudiantes de l'école des soins infirmiers de l'hôpital Royal Jubilee,
qui y soignaient les patients dans le cadre de leur formation. L'hôpital
fut fondé en 1890 et l'école de soins infirmiers, en 1891. Ses salles de
conférence, ses laboratoires et sa bibliothèque de référence modernes
appuyaient la formation scientifique essentielle à leur travail. Ici,
comme ailleurs au Canada, les infirmières bénéficiaient d'un endroit qui
leur était réservé pour développer le rôle professionnel qui leur était
indispensable pour offrir des soins de santé à l'hôpital et dans la
collectivité. Leur succès a inspiré les femmes à assumer de nouveaux
rôles au sein de la société. Cette ancienne résidence de femmes abrite
maintenant le siège social corporatif de santé de la Région de la
capitale.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Roger Eddy, 2002. |
Lieu historique national du Canada Boat Encampment
Warsaw Mountain, Red Rock Bay, Colombie-Britannique
À l'origine, le lieu historique national du Canada Boat Encampment se
situait à l'embouchure des rivières Wood et Canoe, dans le grand virage
du fleuve Columbia. En 1973, le monument de la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada marquant le lieu original est relocalisé
près du barrage Mica, avant l'inondation du secteur pour les
installations hydroélectriques aménagées sur le fleuve Columbia. Déplacé
de nouveau en 2000, ce monument, érigé sur une pointe de terre située
dans l'aire de loisirs de Sprague Bay, est orienté vers l'emplacement
initial de Boat Encampment, maintenant sous les eaux du réservoir du
barrage Mica.
Le Boat Encampment sert de point de transbordement important pour les
pelleteries de tout le continent qui empruntaient le fleuve Columbia.
David Thompson, un commerçant de pelleteries au service de la Compagnie
du Nord-Ouest fût le premier, en 1811, à visiter l'endroit, où il passa
l'hiver après avoir traversé le col Athabasca. Pendant une cinquantaine
d'années, Boat Encampment resta un point de rencontre pour les brigades
des fourrures de la Compagnie du Nord-Ouest, et plus tard, de la
Compagnie de la Baie d'Hudson. Elles y attendaient les convois qui
traversaient les montagnes depuis Jasper House, un important poste de
ravitaillement pour les commerçants de fourrures. Au printemps 1940,
voyageurs et touristes pouvaient se rendre à Boat Encampment, jusque-là
inaccessible par voie de terre, grâce à la construction de la boucle Big
Bend de la route Transcanadienne. Trente ans plus tard, l'endroit fût
inondé dans le cadre de l'aménagement hydroélectrique du fleuve
Columbia.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Canyon-Kitselas
Kitselas, Colombie-Britannique
Situé sur les rives de la rivière Skeena, dans la réserve indienne
Kitselas numéro un, le lieu historique national du Canada du Canyon
Kitselas est un emplacement naturel impressionnant contenant des
ressources culturelles importantes, comme des pétroglyphes, des mats de
totem, des arbres culturellement modifiés et des vestiges
archéologiques.
Cet endroit est peuplé par les Autochtones depuis environ 5 000 ans. Le
canyon est situé à un endroit stratégique entre l'intérieur et la côte,
et pour cette raison il a joué un rôle crucial dans la traite des
fourrures sur la côte ouest. La richesse du matériel qui survit sur ce
site a fourni des indices uniques et abondants sur l'histoire culturelle
du canyon.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Mario Savard, 2008 |
Lieu historique national du Canada de la Cathédrale-Catholique-St. Andrew's
Victoria, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada de la Cathédrale-Catholique-St.
Andrew's est un point de repère patrimonial imposant du noyau urbain de
Victoria, en Colombie-Britannique. La verticalité emphatique et
l'asymétrie pittoresque des tours jumelles de la cathédrale sont
rehaussées par une flèche élancée et une combinaison hardie des
matériaux de construction : brique rouge, pierre grise pâle, ardoise et
métal. Au sein de l'intérieur bien préservé, la voûte ornée, les vitraux
et les tribunes contribuent à la sensation de grandeur.
Conçue en 1892 par les architectes de Montréal Perreault et Mesnard et
construite par l'entrepreneur J.H. Donovan, St. Andrew's s'inspire des
cathédrales européennes dont la verticalité emphatique et l'asymétrie
pittoresque plaisaient beaucoup aux architectes du XIXe siècle.
L'influence du style néo-gothique français est évidente dans la façade
aux tours jumelles, la rosace centrale et le portail d'entrée triple.
Des éléments tels que le contraste de la riche palette de couleurs et
matériaux, créé par les murs de brique rouge, le cordon de pierre grise
et le toit d'ardoise, sont caractéristiques du style néo-gothique de
l'apogée victorienne.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, (NHS-images), 2004 |
Lieu historique national du Canada du Chantier-Naval-Britannia
Richmond, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada du Chantier-Naval-Britannia est un
parc historique situé le long du bras sud de la rivière Fraser, à
Richmond (Colombie-Britannique). Le site est lié à la longue
participation de la région à la pêche au saumon. Construit au-dessus de
l'eau, le chantier naval fait partie de l'agrandissement historique «
Cannery Row » de Steveston » à partir de Garry Point et du lieu
historique national du Canada Gulf of Georgia Cannery vers l'ouest à
London Heritage Farm à l'est. La désignation cartographique concerne le
site de 3,3 hectares situé le long du canal Steveston de la rivière
Fraser. Le parc historique comprend plusieurs constructions en bois
utilisées pour la conserverie et la construction de bateaux entre 1890
et le milieu des années 1950, qui ne sont pas compris dans la
reconnaissance officielle.
Le chantier naval Britannia a été désigné lieu historique national en
1991, parce que sa présence est représentative des activités de
construction et de réparation de bateaux de pêche au saumon de la côte
du Pacifique du Canada.
À l'origine, c'est-à-dire à partir de 1890, il s'agissait d'une
conserverie, qui a ensuite été transformée en chantier naval en 1918,
sous le nom de Chantier naval Britannia, spécialisé dans la réparation
des bateaux jusqu'en 1980, avec des bâtiments particuliers dans un
complexe pour servir autant de conserverie que de chantier naval. Le
chantier est représentatif des ateliers autrefois plus nombreux où se
construisaient et se réparaient les bateaux de pêche au saumon basés à
terre. La valeur patrimoniale du lieu historique tient à son association
historique avec la construction et la réparation de bateaux de pêche,
comme le montrent le site de 3,3 hectares, son emplacement et sa
relation spatiale avec les activités liées à la pêche le long de la
rivière Fraser.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national du Canada Church of Our Lord
Victoria, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada Church of Our Lord est un point
d'intérêt architectural important situé au cœur de Victoria, en
Colombie-Britannique. À l'extérieur de l'édifice, des éléments
d'architecture traditionnels en brique et en pierre de style gothique
sont adroitement adaptés à la construction de bois. La flèche sur le
toit, des pinacles corniers et le parement avec couvre-joints, tous en
séquoia de Californie, confèrent une certaine verticalité à l'édifice. À
l'intérieur, la nef est supportée par un système de blochets gothiques,
si bien qu'on jouit d'une vue sans obstacle sur l'abside et sur la
chaire. Une annexe a été ajoutée en 1913 du côté sud de l'église.
Suite à un schisme dramatique avec le diocèse anglican, le révérend
Edward Cridge a demandé à l'architecte renommé de la côte Ouest John
Teague de concevoir l'église Church of Our Lord, et il l'a fait
construire par la firme de constructeurs Haywood & Jenkinson pour
l'Église épiscopale réformée de Victoria. Le caractère néo-gothique de
l'édifice a été intensifié en exploitant les avantages du parement avec
couvre-joints qui renforce l'élan vertical de son toit à pignon, de ses
pinacles et de sa flèche sur le toit. L'intérieur de l'église présente
un bel exemple de voûte en blochets. L'architecte Samuel Maclure, bien
connu dans la région, a conçu en 1913 l'annexe de l'église appelée
Cridge Memorial Hall.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2000. |
Lieu historique national du Canada du Cimetière-Chinois-de-Harling Point
Oak Bay, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada du Cimetière-Chinois-de-Harling
Point est un site de 3,5 acres descendant en pente douce vers le
sud-ouest, en direction de la côte du détroit de Juan de Fuca. La zone
d'inhumation est recouverte d'une pelouse. Elle se compose de rangées
serrées de tombes individuelles dont la plupart sont parallèles au bord
de mer, ainsi que de 13 fosses communes. Trois cents de ces tombes ont
une pierre tombale. Deux tours d'incinération et un autel en plate-forme
constituent des centres d'intérêts cérémonials et visuels du cimetière.
L'absence d'éléments paysagers comme des arbres, des arbustes
ornementaux, ou des sentiers et allées en ligne droite, est conforme aux
principes du feng shui sur lesquels reposent les croyances spirituelles
traditionnelles chinoises.
La Chinese Consolidated Benevolent Association, qui est encore
propriétaire du site et continue à l'entretenir, a érigé ce cimetière en
1903. Jusqu'à 1950 il a servi à des inhumations privées. Il a été fermé
officiellement en 1961, après l'inhumation des restes de 849 pionniers
chinois dont le retour en Chine était empêché depuis 1937. Le cimetière
est alors devenu un site commémoratif en l'honneur de ces pionniers
sino-canadiens.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Col-Kicking Horse
Yoho National Park, Colombie-Britannique
Franchi par l'expédition Palliser (1857-1860); le Canadien Pacifique
l'adopta pour sa route à travers les Rocheuses, 1881.
Situé dans les parcs nationaux du Canada de Banff et de Yoho, le lieu
historique national du Canada du Col-Kicking Horse est un important
corridor de transport ferroviaire et autoroutier qui traverse les
montagnes Rocheuses. Le corridor constitue un paysage aménagé de rails,
d'emprises de voie ferrée, de pentes et de virages, de voies
d'accotement, de déversoirs à neige, de tunnels, de voies d'évitement,
de découpage dans le roc, de vestiges de camps de travail et d'autres
éléments de construction. Certains paysages de montagne parmi les plus
spectaculaires du monde entourent ce corridor de transport de chaque
côté.
Mentionné pour la première fois par l'expédition de Palliser de
1857-1860, ce col tire son nom d'un incident au cours duquel le Dr James
Hector, chirurgien de l'expédition, fut rué par son cheval en explorant
les environs. Le col fut peu utilisé jusqu'en 1881, année où le chemin
de fer Canadien Pacifique décida de l'adopter comme nouvelle route
traversant les Rocheuses, malgré sa préférence antérieure pour le col
Yellowhead, situé plus au nord. Cette décision a modifié l'emplacement
du chemin de fer dans tout l'Ouest canadien et a dramatiquement affecté
le développement de l'Ouest.
|
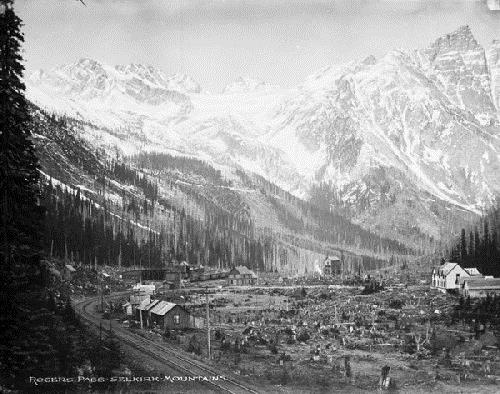
©Albertype Company / Library and Archives Canada - Bibliothèque et Archives Canada / PA - 032019, ca/v. 1900-1925 |
Lieu historique national du Canada du Col-Rogers
Glacier National Park of Canada, Colombie-Britannique
Lieu par lequel la voie ferrée du Canadien Pacifique traversait les
monts Selkirk.
Le lieu historique national du Canada du Col-Rogers est un corridor
historique à travers la chaîne Selkirk, situé entre un tronçon supérieur
de la rivière Columbia qui coule vers le nord où il traverse la chaîne
Selkirk à Big Bend et un tronçon inférieur qui coule vers le sud. Le col
se trouve dans les limites actuelles du parc national du Canada des
Glaciers.
La valeur patrimoniale du Col Rogers réside dans ses associations
historiques couvrant la période 1886-1917 représentées par le paysage et
les ressources connexes le long du tronçon de la Transcanadienne qui
traverse la chaîne Selkirk.
À la suite de la décision du Canadien Pacifique en 1881 d'adopter la
route sud qui franchit les Rocheuses au Col Kicking Horse, il a fallu
trouver un passage à travers la chaîne Selkirk difficile d'accès et
largement inexplorée. Le major A.B. Rogers, un ingénieur américain
spécialise dans la localisation de chemins de fer, franchi ce col
l'année suivante, surmontant ainsi le plus grand obstacle qui se
dressait devant le chemin de fer. La pente très abrupte et les risques
d'avalanches rendaient cette partie de la ligne particulièrement
dangereuse et, pour y remédier, on'y constuisit le tunnel Connaught en
1916. Depuis l'inauguration de la Transcanadienne en 1962, le col fait
de nouveau partie d'un axe de transport national.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Colline-Battle Hill-des-Gitwangaks
Gitwangak, Colombie-Britannique
XVIIIe siècle fort Tawdzep entourage de cinq longhouses, occupé par la
tribu Gitwangak, s'élevait sur cette colline.
Le lieu historique national du Canada de la Colline-Battle
Hill-des-Gitwangaks (anciennement connue sous le nom de fort Kitwanga)
contient les ruines d'un village fortifié du peuple Gitwangak. Il est
situé sur la rivière Kitwanga, dans les chaînes de montagnes Hazelton et
Buckley, au centre de la Colombie-Britannique.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la
Colline-Battle Hill-des-Gitwangaks a trait à ses liens avec l'histoire
des Gitwangaks, attestés par le site lui-même et par les ressources
archéologiques qu'on y a découvert. Selon la légende, le guerrier Nekt a
construit le fort Kitwanga comme place forte défensive. Ce fort, qui a
été occupé au moins depuis le XVIIIe siècle, se composait de cinq
longues maisons situées en haut d'une colline et entourées d'une
palissade. Le fort, lié de près au principal village résidentiel des
Gitwangaks, était situé au-dessus de la colline pour le protéger. Les
Gitwangaks partaient du fort pour leurs raids sur les établissements
situés le long de la rivière Skeena et sur la côte. Il a été brûlé et
abandonné vers 1835.
|

©Britannia Mine Museum |
Lieu historique national du Canada du Concentrateur-des-Mines-Britannia
Britannia Beach, Colombie-Britannique
Le Concentrateur des Mines Britannia est un concentrateur à alimentation
par gravité utilisé pour traiter le minerai de cuivre d'une des plus
grandes exploitations minières du Canada dans les années 1920 et 1930.
Il s'agit de la pièce centrale d'un complexe de bâtiments associés à
l'exploitation minière et à l'expédition de minerai, d'une construction
monolithique qui s'étage sur la face rocheuse du mont Sheer, à la pointe
de la baie Howe, à 28 milles, (45 kilomètres) au nord de Vancouver. Il
appartient actuellement à la Britannia Beach Historical Society et fait
partie du British Columbia Museum of Mining.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du
Canada-du-Concentrateur-des-Mines-Britannia tient au fait qu'il est un
exemple concret de la technologie novatrice qui a fait des Mines
Britannia un site d'exploitation de cuivre important dans l'histoire du
Canada. Le Concentrateur des Mines Britannia a été construit en
1922-1923 par Mines Britannia, qui extrayait du minerai de cuivre dans
la région du mont Sheer, sur la rive orientale de la baie Sound depuis
1903. Il a remplacé les concentrateurs à alimentation par gravité
précédents installés sur le site entre 1904 et 1914. Cette structure en
acier et en béton incorporait de nouvelles techniques de traitement et
d'exploitation minière. Grâce à ce concentrateur, conçu pour traiter 2
500 tonnes de minerai par jour, Britannia était le plus grand producteur
de concentré de minerai de cuivre de l'Empire britannique entre 1925 et
1930. Il a continué à fonctionner jusqu'à la fermeture des
Mines-Britannia, en 1974.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2002 |
Lieu historique national du Canada de la Conserverie-North Pacific
Port Edward, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada de la Conserverie-North Pacific
est un complexe de conserverie de saumon des XIXe et XXe siècles, situé
dans la communauté de Port Edward, juste au sud de la ville de
Prince-Rupert, sur la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique. Le
complexe est situé à l'embouchure de la rivière Skeena, sur une étroite
bande de terre entre les montagnes et le passage Inverness. Il se
compose d'un ensemble d'édifices en bois, pour la plupart de plain-pied,
regroupés le long d'un appontement en bois. L'appontement et plusieurs
des édifices sont sur pilotis. Le site est maintenant un musée de la
conserverie.
John Carthew a fondé cette conserverie, la North Pacific Canning Company
Ltd, en 1889. En 1891, il l'a vendue à Henry Bell-Irving, qui l'a
exploitée sous l'appelation l'Anglo-British Columbia Packing Company.
Elle a continué à fonctionner jusqu'en 1980. Les ressources bâties du
site se composent d'un assemblage relativement intact de structures
associées à divers aspects de l'industrie de la pêche de la côte Ouest
pendant presque un siècle. Le principal édifice de la conserverie
(1889), bien que légèrement modifié, est le plus ancien bâtiment de
conserverie subsistant en Colombie-Britannique. Le complexe a abrité de
nombreuses activités, y compris une conserverie de saumon (des années
1890 aux années 1950), une usine de salage (des années 1890 à 1920), une
fabrique de boîtes de conserve (après la Première guerre mondiale), des
installations de conservation frigorifiques (1900 à 1954), une usine de
production d'huile libre (début des années 1950), et une usine de
transformation du hareng (de 1955 à 1968 et de 1972 à 1980). La
disposition et les ressources bâties du complexe (y compris une centrale
électrique, des entrepôts d'approvisionnement, et les logements des
ouvriers), traduisent son isolement qui a nécessité son autosuffisance.
Ces deux caractéristiques sont typiques des conserveries du nord de
cette côte. La conception et la disposition des logements des ouvriers
illustrent le multiculturalisme de la main d'œuvre et la ségrégation qui
régnait dans les zones d'habitation et de travail en fonction des
ethnies.
Le riche collection d'édifices et de structures du site illustre
l'évolution, les procédés industriels et l'organisation complexe des
conserveries de la côte Nord-Ouest. Ensemble, les bâtiments reflètent
l'infrastructure nécessaire pour traiter toute une gamme de produits
associés à l'industrie de la pêche de la côte Ouest. Les édifices
attestent l'autosuffisance de la conserverie pendant la plus grande
partie de son histoire, la diversité culturelle et la ségrégation de sa
main d'œuvre, ainsi que le travail et la vie des ouvriers de la
conserverie et de leurs familles. À eux tous, les bâtiments du complexe
de la conserverie illustrent les réalités démographiques des communautés
exploitant une ressource unique, ainsi que le rôle qu'ont joué les
cultures européennes, asiatiques et autochtones dans le développement de
l'industrie halieutique de la côte Ouest et dans le développement
industriel de la Colombie-Britannique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Butterill, 1994 |
Lieu historique national du Canada Craigdarroch
Victoria, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada Craigdarroch, situé au sommet
d'une colline proche du centre-ville de Victoria, en
Colombie-Britannique, est un point d'intérêt éminent et renommé. Sa
conception en manoir écossais combine de façon éclectique des éléments
provenant de divers styles architecturaux, si bien qu'il évoque un
château romantique perché sur une colline. Construit de 1887 à 1890, ce
château se démarque à cause de sa combinaison unique de matériaux, de
son volume asymétrique à fort accent vertical, de sa ligne de toiture
pittoresque à forte pente, et du riche contraste de ses matériaux, de
ses couleurs et de ses ornements. L'édifice est situé sur une partie de
ce qui subsiste du domaine d'origine de Dunsmuir, qui mesurait 11
hectares (28 acres). Il domine le quartier résidentiel de Rockland, de
la ville de Victoria.
Le profil impressionnant du château, perché sur une colline surplombant
le centre-ville de Victoria, a été conçu exprès pour exprimer
ouvertement la richesse et le statut social de son premier propriétaire,
Robert Dunsmuir, un riche industriel qui a fait fortune grâce à
l'exploitation du charbon sur l'île de Vancouver. Craigdarroch incarne
le château de type «Bonanza», terme pouvant décrire les manoirs
construits pour de riches industriels nord-américains à la fin du XIXe
et au début du XXe siècles, pour symboliser leur réussite.
À ce titre, on a tout fait pour s'assurer que Craigdarroch soit le
manoir le plus grand et le mieux ouvragé dans l'Ouest canadien. Son
architecte, Warren H. Williams a combiné des éléments de divers styles
architecturaux pour créer une conception impressionnante voulant évoquer
un château d'Écosse, patrie d'origine de Dunsmuir. L'excellente qualité
du travail des ouvriers spécialisés, évidente dans la maçonnerie et les
ornements extérieurs, est tout aussi manifeste dans le parement des murs
et des planchers, les vitraux et la menuiserie de l'intérieur. La
combinaison de matériaux canadiens et importés (grès et granit de la
Colombie-Britannique, fer forgé fabriqué localement, marbre italien et
ardoise du Vermont, carreaux de terre cuite de Californie, lambris
d'intérieur de bois importés), qui était sans précédent dans l'Ouest
canadien à l'époque, a établi de nouvelles normes d'opulence dans la
région. Craigdarroch est un des premiers, des plus flamboyants et des
mieux conservés des châteaux de type «Bonanza» construits au Canada.
Par la suite, Craigdarroch a accueilli l'hôpital militaire de
Craigdarroch (de 1919 à 1921), le Collège de Victoria (de 1920 à 1946),
et le Conservatoire de musique de Victoria (de 1968 à 1979).
Aujourd'hui, il est exploité comme maison-musée.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, N. Clerk, 2002 |
Lieu historique national du Canada du Domaine-du-Lieutenant-Gouverneur-de-la-Colombie-Britannique
Victoria, Colombie-Britannique
Le domaine du lieutenant-gouverneur est un paysage culturel évolutif de
14,6 hectares situé dans une zone résidentielle de Victoria, sur une
hauteur appelée l'escarpement Rockland. Il jouit d'une vue imprenable
sur le détroit Juan de Fuca. Le site contient une mosaïque d'éléments
paysagers divers, comprenant 5,7 hectares de jardins et de terrains
agricoles, un peuplement mature de sapins de Douglas, et un grand
écosystème de chênes de Garry. Le site contient aussi la résidence
officielle construite en 1957-1959 pour remplacer l'ancienne détruite
par un incendie, un ensemble de cinq bâtiments construits entre 1872 et
1903, appelé The Mews, ainsi que les anciens bungalows du jardinier
(1903) et du chauffeur (1929).
La résidence actuelle, construite en 1957-1959, est la troisième
résidence officielle bâtie sur le site. Elle conserve les liens que les
deux précédentes avaient avec le site, et notamment son emplacement, ses
éléments de style néo-Tudor modifié, et la porte cochère de la résidence
antérieure détruite par un incendie. Les terrains du domaine, aménagés
originellement au début du XXe siècle selon un plan inspiré des grands
domaines britanniques de l'époque d'Édouard VII, présentent un éventail
de jardins d'ornement qui ont changé au fil des ans. Cette riche
mosaïque de paysages pittoresques, bucoliques et naturels, confère un
caractère distinct à ce domaine qui a joué un rôle remarquable dans
l'histoire de la Colombie-Britannique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1994 |
Lieu historique national du Canada de l'École-Craigflower
View Royal, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada de l'École-Craigflower est un
édifice de deux étages à ossature de bois situé sur la rive nord de
l'estuaire Gorge, dans la grande région métropolitaine de Victoria.
L'école a été construite en 1854-1855 pour répondre aux besoins des
enfants de la ferme Craigflower en matière d'éducation. Son plan à cinq
baies, son toit à pignon, ses proportions de style géorgien et son
parement extérieur blanc de planches à clins rappellent la forme et la
conception du lieu historique national du Canada du Manoir-Craigflower,
un autre lieu historique national du Canada situé à proximité. L'école
est une curiosité historique située bien en évidence.
L'école a été construite avec du bois provenant d'une scierie à vapeur
de la ferme Craigflower appartenant à la Compagnie de la Baie d'Hudson.
Conçu avec une salle de classe, une habitation pour le professeur et sa
famille au rez-de-chaussée et les chambres pour les pensionnaires, le
bâtiment desservait les enfants de la ferme et des établissements
avoisinants. Le bâtiment a également servi de lieu de rassemblement
public et religieux. Après avoir cessé ses opérations en 1911, le
bâtiment fut laissé à l'abandon jusqu'en 1927, soit au moment où il fut
restauré et transformé en musée par les « Native Sons and Native
Daughters of British Columbia ». Son intérieur et son extérieur
préservés illustrent les pratiques architecturales et les méthodes de
construction liées à la transition entre la traite des fourrures et la
colonisation sur la côte Ouest. Ils attestent de l'importance accordée à
l'éducation pendant les premiers stades de la colonisation de l'Ouest
canadien.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, N. Shields, 2006 |
Lieu historique national du Canada de l'Édifice-Chee Kung Tong
Barkerville, Colombie-Britannique
Situé dans le lieu historique provincial de la
Ville-Historique-de-Barkerville en Colombie-Britannique, le lieu
historique national du Canada de l'Édifice-Chee Kung Tong est niché au
creux des montagnes de la région de Cariboo, à une altitude de 1 280,2
mètres (4 200 pieds). Constitué d'une structure rectangulaire de deux
étages recouverte d'un parement de planches avec couvre-joints et
flanqué à l'est et au nord de deux appentis en bois, l'édifice Chee Kung
Tong s'élève du côté est de la route principale, au centre du quartier
chinois de Barkerville.
La structure principale de l'édifice Chee Kung Tong, l'une des plus
vieilles à subsister dans la ville historique de Barkerville, a été
construite entre 1874 et 1877. À l'origine, le bâtiment servait de lieu
de cérémonie, d'habitation et d'échange aux membres de l'organisation
Chee Kung Tong. À l'intérieur se trouvent une auberge, une cuisine et
une aire consacrée aux échanges sociaux au rez-de-chaussée, ainsi qu'une
salle de réunion et un autel au premier étage. Ce plan d'aménagement
intérieur fait du bâtiment un excellent exemple, bien conservé, de
l'architecture Chee Kung Tong du XIXe siècle au Canada et témoigne des
structures de l'organisation à l'époque des villes champignons en bois,
typiques des quartiers chinois de Colombie-Britannique. En tant
qu'association de bienfaisance, le Chee Kung Tong de Barkerville a
offert un gîte aux nouveaux arrivants et aux hivernants, ainsi qu'un
site pour la tenue régulière d'activités à caractère social, en plus de
coordonner les célébrations traditionnelles chinoises et Hong qui ont
renforcé le sentiment d'appartenance à la communauté. Exerçant un
certain contrôle politique sur les membres du Hong par l'entremise de
rencontres dans la salle de réunion du premier étage de l'édifice Chee
Kong Tong, la société Chee Kung Tong de Barkerville jouait un rôle actif
dans la vie sociale, politique, économique et récréative de ses
membres.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Andrew Waldron, 2011 |
Lieu historique national du Canada de l'Édifice-Malahat / Ancien-Édifice-de-la-Douane-de-Victoria
Victoria, Colombie-Britannique
L'Édifice Malahat / ancien édifice de la douane de Victoria est un
bâtiment en brique de trois étages, avec un toit mansardé, construit en
1874 et 1875. Il est situé dans le secteur riverain du port de Victoria
en Colombie-Britannique.
L'Édifice Malahat / ancien édifice de la douane de Victoria a été
désigné lieu historique national en 1987 parce qu'il était étroitement
associé à Victoria alors que la ville était le principal centre
commercial de la côte pacifique canadienne, et parce qu'il est un des
rares exemples préservés de bâtiment fédéral de style Second Empire.
À titre d'édifice de la douane de Victoria de 1875 à 1899, l'Édifice
Malahat a servi au commerce d'importation et d'exportation alors que
Victoria était le centre le plus achalandé de la côte Ouest. On y gérait
les permis d'exploitation minière pendant la ruée vers l'or du Klondike.
L'Édifice Mahalat est un des rares exemples préservés des bâtiments
fédéraux érigés dans tous les coins du Canada par le nouveau
gouvernement constitué juste après la Confédération. En bâtissant une
série de bâtiments imposants fournissant les services gouvernementaux de
base, et en particulier des bureaux de postes et des édifices des
douanes, le gouvernement du Dominion cherchait à établir une présence
fédérale dans tous les coins du pays. L'Édifice Mahalat, construit en
1874 et 1875, est un exemple manifeste de l'imposant style Second Empire
adopté sous la direction de Thomas Seaton Scott, premier architecte en
chef du ministère des Travaux publics (1872-1881). La réserve de sa
conception et de ses matériaux cadrait avec la taille modeste de
Victoria à l'époque.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Andrew Waldron, 2011 |
Lieu historique national du Canada de l'Édifice Rogers
Victoria, Colombie-Britannique
L'Édifice Rogers est un petit bâtiment commercial de l'ère victorienne,
avec une extravagante devanture de boutique de style néo-Queen Anne. Il
est situé au centre ville de Victoria.
L'Édifice Rogers a été désigné lieu historique national en 1991 parce
que cette boutique est un exemple exquis d'adaptation du style néo-Queen
Anne aux petits édifices commerciaux.
La façade de l'Édifice Rogers est représentative des applications
commerciales du style néo-Queen Anne. Les accessoires et ornements
décoratifs, d'origine, de l'intérieur de la boutique créent une
atmosphère accueillante et conviviale typique de ce style.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Catholique-Saint-Paul
North Vancouver, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada de l'Église-Catholique-Saint-Paul,
avec ses flèches jumelles et conçue selon le style néo-gothique.
L'Église constitue un point de repère important situé dans la réserve
des Premières nations Mission qui occupe quinze hectares sur la rive
nord de Burrard Inlet, en face du port de Vancouver. Érigée au cœur de
la communauté de la réserve Mission, elle est entourée de résidences et
d'édifices publics, et est adjacente au jardin « Celebration of
Creation, » créé en 1998 pour commémorer les Anciens de la nation
Squamish.
L'église catholique Saint-Paul est associée aux Oblats de Marie
Immaculée, un ordre missionnaire catholique qui a joué un rôle important
dans l'introduction du catholicisme dans l'Ouest du Canada et les basses
terres continentales de la Colombie-Britannique. Créée en 1864, cette
réserve de mission a été le premier établissement permanent de ce qui
est devenu la région de North Vancouver. La chapelle d'origine datant du
milieu des années 1860 a été remplacée en 1884 par une église plus vaste
à ossature de bois, munie d'un clocher saillant à l'avant. L'église
catholique Saint-Paul actuelle, construite à partir des murs de l'église
de 1884, a été considérablement modifiée et agrandie avec deux flèches
jumelles en 1909.
L'église catholique Saint-Paul est un exemple remarquable de
l'architecture religieuse néo-gothique au Canada. Les murs de l'édifice
de 1884 ont été conservés, tandis que des tours d'angle hautes de 26
mètres ont remplacé la tour centrale d'origine. L'ajout des transepts,
de la sacristie et des chapelles circulaires a conféré à l'édifice une
élégante forme de croix, unique en son genre parmi les églises de
mission des Oblats en Colombie-Britannique. À l'exception des deux
colonnes du chœur qui datent de 1884, la décoration s'est limitée à la
menuiserie ouvragée à la scie à chantourner dont la plus grande partie a
été supprimée pendant les rénovations ultérieures. L'église a réouvert
en 1910 sous le nom de Saint-Paul, en mémoire du Père Durieu, le premier
missionnaire oblat de la région. Il s'agit de la dernière église de
mission des Premières Nations de cette taille et de cette complexité à
être construite en Colombie-Britannique, ainsi que la dernière qui
subsiste encore.
|
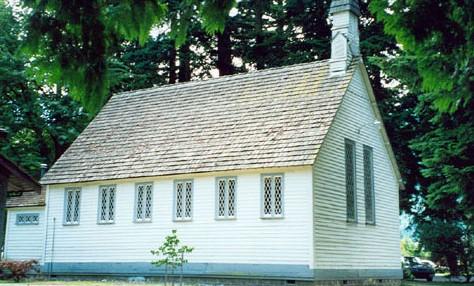
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Janet Wright, 1994 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Christ Church
Hope, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada de l'Église-Christ Church consiste
en un édifice de bois, modeste, de style néogothique, admirablement
construit et situé dans la ville de Hope en Colombie-Britannique. Le
bâtiment est constitué des sections clairement lisibles de la nef, du
sanctuaire et d'un porche sur le côté, le tout coiffé de toits à pignon.
L'extérieur est recouvert de planches à clins et comporte des fenêtres
carrées et un porche d'inspiration gothique. Le caractère historique du
bâtiment est mis en valeur par la beauté du milieu où il se trouve sur
un grand terrain bien entretenu et entouré de sapins matures.
Associé à l'Église anglicane, le style néo-gothique religieux
constituait un retour à des formes plus traditionnelles dans la
conception des églises basée sur l'architecture anglaise du Moyen-Âge.
Les éléments, tels que l'entrée sur le côté dotée d'un portique
gothique, le clocher et la séparation évidente de la nef et du
sanctuaire dans des volumes visiblement distincts, sont caractéristiques
de ce style. À l'intérieur, la séparation entre la nef et le sanctuaire
est accentuée, au moyen d'une balustrade, et en élevant le sanctuaire de
trois marches au-dessus de la nef.
L'église Christ Church est une des 14 églises anglicanes semblables
construites en Colombie-Britannique de 1859 à 1866 sous la direction de
l'évêque George Hills et exécutées sous l'égide du Corps of Royal
Engineers cantonné en Colombie-Britannique au plus fort de l'époque de
la ruée vers l'or. La construction de ces églises faisait partie d'un
plan concerté visant à établir des institutions britanniques dans les
nouvelles colonies de l'île de Vancouver et la Colombie-Britannique
continentale. À l'église Christ Church, ces objectifs étaient exprimés
clairement par la haute qualité de la construction et le respect
rigoureux des normes de conception « high church » exigées par l'évêque
Hills et fournis par les Royal Engineers et les constructeurs locaux.
L'église Christ Church est l'une des églises les plus anciennes et les
mieux conservées de l'Ouest canadien.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1983 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Holy Cross
Skookumchuck Hot Springs, Colombie-Britannique
L'église Holy Cross constitue une remarquable et pittoresque
interprétation d'une église en bois de style néo-gothique que les
membres de la communauté des Premières nations Skookumchuk ont construit
pour leurs besoins. Située dans le village de Skatin (Skookumchuk),
l'église se trouve au coeur même de la communauté et est orientée vers
la rivière Lillooet. La façade avant comporte trois flèches octogonales
allongées qui s'élèvent des clochers en lattes de bois. L'église est
constituée d'une aire de culte principale et d'une sacristie en appentis
à l'extrémité est du bâtiment. Les murs de l'aire de culte, de la
sacristie et des tours sont constitués d'un bardage de planches
horizontales, peintes en blanc, se chevauchant sur une charpente de
bois. Le toit et les flèches sont recouverts de bardeaux de cèdre
ordinaires et décoratifs.
L'église Holy Cross a été désignée lieu historique national du Canada en
1981 du fait qu'il s'agit d'un bel exemple d'église de mission de style
néo-gothique.
Le bâtiment est une impressionnante église en bois de style néo-gothique
située dans une région isolée de la Colombie-Britannique. Son profil
distinctif, incluant ses trois flèches néo-gothiques, en fait un lieu
d'intérêt immédiatement reconnaissable pour les Premières nations et les
autres résidents de la province. Du point de vue historique, l'église
est une des nombreuses églises de mission construites par les Oblats de
Marie Immaculée, communauté catholique qui a établi des missions dans de
nombreuses communautés autochtones dans l'Ouest canadien à la fin du
XIXe siècle et au début du XXe siècle. L'église est un symbole
communautaire qui a servi de centre d'accueil spirituel pour le peuple
Skatin et les autres peuples de la Nation Stl'atl'imx au cours du siècle
dernier.
La qualité d'exécution évidente de la construction de l'église témoigne
du savoir-faire des personnes qui l'ont construite. L'extrémité nord-est
de l'aire de culte contient un autel très décoré garni d'un parement
délicatement sculpté (retable). Le plafond au-dessus de la section de
l'autel (choeur) est rabaissé en une voûte ogivale et deux voûtes
latérales en plein cintre, conférant une importance visuelle au parement
d'autel et aux autels latéraux. L'église possède aussi une colombe en
bois magnifiquement sculpté qui à l'origine était suspendue au-dessus de
l'aire réservée à l'hostie. Une table de communion basse sépare le
choeur, tant physiquement que spirituellement, de la nef meublée de
bancs en bois peint de couleur bourgogne aux extrémités sculptées de
chaque côté d'une allée centrale. Deux confessionnaux en bois sculpté
non peint sont situés à l'arrière de la nef et deux volées d'escalier en
bois dans chaque coin mènent à un jubé doté de bancs semblables à ceux
décrits précédemment et d'une rampe chantournée peinte de façon
décorative. Bien que les détails reflètent l'influence du style
néo-gothique, on retrouve des dérogations subtiles et complémentaires à
ce style qui sont l'expression d'un mélange de motifs de conception
européenne et autochtone évidentes dans la croix et les arcs du
tabernacle, les extrémités en forme de bec des lobes des fleurs de lis,
les montants tournés et cannelés et la forme de la base des bouts de
banc.
|

©British Columbia Archives / Archives de la Colombie Britannique, #F-05775 |
Lieu historique national du Canada Fort-Alexandria
Alexandria, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada Fort Alexandria est situé sur la
rive ouest du fleuve Fraser, près de la communauté d'Alexandria dans le
district de Cariboo en Colombie Britannique. Il ne subsiste aucun
vestige visible du fort érigé en tant que poste de traite par la
Compagnie du Nord-Ouest en 1821.
Alexander Mackenzie fut le premier européen à visiter la ville actuelle
d'Alexandria au cours de ses expéditions. Après son arrivée en 1793, il
trouva un village de Premières nations, probablement Secwepemc
(Shushwap), sur le fleuve Fraser. Ses habitants, invoquant la présence
de groupes autochtones hostiles, le découragèrent de s'aventurer plus au
nord. Mackenzie rebroussa donc chemin, et 30 ans s'écoulèrent avant que
d'autres explorateurs européens ne visitent la région. En 1821, la
Compagnie du Nord Ouest établit un poste de traite sur le fleuve Fraser
et lui donna un nom inspiré de celui d'Alexander Mackenzie en
reconnaissance de sa visite antérieure de la région. Le fort Alexandria
fut le dernier poste créé avant la fusion de la Compagnie du Nord Ouest
et de la Compagnie de la Baie d'Hudson plus tard au cours de la même
année. Le fort représenta le terminus nord de la piste des brigades de
la Compagnie sur la côte du Pacifique. À partir de 1826, les brigades
remontèrent le fleuve Columbia jusqu'au fort Okanagan pour y amener des
produits qui furent ensuite envoyés au fort Alexandria par convois
muletiers, avant d'être acheminés au poste de Nouvelle Calédonie par
voie maritime. Cette façon de faire persista jusqu'à ce que le transport
routier supplantât les brigades dans les années 1860.
Au milieu du XIXe siècle, on découvra de l'or dans le district de
Cariboo en Colombie Britannique, où est situé le fort Alexandria. En
1863, un sentier connu sous le nom de la route d'accès à la région de
Cariboo, fut prolongé jusqu'à Alexandria pour être emprunté par les
prospecteurs. La route Cariboo, qui passa tout près de l'ancien fort
Alexandria, est le pendant moderne de cette piste. En 1867, le fort fut
converti en ferme et fournit des produits agricoles à la communauté
voisine de Quesnel ainsi qu'aux mineurs qui se dirigèrent vers le nord,
à Barkerville. La Compagnie de la Baie d'Hudson abandonna la propriété
en 1881, et les bâtiments furent démolis en 1915.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2008 |
Lieu historique national du Canada Fort-Hope
Hope, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada du Fort-Hope est situé dans la
ville de Hope, dans le sud de la Colombie-Britannique. En 1848-1849, un
poste de la baie d'Hudson entouré d'une estacade est construit ici en
face du fleuve Fraser. Il ne subsiste aucun vestige lié à l'emplacement
d'origine du fort Hope. Situé au 211, rue Wallace, le lieu désigné
occupe une superficie de 0,6 hectare et comprend un petit ensemble de
bâtiments commerciaux et de parcs de stationnement. Le cairn de la
Commission des lieux et monuments historiques du Canada commémorant le
fort Hope est situé non loin du lieu désigné, sur la rive du fleuve
Fraser, au coin des rues Wallace et Walter.
Construit à Hope comme poste de traite de la Compagnie de la Baie
d'Hudson, le fort Hope est l'un des points d'entrée vers l'intérieur des
terres. La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du
Fort-Hope réside dans ses associations historiques avec le développement
de l'économie et des relations internationales du pays. À la suite du
règlement de frontière de 1846, qui stipule que l'embouchure du fleuve
Columbia se trouve sur le territoire des États-Unis, la Compagnie de la
Baie d'Hudson ne peut plus emprunter cette voie navigable et doit
trouver une nouvelle route d'approvisionnement. Elle décide donc
d'acheminer les biens en provenance de Langley sur le fleuve Fraser
jusqu'au point de départ de la navigation, où l'on construit le fort
Hope entre 1848 et 1849. Le fort devient le point de transbordement
entre la voie fluviale et la voie terrestre connue sous le nom de «
piste des brigades » reliant le fort Langley et les postes de
l'intérieur. Les biens sont ensuite transportés par convoi jusqu'à
Kamloops, puis jusqu'à Alexandria, où ils sont acheminés par voie
navigable jusqu'aux postes de la Nouvelle-Calédonie, un district de la
Compagnie de la Baie d'Hudson en Colombie-Britannique. La Compagnie de
la Baie d'Hudson utilise ce réseau de transport complexe jusqu'au début
de la ruée vers l'or, qui entraîne une multiplication des routes dans la
région après 1860. Le lieu comprend actuellement un petit ensemble de
bâtiments commerciaux et de parcs de stationnement répondant aux besoins
des entreprises locales et de la communauté.
|
|
Lieu historique national du Canada Fort-Kamloops
Kamloops, Colombie-Britannique
David Stuart construisit ici en 1812 le premier poste de la Pacific Fur
Company. La Compagnie du Nord-Ouest, qui s'était établit au même endroit
en 1812, acheta l'année suivante le poste qui devint la priopriété de la
Compagnie de la Baie d'Hudson. Le poste de la rivière Thompson ne fut
jamais une entreprise lucrative, mais il avait l'avantage de chevaucher
la route de la brigade qui menait du département de Columbia à New
Caledonia. La Compagnie conserva Kamloops pour l'élevage des bêtes de
somme. L'orsque les routes provinciales furent améliorées, ce ranch
devint inutile et on abandonna le poste vers 1885.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Gordon, 2005

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, A. Cornellier, 1988 |
Lieu historique national du Canada du Fort-Langley
Langley, Colombie-Britannique
Poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson établi au début du XIXe
siècle.
Le lieu historique national du Canada du Fort-Langley est le site d'un
poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson situé sur la rive sud du
fleuve Fraser, à environ 48 km de Vancouver. Il contient un entrepôt
d'origine en billots de bois, ainsi que plusieurs évocations plus
récentes de bâtiments historiques à l'intérieur d'une palissade en bois
reconstruite. Le site est l'objet d'une interprétation et est ouvert au
public.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du
Fort-Langley a trait à ses liens historiques, tels qu'illustrés par le
site et les ressources subsistantes. Construit à l'origine en 1827 sur
un site situé 4 km en amont de son emplacement actuel, le poste a été
déménagé et reconstruit en 1839. Mais un incendie l'ayant détruit en
1840, il a fallu le reconstruire à nouveau. La Compagnie de la Baie
d'Hudson a continué à exploiter un poste sur ce site jusqu'en 1886, bien
que vers la fin son activité se concentrait davantage sur le commerce
agricole et sur l'empaquetage du poisson. Fort Langley est devenu lieu
historique national en 1923. Depuis, des fouilles archéologiques ont
permis de localiser ses palissades ainsi que les vestiges de plusieurs
de ses bâtiments et structures. Le site a été développé pendant deux
principales périodes d'expansion, à savoir tout d'abord dans les années
1950 lors des célébrations du centenaire de la province, puis dans les
années 1990.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Department of Mines and Technical Surveys (Natural Resources Canada), 1929 |
Lieu historique national du Canada Fort-McLeod
McLeod Lake, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada du Fort-McLeod se trouve sur la
rive ouest de la rivière Pack, à l'extrémité nord du lac McLeod, en
Colombie-Britannique. Il se situe dans un lieu patrimonial provincial,
soit le parc historique du Fort McLeod, et comprend un atelier, une
maison et un entrepôt se trouvant dans la section clôturée du fort. Les
petits bâtiments de bois surmontés de toit à pignon sont construits de
façon simple.
Au début du XIXe siècle, la traite des fourrures prenait de l'expansion
dans l'ouest, gagnant les montagnes Rocheuses jusqu'à l'océan Pacifique
alors que la Compagnie du Nord-Ouest subissait de plus en plus la
concurrence de la Compagnie de la Baie d'Hudson et des commerçants de
fourrures américains. Par conséquent, en 1805, Simon Fraser a entrepris
une expédition vers l'ouest en partance de Fort William, sur le lac
Supérieur, afin de s'emparer du marché de la traite des fourrures du
côté ouest des montagnes Rocheuses pour le compte de la Compagnie du
Nord-Ouest. La région ainsi découverte a été baptisée
Nouvelle-Calédonie.
Fraser a chargé un groupe d'hommes de remonter la rivière Pack afin de
construire, au lac Trout, un fort en rondins entouré d'une palissade; ce
fort a ensuite été nommé Fort McLeod en l'honneur d'Archibald Norman, un
des associés principaux de la Compagnie du Nord-Ouest. Le Fort McLeod
est devenu la plaque tournante des activités de traite des fourrures de
la Compagnie en Nouvelle-Calédonie; pendant deux décennies, il a
constitué le seul lien entre les deux versants des montagnes Rocheuses.
Suite à la fusion des Compagnies du Nord-Ouest et de la Baie d'Hudson en
1821, le fort est demeuré un poste de traite des fourrures actif
jusqu'au XXe siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada J. Mattie, 1997 |
Lieu historique national du Canada Fort Rodd Hill
Colwood, Colombie-Britannique
Fort érigé à la fin du XIXe siècle pour assurer la défense de Victoria
et d'Esquimalt.
Le lieu historique national du Canada Fort Rodd Hill est un emplacement
de la défense côtière du XIXe et du XXe siècles situé stratégiquement
dans le port d'Esquimalt près de Victoria en Colombie-Britannique. Il
contient trois batteries d'artillerie situées dans un lieu ouvert,
semblable à un parc, reliées par un réseau de circulation historique. Le
lieu comprend d'autres bâtiments et structures se trouvant à l'extérieur
des batteries individuelles. Le fort est entouré d'aires forestières
naturelles au nord et à l'ouest, du port d'Esquimalt à l'est et du
détroit de Juan de Fuca au sud.
La valeur patrimoniale du fort Rodd Hill a trait à l'intégrité et à la
visibilité de son paysage culturel. Son emplacement et son cadre
stratégiques ainsi que l'aménagement, l'orientation, la nature et la
composition des nombreux ouvrages de défense qu'il contient sont le
témoignage de près d'un siècle de changements en matière de conception
et d'exigences militaires.
En 1878, le Canada a construit des batteries temporaires a Macaulay
Point avec du matériel militaire excédentaire de la marine britannique.
Ces batteries furent construites pour protéger le port de Victoria et la
base navale d'Esquimalt durant la crise anglo-russe de cette même année.
Au cours des années 1890, le Canada a négocié avec la Grande-Bretagne la
construction d'une série de défenses permanentes pour la région
Victoria-Esquimalt, pourvues de troupes britanniques pour défendre
l'Empire. Construction a commencé sur Fort Rodd Hill en 1895. Le Canada
a assumé le contrôle de ces fortifications en 1906 et les a
considérablement agrandies et reconstruites avant la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Elles ont été déclarées désuètes en 1956. Le lieu a par
la suite été acquis par Parcs Canada.
|
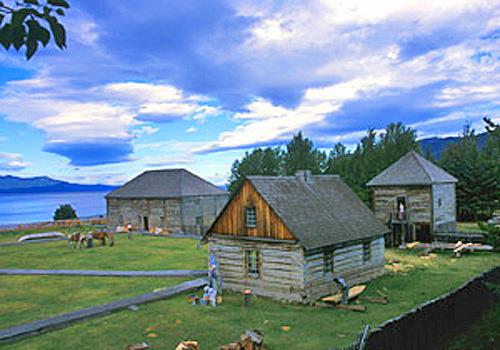
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, D. Houston, 2003

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, D. Houston, 2003 |
Lieu historique national du Canada du Fort-St. James
Fort St. James, Colombie-Britannique
Poste de traite des fourrures établi par Simon Fraser en 1806, la
Compagnie de la Baie d'Hudson.
Le Lieu historique national du Canada du Fort-St. James est un ancien
poste de traite situé dans le village de Fort St. James, à l'extrémité
sud du lac Stuart en Colombie-Britannique. Ce complexe restauré est
établi sur la rive d'un lac, entre la réserve des Premières nations
Nak'azkli et le quartier d'affaires du village. Le site comprend des
bâtiments, des ressources archéologiques et des éléments reconstruits.
Le lieu historique national du Canada du Fort-St. James doit sa valeur
patrimoniale à ses liens historiques, tels qu'illustrés par son
emplacement et ses ressources historiques préservées. La Compagnie du
Nord-Ouest a fondé le fort St. James pour faire du commerce avec la
Première nation Carrier, puis ce poste a été exploité à partir de 1821
par la Compagnie de la Baie d'Hudson. De 1826 à 1862, il était le siège
social du district de Nouvelle-Calédonie de la Compagnie de la Baie
d'Hudson. Par la suite, il lui a servi de base pour le transport vers le
nord de la Colombie-Britannique. Pendant cette période, le fort
occupait, sur la rive du lac Stuart, un site vaguement défini et en
constante évolution. Le poste a fermé ses portes en 1952, quatre ans
après avoir été déclaré lieu historique national.
On l'a subséquemment restauré et reconstruit tel qu'il était en 1896,
pour que le public puisse le visiter. Le fort contient des ressources
archéologiques datant de la période de 1806 à 1952, ainsi que des
bâtiments d'origine, à savoir : l'Entrepôt général, de 1888-89; la Cache
à poissons, de 1888; le Bâtiment des hommes, de 1884-85 et 1888-89; le
Logement des officiers, de 1884-85; et la Laiterie, déjà construite en
1896.
|
|
Lieu historique national du Canada Fort-St-John
Fort St. John, Colombie-Britannique
Après les expéditions de Mackenzie, la Compagnie du Nord-Ouest établit
plusieurs postes de traite entre Dunvegan et Hudson Hope. Le premier
fort St. John, bâti en 1806 au confluent des rivières Beatton et de la
Paix, fut souvent déplacé le long de cette dernière. Devenu possession
de la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1821, à la suite d'une razzia
indienne en 1823, il fut abandonné pendant trente-sept ans. C'est au
dernier poste (1925) que la localité de Fort St.John doit son
nom.
|

©Google Earth, 2009. |
Lieu historique national du Canada Fort-Steele
Fort Steele, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada Fort Steele, aussi appelé le poste
Kootenay, se trouve dans la ville de Fort Steele, en
Colombie-Britannique. Le fort, établi en 1887, est le premier poste de
la Police à cheval du Nord-Ouest en Colombie-Britannique. Il est situé
de façon stratégique sur une falaise surplombant la rivière Kootenay. Il
ne subsiste aucun bâtiment d'origine du fort Steele.
Le fort Steele fut établi au cours de l'été 1887 par le chef de police
Samuel B. « Sam » Steele en tant que premier poste de la Police à cheval
du Nord-Ouest (P.C.N.-O.) en Colombie-Britannique. D'abord appelé poste
Kootenay, le fort fut construit lorsque le détachement (Division « D »)
de la P.C.N.-O. est envoyé dans la région pour résoudre un conflit entre
la tribu locale des Ktunaxa et les colons européens. La présence de Sam
Steele et de la P.C.N.-O. assura la résolution pacifique du conflit et
rétablit l'ordre dans la communauté, ce qui ouvra la voie au
développement de la région. À partir de juillet 1888, le détachement fut
envoyé au fort Macleod et le poste Kootenay fut abandonné. Après le
départ de Sam Steele, les citoyens de Galbraith's Ferry renommerent leur
ville Fort Steele, témoignant ainsi de leur reconnaissance pour son
travail. En 1897, la ville de Fort Steele s'agrandit et engloba
désormais l'emplacement du poste Kootenay.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Andrew Waldron, 2011 |
Lieu historique national du Canada Fort-Victoria
Victoria, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada Fort-Victoria se trouve à
l'extrémité sud de l'île de Vancouver, à Victoria, en
Colombie-Britannique. Aujourd'hui situé dans le centre-ville de Victoria
au coin des rues Fort et Government, le site a été établi par la
Compagnie de la Baie d'Hudson en 1843. Les seuls vestiges de ce poste du
XIXe siècle sont une palissade, deux bastions, et trois anneaux
d'amarrage, lesquels se trouvent à l'ouest du site dans le port de
Victoria, à côté du lieu historique national du Canada de
l'Édifice-Malahat / Ancien-Édifice-de-la-Douane-de-Victoria.
La valeur patrimoniale du fort Victoria réside dans son association
historique avec les activités commerciales de la Compagnie de la Baie
d'Hudson (HBC), ainsi que dans son rôle de centre politique parmi les
premiers de la Colombie-Britannique. En 1843, la Compagnie de la Baie
d'Hudson a établi le fort Victoria au bord de James Bay, où se trouve
aujourd'hui la ville de Victoria. Les Britanniques ont construit le fort
à la suite de l'invasion d'une partie de leur territoire par les
Américains, craignant que ces derniers prennent le contrôle de l'Oregon
et des terres du Nord. L'ouvrage a servi comme un rappel visuel que la
région appartenait bien à l'Empire. En 1846, la frontière de l'Oregon a
été fixée au 49e parallèle, et le poste du fort Victoria est devenu le
principal entrepôt et le siège social de la HBC pour ses activités de
traite de fourrures dans la région du Pacifique. Les navires y ont
déchargé des approvisionnements destinés à un vaste réseau de forts et y
ont pris des produits naturels pour l'exportation vers l'Alaska, la
Californie et Hawaii.
En 1849, la première assemblée législative de la colonie de Vancouver se
réunit au fort Victoria et l'année suivante, la colonie de l'île de
Vancouver a été établi avec Richard Blanshard à titre de gouverneur et
fort Victoria comme capitale. Après une brève montée en flèche de la
population en 1858 en raison de la ruée vers l'or, le terrain sur lequel
se trouve le fort a été vendu et la palissade démolie. Quelques années
plus tard, les derniers bâtiments de l'ouvrage ont été rasé.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Gulf of Georgia Cannery
Richmond, Colombie-Britannique
Remarquable usine de transformation du poisson située sur la côte Ouest
(1894).
Le lieu historique national du Canada Gulf of Georgia Cannery est un
grand complexe de bâtiments de bois associés à la transformation et à la
mise en conserve du poisson. Il est bâti sur un quai situé sur la rive
nord du bras sud du fleuve Fraser, au niveau de son embouchure dans le
détroit de Géorgie, dans le village de Steveston. Ce site historique est
maintenant ouvert au public.
La valeur patrimoniale du site est attestée physiquement par le complexe
de bâtiments, construits et modifiés entre 1894 et 1964, qui illustrent
l'industrie de la transformation et de la mise en conserve du poisson
pendant la première moitié du XXe siècle. Au fil des ans, la conserverie
est devenue une usine de réduction du hareng. Finalement, elle a fermé
ses portes en 1979 et on a utilisé ses bâtiments comme entrepôts et
comme ateliers à filets, jusqu'à ce que le gouvernement du Canada
l'achète pour l'exploiter à titre de lieu historique national.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, L. Maitland, 1995 |
Lieu historique national du Canada Hatley Park / Ancien-Collège-Militaire-Royal Roads
Colwood, Colombie-Britannique
Hatley Park est un domaine de 228,84 hectares situé au bord d'Esquimalt
Lagoon. L'élément central du domaine est le château Hatley, un manoir de
style néo-Tudor érigé dans un paysage ouvragé de style d'Édouard VII
composé de quatre zones : les jardins, les espaces de loisirs, les
terres agricoles et la forêt. Le domaine contient aussi divers éléments
illustrant son long rôle à titre de collège militaire, ainsi que le
paysage évolutif de Hatley Park. On y a notamment adapté et aménagé
plusieurs bâtiments annexes en salles de classe et en logements pour le
personnel. De plus, le domaine comporte toute une gamme de structures à
vocation spécifique, deux terrains de sport et un terrain de parade,
construits entre les années 1940 et le milieu des années 1970.
Le château Hatley, construit en 1908-1909 pour James Dunsmuir, un
industriel prospère qui faisait aussi de la politique provinciale, est
remarquable à cause de son plan de style néo-Tudor conçu par Samuel
Maclure, un architecte renommé de la côte ouest. Il se distingue aussi
parce qu'il se trouve au centre d'un paysage de style d'Édouard VII
conçu par les architectes paysagistes Brett et Hall. La famille Dunsmuir
y a vécu jusqu'en 1937. Le ministère de la Défense nationale a acheté le
domaine en 1940 pour y installer le collège militaire Royal
Roads.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-Empress
Victoria, Colombie-Britannique
L'hôtel Empress est un hôtel de pierre de style château construit au
début du XXe siècle. Il est situé bien en vue en haut de l'arrière-port
de Victoria.
L'hôtel Empress a été désigné lieu historique national en 1980, car son
type architectural de style château revêt une importance nationale.
L'hôtel Empress a été construit pour la Compagnie de chemin de fer du
Canadien Pacifique (CP). Il fait partie d'une série d'hôtels de style
château construits par les compagnies ferroviaires canadiennes au début
du XXe siècle pour inciter les touristes à emprunter leurs itinéraires
transcontinentaux. Ces hôtels, dont le public appréciait les décorations
ouvragées et le confort élégant, sont rapidement devenus des symboles
nationaux d'un hébergement de qualité. Le vocabulaire architectural de
style château de ces hôtels ferroviaires est progressivement devenu un
genre typiquement canadien. L'hôtel Empress est caractéristique du début
de cette évolution d'une conception strictement de style château à une
conception intégrant des formes contemporaines. L'Empress a été
construit de 1904 à 1908 d'après des plans de Francis M. Rattenbury. Il
a par la suite été agrandi en 1910-12 selon des plans de W.S. Painter,
puis en 1928 selon les plans de J.W. Orrock.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2001 |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Chilliwack
Chilliwack, Colombie-Britannique
L'hôtel de ville de Chilliwack consiste en un petit édifice
magnifiquement détaillé, conçu dans le style Beaux-Arts classique et
occupant un coin de rue bien en vue du centre-ville de Chilliwack en
Colombie-Britannique. L'emplacement occupé par l'édifice comporte des
éléments paysagers matures et un cénotaphe à la mémoire des soldats de
la communauté morts en service.
Conçu par l'architecte de renommée de la côte ouest Thomas Hooper,
l'édifice hébergeait à l'origine la police et les salles d'audience en
plus des salles du conseil et des bureaux administratifs municipaux.
L'édifice demeure un édifice patrimonial vital pour la ville, bien qu'il
ne serve plus d'édifice municipal depuis 1980. Il héberge présentement
le musée de Chilliwack. L'aménagement paysager mature et le parc
commémoratif de guerre à l'arrière de l'édifice soulignent son
importance de longue date aux yeux des citoyens de Chilliwack.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2003 |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Kaslo
Kaslo, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Kaslo est
situé au cœur de la municipalité de Kaslo, en Colombie-Britannique. Le
bâtiment de deux étages à charpente de bois est surmonté d'un toit à
quatre versants, au sommet tronqué, et il repose sur des fondations de
moellons et de briques. L'architecture du bâtiment adopte un vocabulaire
classique dans le traitement des colonnes et des frontons souvent
associés aux édifices publics de la fin du XIXe siècle. Une entrée
centrale majestueuse domine un escalier en fer à cheval et définit
l'élévation principale. L'entrée est encadrée par un portique en saillie
qui s'élève sur deux étages, surmonté d'un beffroi imposant muni
d'arcades ouvertes et d'une base décorative. Ces éléments accentuent la
verticalité de l'édifice et lui confèrent la noblesse et l'importance
qui en ont fait un point de repère durable au sein de la communauté.
Construit à l'apogée de l'essor minier qui a transformé la région de
Kootenay, en Colombie-Britannique, et exactement cinq ans après
l'établissement de Kaslo en tant qu'important centre administratif, de
services et de transport, cet hôtel de ville symbolisait les aspirations
et l'optimisme des citoyens quant à l'avenir de leur communauté.
L'hôtel de ville de Kaslo a été érigé pour abriter les salles du conseil
municipal et les bureaux administratifs, le tribunal provincial, les
services d'incendie et de police et la prison. Cet imposant édifice à
plusieurs fonctions est devenu un point de repère durable qui
confèrerait un air de progrès et de stabilité à la jeune municipalité.
L'oeuvre fut conçue par le cabinet d'architectes Ewart and Carrie de
Nelson en Colombie-Britannique. La conception exploite le potentiel
architectural et décoratif du bois de Colombie-Britannique, évident dans
les éléments d'inspiration classique qui entourent les fenêtres, les
portes, la corniche, le portique de l'entrée et le beffroi. L'intérieur
qui a subi relativement peu de modifications depuis la construction
constitue un excellent exemple d'édifice public important construit en
bois.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Andrew Waldron, 2011 |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Victoria
Victoria, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Victoria
est un édifice en brique de deux étages et demi, de style Second Empire.
Ses éléments architecturaux, et notamment la tour de l'horloge centrale
proéminente, le toit en mansarde percé de lucarnes, et les nombreux
ornements muraux, confèrent à l'édifice une stature de monument durable
qui exprime la fierté municipale.
L'Hôtel de ville de Victoria a été désigné lieu historique national du
Canada en 1977, car c'est un des plus beaux exemples architecturaux qui
subsistent de bâtiments publics de style Second Empire dans l'Ouest du
Canada.
L'Hôtel de ville de Victoria est caractéristique de la volonté qu'ont
depuis longtemps les Canadiens d'ériger des monuments pour exprimer leur
fierté municipale et leur optimisme vis-à-vis de l'avenir. Les
dimensions de cet édifice, construit en trois étapes entre 1878 et 1890
pour en amortir les coûts, sont justifiées parce qu'il abrite un large
éventail de fonctions municipales, et notamment les salles du conseil,
des bureaux municipaux, une caserne de pompiers, un marché public et une
prison. L'annexe arrière a été construite en 1963. L'Hôtel de ville de
Victoria continue de concrétiser la vision de ses bâtisseurs, car il est
toujours le siège du gouvernement local, et il demeure un point
d'intérêt sur le plan architectural.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2002 |
Lieu historique national du Canada de l'Installation-Hydroélectrique-de-Stave Falls
Mission, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada de
l'Installation-Hydroélectrique-de-Stave Falls est située à cinq
kilomètres au nord du fleuve Fraser, au cœur de la vallée de la rivière
Stave, dans le district régional de Dewdney-Alouette de la
Colombie-Britannique. Le vaste bassin de la propriété et les chutes de
30 mètres peuvent produire 300 mégawatts de l'alimentation en énergie
pour le Lower Mainland. L'installation comprend trois barrages,
l'ouvrage d'amenée, le barrage principal et le barrage Blind Slough,
ainsi que la centrale, le poste extérieur et l'équipement connexe.
Dominant le lieu, la centrale située sous les barrages qui forment le
lac Stave, est un bâtiment en béton armé avec une charpente intérieure
en acier qui sert maintenant de musée et de centre d'interprétation
consacré à l'histoire du développement hydroélectrique en
Colombie-Britannique.
Terminée en 1912 puis agrandie dans les années 1920, l'installation
hydroélectrique de Stave Falls est un exemple bien préservé d'usine
hydroélectrique caractéristique du début du XXe siècle. Les deux
premières unités et les barrages de Stave Falls ont été construits au
point culminant de la deuxième phase du développement hydroélectrique du
Canada, axée sur l'introduction de systèmes électriques en courant
alternatif, une innovation technologique qui a permis de construire des
centrales électriques éloignées des utilisateurs. Bon nombre de
problèmes relatifs à l'hydroélectricité ont été résolus durant cette
période et les installations hydroélectriques ont proliféré dans un pays
riche en ressources hydrauliques.
De par sa conception et sa technologie, Stave Falls était une centrale
caractéristique de cette deuxième phase. Le lieu est remarquable pour
l'inventaire complet et intact de l'infrastructure hydroélectrique, à
savoir, les barrages, les conduites forcées, le poste extérieur et la
centrale complète avec les alternateurs, les turbines et les
transformateurs d'origine. La conception extérieure constitue également
un bon exemple de la richesse architecturale caractéristique des
centrales de cette époque. Les détails des murs extérieurs ont été
soigneusement étudiés comme en témoignent les pilastres qui ponctuent
les baies structurales du bâtiment, les lignes de corniche à chacun des
deux niveaux de toit, les parapets à gradin de chaque mur pignon, et les
appuis en béton sous la plupart des fenêtres.
Le développement hydroélectrique et la production d'électricité ont
largement contribué à modeler l'histoire et le paysage de la vallée
Stave et à favoriser l'essor économique de la Colombie-Britannique.
L'installation de Stave Falls reflète le climat politique et économique
dans lequel le développement hydroélectrique s'est fait en
Colombie-Britannique, une période où les pratiques de pillage des
promoteurs privés étaient monnaie courante et ont permis à une seule
compagnie de dominer le marché durant les premières décennies du
vingtième siècle. Le regroupement des entreprises de ce secteur a
conduit à la création de la British Columbia Electric Railway Company
(BCER) qui a privilégié le développement hydroélectrique, devenant ainsi
l'une des principales entreprises de production d'électricité de
l'Empire britannique. Depuis le déclassement de la centrale, ce lieu est
devenu un musée.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, M. Trépannier, 2001 |
Lieu historique national du Canada des Jardins-Butchart
Brentwood Bay, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada des Jardins-Butchart est une
attraction publique de renommée internationale et ouverte aux visiteurs
depuis 1904. Ils sont situés dans la péninsule de Saanich, environ 21
kilomètres au nord de Victoria, en Colombie-Britannique. Les jardins
occupent le site d'une ancienne carrière en bordure de Tod Inlet. La
zone désignée des jardins occupe environ 5,26 hectares et correspond aux
espaces mis en valeur sous la direction de Jennie Butchart de 1904 à
1939. Les jardins présentent des arrangements floraux spectaculaires aux
formes et aux styles diversifiés sur un fond d'arbres et d'arbustes
matures et reliés par un réseau de sentiers et d'aires de transition.
Les jardins sont parsemés de belvédères offrant des points de vue de Tod
Inlet et des collines au loin.
L'aménagement des jardins en une série d'espaces clairement définis ou «
pièces », chacun doté de son propre caractère et style, est
caractéristique des aménagements paysagers édouardiens. Le plus grand et
le plus particulier de ces espaces est le jardin en contrebas, qui
occupe l'ancienne carrière de calcaire. On y accède par un escalier en
lacet en descendant les 15 mètres (50 pieds) jusqu'au sol ondulé de ce
jardin, le noyau initial du processus d'aménagement paysager amorcé par
Jennie Butchart. Le sol du jardin contient des massifs d'annuelles
répartis parmi les arbres et les arbustes à fleurs plantés jusqu'à la
base des parois imposantes de la carrière couronnées de sapin de Douglas
matures, de des cèdres et de peupliers de Lombardie. Les autres espaces
comprennent la roseraie constituée de massifs de rosiers hybrides de
thé, d'arceaux de rosiers et de haies de buis; le jardin japonais
commencé en 1906 par Jennie Butchart et le paysagiste japonais Isaburo
Kishida avec son réseau complexe de bassins interconnectés, entrecroisés
de sentiers et de ponts, de surfaces couvertes de mousse, de bambou et
d'arbres et arbustes taillés minutieusement; le bassin Star Pond doté
d'un bassin d'eau de la forme d'une étoile à 12 pointes entrecoupées de
massifs d'annuelles et d'une grenouille comme pièce d'eau centrale; le
jardin italien, un jardin en contrebas classique défini par une terrasse
rectangulaire en béton qui encadre un bassin d'eau en forme de croix.
La résidence Butchart atteste que ces magnifiques jardins ont déjà fait
partie d'un domaine patrimonial privé. À l'origine une petite résidence
d'été, ce bungalow horizontal a été agrandi et transformé lors de
rénovations effectuées entre 1911 et 1925 selon des plans du célèbre
architecte de la côte Ouest Samuel Maclure. Cette ancienne résidence est
flanquée d'un vaste patio appelé la Piazza, du jardin italien et du
jardin privé initial de Jennie Butchart. Ce dernier est un petit jardin
classique contenant des massifs de fleurs, un belvédère et un bassin qui
est encadré par des clôtures en treillis.
|

©Gregory Melle, Flickr, http://www.flickr.com/photos/canadagood/3452022259/, 2007 |
Lieu historique national du Canada Kitwankul
Gitanyow, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada Kitwankul est situé près de la
confluence du ruisseau Kitwankul et de la rivière Kitwanga, à
l'intérieur de la réserve indienne Kitwankul 1, dans le village de
Gitanyow (anciennement appelé Kitwankul). Il y avait autrefois à cet
endroit un village traditionnel tsimshian où s'élevaient des monuments
et des maisons dont l'extérieur était peint selon la coutume de
l'époque. Au moment de la désignation, on y trouvait des vestiges
architecturaux, notamment des empreintes de bâtiment au sol, et environ
20 mâts totémiques originaux datant, pour la plupart, du milieu à la fin
du XIXe siècle. Il y avait également un cimetière situé le long d'une
route principale.
Le lieu historique national du Canada Kitwankul se situe là où se
trouvait l'un des villages gitxsan les plus intactes sur le plan
culturel. Ce village des Gitksans est important pour son art monumental
et son rôle de centre cérémoniel partagé par les habitants des régions
des rivières Nass et Skeena. Ce village a joué un rôle important dans la
tradition de la cérémonie du potlatch. Jusqu'en 1950 environ, il est
uniquement accessible par le « Old Grease Trail », un sentier datant de
la période de pré-contact qui passe entre les rivières Nass et Skeena.
Compte tenu de cet accès difficile, le village est isolé de la
modernité. Son emplacement sur le sentier favorise son utilisation comme
intermédiaire entre les peuples niskas et gitxsan, et ses habitants se
marient et célèbrent des potlatchs avec les membres de ces deux groupes.
Il y avait plus de mâts que dans tout autre village tsimshian, et il en
subsiste aujourd'hui moins de 20. Un grand nombre d'entre eux datent du
milieu à la fin du XIXe siècle, et certains du début du XXe. Trois mâts
sont envoyés par les villageois au Musée provincial de la
Colombie-Britannique, à Victoria, aux alentours de 1960, en échange de
reproductions fabriquées par Henry Hunt, un célèbre sculpteur kwakiutl.
Ces reproductions sont érigées en 1970, accompagnées d'une plaque de
lieu historique provincial. Les autres mâts sont restaurés par la Skeena
River Totem Pole Preservation Society puis érigés à nouveau en
1968.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Kootenae House
Invermere, Colombie-Britannique
Emplacement d'un poste de la compagnie du nord-ouest
(1807-1812).
Situé juste au nord d'Invermere, en Colombie-Britannique, le lieu
historique national du Canada Kootenae House est un site archéologique
situé au confluent du ruisseau Toby et du fleuve Columbia. Il reste
quelques vestiges en surface ainsi que des dépressions qui marquent
l'emplacement sur lequel le fort s'élevait autrefois. Les pâturages, les
pinèdes de sapin Douglas et la terrasse défendable située en surplomb de
la rivière évoquent les qualités du paysage au moment où Kootenae House
s'y trouvait.
En 1806, un commis de la Compagnie du Nord-Ouest, Jaco Finlay, balisa un
sentier qui traversait le col Howse et reliait la Saskatchewan au fleuve
Columbia. L'année suivante, David Thompson suivait ce même itinéraire
pour atteindre le Columbia, puis remontait la rivière pour construire
Kootenae House juste en aval du lac Windermere, afin de faire la traite
avec les Ktunaxa (Kootenae). Utilisant ce fort comme base, il a exploré
les régions en amont du Columbia et de la rivière Kootenay et a établi
une chaîne de postes dans le bassin versant du Columbia. Kootenae House
fut utilisée périodiquement jusqu'en 1812, au moment où les hostilités
avec les Peigans vivant à l'est du col en ont forcé l'abandon. Le
terrain où s'élevait Kootenae House fut légué au gouvernement fédéral en
1935 par Madame Alice M. Hamilton, à la mémoire de son mari Basil G.
Hamilton.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, S.D. Bronson, 1997 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Binning
West Vancouver, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Binning est situé sur
un petit terrain en pente dans une rue résidentielle paisible et bordée
d'arbres de l'ouest de Vancouver, en Colombie-Britannique, et elle offre
une vue sur l'inlet Burrard. Cette petite maison de deux chambres est
composée de deux volumes rectangulaires disposés sur deux niveaux pour
profiter de la topographie naturelle du site. Avec sa volumétrie basse
et son toit plat, la résidence s'intègre au paysage et disparaît presque
entièrement dans la végétation.
La Maison Binning est l'une des premières illustrations du mouvement
moderne en architecture résidentielle au Canada. Destinée à servir de
modèle d'architecture résidentielle, elle alliait une approche
moderniste de la forme et de la fonction avec une économie et une
efficacité de construction, en utilisant des matériaux locaux et les
technologies de construction les plus récentes. Des caractéristiques
telles que la construction à poteaux et à poutres, la simplicité des
volumes rectangulaires, les toits plats et les surplombs profonds, les
grandes fenêtres et le plan intérieur ouvert, ont défini un type de plan
qui allait influencer l'architecture résidentielle de l'après-guerre,
jusqu'aux années 1950 et 1960. Conçue et construite pendant la guerre,
alors qu'il était très difficile de se procurer matériaux et main
d'œuvre pour les résidences privées, la Maison Binning a été érigée avec
des matériaux locaux et traditionnels afin de fournir un type de maison
pouvant être produit en série, à un prix abordable pour toute famille
ayant un revenu moyen. La conception est également remarquable pour
l'intégration de l'architecture dans le paysage. Le plan du bâtiment sur
plusieurs niveaux suit la pente du terrain, et les grandes fenêtres, les
larges terrasses et les treillages en surplomb prolongent l'architecture
dans le paysage et suppriment les barrières entre l'espace intérieur et
l'extérieur.
Selon l'artiste Bertram Charles Binning (1909-1976), un chef de file de
l'idéologie moderniste, l'architecture devait être l'expression
harmonieuse de la science et de la société. Il a conçu les plans en
collaboration avec les architectes-conseils C.E. Pratt et R.A.D.
Berwick, afin que la maison exprime l'union de l'art abstrait et des
nouvelles formes architecturales. Pour ce faire, il a intégré à la
maison une galerie pour y installer une sélection changeante de ses
peintures, s'assurant ainsi que son environnement domestique évoluerait
en même temps que son art. Convaincu que les critères esthétiques
d'harmonie, d'intégrité, d'ordre et d'équilibre s'appliquaient autant à
l'art qu'à l'architecture, Binning a travaillé en tant qu'artiste et
enseignant, transmettant la notion de bonne conception architecturale
dans la vie urbaine contemporaine.
Le paysage ayant évolué, le travail artistique original a été remplacé
par les dernières œuvres de Binning et la maison a subi des
modifications et des réparations mineures; toutefois, l'intention de la
conception initiale demeure intacte.
|
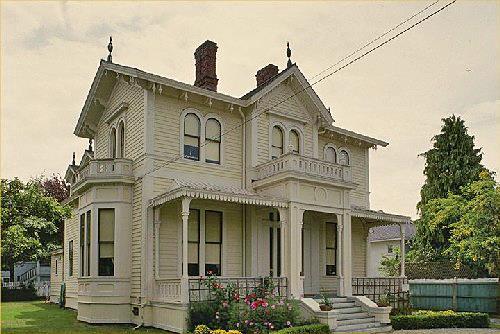
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Emily-Carr
Victoria, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Emily Carr est une
maison de style pittoresque à l'italienne située sur un lotissement
résidentiel du district de la baie James, à Victoria en
Colombie-Britannique. L'artiste Emily Carr y a passé son enfance.
Emily Carr (1871-1945) est une des peintres les plus renommés du Canada,
et une auteure bien connue, qui a passé la plus grande partie de sa vie
dans la région de Victoria. Cette maison, construite pour son père
Richard Carr, ainsi que ses environs, ont eu une influence marquée sur
Emily Carr pendant ses années de formation. Elle l'a d'ailleurs reconnu
dans ses livres. C'est là que sont nés son désir de créer et son
appréciation de l'art. La situation de la maison est importante. En
effet, sa proximité du parc Beacon Hill et de la côte océane ont
beaucoup contribué à faire apprécier à Carr l'environnement naturel
pendant toute sa vie, et lui ont donné sa vision unique de la côte de la
Colombie-Britannique.
La maison est un excellent exemple de villa de style pittoresque à
l'italienne bien préservée. Elle a été conçue par John Wright, de la
firme Wright et Sanders, qui est un des premiers architectes renommés de
la côte Ouest.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-de-la-Point Ellice / Maison-O'Reilly
Victoria, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada de la Maison-de-la-Pointe-Ellice /
Maison-O'Reilly se trouve sur une parcelle de terre boisée surplombant
la voie navigable Gorge dans la ville de Victoria, en
Colombie-Britannique. Il s'agit d'une belle maison de plain pied
d'inspiration victorienne et aux formes asymétriques érigée dans un
jardin convivial de style pittoresque, où arbres matures et massifs de
fleurs bordent des sentiers sinueux. Le bâtiment à charpente de bois se
distingue par les détails pittoresques de ses dentelles, tel que ses
corniches à consoles et sa galerie au toit arqué ornée de balustrades et
de colonnes effilées.
Construite en 1861, la maison est agrandie en 1875, puis en 1889,
période durant laquelle elle appartient à Peter O'Reilly, commissaire en
chef de l'Or pour la Colombie Britannique et distingué citoyen de
Victoria. Après Peter, qui se porte acquéreur de la propriété en 1867,
plusieurs générations d'O'Reilly s'y succèdent jusqu'en 1975.
L'aménagement éclectique de cette résidence pittoresque, la luxuriance
de ses jardins et la beauté de ses pièces, pratiquement inchangées et
débordant d'objets accumulés par la famille O'Reilly, témoignent à
merveille des goûts de la classe distinguée et prospère en matière
d'esthétisme durant la période victorienne. Autrefois entourée d'autres
propriétés majestueuses, dans l'un des quartiers résidentiels les plus
huppés de la ville de Victoria, la maison de la Pointe Ellice / maison
O'Reilly constitue aujourd'hui l'un des derniers témoins d'un style
ayant eu la cote au XIXe siècle et que le développement urbain a
pratiquement fait disparaître. La maison abrite maintenant un
musée.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1990 |
Lieu historique national du Canada du Manège-Militaire-de-la-Rue-Bay
Victoria, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada du Manège-Militaire-de-la-Rue-Bay
est un imposant bâtiment en brique, en acier et en béton dont le plan
évoque une forteresse médiévale monumentale. La taille du bâtiment, la
richesse de ses détails architecturaux, ses vastes installations et son
emplacement central sur la rue Bay près du centre-ville de Victoria, en
Colombie-Britannique, témoignent de la fierté des nouvelles forces
militaires du Canada au moment de sa construction et de l'importance de
son rôle dans l'histoire canadienne du début du XXe siècle.
Érigé pendant la campagne de développement de la milice de 1896 à 1918,
le manège militaire de la rue Bay fait partie de la centaine
d'établissements du genre construits à l'époque dans l'ensemble du pays.
La campagne vise à donner plus de visibilité à la milice canadienne à la
suite de ses succès pendant la Guerre des Boers et aux préparatifs de la
Première Guerre mondiale. Les nouveaux manèges militaires jouent alors
un rôle crucial dans la réforme de la milice en servant à la fois de
centres de formation et de recrutement. Les programmes de formation qui
y sont offerts donnent des résultats impressionnants et l'enrôlement de
miliciens fait un bond spectaculaire, surtout dans l'Ouest canadien.
Construit entre 1914 et 1915, le manège militaire de la rue Bay comprend
une grande salle sur deux étages, entourée d'arsenaux, de magasins, de
salles de cours et de mess. Le bâtiment présente des éléments
néogothiques de style Tudor, comme en témoigne sa tour centrale
octogonale au parapet crénelé, son balcon cérémonial et ses clés de
voûte, dont la combinaison donne à l'ensemble des allures de
fortification médiévale.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Manoir-Craigflower
View Royal, Colombie-Britannique
Le Manoir Craigflower a été construit entre 1853 et 1856, principalement
avec des matériaux coupés, équarris et fabriqués dans les environs.
C'est un édifice de deux étages à charpente de bois avec un toit à
pignon de pente moyenne, une cheminée à chaque extrémité, et un plan
symétrique à cinq baies d'inspiration classique avec une entrée centrale
surmontée d'un fronton. Le manoir se situe sur une parcelle dominant la
voie navigable Gorge, dans la région métropolitaine de Victoria. La
désignation a trait à la maison sur son lotissement légal.
Le Manoir Craigflower a été désigné lieu historique national en 1964.
Construit pour la Puget's Sound Agricultural Company, cet édifice est un
très bon exemple d'architecture domestique ancienne de l'Ouest du
Canada.
En tant que résidence du régisseur Kenneth MacKenzie, le manoir était le
point de mire de la ferme Craigflower, la plus ancienne des quatre
fermes de l'île de Vancouver, dont l'emploi de colons a marqué la
transition entre la traite des fourrures et la colonisation sur la côte
nord-ouest. Cette phase de transition se reflète de façon frappante dans
la conception du manoir, qui combine des modes de construction de la
Compagnie de la Baie d'Hudson avec des influences architecturales
écossaises et le travail d'artisans adapté à l'utilisation de matériaux
locaux.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2008 |
Lieu historique national du Canada de Marpole Midden
Vancouver, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada de Marpole Midden est situé près
de l'extrémité nord du pont Arthur Laing à la limite sud de la ville de
Vancouver, en Colombie-Britannique. Ce vaste tertre contient les
vestiges d'un village hivernal Salish du littoral datant de 1500 à 2900
ans, soit de la phase Marpole, ainsi que des dépôts de mollusques et de
crustacés et divers vestiges des premiers habitants du site, récupérés à
une profondeur moyenne de 1,5 mètres et maximum, de 4,6 mètres. D'autres
dépôts intacts gisent toujours sous une grande partie du dense tissu
urbain recouvrant le site.
La valeur scientifique de Marpole midden repose notamment sur son apport
informatif inestimable concernant la première occupation du delta du
Fraser, et en particulier, la phase Marpole. Vaste zone de débris datant
de l'ère pré-européenne, le tertre est principalement composé de dépôts
de de mollusques et de crustacés témoignant de son emplacement
d'origine, à côté du détroit de Georgia, à l'embouchure de la rivière
Fraser. L'agrandissement vers l'ouest du delta du Fraser, par dépôts
naturels, a déplacé le site en arrière pays.
Le tertre contient plusieurs vestiges culturels des premiers habitants
autochtones associés à la phase Marpole qui correspond à la période de
400 avant J.-C. à 450 après J.-C.. Des outils, des ustensiles et des
ornements en os et en pierre ont été recouverts lors de nombreuses
fouilles archéologiques. Ils témoignent notamment de l'orientation
maritime et du savoir-faire très développé du travail du bois qui
caractérisaient les Salish du littoral, et également les cultures
subséquentes de la Côte nord-ouest, y compris les Musqueam. Par
ailleurs, les fouilles du Marpole midden dirigées par Charles Hill Tout,
en 1892, ont stimulé l'étude archéologique d'autres zones de débris
préhistoriques semblables sur la côte du Pacifique. Vers 1955,
l'expansion urbaine a beaucoup modifié le paysage de Marpole midden en
couvrant le site de résidences, d'infrastructures, et d'autres
caractéristiques urbaines typiques.
|

©Parks Canada / Agence Parcs Canada, Christine Boucher, 2018 |
Lieu historique national du Canada de Miners' Union Hall
Rossland, British Columbia
Situé au 1765, avenue Columbia dans la ville de Rossland en
Colombie-Britannique, le Miners' Union Hall a été construit en 1898 à titre de
lieu de rassemblement pour la section locale 38 de la Western Federation of
Miners. Ce bâtiment témoigne de la lutte acharnée de ce syndicat pour la défense
des droits des mineurs de la région, lutte qui a notamment mené à la législation
pour la journée de travail de huit heures pour les mineurs de la province (1899)
et qui a contribué à la promulgation de la Loi fédérale de la conciliation
(1900). Rare bâtiment de ce type à avoir survécu dans l'Ouest canadien, ce
bâtiment éclectique de bois d'inspiration néogothique de l'époque victorienne
tardive est un point de repère visuel important au sein de la communauté. Doté
d'une excellente intégrité architecturale, celui-ci est un lieu de rassemblement
de prime importance pour la population de Rossland. De plus, il constitue un
exemple particulièrement rare et éloquent au pays de bâtiment expressément conçu
pour loger une salle de syndicat.
La Western Federation of Miners (WFM) est une association syndicale qui
regroupait des travailleurs de l'industrie métallurgique de l'ouest de
l'Amérique du Nord. La section locale 38 de la WFM, fondée en 1895, constituait
le premier syndicat local du domaine des mines en Colombie-Britannique et l'un
des plus influents et fructueux de l'histoire de la province. Cette organisation
s'est entre autres battue pour que les mineurs obtiennent des conditions de
travail équitables et sécuritaires. Leur lutte acharnée a en outre contribué à
ouvrir la voie au mouvement syndical en Colombie-Britannique. Dans les années
1960, un nouveau hall a été acquis dans la ville voisine de Trail, et le Miners'
Union Hall de Rossland s'est retrouvé dans un état de délabrement. Dans les
années 1970, la Rossland Heritage Society a été créée, et les travaux de
réfection ont commencé. Le bâtiment a été finalement vendu à la ville de
Rossland et le hall a ouvert de nouveau ses portes en 1983. Les travaux de
réfection effectués au fil des ans, principalement à la toute fin des années
1970, et plus récemment en 2016-2017, auront permis de conserver les principaux
éléments caractéristiques du bâtiment, à savoir sa volumétrie, l'ordonnancement
de ses façades, la distribution des espaces intérieurs, ses matériaux et ses
principaux éléments décoratifs. Bâtiment multifonctionnel, il est toujours
utilisé par la communauté, notamment comme salle de réunion et de réception,
salle de théâtre ou de représentations artistiques. De plus, les récents travaux
de restauration auront permis de réaménager le grenier situé au 4e étage pour en
faire un espace répondant aux besoins de la population locale.
Sur le plan architectural, le Miners' Union Hall est un bel exemple de bâtiment
de style néogothique de l'époque victorienne tardive. Œuvre de l'architecte E.J.
Weston, un architecte américain pratiquant à Los Angeles, ce bâtiment fait de
bois de plan rectangulaire est chapeauté d'une toiture à deux versants prononcés
et d'un balcon central en saillie à l'étage supérieur. Sa façade se caractérise
par sa grande symétrie et par la présence de plusieurs éléments empruntés au
registre architectural classique, notamment les fenêtres et la porte chapeautés
de frontons triangulaires, le balcon central en saillie et ses ornements de
bois. Les façades latérales se caractérisent également par leur grande symétrie
qui se matérialise par la présence de hautes fenêtres rectangulaires qui
assurent un apport important de lumière naturelle. Des inscriptions d'origine,
telles que « 1898 » au niveau du pignon central, « Miners Union » au niveau du
balcon, et « Miners Union Hall » au-dessus de la porte centrale, témoignent de
l'histoire de ce bâtiment.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1996 |
Lieu historique national du Canada du Moulin-McLean
Port Alberni, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada du Moulin-McLean est une ancienne
scierie et un centre d'exploitation forestière située sur un terrain
forestier de 13 hectares, dans la vallée Alberni de l'île de Vancouver.
La reconnaissance officielle se rapporte à 35 édifices et au terrain qui
les entoure. Les ressources bâties englobent une scierie a vapeur
opérationnelle et diverses structures connexes, dont divers garages en
bois, des bâtisses et structures d'entreposage, un groupe de résidences
et de bâtiments administratifs en bois, et un chemin de fer. Les
éléments du paysage comprennent les espaces extérieurs utilisés pour le
traitement et l'entreposage du bois de sciage, et un étang de flottage.
Le moulin McLean est un rare exemple qui témoigne encore des activités
de l'exploitation forestière d'abattage et de sciage du bois pendant la
période couvrant le début et le milieu du XXe siècle en
Colombie-Britannique. Fondée en 1925 par Robert Bartlett McLean, son
épouse Cora et leurs trois fils, la scierie est demeurée une entreprise
familiale jusqu'en 1965. Les éléments bâtis présents sur le site ont été
construits par la famille McLean et leurs ouvriers, avec des matériaux
de la région. La délimitation méthodique des zones d'activité est encore
clairement visible. Le lieu comprend une scierie à vapeur et le matériel
d'origine, représentatifs des diverses activités de l'industrie
forestière. Les ressources bâties et le matériel témoignent des 40
années d'activité de la scierie, et ils représentent les éléments
caractéristiques d'une scierie et d'une exploitation forestière de la
Colombie-Britannique de cette période, et leur évolution au fil des
années. Le lieu comprend aussi les infrastructures nécessaires à une
locomotive à vapeur.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de Nan Sdins
Gwaii Haanas National Park Reserve of Canada, Colombie-Britannique
Vestiges de longues maisons et de mâts totémiques Haïdas.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Arnold E. Roos, 1999 |
Lieu historique national du Canada du Navire-à-Moteur-BCP 45
Campbell River, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada du Navire-à-Moteur-BCP 45, situé
au Campbell River Maritime Heritage Centre, est un bateau de pêche en
bois, à une hélice, d'une longueur de 14,3 mètres. Son pont avant est
légèrement surélevé, et son rouf est situé à l'avant du navire. Cette
configuration est caractéristique des senneurs en bois de la côte Ouest
du Canada.
Le navire à moteur BCP 45 est l'un des bateaux de pêche construits selon
un modèle standard par son premier propriétaire, la BC Packers Ltd.,
principale entreprise de conserverie de la côte de la Colombie
Britannique durant la seconde moitié du XXe siècle. Il est construit en
1927 par la Burrard Shipyard, à Coal Harbour (Vancouver), considéré, à
l'époque, comme la plaque tournante de l'industrie de la construction de
navires en bois sur la côte Ouest. En plus de son association directe
aux importants changements survenus dans la structure sociale de
l'industrie de la pêche sur la côte Ouest, la longue vie du navire à
motor BCP 45 comme bateau de pêche illustre les nombreux changements
technologiques qui ont eu une incidence importante sur les pêcheurs. Il
est exploité successivement comme senneur dont la mise à l'eau de seine
se fait depuis le pont, ligneur, senneur munie d'une poulie hydraulique
Puretic et finalement comme senneur à tambour. En raison de sa
conception, de son adaptation à une succession de technologies et de ses
associations directes aux fondements de l'industrie de la pêche et au
rôle important joué par les peuples autochtones dans cette industrie, le
navire à moteur BCP 45 est un symbole significatif et un emblème
national familier de l'industrie de la pêche au Canada.
|
|
Lieu historique national du Canada Village de New Gold Harbour
Haina, British Columbia
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, C. Cournoyer, 2006 |
Lieu historique national du Canada du Nikkei Internment Memorial Centre
New Denver, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada du Nikkei Internment Memorial
Centre est situé à New Denver, en Colombie-Britannique, aux abords de la
pointe nord-est du lac Slocan, dans la partie ouest de la région
Kootenay. Il se trouve sur un vaste terrain autrefois utilisé pour la
production maraîchère jusqu'à ce que le camp d'internement y soit
construit lors de la Seconde Guerre mondiale. Le lieu est entouré d'une
haute clôture de planches de bois, ponctuée à l'avant par deux accès
indiquant aux visiteurs qu'ils s'apprêtent à entrer dans un endroit
spécial. Un jardin ornemental de tradition japonaise et un sentier
sillonné contrastent avec les cabanes d'internés d'allure austère. Le
site renferme également un sanctuaire bouddhiste, un certain nombre
d'artefacts et de panneaux d'interprétation ainsi qu'une collection de
documents manuscrits et d'illustrations.
Le Nikkei Internment Memorial Centre est étroitement associé à
l'internement des Japonais lors de la Seconde Guerre mondiale. Il se
situe au cœur du site connu sous le nom de Verger (The Orchard), soit
l'emplacement d'un camp d'internement construit de toute pièce par le
gouvernement canadien pour loger des déplacés forcés de la côte Ouest.
Ce camp constitue d'ailleurs l'un des rares sites de détention
construits dans le cadre de l'internement qui ne fut pas rasé après la
guerre et le seul où réside depuis une communauté canadienne-japonaise
issue du déplacement forcé.
Le Nikkei Internment Memorial Centre a été aménagé en 1992-1994 afin
d'assurer la pérennité d'exemples de bâtiments associés à l'internement
et par le fait même, commémore l'expérience des internés.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Andrew Waldron, 2008 |
Lieu historique national du Canada de l'Observatoire-Fédéral-d'Astrophysique (C.-B.)
Saanich, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada
l'Observatoire-Fédéral-d'Astrophysique (C.-B.) est situé au sommet d'une
colline s'élevant à 227 mètres au-dessus du niveau de la mer, à Saanich
en Colombie-Britannique. Construit de 1914 à 1918, l'observatoire est
une structure cylindrique de 20,2 mètres de diamètre et haute de 22,3
mètres, coiffée d'un dôme où deux plaques incurvées s'ouvrent pour
permettre au télescope d'explorer le ciel nocturne. Le bâtiment éminent
de deux étages et d'une charpente d'acier est revêtu de panneaux de
métal peints en blanc, et comprend des décorations architecturales
d'inspiration classique comme des pilastres, des cordons, et des
cintres.
L'Observatoire fédéral d'astrophysique (C.-B.) (OFA) est construit au
début du XXe siècle dans la foulée des développements dans la
technologie des télescopes à réflexion auxquels sa conception en
charpente en acier s'apparente. En 1914, l'astronome canadien et premier
directeur de l'OFA, John S. Plaskett, désigné personne d'importance
historique nationale du Canada, a réussi à persuader le gouvernement
fédéral de financer la construction d'un nouvel observatoire doté d'un
télescope à réflexion très puissant. De son achèvement en 1918 jusqu'en
1960, l'OFA a compté parmi les principaux centres de recherche en
astrophysique du monde.
Plusieurs découvertes ont été faites à l'OFA grâce à son télescope à
réflexion de 1,83 mètres et ses spectroscopes. Parmi les premiers
travaux menés, l'identification et la classification d'étoiles de haute
température ont été les plus importants. En 1922, John Plaskett a
découvert une binaire spectroscopique quatre fois plus massive que
toutes celles connues jusque là. Durant les années 1920 et 1930, l'OFA a
aussi produit des études approfondies sur la nature de l'évolution des
étoiles et sur leurs mouvements dans l'espace, ce qui a enrichi les
connaissances sur la rotation de la Voie lactée et le vieillissement des
étoiles. La majorité des travaux de l'OFA étaient axés sur des
catégories d'étoiles particulières, pour lesquels tant l'OFA que les
astronomes canadiens se sont fait remarquer à l'échelle internationale.
L'OFA est construit selon la conception la plus avancées au monde, à
l'époque, pour un observatoire. Le télescope de 1,83 mètres, remarquable
pour sa précision, la clarté de ses verres optiques et ses spectroscopes
était une merveille d'ingénierie et fut temporairement le plus grand
télescope au monde. L'ouverture numérique utile du télescope convenait
parfaitement à la spectroscopie stellaire à l'OPA, et son support
asymétrique, le premier de ce type pour un télescope à réflexion, lui
donnait accès à une très grande partie du ciel. Les dispositifs à
entraînement électrique avaient été mis de côté au profit de dispositifs
mécaniques traditionnels à roulement à billes, réduisant les coûts sans
sacrifier la précision.
|
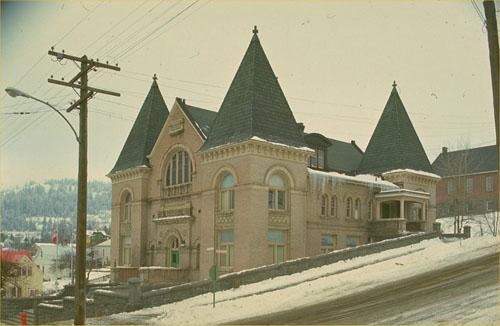
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-de-Rossland
Rossland, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-de-Rossland
est un important édifice en brique de deux étages, situé sur un terrain
en pente raide qui domine les environs et lui confère son statut de
point de repère dans la communauté. L'édifice est construit en brique
chamois sur un soubassement de pierre, selon un plan original qui
intègre des sections de tour en saillie aux quatre coins, trois d'entre
elles étant couronnées de toits pyramidaux à forte pente couverts de
tuiles. Les surfaces des murs extérieurs de l'édifice sont richement
ornées d'éléments polychromes. L'intérieur, magnifiquement préservé, est
remarquable pour les boiseries de la salle d'audience et le grand
vitrail qui représente les armoiries de la province, flanquées des
armoiries du juge en chef Matthew Baillie Begbie et du gouverneur de la
colonie, James Douglas.
Le palais de justice de Rossland a été désigné lieu historique national
en 1980, car il est très représentatif des palais de justice régionaux
construits en Colombie-Britannique à la fin du XIXe siècle.
Les premiers législateurs de la province se sont efforcés de mettre en
évidence les origines britanniques du système judiciaire de la province
dans les nouvelles régions colonisées à la suite des vagues successives
de mineurs américains et autres coureurs de fortune. Dans les centres
miniers importants comme l'était Rossland, cette volonté s'est exprimée
dans le plan du palais de justice, symbole visuel de l'autorité de la
Couronne. Les plafonds à poutres apparentes, les murs lambrissés et les
vitraux baignaient d'une atmosphère solennelle les débats du tribunal,
tandis que les éléments architecturaux extérieurs visaient à exprimer un
caractère résolument britannique. Construit selon les plans de J.J.
Honeyman originaire de Glasgow, le palais de justice de Rossland
illustre parfaitement cette approche, grâce à son extérieur et à son
intérieur bien préservés.
|

©Stanley Park, Stephen Downes, 2010 |
Lieu historique national du Canada du Parc-Stanley
Vancouver, Colombie-Britannique
Immense et remarquable parc urbain (vers 1890).
Le lieu historique national du Canada du Parc-Stanley est une magnifique
oasis verte au milieu du paysage urbain de Vancouver. Le parc, qui
comprend des terrains forestiers et récréatifs, est entouré sur trois
côtés par la baie English, les First Narrows et l'Inlet Burrard, et est
bordé sur le quatrième côté par le quartier central des affaires et le
quartier résidentiel West End de Vancouver.
Le parc Stanley a été aménagé sur une péninsule qui a d'abord servi de
lieu de cérémonie aux Premières nations, puis de réserve militaire
britannique et, enfin, de jardin public en 1888. La ville de Vancouver
l'a aménagé entre 1913 et 1936. Influencé par des antécédents
britanniques, son premier superintendant, W.S. Rawlings, a marié les
caractéristiques naturelles avec les jardins, les aménagements paysagers
et les installations récréatives. Pendant la période de l'après-guerre,
des attractions supplémentaires ont été ajoutées, y compris un aquarium,
un petit train et un zoo pour les enfants. Le parc continue d'être un
lieu cérémoniel où l'on célèbre le souvenir de personnes et d'événements
importants, comme Pauline Johnson, Lord Stanley, John Drainie, le
Vancouver Centennial, les bûcherons de la Colombie-Britannique, les
Canadiens d'origine japonaise de la Première Guerre mondiale, l'Armée du
Salut, et les naufrages du Chehalis, du Beaver, et du HMS Egeria, entre
autres.
Au fil des ans, plusieurs architectes et architectes paysagistes ont
apporté des contributions particulières à l'ambiance du parc, y compris
William Livingstone (Pavilion Garden, 1913), Thomas Mawson (Lost Lagoon
et Causeway 1916-26), Charles Marenga (monument commémoratif Harding,
1923 et pont promenade, 1925), Walker et McPherson (terrain de golf
Pitch and Putt, 1932), Percy Underwood (Stanley Park Pavilion, ajout en
1946-1950, et la billetterie du terrain de golf, 1953-1955) et Alleyne
Cook (le jardin Ted and Mary Greig Rhododendron, 1989). De plus, les
œuvres d'artistes très talentueux sont exposées dans le parc, y compris
James Cunningham (maître maçon, ouvrage rustique en pierre), Bill Reid
(reproduction du pôle mortuaire Skedans par Jackson, chef de la bande de
Skidegate), Doug Cranmer (reproduction du pôle Nhe-is-bik Salmon par
Willie Seaweed, restoration du pôle Wakias et du pôle du mythe Yakdzi),
Ellen Neel (restoration des poteaux de maison Thunderbird), Yurhwaya
(pôle Wakias), Yaakutlas, Charlie James (poteaux de maison Thunderbird,
pôle Sisa-Kaulas), Sydney March (sculpteur, monument à la mémoire de
Lord Stanley), la Première nation Shuswap (rocher avec pétroglyphes), et
Elek Imredy (monument commémoratif en bronze, Girl in Wet Suit - Fille
en combinaison de plongée, 1970).
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, L. Dick, 1997 |
Lieu historique national du Canada du Passage-Metlakatla
Metlakatla, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada Passage-Metlakatla est situé sur
l'île Pike près de l'extrémité ouest du passage Metlakatla, un canal
océanique étroit et protégé à l'entrée nord du port de Prince Rupert sur
la côte nord de la Colombie-Britannique. Le passage Metlakatla était
traditionnellement le lieu où les Tsimshians de la Côte Nord
établissaient leur campement d'hiver. Des forêts de conifères couvrent
l'île et ses rivages contiennent des sites et vestiges archéologiques
dont cinq établissements des Premières nations, trois anciens villages
et deux sites de pétroglyphes. Le plus grand des trois villages, occupé
avant et après les contacts avec les Européens, couvre un territoire
mesurant 211 par 70 mètres. Les sites des plus anciens villages mesurent
respectivement 115 par 95 mètres et 75 par 45 mètres. Des sentiers
relient les sites des différents villages de l'île, cependant les
pétroglyphes gravés sur des blocs rocheux ou des saillies rocheuses se
retrouvent sur les plages de l'île.
Le passage Metlakatla était traditionnellement le lieu où les Tsimshians
de la Côte Nord et les groupes ancestraux établissaient leur quartier
d'hiver. Le site illustre non seulement plusieurs chapitres de
l'histoire des Tsimshians au passage Metlakatla, mais il représente en
outre des éléments importants de l'histoire à plus long terme des
Tsimshians de la Côte Nord à Metlakatla. La disposition naturelle de
l'île contribue à accentuer l'ambiance historique et l'esprit du lieu,
aidant ainsi à communiquer sa valeur historique aux visiteurs. Vers la
fin des années 1830, les Tsimshians avaient migré de Metlakatla vers de
nouveaux quartiers d'hiver à Fort Simpson (Compagnie de la Baie
d'Hudson). En 1862, William Duncan, un jeune missionnaire anglican, fut
à l'origine d'un retour à Metlakatla pour y établir une communauté
modèle. En 1887, Duncan et une partie des Tsimshians partirent pour
l'Alaska. L'île Pike demeure la propriété de la Première Nation
Metlakatla.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2001 |
Lieu historique national du Canada Pemberton Memorial Operating Room
Victoria, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada Pemberton Memorial Operating Room
est situé au cœur du complexe hospitalier Royal Jubilee à Victoria. Le
lieu historique se compose d'une salle d'opération octogonale en brique,
construite en 1896, et de deux salles de stérilisation, l'une qui date
de la même époque et l'autre ajoutée en 1918. Les deux salles de
stérilisation forment une seule structure de brique rectangulaire,
rattachée à un seul côté du mur de la salle d'opération octogonale. De
grandes fenêtres à linteaux de grès et appuis de béton dominent les six
pans de mur extérieurs. Une coupole de ventilation orne le faîte du toit
de la salle d'opération octogonale, et un ventilateur plus petit est
situé sur une arête du toit en croupe qui couvre la section des salles
de stérilisation.
Les plans de la salle d'opération sont l'œuvre de John Teague,
architecte renommé de Victoria, avec la collaboration du docteur John
Chapman Davie à qui l'on doit l'introduction des théories de chirurgie
antiseptique de Lister à Victoria. En intégrant des éléments
architecturaux des XIXe et XXe siècles, ce bâtiment illustre la
transition qui s'opérait dans la conception architecturale des hôpitaux
à cette époque. La conception de la structure offre un espace facile à
nettoyer et un environnement stérile adapté aux interventions
chirurgicales. Les grandes fenêtres de la salle d'opération permettaient
de profiter de la lumière naturelle, tandis que le nettoyage, la
désinfection et la ventilation étaient facilités par les sols recouverts
de céramique, les murs de plâtre peints et les systèmes modernes de
plomberie, de chauffage et de ventilation. Bien que reliée au bâtiment
principal de l'hôpital par un corridor en bois, la salle d'opération se
définit comme un espace distinct, afin de réduire au minimum les risques
de contamination depuis l'extérieur. Actuellement, des jardins aménagés
récemment et une aire de stationnement entourent le lieu et le séparent
du complexe hospitalier moderne plus vaste et de la chapelle
contemporaine.
|
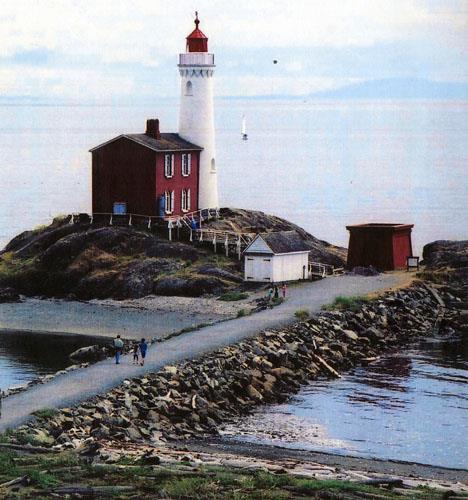
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Ian Doull, 2011 |
Lieu historique national du Canada du Phare-de-Fisgard
Colwood, Colombie-Britannique
Premier phare élevé en permanence sur la côte Ouest canadienne
(1859-1860).
Le lieu historique national du Canada du Phare-de-Fisgard et la
résidence du gardien se compose d'une résidence de deux étages avec un
phare cylindrique attenant, situés sur l'île Fisgard, du côté est de
l'entrée du port d'Esquimalt, juste au nord du détroit Juan de Fuca.
Le phare de Fisgard a été désigné lieu historique national du Canada en
1958 parce que c'était le premier phare permanent construit sur la côte
Pacifique canadienne.
Les gouvernements britannique et colonial ont construit le phare de
Fisgard de 1859 à 1860 pour signaler l'entrée du port d'Esquimalt. Conçu
par Joseph Pemberton et par John Wright, de Victoria, il a été construit
par ce dernier ainsi que par John J. Cochrane. Il a été continuellement
en opération jusqu'en 1957, date où un incendie a temporairement mis fin
à son utilisation comme aide à la navigation. Une fois réparé, il est
devenu un lieu historique national et, depuis, on l'a restauré pour les
visites publiques. Il demeure en service pour aider à la navigation.
La valeur patrimoniale du phare de Fisgard a trait à son emplacement
stratégique ainsi qu'à la lisibilité et l'intégralité préservée du
phare, du fanal et de la maison du gardien. Cet ensemble marque un point
de repère sur l'île.
|
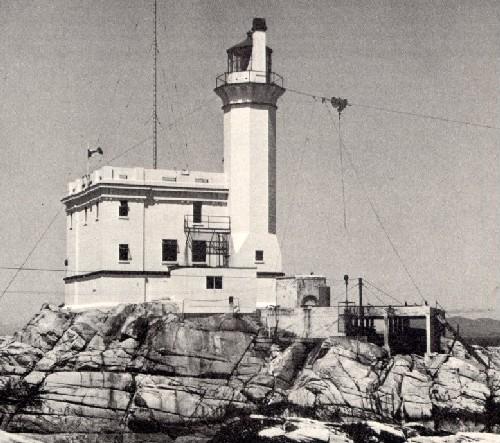
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Phare-de-l'Île-Triple
Triple Island, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada du Phare-de-l'île-Triple se dresse
en sentinelle sur un îlot rocheux à découvert, au large des côtes de la
Colombie-Britannique. La tour de béton octogonale s'élève depuis l'angle
nord-est d'un édifice carré sans ornement qui sert d'avertisseur de
brume et de résidence pour le gardien de phare. De conception classique
simplifiée et bien proportionnée, le phare occupe une grande partie de
l'île Triple. Sa situation stratégique le rend très visible à la
circulation maritime.
La valeur patrimoniale de ce lieu tient à la présence du phare qui est
le témoin de sa construction sur un lieu aussi exposé aux intempéries.
L'entrepreneur J.H. Hildritch, de Prince Rupert, a terminé les travaux
en dix-sept mois sans perte humaine. Le phare de l'île Triple est aussi
témoin de l'amélioration de l'aide à la navigation sur la côte ouest du
Canada. Il a été construit en 1919-1920 pour faciliter le trafic
maritime en utilisant le passage de l'intérieur vers l'Alaska et pour
aider les navires en partance pour Prince Rupert. Le phare, avec son feu
dioptrique de 3e niveau au plan focal de 29,5 mètres, a été conçu
spécialement pour le site et construit selon les plans du colonel W. A.
Anderson du ministère de la Marine et des Pêcheries.
|

©Point Atkinson Lighthouse, Mandy Jansen, 2009 |
Lieu historique national du Canada du Phare-de-la-Pointe-Atkinson
West Vancouver, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada du Phare-de-la-Pointe-Atkinson est
situé dans Lighthouse Park, un parc d'une superficie de 75 hectares en
face de l'îlet Burrard de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique.
Il s'élève sur un promontoire adjacent à la plus grande forêt côtière
naturelle des basses-terres continentales. La tour de phare hexagonale
en béton armé s'élève à 18,30 mètres de hauteur. La maison du gardien et
un petit complexe de baraques militaires datant de la Seconde Guerre
mondiale se trouvent à côté de la tour.
Premier des trois phares érigés pour servir le port de Vancouver, le
phare de la pointe Atkinson a été construit pour protéger le commerce
maritime international croissant de Vancouver. Construit en 1912 par
l'entrepreneur W.H. Rourke, le phare a remplacé l'ancienne structure en
bois qui datait de 1875. La construction en béton armé constituait une
innovation dans la conception des phares au Canada pendant la première
décennie du XXe siècle. Le phare est maintenant automatique et continue
de fournir l'aide à la navigation au trafic maritime qui approche de
Vancouver par le nord-ouest.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Adam Roth, 2010

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Michael Prochazka, 2009

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Michael Prochazka, 2009 |
Lieu historique national du Canada de la Piste-Chilkoot
Chilkoot, Colombie-Britannique
Voie qui conduisait aux gisements aurifères du Klondike.
Le lieu historique national du Canada de la Piste-Chilkoot est une route
traditionnelle qui traverse un terrain montagneux accidenté. Elle relie
le cours supérieur de la rivière Yukon à la côte du Pacifique au niveau
du passage Taiya en Alaska. Elle est connue comme étant la route
empruntée par des milliers de chercheurs d'or venus au Yukon pendant la
ruée vers l'or de 1897-1900. La désignation a trait à la partie
canadienne de la piste qui part du sommet du col Chilkoot, longe une
vallée naturelle, jusqu'à l'ancien site de la localité de Bennett en
Colombie-Britannique.
La piste Chilkoot a été désignée lieu historique national du Canada en
1967 pour son rôle dans la grande migration vers le Yukon pendant la
ruée vers l'or du Klondike.
La valeur patrimoniale de la piste Chilkoot a trait au rôle qu'elle a
joué dans la ruée vers l'or du Yukon en 1897-1900 attestée par des
vestiges du paysage culturel. Cette piste, route de commerce et de
déplacement des peuples des Premières nations pendant des années,
faisait partie d'un plus grand réseau de pistes et de voies navigables
menant aux champs aurifères du Klondike, dans le Territoire du
Yukon.
|
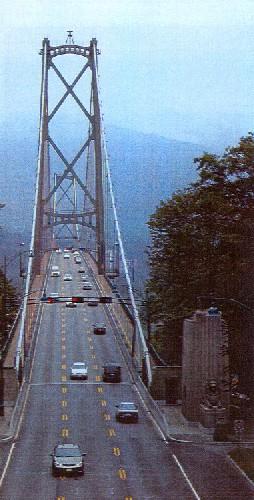
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Judith Dufresne, 2003. |
Lieu historique national du Canada du Pont-Lions Gate
Vancouver, Colombie-Britannique
Situé à l'entrée du port de Vancouver dans le décor spectaculaire des
montagnes et de l'océan Pacifique, le lieu historique national du Canada
du Pont-Lions Gate est le plus long pont suspendu de l'Ouest canadien,
avec une longueur totale de 1517 mètres (y compris les travées
d'approche). Le pont possède trois voies de circulation et une voie
piétonnière et cyclable de chaque côté du tablier. C'est un lien de
transport essentiel pour les communautés de la région qui vivent de part
et d'autre de l'inlet Burrard. Le lieu comprend la levée sud du pont qui
émerge du lieu historique national du Canada du Parc-Stanley près de
Prospect, la travée principale soutenue par des tours identiques et le
viaduc sur la rive nord, situé dans un corridor terrestre qui traverse
la réserve amérindienne de Capilano.
Reconnu comme l'un des points de repère du Canada en matière de
technique et d'ingénierie, le pont Lions Gate constitue un exemple de
génie civil novateur. À son achèvement, il fut considéré comme le plus
long pont suspendu de l'Empire britannique et l'un des plus grands
projets de construction entrepris au Canada pendant les années 1930.
Malgré les dimensions impressionnantes de l'ouvrage, les tours en acier
ajourées identiques et l'utilisation novatrice d'un tablier mince
conféraient à la structure une légèreté aérienne qui s'intégrait
parfaitement dans le décor pittoresque. Le pont se distinguait aussi par
sa longueur et les innovations techniques dans l'utilisation des câbles
et de la construction. La réfection du tablier au début du XXIe siècle
fut aussi une réalisation exceptionnelle car c'était la première fois
que l'on remplaçait simultanément le tablier, les suspentes et les
poutres de rigidité d'un pont sans le fermer à la circulation.
Le pont a stimulé le développement géographique et socio-économique de
la rive nord de Vancouver. Financé par le magnat de la bière Sir Arthur
Guinness par le biais du syndicat British Pacific Properties Ltd., le
pont Lions Gate devait favoriser le développement de la banlieue de West
Vancouver en établissant un lien direct entre Vancouver et la rive nord
du chenal First Narrows de l'inlet Burrard. La conception du pont doit
beaucoup à Alfred J.T. Taylor, un ingénieur visionnaire et homme
d'affaires de Victoria, qui possédait de vastes biens immobiliers sur la
rive nord et s'est occupé du financement du projet.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1994 |
Lieu historique national du Canada du Pont-Suspendu-Doukhobor
Castlegar, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada du Pont-Suspendu-Doukhobor enjambe
la rivière Kootenay pas très loin en amont de sa confluence avec le
fleuve Columbia dans la région de West Kootenay de la
Colombie-Britannique. Construite à partir d'une initiative
communautaire, la structure est constituée de tours en béton armé d'une
hauteur de 14,6 mètres (48 pieds) qui reposent sur des piles de béton
enfoncées dans la paroi rocheuse sur les rives opposées de la rivière.
Les deux tours supportent quatre câbles en fil d'acier dont les deux
extrémités sont fixées à des culots en acier ancrés dans la paroi
rocheuse. Le tablier du pont d'une longueur de 100,9 mètres (331 pieds)
reliant les tours est suspendu aux câbles porteurs par des tiges d'acier
verticales. La charpente du tablier en acier est recouverte de madriers,
de longerons et de platelage. Le platelage en bois est en mauvais état
présentement et les rampes d'accès au pont ont été retirées de façon à
empêcher l'accès.
Le pont suspendu doukhobor fournit un lien routier vital entre les
communautés doukhobors de Brilliant et d'Ootenshenie sur les rives
opposées de la rivière Kootenay. Sa construction a été entreprise par
des membres de cette communauté utopique qui ont travaillé bénévolement
à la demande de leur chef, Peter Vasilevich Verigin. Au moyen de
techniques de travail manuel traditionnelles, les travailleurs ont
effectué les tâches ardues de coffrage et de coulage des piles et des
tours selon le nouveau procédé de béton armé, puis d'assemblage et
d'installation des câbles massifs et du platelage en acier. Débuté en
avril 1913 et terminé seulement 8 mois plus tard, le pont suspendu
doukhobor a été en grande partie financé par la communauté doukhobor et
a joué un rôle important dans la croissance culturelle et économique de
cette société communale, particulière et autosuffisante et de la région
de Kootenay ouest pendant plus de 50 ans.
|

©Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives Canada, C-003131

©Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives Canada, C-003133 |
Lieu historique national du Canada de la Première-Traversée-de-l'Amérique-du-Nord
Bella Coola, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada de la
Première-Traversée-de-l'Amérique-du-Nord est situé dans le parc
provincial Sir-Alexander-Mackenzie, à environ 65 kilomètres au nord
ouest de Bella Coola, sur la côte centrale de la Colombie-Britannique.
Il s'agit d'un promontoire rocheux qui surplombe le chenal Dean près de
l'embouchure d'Elcho Harbour, où Alexander Mackenzie, de la Compagnie du
Nord-Ouest, a marqué le point le plus à l'ouest de sa traversée de 1793.
En 1926, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada
(CLMHC) a érigé un monument au dessus des rochers en vue de commémorer
l'endroit.
Le 9 mai 1793, Alexander Mackenzie, de la Compagnie du Nord-Ouest,
quitte Fort Fork, sur la rivière de la Paix, près du Fort Chipewyan, à
la recherche de l'océan Pacifique. Ses compagnons et lui remontent la
rivière Parsnip en canoë jusqu'à sa source, puis se déplacent sur terre
jusqu'à la partie supérieure du fleuve Fraser. Convaincu qu'il est
impossible de naviguer sur le fleuve Fraser, le groupe recule jusqu'à la
rivière West Road, puis remonte la vallée à pied. Le 19 juillet, il
arrive à un établissement autochtone à Bella Coola et, deux jours plus
tard, atteint sa destination, un promontoire rocheux où Mackenzie et ses
compagnons passent la nuit du 22 juillet 1793. Mackenzie marque sa
position et peint le message suivant sur la face sud est d'un gros
rocher avec de la graisse et du cinabre : « Alexander Mackenzie, from
Canada, by land, the twenty-second of July, one thousand seven hundred
and ninety-three » (Alexander Mackenzie, du Canada, par voie terrestre,
le vingt deux juillet mille sept cent quatre vingt treize). Le 24 août,
le groupe est de retour à Fort Chipewyan, ils seront les premiers hommes
à traverser le continent, du nord du Mexique jusqu'à l'océan
Pacifique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Kate MacFarlane, 2010 |
Lieu historique national du Canada du Quartier-Chinois-de-Vancouver
Vancouver, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada du Quartier-Chinois-de-Vancouver
est un quartier distinct situé à l'est du centre-ville de Vancouver, en
Colombie-Britannique. Son centre d'intérêt est la rue Pender, entre la
rue Taylor à l'ouest et l'avenue Gore à l'est, et les voies nord et sud
de la rue Pender. L'architecture du quartier est caractérisée par un
style hybride distinctif qui combine des aspects de l'architecture
chinoise régionale avec des méthodes de construction et des éléments de
style occidentaux. Le tracé des grandes rues reflète le quadrillage
classique des années 1880, tandis que la partie nord est propre au
quartier chinois, avec ses cours intérieures, ses allées et ses façades
qui donnent à la fois sur les rues et sur les allées. Érigés sur les
limites avant des parcelles, la plupart des bâtiments de deux à quatre
étages abritent des commerces, des institutions et des résidences. Du
côté sud, l'uniformité du quartier change pour faire place au centre
culturel chinois avec sa vaste cour intérieure menant au plus grand
espace public de l'arrondissement, le jardin chinois classique Sun
Yat-Sen.
La valeur patrimoniale du quartier chinois de Vancouver tient aussi à
ses liens avec le développement de la vie sociale et culturelle des
immigrants chinois en Colombie-Britannique et au Canada, ainsi qu'aux
activités commerciales des secteurs commerciaux et portuaires d'origine
de Vancouver. L'arrondissement est défini par sa forme, ses ornements,
sa disposition et son architecture. Constituée en 1886, la Ville de
Vancouver devient un point d'entrée majeur pour les immigrants chinois,
dont un grand nombre s'installent dans le quartier chinois de la ville.
Les travailleurs Chinois obtiennent alors un bail portant sur une
parcelle de 160 acres et s'établissent le long de la rue Main à partir
de la rue Pender Est. Au début des années 1900, le quartier chinois de
Vancouver devient le plus important quartier chinois du Canada et le
demeure jusque dans les années 1970. Les 70 propriétés contigües du
paysage de rue de l'arrondissement offrent un mélange de bâtiments à
vocation commerciale, résidentielle et culturelle, dont plusieurs
remontent au début du XXe siècle. Des éléments culturels importants et
plus récents, comme le parc et jardin chinois classique Sun Yat-Sen
(1986), le centre culturel chinois (de 1981 à 1986) et la porte du
millénaire (2002), mettent en valeur le caractère chinois traditionnel
de l'endroit. Protégé depuis 1971 en vertu de lois provinciales et de
règlements municipaux sur le patrimoine, le secteur compte 24 propriétés
inscrites au registre patrimonial de Vancouver. Le quartier chinois de
Vancouver s'inscrit dans la continuité tout en conservant ses liens avec
son passé et, en sa qualité de quartier urbain fonctionnel, il offre des
contrastes dynamiques entre son paisible jardin public, ses bâtiments
distinctifs et sa vie de quartier colorée.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Andrew Waldron, 2011 |
Lieu historique national du Canada du Quartier-Chinois-de-Victoria
Victoria, Colombie-Britannique
Le quartier chinois de Victoria est un quartier reconnaissable
d'édifices en brique d'un et deux étages à usage mixte qui couvre trois
pâtés de maisons dans le centre-ville de Victoria
(Colombie-Britannique). La rue Fisgard en est le cœur, et on y accède
par un agencement d'allées et de passages distincts. L'ensemble uni
d'édifices qui adapte les formes courantes trouvées ailleurs dans la
ville, est décoré de toits évasés comme ceux de temples, de balcons
insérés et en saillie en fer forgé, de cours intérieures et d'avancées
en tuiles aux couleurs brillantes. Une arche d'entrée cérémoniale a été
montée dans le cadre d'un programme de réhabilitation, dans les années
1980.
La valeur patrimoniale de ce lieu tient à la collection de structures
différentes à l'intérieur du quartier, à leurs relations spatiales, et
au rôle continu qu'il joue dans les activités commerciales, sociales et
institutionnelles de la communauté canadienne d'origine chinoise. Il
souligne le fait que, pendant presque trois décennies avant que le
Canadien Pacifique Limitée soit terminé, Victoria était le premier port
d'entrée de la plupart des immigrants chinois et qu'il est resté une
enclave importante jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Mills Photo No. 2, 1991 |
Lieu historique national du Canada de la Rotonde du chemin de fer Esquimalt and Nanaimo
Victoria, Colombie-Britannique
Conçue en 1912 et achevée en octobre 1913, la rotonde du chemin de fer
Esquimalt et Nanaimo est située à Victoria en Colombie-Britannique. Le
lieu est constitué de trois sections : la rotonde de locomotives et deux
structures contiguës qui logeaient différentes installations d'atelier
pour l'entretien des locomotives à vapeur. Le bâtiment de la rotonde a
été construit selon un plan en arc de cercle et comporte une façade et
un mur arrière recourbés de briques rouges massives. Elle contient 10
compartiments qui donnent sur une plaque tournante opérationnelle d'un
diamètre de 25,9 mètres (85 pieds). L'atelier d'usinage consiste en un
édifice rectangulaire en briques qui jouxte le coin sud-ouest arrière de
la rotonde. L'ensemble de la rotonde est entouré d'éléments connexes,
notamment la plaque tournante, les embranchements et les voies ainsi que
deux bâtiments de briques indépendants qui sont des composantes du
complexe industriel et qui sont du même âge que la rotonde.
La rotonde du chemin de fer Esquimalt et Nanaimo a été désignée lieu
historique national du Canada en 1992 parce qu'elle demeure pratiquement
intacte depuis sa construction en 1912. Entourée de différents ateliers
et dépendances ferroviaires connexes bien préservés, elle est l'exemple
parfait d'une structure industrielle associée à l'ère des trains à
vapeur au Canada.
La rotonde du chemin de fer Esquimalt et Nanaimo est située sur le site
du terminus ferroviaire initial de 1886 pour Victoria. Ce complexe
industriel a été construit par le Canadien Pacifique pour servir
d'installation principale d'entretien des locomotives à vapeur et du
matériel roulant du chemin de fer Esquimalt et Nanaimo. Il a servi à
cette fin jusqu'en 1949 lorsque les locomotives à vapeur ont été
remplacées par les locomotives diesel sur l'île. Par la suite, la
rotonde a servi d'installation d'entretien pour les locomotives diesel
d'E & N et, présentement, elle dessert les automotrices à passagers
utilisées par le chemin de fer. Fait remarquable, la rotonde et les
ateliers contemporains ont survécu grâce à des transformations minimales
depuis le moment de leur construction.
L'ensemble de la rotonde, comprenant la rotonde elle-même, l'atelier
d'usinage attenant, la plaque tournante et des voies d'approche,
témoigne clairement de ses fonctions premières par sa structure et son
aménagement organisationnel. La rotonde elle-même entoure la plaque
tournante et comporte 10 grandes ouvertures créant ainsi 10 aires de
travail pour réparer les locomotives. Les grandes fenêtres à l'arrière
du bâtiment laissent pénétrer la lumière naturelle dans chacune des 10
aires de travail. L'atelier d'usinage est attenant à l'arrière de la
rotonde et les wagons pouvaient entrer dans le bâtiment à travers la
rotonde ou par une voie distincte reliant la plaque tournante.
L'intérieur de l'atelier d'usinage est divisé en deux sections par une
cloison de brique. La partie arrière a été construite pour accueillir
une forge et une chaudronnerie.
Un sentiment particulier d'appartenance est transmis grâce à
l'uniformité des matériaux, au fenêtrage, à la configuration du bâtiment
et par la présence de la plaque tournante qui unit l'ensemble des
bâtiments du complexe en une installation industrielle efficace. La
rotonde du chemin de fer Esquimalt et Nanaimo est l'installation
associée à l'entretien des locomotives à vapeur la plus intacte dans
l'Ouest canadien.
|
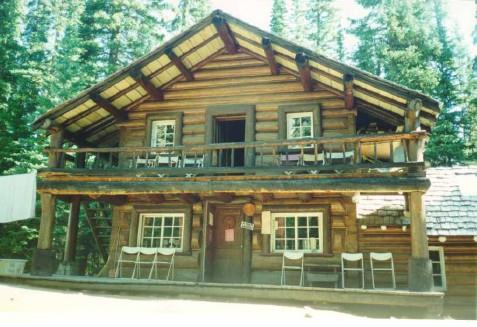
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1995 |
Lieu historique national du Canada du Salon-de-Thé-des-Chutes-Twin
Yoho National Park of Canada, Colombie-Britannique
Maison de thé ancienne de style rustique érigée dans un parc national
(1923-1924).
Le lieu historique national du Canada du Salon-de-Thé-des-Chutes-Twin
est situé dans une clairière faisant face à la crique des chutes Twin
près du Glacier Yoho, dans la haute vallée de la rivière Yoho, en
Colombie-Britannique. Construit en trois étapes, cette structure
pittoresque en billes de bois fournis un exemple d'architecture
vernaculaire rustique.
Sa valeur patrimoniale réside dans sa concrétisation de la tradition
rustique, et à sa fonction d'étape sur un sentier de randonnée très
achalandé du parc national du Canada Yoho. Le salon de thé des
Chutes-Twin a été construit en trois étapes, en association avec la
Compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique : une cabane de
plain-pied (1908-1910), un chalet et pavillon à deux étages (1922-1923)
et un lien entre les deux unités (1925-1928).
|

©M.A. Klassen |
Lieu historique national du Canada du Sentier-des-Esprits-de-la-Similkameen
Hedley, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada du Sentier des Esprits de la
Similkameen est situé sur le territoire traditionnel de la bande
indienne de Upper Similkameen, dans le sud de la Colombie Britannique.
Le site longe des falaises du bord d'un lac, traverse des vallées
sinueuses entourées par des cimes escarpées et dentelées et franchit des
affleurements rocheux s'étendant dans la plaine inondable. Le lieu est
composé de trois éléments importants reliés par un sentier autochtone :
les falaises d'ocre de Tulameen, l'abri sous roche de Chuchuwayha et un
ensemble de 27 sites de pictographes. Combiné, ces trois éléments
représentent un paysage culturel illustrant les principaux aspects de la
culture et de l'histoire de Upper Similkameen, qui datent de plus de 4
000 ans.
Le paysage culturel de Upper Similkameen symbolise les liens entre le
peuple de l'endroit, le paysage et le monde spirituel. Les personnes qui
empruntent le sentier se trouvent à faire un voyage concret et
métaphorique entre le monde physique et le monde spirituel. C'est dans
les falaises situées à l'extrémité ouest du lieu de commémoration que
l'on trouve l'ocre utilisée autrefois pour communiquer avec les esprits.
À l'est du lieu de commémoration, des pictographes, des traces de
traditions orales et des couches de l'histoire archéologique de l'abri
sous-roche de Chuchuwayha témoignent des liens entre le monde spirituel
et un ancien site d'habitation du peuple de Upper Similkameen. Le long
du vieux sentier, entre Tulameen et Chuchuwayha, on trouve des dizaines
de sites de pictographes, chacun marquant l'endroit où les jeunes hommes
et les jeunes femmes jeûnaient et invoquaient les esprits, et où les
rêves et les esprits gardiens étaient représentés en peintures
rupestres. À l'époque, on utilisait l'ocre rouge, orange et jaune tiré
des falaises d'ocre de Tulameen pour peindre des pictographes. Certains
des pictographes découverts ont été peints il y a environ 4 000 ans.
L'ocre provenant des falaises était également utilisée pour des
activités spirituelles et cérémonielles, pour décorer des vêtements et
d'autres objets et comme peinture faciale et corporelle. Les falaises
sont situées près de la confluence des rivières Similkameen et Tulameen,
autrefois utilisées comme voies de transport et de commerce autochtones
de premier ordre reliant la côte et les terres. De plus, dans la région,
les falaises étaient également une source non négligeable de chert,
qu'on utilisait pour fabriquer des outils de pierre. La vallée de la
haute Similkameen contient l'une des plus fortes concentrations de
pictographes du plateau intérieur de la Colombie Britannique. Ces
pictographes, allant de simples glyphes à des ensembles complexes
présentant une grande variété de motifs, sont pour la plupart peints sur
de grosses roches s'étant détachées des parois escarpées de la vallée.
Bien que certains des pictographes ressemblent à ceux découverts dans
les terres intérieures du sud de la Colombie Britannique, bon nombre
présentent des motifs propres à la Similkameen. L'abri sous roche de
Chuchuwayha, où ont été découverts des pictographes, se trouve au pied
d'une falaise, du côté nord de la vallée, dans un cadre ouvert semblable
à un parc, abritant des douglas de Menzies. L'abri sous roche est une
cavité rocheuse peu profonde pratiquée à la base d'une haute paroi de
granite lisse. Des fouilles y ont été réalisées et ont révélé de
nombreuses couches de dépôts culturels de même que des vestiges
archéologiques datant de 200 à 4 000 ans avant notre ère, preuve que
l'abri a servi pendant de nombreuses années.
|
|
Lieu historique national du Canada du Site-Indien-du-Village-de-Yan
Masset, British Columbia
|
|
Lieu historique national du Canada du Site-du-Sanctuaire-du-Baleinier
Yuquot, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada du Site-du-Sanctuaire-du-Baleinier
est situé à l'extrémité sud d'une île sans nom dans Jewitt Lake, à
Nootka Island, en Colombie-Britannique. Situé au sein du lieu historique
national du Canada Yuquot, le site comprend l'empreinte du sanctuaire
des baleiniers d'origine, telle qu'elle a été définie par les recherches
archéologiques. Le sanctuaire lui-même fut démantelé puis retiré par un
anthropologue culturel américain en 1905 et réside actuellement à
l'American Museum of Natural History à New York. Ce qui subsiste est un
site densément boisé à proximité de la rive et, possiblement, certains
vestiges archéologiques.
La valeur patrimoniale du site du sanctuaire du baleinier réside dans
ses associations historiques avec la pêche à la baleine par les
Nuu-chah-nulth. Selon la tradition orale Mowachaht, la pêche à la
baleine fut inventée dans les villages de E'as et Tsaxis. Les habitants
de ces villages furent gratifiés d'un statut social spécial à cause de
leur invention, et, un jour, les Yaluactakamlath, une famille élite,
quitta E'as pour prendre le contrôle du village de Yuquot, emmenant avec
eux leurs connaissances en matière de pêche à la baleine. Les baleiniers
de Yuquot devaient alors posséder leur propre sanctuaire familial de
quelque type que ce soit; il pouvait s'agir d'une simple clairière ou
parfois d'une structure légère. Ces sanctuaires servaient à des rites de
purification. Il s'agissait de constructions ressemblant à des maisons
et abritant des représentations d'animaux et d'esprits, aussi bien que
des cadavres et squelettes. L'emplacement des sanctuaires était connu
seulement des membres de la famille, et, particulièrement pour le
sanctuaire du chef, nul n'avait le droit de s'en approcher et encore
moins d'y pénétrer. La structure désignée sous le nom de « Sanctuaire
des baleiniers » ou de « Sanctuaire de purification des baleiniers »
était la propriété du chef et se transmettait à ses descendants. On ne
sait pas de manière précise à quand remonte sa construction. Elle est
abritée à l'American Museum of Natural History à New York, depuis le
début du 20e siècle.
|
|
Lieu historique national du Canada du Site des travaux en terre Weir's (Taylor's) Beach
Metchosin, British Columbia
|
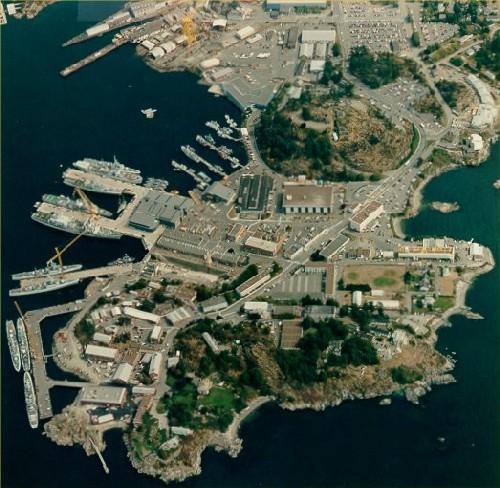
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2001 |
Lieu historique national du Canada des Sites-Navals-d'Esquimalt
Esquimalt, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada des Sites-Navals-d'Esquimalt est
un arrondissement historique comprenant quatre sites de stations navales
disposées en cercle autour du port d'Esquimalt, en Colombie-Britannique.
Il s'agit de l'arsenal canadien de Sa Majesté, de l'ancien hôpital de la
Marine royale, du cimetière des anciens Combattants et du magasin de
l'île Cole.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada des
Sites-Navals-d'Esquimalt a trait à l'étendue et à la richesse de
l'histoire navale illustrée par les quatre composantes du site, par leur
situation, et par leurs ressources bâties et éléments paysagers. Même si
le groupement homogène de chacune d'entre elles lui confère un esprit du
lieu particulier, leurs formes, matériaux, fonctions prioritaires et
technologies donnent un portrait complet et lisible du développement
naval sur la côte pacifique.
L'arsenal CSM, créé en 1865 par la Marine royale, est devenu par la
suite le cœur de la base des Forces canadiennes (BFC) d'Esquimalt.
Aujourd'hui, il se compose de deux zones principales : les 12 hectares
(30 acres) développés par la Marine royale britannique avant 1906, et
une deuxième zone développée par la Marine royale du Canada pendant la
Deuxième Guerre mondiale, puis régulièrement agrandie et reconstruite
par le ministère des Travaux publics et la Marine royale du Canada. Les
autres composantes de cet arrondissement historique comprennent :
l'ancien hôpital de la Marine royale (construit dans les années 1860,
reconstruit de 1887 à 1901, puis en 1929), le cimetière des anciens
Combattants (créé en 1868, agrandi en 1901 puis dans les années 1960) et
le magasin de l'île Cole (construit en 1859, agrandi de 1887 à 1904 et
fermé en 1938).
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Skedans
Gwaii Haanas, Colombie-Britannique
Ancien village Haïda.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada S.S. Moyie
Kaslo, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada S.S. Moyie est un bateau à aubes
et à vapeur de la fin du XIXe siècle. Il est situé sur la rive sud de
Kaslo Bay, sur le lac Kootenay. Il est en cale sèche depuis 1958. La
désignation officielle concerne le bâtiment lui-même.
La valeur patrimoniale de ce lieu historique tient à ses associations
historiques et aux propriétés physiques du bateau lui-même.
Le S.S. Moyie a été construit et assemblé en 1898 dans les chantiers
navals du Canadien Pacifique, à Nelson, Colombie-Britannique. À bien des
égards, il est typique des bateaux à vapeur des eaux intérieures de
l'ouest et du nord, mais il s'en distingue par la construction en
composite de sa coque en bois sur une armature métallique. Son armature
et ses systèmes de propulsion ont été construits par Bertram Engine
Works de Toronto.
Le S.S. Moyie a été construit pour assurer une liaison maritime entre
Nelson et Kootenay Landing, sur le lac Kootenay, et donc faire la
jonction entre la ligne ferroviaire du pas du Nid-de-Corbeau et celles
du Canadien Pacifique vers l'ouest. Ses aménagements intérieurs
répondent à cette fonction, avec beaucoup d'espace pour la restauration
et la détente, ainsi que des cabines-couchettes. Le S.S. Moyie, qui
était exploité par le British Columbia Lake and River Service du
Canadien Pacifique, a assuré différents services sur le lac Kootenay, de
son lancement en 1898 à son désarmement, en 1957.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1982 |
Lieu historique national du Canada St. Roch
Vancouver, Colombie-Britannique
Mit en cale sèche sous une structure en ‘A' construite spécialement pour
son exposition en permanence au Musée maritime de Vancouver à la pointe
Kitsilano, le St. Roch est une goélette à voiles de la Gendarmerie
Royale du Canada, dotée d'un moteur auxiliaire. L'extérieur du vaisseau
a été restauré, lui redonnant l'aspect qu'il avait en 1944, pendant sa
traversée du passage du Nord-Ouest. Le navire mesure 31,6 mètres de
long, 7,6 mètres de barrot, 3,4 mètres de creux, et il a une jauge de
323 tonnes. Le St. Roch est construit principalement avec d'épaisses
planches de pin de Douglas recouvertes d'eucalyptus d'Australie à
l'extérieur, et il possède une coque intérieure renforcée pour résister
à la pression de la glace.
La valeur patrimoniale du St. Roch, construit au Canada, tient au fait
qu'il illustre à merveille l'histoire maritime nationale. Le St. Roch a
traversé le passage du Nord-Ouest, rejoignant Halifax en 1942, après
avoir passé deux hivers emprisonné dans les glaces. Il fut le deuxième
navire à franchir ce passage, et le premier à effectuer la traversée
dans le sens Pacifique-Atlantique. En 1944, le St. Roch radoubé a
regagné Vancouver par une voie plus au nord, en passant par le détroit
du Prince-de-Galles, en quatre-vingt-six jours libres de glace, devenant
ainsi le premier navire à avoir franchi le passage du Nord-Ouest en une
seule saison. Retiré du service en 1948, le St. Roch fut envoyé à
Halifax par le canal de Panama en 1950, ce qui lui valut d'être le
premier navire à avoir fait le tour de l'Amérique du Nord.
Sous le commandement du sergent Henry Larsen (1899-1964) qui fut le
second puis le capitaine du navire pendant vingt ans, les voyages du St.
Roch ont renforcé la souveraineté canadienne dans l'Arctique. Il a
contribué à l'extension et au maintien de la présence canadienne sur les
vastes territoires du Nord en tant que navire de transport, de
ravitaillement, patrouilleur et représentant du gouvernement pour les
détachements de la Gendarmerie Royale du Canada en service dans ses
contrées isolées et relativement inaccessibles où elle régla les
différends et mena un recensement de la population inuit. À cette
époque, le St. Roch était la seule présence fédérale dans le Grand Nord.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le St. Roch fut envoyé dans le
passage du Nord-Ouest pour protéger les industries de guerre dans le
Nord, en particulier une mine du Greenland qui était la seule source de
cryolite, un minéral indispensable à l'industrie de l'aluminium.
La valeur patrimoniale du navire réside dans sa conception d'origine et
dans les nombreuses modifications apportées pour qu'il affronte des
conditions de navigation difficiles, et qui reflètent l'évolution des
technologies du transport maritime pendant la durée de son service. Le
St. Roch a été restauré pour lui redonner l'aspect qu'il avait pendant
ses traversées épiques entre 1940 et 1944, constitué d'un mélange
d'éléments originaux et d'aménagements ultérieurs. La valeur
supplémentaire de la conception du navire tient aussi aux détails sobres
et judicieux qui confèrent efficience et économie aux espaces
d'habitation et de travail.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Butterill, 1994 |
Lieu historique national du Canada Synagogue-de-la-Congrégation-Emanu-el
Victoria, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada
Synagogue-de-la-Congrégation-Emanu-el est un édifice en brique rouge de
deux étages situé à une intersection importante du centre-ville de
Victoria, en Colombie-Britannique. Construite en 1863, cette synagogue
se distingue par ses ornements extérieurs et intérieurs de style
néo-roman bien préservés. Le fait qu'elle soit en retrait d'environ deux
mètres par rapport aux trottoirs des deux rues aide à distinguer la
synagogue des édifices commerciaux et à bureaux avoisinants.
Le bâtiment a été construit à peine cinq ans après l'arrivée des
premiers colons juifs en Colombie-Britannique en 1858. Malgré sa taille
modeste, la communauté juive de Victoria a joué un rôle actif et
dynamique dans la vie économique, culturelle et politique de la jeune
ville et de la colonie. À son achèvement en 1863, la synagogue
constituait un ajout impressionnant au paysage urbain de la ville, et
une affirmation de l'engagement de cette petite mais importante
communauté vis-à-vis de l'avenir de la Colombie-Britannique.
La conception de la synagogue, œuvre de l'éminent architecte de la côte
Ouest John Wright, fait appel à des formes néo-romanes souvent choisies
par les juifs au XIXe siècle parce qu'elles exprimaient adéquatement
leur culture et leur spiritualité. Il reste très peu de ces synagogues
de style néo-roman, bien qu'elles aient déjà foisonné en Europe et en
Amérique du Nord. La synagogue de la congrégation Emanu-el, à titre de
plus ancienne synagogue du pays, revêt une valeur exceptionnelle parce
qu'elle constitue un lien rare et bien préservé avec cette tradition de
conception, et à cause de ses liens avec l'histoire et les traditions
des premières communautés juives du Canada.
|
|
Lieu historique national du Canada Tanu
New Clew, British Columbia
|

©Khalsa Diwan Society, Abbotsford |
Lieu historique national du Canada du Temple-Sikh-d'Abbotsford
Abbotsford, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada du Temple-Sikh-d'Abbotsford est
situé sur une propriété d'un acre au sommet d'une colline du centre
d'Abbotsford, dans la basse vallée du Fraser, en Colombie-Britannique.
Construit en 1911, ce bâtiment simple, rectangulaire au toit à pignons
comporte une structure de bois recouverte de clin de bois. La fausse
façade du côté de la rue est typique du style des immeubles commerciaux
d'architecture vernaculaire. Une véranda contourne trois des côtés de
l'édifice au deuxième étage.
Le Temple sikh d'Abbotsford est un exemple des premiers temples sikhs et
fait partie d'un réseau de temples qui témoigne de la phase des
pionniers de la communauté sikhe au Canada. Construit par les premiers
immigrants, la structure reflète les ressources limitées de ses
constructeurs ainsi que leur adaptation d'un type d'architecture
canadien, la fausse façade. Construit en 1911 et utilisé sans arrêt
depuis, ce temple est un vestige des premières racines de la communauté
sikhe et de la communauté indo-canadienne dans cette région du Canada.
La conception simple de cette structure représente un mélange de formes
architecturales canadiennes et d'éléments clés des traditions de
construction de bâtiments religieux sikhs, comme la salle de prière, les
quatre portes d'entrée, le Sukh Aasan, (la salle où le Guru Granth Sahib
était conservé) ainsi que les quartiers du Granthi au deuxième étage, la
cuisine communautaire et la salle à manger. Ces éléments architecturaux
ont une signification religieuse et symbolisent l'ouverture du temple à
tous, sans égard à la caste, à la foi ou à la couleur.
|
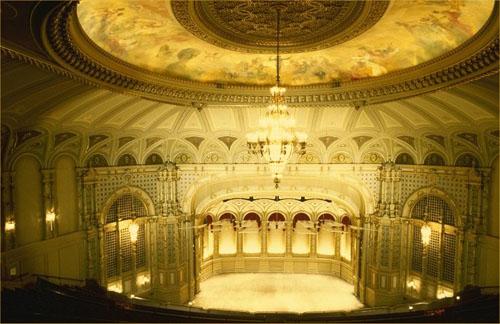
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Théâtre-Orpheum
Vancouver, Colombie-Britannique
Le théâtre Orpheum est un édifice de trois étages situé sur la rue
Granville, au cœur du quartier des divertissements de la ville de
Vancouver, à côté d'autres édifices commerciaux édouardiens. Il a été
agrandi dans les années 1980 et une nouvelle entrée a été créée sur un
côté du bâtiment. La façade sur la rue Granville recouverte de brique et
de terre-cuite a conservé sa symétrie d'origine et sa grande marquise
surmontée d'une enseigne au néon verticale.
Le théâtre Orpheum a été désigné lieu historique national du Canada en
1979, parce qu'il est l'une des rares salles de spectacle d'autrefois
qui subsistent encore dans leur état original.
Appelé aussi «Grand Old Lady of Granville», le quatrième théâtre Orpheum
de Vancouver était l'un des dix-sept grands cinémas au Canada construits
par l'Orpheum Circuit, basé à Chicago, et le plus vaste et le plus
extravagant de la côte du Pacifique. Il illustrait la confiance de la
compagnie en la croissance métropolitaine de Vancouver et il est devenu
un symbole du progrès de Vancouver.
Le théâtre Orpheum a été conçu par B. Marcus Priteca, un architecte de
Seattle qui a dessiné les plans de près de deux cents théâtres, de San
Diego à l'Alaska. Priteca a introduit de nombreuses innovations à la
conception du théâtre, notamment un plafond à triple dôme, un profond
balcon en porte-à-faux dont l'angle des rangées de sièges a été
soigneusement calculé pour offrir de meilleures lignes de visibilité,
une fosse d'orchestre et une mezzanine. Priteca était également maître
dans l'art de créer à peu de frais une illusion d'opulence en recouvrant
le béton armé de motifs décoratifs en plâtre. Frederick J. Peters a été
l'architecte collaborateur du projet.
L'Orpheum est un excellent exemple de la conception architecturale des
théâtres des années 1920. Situé au centre d'un quartier urbain, il
offrait un grand nombre de places, un foyer spacieux et un décor
intérieur somptueux qui créait une atmosphère d'opulence exotique. Dans
tous les espaces publics richement décorés, une série de motifs
répétitifs, tels que les colonnades, créent une stimulation visuelle
constante et de nombreuses perspectives commandées. Le design est un
mélange d'influences architecturales – les plafonds en voûte du grand
hall et du foyer, le revêtement en terre-cuite sur la partie inférieure
des marquises et les murs et piliers en travertin d'influence italienne,
les motifs exotiques des plafonds, les emblèmes héraldiques
britanniques, les lustres en cristal de Tchécoslovaquie, les panneaux
d'inspiration mauresque de l'orgue et le style baroque du revêtement des
plafonds et du dôme.
Le théâtre Orpheum fut un symbole important du développement de la rue
Granville en tant que quartier des divertissements entre 1920 et les
années 1940. Longtemps géré par Ivan Ackery, l'homme de spectacle
renommé, le théâtre a accueilli de nombreuses pièces prestigieuses, la
plupart reliées aux productions de l'Orpheum Circuit. Au fil des années,
le public a pu apprécier des concerts, des pièces de vaudeville et des
projections cinématographiques, et l'Orpheum a vu défiler des artistes
mondialement célèbres. L'Orpheum a accueilli le premier radio théâtre de
Vancouver et on trouve à l'intérieur la « Starwall Gallery » et à
l'extérieur la «Starwalk» qui honorent les artistes de la province ayant
excellé dans les arts de la scène.
Le théâtre a fait l'objet de l'un des premiers grands projets de
conservation patrimoniale entrepris à Vancouver. Des rénovations ont été
éffectuées, entre 1974 et 1977, par la firme Thompson, Berwick, Pratt
and Partners de Vancouver. De nos jours, il demeure la principale salle
de concert municipale et l'Orchestre symphonique en est le principal
locataire.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Andrew Waldron, 2011 |
Lieu historique national du Canada du Théâtre-Royal
Victoria, Colombie-Britannique
Le Théâtre Royal est un grand théâtre à façade de brique situé au centre
ville de Victoria. Il occupe la plus grande partie de son lotissement
urbain.
On a commémoré le lieu historique national du Canada du Théâtre-Royal à
titre de bâtiment ayant une importance historique et architecturale
parce que c'est un des plus beaux théâtres dramatiques d'envergure
préservés du Canada.
La valeur patrimoniale du Théâtre Royal a trait au caractère monumental
du bâtiment et à la splendeur de sa texture préservée. La Victoria Opera
House Company l'a construit en 1912-1913 sous le nom de Théâtre Royal
Victoria. Oeuvre des architectes William D'Olyly Rochfort et Eben W.
Sankey, ce théâtre présentait des spectacles dramatiques, musicaux et de
vaudeville sur scène. Famous Players a acheté l'édifice en 1930, l'a
rebaptisé Théâtre Royal et l'a consacré au cinéma. Il a repris en 1972
ses fonctions de théâtre.
|
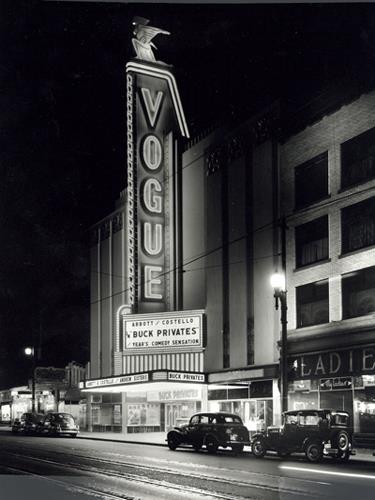
©Vancouver Public Library, Historical Photo Collection, 33461 |
Lieu historique national du Canada du Théâtre Vogue
Vancouver, Colombie-Britannique
Le Théâtre Vogue est un théâtre de style Art déco construit en 1940-41
pour y accueillir des spectacles de scène et des projections de cinéma.
Il est situé dans la rue Granville, au coeur du «Theatre Row» de
Vancouver.
L'effet atmosphérique de l'auditorium du Vogue repose intégralement sur
la fusion des formes, des masses et des systèmes électriques. Les
surfaces lisses et incurvées des murs n'ont pas seulement une fonction
esthétique, mais elles servent aussi d'amplificateurs et d'arrière-plan
aux tonalités subtiles créées pas le système d'éclairage modulaire. Le
principal élément atmosphérique remplaçant la décoration des murs est le
spectacle de lumière qui simule des levers et couchers de soleil. À cet
égard, le Vogue a été le fer de lance d'une tendance nouvelle de la
conception des théâtres.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, HRS 1131, 2004 |
Lieu historique national du Canada du Tronçon-du-Canyon-Myra-du-Chemin-de-Fer-Kettle Valley
Central Okanagan, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada du
Tronçon-du-Canyon-Myra-du-Chemin-de-Fer-Kettle Valley est un tronçon de
9,6 km de long de plate-forme de voie ferrée, qui traverse un terrain
très montagneux par le biais de tunnels et des hauts ponts à chevalets
en acier et en bois.
Le tronçon du canyon Myra du chemin de fer Kettle Valley a été désigné
lieu historique national du Canada parce que l'emplacement, la
disposition et la construction du chemin de fer Kettle Valley à travers
le canyon Myra constituent une prouesse d'ingénierie extraordinaire où
des technologies conventionnelles ont été combinées avec de
l'imagination et de l'ingéniosité pour tracer l'itinéraire de la voie
ferrée dans un terrain montagneux, et la construire.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait au fait qu'il illustre cette
prouesse d'ingénierie. Ce tronçon a été utilisé depuis son achèvement en
1914 jusqu'à sa fermeture à la circulation en 1978. Par la suite, on en
a fait un sentier pédestre dans le cadre du Sentier transcanadien. En
2003, il a été très endommagé par un incendie.
|

©M. Stopp, Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Tse'K'wa
Fort St. John, Colombie-Britannique
Situé au nord-est de la Colombie-Britannique, Tse'K'wa est un site archéologique
exceptionnel qui a contribué à la compréhension des changements environnementaux
et de l'occupation humaine depuis la fin de la dernière glaciation, il y a 12
500 ans, jusqu'à il y a 1 000 ans. Aussi connue sous le nom de grotte du lac
Charlie, Tse'K'wa présente une succession de couches de sol datées au
radiocarbone et assez peu perturbées, un phénomène rare en Amérique du Nord. Le
site est important en raison de ce qu'il a révélé sur les premiers humains,
leurs déplacements au fil du temps, leur mode de vie, les cultures qui ont suivi
et les changements environnementaux postglaciaires.
Tse'K'wa se trouve dans le terrain vallonné du district de la rivière de la
Paix, à l'est des Rocheuses, à neuf kilomètres au nord-ouest de Fort St. John.
Le site fait partie du territoire traditionnel des Premières Nations Dane-zaa,
et pour ces groupes des Premières Nations, qui assurent l'intendance du site,
Tse'K'wa est un lieu spirituel et emblématique de leur longue occupation de la
région de la rivière de la Paix, du lac Charlie et du site lui-même. Le site est
devenu un élément intégral de l'identité des Dane-zaa et des traditions
perpétuées par des histoires, des chansons et des récits.
À Tse'K'wa, les couches de sol les plus profondes contiennent une combinaison
d'éléments intacts qui témoignent de la présence des premiers habitants du
Canada, connus des archéologues sous le nom de peuples paléo-indiens. Ces
éléments comptent des outils en pierre et des os d'animaux de la dernière
glaciation. L'analyse des restes d'ossements de bisons anciens a révélé que ces
animaux étaient chassés, et le nombre élevé d'os de pattes par rapport aux
autres parties de squelette suggère que les viandes préférées apportées dans ce
camp provenaient d'ailleurs. De plus, l'analyse génétique des ossements de bison
a contribué à la compréhension de la spéciation du bison et a permis de mieux
comprendre les schémas de migration du bison et de l'humain à la fin de la
période glaciaire. Deux squelettes pratiquement complets de corbeaux ont
également été trouvés dans les couches de sol plus profondes. Il peut s'agir
d'enterrements délibérés liés à des systèmes de croyances anciens et
possiblement les plus anciens éléments de ce genre au pays.
Les couches de sol supérieures contiennent des artefacts et des os d'animaux des
cultures qui ont suivi, illustrant une présence humaine presque continue après
la période paléo-indienne jusqu'à il y a 1 000 ans. Ce matériel a fourni des
données comparatives clés pour l'étude du changement culturel dans l'Ouest du
Canada.
|

©City of Victoria, Steve Barber, 2004 |
Lieu historique national du Canada du l'Union Club of British Columbia
Victoria, Colombie-Britannique
L'Union Club of British Columbia illustre parfaitement la nature d'un
club pour messieurs. Fondé en 1879, il s'inspire d'un concept de club
privé, réservé aux membres, importé de Grande‑Bretagne et devenu
populaire au Canada entre la fin du 19e et le début du 20e siècle.
Depuis 1913, le club loge dans un édifice élégant en plein centre de la
ville de Victoria.
Les clubs pour hommes voient le jour en Grande-Bretagne au cours du 18e
siècle et offrent aux hommes de l'élite un lieu pour jouer, boire et
manger des mets raffinés avec leurs pairs. Ces clubs privés confèrent du
prestige et un statut social à leurs membres, qui socialisent et nouent
des relations dans un cadre souvent luxueux. Au Canada, le Beaver Club
de Montréal, fondé par des marchands et des négociants de fourrures en
1785 et dissous en 1827, en constitue l'un des premiers exemples. Au 19e
siècle, les clubs pour hommes se répandent dans les villes du pays, sous
l'impulsion des élites locales voulant recréer les clubs de
Grande-Bretagne.
Après sa création en 1879, l'Union Club of British Columbia devient
rapidement un second chez-soi pour les hommes politiques, les
fonctionnaires, les militaires, les professionnels et les journalistes.
Bien que les discussions politiques et d'affaires y soient interdites,
la fondation du club constitue, dans une certaine mesure, un geste
politique. La promesse de la construction d'un chemin de fer
transcontinental dans les deux ans et devant se réaliser dans la
décennie était une condition importante pour l'entrée de la
Colombie‑Britannique au sein de la Confédération en 1871. Le
mécontentement grandit au sein du club lorsqu'il apparaît évident que le
gouvernement du Dominion est incapable de respecter ces délais.
Certaines personnalités de Victoria sont résolument en faveur de la
Confédération. La formation de l'Union Club en des temps de turbulence
politique ainsi que l'appellation même du Club traduisent la position de
ses fondateurs, qui favorisent une union permanente entre le Canada et
la Colombie-Britannique.
Les membres du Club se réunissent dans des salles louées jusqu'en 1885,
année où celui‑ci déménage dans son premier bâtiment construit à cet
effet. Après une période de grande prospérité à Victoria, dans les
années précédant la Première Guerre mondiale, et l'adhésion de nombreux
membres, la volonté de construire un nouvel édifice moderne se précise.
Achevé en 1913, l'élégant bâtiment est depuis le foyer de l'Union Club.
Sa monumentalité, la symétrie de ses lignes, sa décoration classique,
son grand escalier et son emplacement de premier plan reflètent les
principes et les caractéristiques du style Beaux‑Arts, lequel domine
l'architecture publique et commerciale du début du 20e siècle. Le design
intérieur du club, sa disposition et ses fonctions reflètent encore
aujourd'hui les goûts et les intérêts de ses membres privilégiés.
|

©Dr. Larry McCann |
Lieu historique national du Canada Uplands
Oak Bay, Colombie-Britannique
Uplands est un lotissement résidentiel de 188 hectares situé dans la partie nord
est d'Oak Bay, la plus ancienne municipalité de banlieue du Grand Victoria.
Conçu en 1908 par John C. Olmsted, associé principal dans le cabinet
d'architectes Olmsted Brothers, pour William Gardner, promoteur immobilier de
Winnipeg, le quartier Uplands est un exemple exceptionnel de conception et de
planification de banlieue, et constitue l'une des plus belles œuvres d'un
architecte paysager de renom. L'utilisation intégrée d'éléments de conception
comme le réseau de rues au tracé légèrement incurvé, le respect de la
topographie et de la flore locale, les formes irrégulières et la taille
généreuse des terrains, la présence de multiples parcs et les restrictions sur
les titres imposés par mesure de protection ont permis de préserver le paysage
distinctif du quartier et modifié la façon de concevoir les banlieues pour une
bonne partie du XXe siècle. Son regroupement hétérogène d'habitations
unifamiliales de haute qualité, conçues par des architectes et des
constructeurs, illustre une gamme de tendances observées dans les quartiers de
banlieue au Canada, du style Arts and Crafts jusqu'aux styles néo-modernes du
XXIe siècle. Uplands préserve également des éléments archéologiques et des
pratiques paysagères des Premières Nations. Le parc Uplands comprend plusieurs
cairns funéraires des Premières Nations, et la préservation des prés de chênes
de Garry dans le parc et le lotissement résidentiel est attribuée en partie aux
pratiques saisonnières de brûlage de la Songhees First Nation qui datent d'avant
la colonisation par les Européens.
Uplands compte 600 habitations unifamiliales qui abritent quelque 2 000
personnes. Ce site côtier idyllique est bordé par la mer des Salish, le terrain
de golf Uplands et les municipalités de Saanich au nord et d'Oak Bay au sud-est.
Le quartier Uplands est l'un des premiers lotissements résidentiels au Canada
entièrement conçu comme parc résidentiel, c'est-à-dire un ensemble de maisons
disposées dans un paysage bucolique. Le cabinet Olmsted conçoit Uplands dans la
tradition des banlieues naturalistes ou des cités-jardins comme Llewellyn Park,
au New Jersey (1853) et Riverside, en Illinois (1869). Nouveauté au Canada au
tournant du siècle, la typologie des parcs résidentiels s'est avérée très
influente.
La conception organique d'Uplands contraste de façon spectaculaire avec celle
des municipalités avoisinantes du Grand Victoria, dont les limites renferment
une mosaïque de lotissements divisés en petits lots rectangulaires. Comme
d'autres lotissements résidentiels planifiés au Canada et ailleurs dans le
monde, ce quartier s'est développé par étapes. La première maison a été achevée
en 1912 et la construction s'est poursuivie jusqu'en 1976, date à laquelle tous
les lots avaient été aménagés. Un certain nombre de maisons d'Uplands ont été
conçues par les plus grands architectes du Canada et de la Colombie-Britannique.
Le respect qu'avait John Charles Olmsted pour les paysages locaux et sa
technique de planification « avec la territoire » ont eu pour conséquence la
préservation d'éléments archéologiques et des pratiques paysagères des Premières
Nations. Les savanes de chênes de Garry trouvées sur le site par John Olmsted
lors de sa première visite en 1907 ont été protégées et peuvent encore être
observées dans les cours, les terrasses publiques et le parc Uplands, un parc
naturel de grande dimension qui s'étend sur 31 hectares de terrains légués par
William Gardner à la municipalité en 1946.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Jennifer A. Cousineau, 2018 |
Lieu historique national du Canada l'École de langue japonaise de Vancouver et salle japonaise
Vancouver, British Columbia
L'École de langue japonaise de Vancouver et salle japonaise, située au 487, rue Alexander, est la
première et la plus grande école de langue japonaise au Canada et l'une des 50
écoles de cette nature en service avant 1941. C'est un rare exemple d'école de
langue de l'entre-deux-guerres se trouvant dans l'un des plus anciens quartiers
d'immigrants de la Colombie-Britannique qui subsiste encore de nos jours.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est l'une des milliers de propriétés
confisquées aux Canadiens d'origine japonaise par le gouvernement fédéral, et
elle est l'un des rares bâtiments restitués à ses propriétaires après la période
d'internement. Elle atteste de la persévérance des Canadiens d'origine japonaise
dans leurs campagnes menées pendant et après la guerre pour recouvrer leurs
propriétés et leurs biens. Conçue par le cabinet d'architecte Sharp and
Thompson, l'un des cabinets d'architectes les plus réputés de la
Colombie-Britannique, cette école de style Art déco fonctionnelle et élégante
témoigne de la croissance, du succès financier et de l'intégration culturelle de
la communauté japonaise de Vancouver dans les années précédant la Seconde Guerre
mondiale ainsi que de la résilience et de la fierté culturelle des Canadiens
d'origine japonaise.
L'École de langue japonaise de Vancouver est fondée en 1906 et est située à
l'origine au 439, rue Alexander, plus bas sur la rue où elle se trouve
présentement. Dans les années 1920 et 1930, la communauté japonaise s'épanouit à
Vancouver, particulièrement dans le quartier de la rue Powell. Les écoles de
langue sont parmi les organismes les plus appréciés de la communauté. Bien que
la majorité des enfants canado-japonais fréquentent l'école publique à cette
époque, une éducation immersive en langue et en culture japonaise est considérée
d'une grande importance par la communauté. En 1928, après avoir fructueusement
levé les fonds nécessaires, le bâtiment actuel de l'École est construit afin de
remplacer l'édifice d'origine alors surpeuplé. La conception Art déco du
bâtiment reflète la vivacité économique de la communauté, la priorité qu'elle
accorde à l'éducation et la volonté des Canadiens d'origine japonaise à
Vancouver de s'intégrer à la société canadienne.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le Canada déclare la guerre au Japon.
Dès février 1942, le gouvernement fédéral relocalise de force les Canadiens
d'origine japonaise habitant en Colombie-Britannique dans des camps
d'internement loin de la côte pacifique. L'année suivante, le gouvernement
saisit des fermes, des terres, des maisons, des bateaux ainsi que des
institutions commerciales, industrielles et communautaires appartenant à des
gens d'origine japonaise au Canada, des biens représentant des millions de
dollars. La plupart de ces propriétés sont vendues et ne sont jamais récupérées
par leurs propriétaires d'origine. L'École de langue japonaise de Vancouver est
confisquée et utilisée par le ministère de la Défense nationale, mais elle n'est
pas vendue. En 1953, après des années de pétition, le gouvernement fédéral rend
l'école à la communauté canado-japonaise. Après d'importantes collectes de fonds
menées par la communauté, l'édifice rouvre ses portes au public en tant qu'école
et centre communautaire, fonctions qu'il conserve à ce jour.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1998 |
Lieu historique national du Canada Village-et-Forteresse-de-Kiix?in
Barkley Sound, Colombie-Britannique
Les valeurs scientifiques et historiques du site reposent sur la rareté
d'un tel village des Premières Nations au sud de la côte de la
Colombie-Britannique, ayant conservé une intégrité relative et sur sa
contribution à accroissement de la compréhension de 3000 années
d'occupation continue sur le site. Le village principal (DeSh 1)
comporte des traces de dix maisons, desquelles huit ont des charpentes
traditionnelles des grosses maisons en poteaux, plusieurs ayant été
sculptés, et poutres en bois d'œuvre, sont demeurées debout ou sont
tombées au sol. Le site de la forteresse (DeSh-2) présente un aperçu de
cinq maisons situées sur trois plates-formes de différentes élévations.
Un petit tertre (DeSh 24) et un plus large (DeSh 25) avec les vestiges
de trois autres maisons démontrent la continuité de l'occupation de la
région sur près de 3000 ans, avec l'établissement du village et la
forteresse de Kiix?in étant l'occupation la plus récente après l'arrivée
des Européens.
Les éléments naturels faisaient du lieu l'endroit idéal pour
l'occupation et la défense. Les deux plages sablonneuses étaient
utilisées comme site de débarquement pour les canots, alors que les
promontoires rocheux élevés formaient une place forte et offraient des
vues surplombant les environs. Les ressources naturelles y étaient
abondantes avec les zones intertidal et infralittoral riches en
invertébrés, poissons, oiseaux, mammifères et varech. Étant un village
situé stratégiquement, Kiix?in était au centre du transport côtier, des
routes commerciales et des alliances changeantes des Huu-ay-aht, entre
environ 500 avant notre ère vers la fin du XIXe siècle. Vers les années
1880, les Nuu-chah-nulth ont quitté le village, mais le site est demeuré
important dans la vie de ses membres et pour l'approvisionnement en
nourriture ainsi que pour des raisons cérémonielles et
spirituelles.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Smyth, 1997 |
Lieu historique national du Canada Xá:ytem / Hatzic Rock
Mission, Colombie-Britannique
Xa:ytem comprend un site archéologique d'habitation et un ancien rocher
de transformation sto:lo. L'élément caractéristique du lieu est ce
rocher de transformation situé sur un terrain de faible élévation et en
pente, anciennement une plage de la rive nord du fleuve Fraser.
Xa:ytem a été désigné lieu historique national en raison de l'âge du
lieu d'habitation de « Hatzic Rock » (sic) et de son étroite association
avec le site de transformation qui revêt une importance indéniable pour
le peuple sto:lo. Ce site est important, car il incarne les raisons pour
lesquelles il faut préserver l'histoire, la culture et la spiritualité
sto:lo.
La valeur patrimoniale de Xa:ytem est attribuable essentiellement à
l'importance spirituelle du rocher de transformation et à son lien avec
la préservation de l'histoire, de la culture et de la spiritualité
sto:lo. Xa:ytem témoigne de la spiritualité et de la survie de la nation
sto:lo. Il est important pour l'enseignement de la culture sto:lo, des
liens avec la Terre mère, et de l'histoire et de la création du peuple
sto:lo. C'est un lieu d''éveil et de ressourcement spirituel. Le rocher
de transformation est un repère dans le paysage parce qu'il est visible
de divers points d'observation.
Le site d'habitation attenant est l'un des plus vieux jamais découverts
(environ 5 000 ans). Sa valeur tient aux liens avec l'histoire et la
culture sto:lo, et aux renseignements scientifiques qu'il
renferme.
|
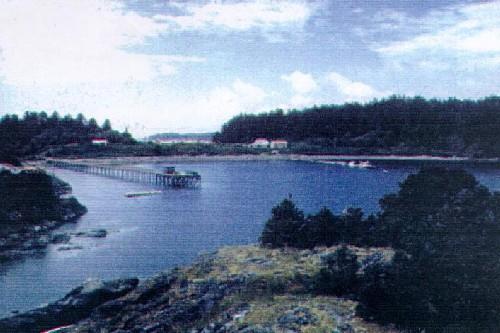
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1997 |
Lieu historique national du Canada Yuquot
Yuquot, Colombie-Britannique
Le lieu historique national du Canada Yuquot est un vaste site situé à
l'anse Friendly, sur la côte nord-ouest isolée de l'île de Vancouver. Le
paysage naturel accidenté comporte une plage prononcée de forme
semi-circulaire qui trace le bord de l'eau et les îles environnantes,
ainsi qu'une terrasse de terre et un boisés en retrait. Les éléments du
site sont variés et comprennent le paysage, les structures et les
nombreux vestiges archéologiques. Les ressources sont intimement liées
aux traditions orales, à la langue et à l'histoire des Premières nations
Mowachaht / Muchalaht ainsi qu'aux noms donnés par les Autochtones aux
réalités géographiques. La reconnaissance officielle vise le village de
Yuquot, les ouvrages de défense de Yuquot, le sanctuaire du baleinier,
le fort et l'établissement espagnol, le poste de traite des fourrures
anglais et le port de l'anse Friendly, tous situés à l'intérieur des
limites de la réserve no 1 des Premières nations Mowachaht / Muchalaht.
La valeur patrimoniale de Yuquot réside dans son association avec les
Premières nations Mowachaht / Muchalaht et leur monde social, politique
et économique. Occupé sans interruption depuis plus de 4 300 ans, le
village est devenu la capitale des 17 tribus que compte la région du
détroit de Nootka. La chasse à la baleine constitue un élément
fondamental de la vie des Mowachahts / Muchalahts, et de tous les
peuples Nuu-chah-nulths. Vers la fin du XVIIIe siècle, Yuquot devient
également un lieu important de prise de contact entre les Autochtones et
les explorateurs, et les commerçants européens. Les explorateurs ont été
séduits par l'aspect sécuritaire du port, qu'ils ont baptisé « l'anse
Friendly ». Yuquot, également appelée « Nootka », devient ainsi un
important centre commercial et diplomatique et abritait pendant une
courte période le seul établissement militaire espagnol du Canada
contemporain. Yuquot s'est retrouvé ensuite au centre de la controverse
du détroit de Nootka, entre 1789 et 1794, alors que des intérêts
divergents entre la Grande Bretagne et l'Espagne ont presque provoqué
une guerre entre ces deux pays.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada des Glaciers
Siège social: Revelstoke, Colombie-Britannique
Forêt ombrophile de l'intérieur de la Colombie-Britannique et glaciers
permanents.
Le parc national du Canada des Glaciers protège à tout jamais une partie
de la région naturelle de la chaîne Columbia, située dans la zone humide
de l'intérieur de la Colombie-Britannique. Les montagnes escarpées et
tourmentées, le climat chaud et humide et la variété d'espèces végétales
et animales sont typiques de cette région naturelle. Le parc protège
aussi des vieux peuplements uniques de thuyas et de pruches, et des
habitats essentiels à des espèces fauniques menacées et en danger de
disparition, comme le caribou de montagne, le chèvre de montagne, et le
grizzly. Le lieu historique national du Col-Rogers est situé dans le
parc national des Glaciers. Le col Rogers a été un jalon dans la
construction et l'aménagement de la première grande voie de transport
nationale du pays.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Réserve de parc national du Canada des Îles-Gulf
Siège social: Sidney, Colombie-Britannique
Un paysage exceptionnel d'îles cotières dans la partie sud du détroit de
Georgia.
Créée en 2003, la réserve de parc national des Îles-Gulf préserve un
secteur représentatif du superbe archipel de la région sud des îles
Gulf, en Colombie-Britannique. Ces îles sont représentatives des
Basses-Terres du détroit de Georgia, une des régions naturelles les plus
menacées du Sud du Canada. Cette toute nouvelle réserve de parc comprend
36 kilomètres carrés de terres et d'aires marines réparties sur une
quinzaine d'îles et de nombreux îlots et constituent d'habitats précieux
pour les phoques ou d'aires de nidification pour les oiseaux de rivage.
En plus, 26 kilomètres carrés de terres submergées sont également
administrées pour les besoins du parc national.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2014 |
Parc national du Canada Kootenay
Siège social: Radium Hot Springs, Colombie-Britannique
Site du patrimoine mondial de l'UNESCO et les sources thermales de
Radium.
Le parc national Kootenay représente la région sud-ouest des Rocheuses.
Ce parc aux paysages et aux milieux écologiques variés comprend non
seulement des pics coiffés de glaciers le long de la Ligne de partage
des eaux, mais aussi, dans le sillon des Rocheuses, des prairies
semi-arides où l'on trouve des cactus.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada du Mont-Revelstoke
Siège social: Revelstoke, Colombie-Britannique
Forêt ombrophile de thuyas de mille ans et montagnes
spectaculaires.
Le parc national du Mont-Revelstoke est un endroit de contrastes. Roulez
sur la promenade des Prés-dans-le-Ciel et vous traverserez diverses
zones géographiques. Depuis les vieux peuplements de pin et de genévrier
géants des denses forêts ombrophiles, montez vers la forêt subalpine
puis vers les prairies alpines et la toundra. Profitez du merveilleux
spectacle des sommets couverts de glace des monts Monashee et, vers
l'est, de la chaîne Selkirk. Le sentier de randonnée des genévriers
géants vous conduit à un peuplement de genévrier rouge vieux de 1000
ans.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2014 |
Parc national du Canada Yoho
Siège social: Field, Colombie-Britannique
Site du patrimoine mondial de l'UNESCO dans les Rocheuses.
Voici les versants ouest des Rocheuses canadiennes – des murs de roche
imposants, des chutes spectaculaires et des pics majestueux qui donnent
tout son sens au mot Yoho, une expression crie qui marque
l'émerveillement. Ici, à l'ombre de la Ligne de partage des eaux, vous
découvrirez les secrets d'une vie océanique ancienne, la puissance de la
glace et de l'eau et les récits de plantes et d'animaux qui continuent
d'évoluer en pleine nature.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Réserve de parc national, réserve d'aire marine nationale de conservation, et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas
Siège social: Queen Charlotte, Colombie-Britannique
Culture haïda et forêt ombrophile côtière des
Îles-de-la-Reine-Charlotte.
Le gouvernement du Canada et le conseil de la nation Haïda administrent
ensemble un lieu spécial : Gwaii Haanas, ce qui veut dire « îles de la
beauté » dans la langue haïda. Gwaii Haanas représente toute la nature
et l'écologie florissante de la côte du Pacifique. Les gardiens de Haïda
Gwaii collaborent étroitement avec Parcs Canada pour veiller sur
d'importants lieux culturels, notamment les mâts qui sont encore debout
à SGang Gwaay, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une épinette
de Sitka géante, un rorqual à bosse remontant à la surface et des eaux
regorgeant de saumons et de harengs ne sont que quelques-unes des
merveilles que vous pourriez apercevoir en visitant Gwaii Haanas.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Réserve de parc national, réserve d'aire marine nationale de conservation, et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas
Siège social: Queen Charlotte, Colombie-Britannique
Parcs Canada a déterminé que les eaux entourant la réserve de parc
national et le site du patrimoine haïda Gwaii Haanas pourraient
éventuellement être désignés comme aire marine nationale de
conservation.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2014 |
Réserve de parc national du Canada Pacific Rim
Siège social: Ucluelet, Colombie-Britannique
Milieu marin et forestier dans les montagnes de la côte du
Pacifique.
Avec la chaîne l'île de Vancouver comme toile de fond et l'océan
Pacifique à ses pieds, la réserve de parc Pacific Rim présente le riche
patrimoine naturel et culturel de la côte ouest du Canada. Son climat
frais et humide donne lieu à une abondance de vie marine et terrestre.
La riche forêt pluviale tempérée côtière cède la place à des zones
intertidales et subtidales fertiles et diversifiées. Ces merveilles
naturelles sont rehaussées par la longue histoire dynamique des
Premières nations Nuu-chah-nulth et des explorateurs et pionniers
européens.
|
|