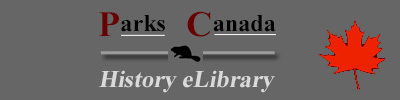|
Résumés parc
Manitoba
Tous les textes et photos sont la propriété de Parcs Canada ou le Répertoire canadien des lieux patrimoniaux
(Sauf indication contraire) et ont été extraites de l'une ou l'autre Parcs
Canada ou Lieux patrimoniaux du Canada. Les parcs avec un fond
gris sont gérés par Parcs Canada.

©Historic Resources Branch, Manitoba Culture, Heritage, Tourism and Sport, 2009 |
Lieu historique national du Canada de ancienne gare de la Northern Pacific and Manitoba Railway Station à Miami
Highway 23, Thompson, Manitoba
Gare-résidence de deux étages en bois, construite en 1889, avec un
hangar à marchandises attenant d'un étage, datant de 1903, l'ancienne
gare de la Northern Pacific and Manitoba Railway Station à Miami est
située à côté d'une emprise de chemin de fer, près de la limite sud de
Miami.
L'ancienne gare de la Northern Pacific and Manitoba Railway Station à
Miami, aux proportions, au style et aux matériaux sobres synonymes
d'efficacité et d'économie, est la plus vieille gare ferroviaire encore
intacte au Manitoba et dans son lieu d'origine. L'ensemble robuste à
ossature de bois est aussi l'un des quelques établissements seulement
qui subsistent encore pour marquer le rôle de la compagnie de chemin de
fer Pacifique du Nord et Manitoba, auxiliaire d'une compagnie
américaine, qui fut l'une des premières à faire concurrence au chemin de
fer Pacifique canadien dans le sud du Manitoba. La partie compacte de
1889 est une variante superbe et exceptionnelle du plan standardisé
utilisé par la Pacifique du Nord pour ses gares-résidences, soit la
seule de ce type qui ait survécu sur les trois que la compagnie
construisit dans la province. Ses éléments caractéristiques ' côtés
fortement tronqués, toit en croupe élevé, baie d'observation perçant le
toit et se transformant en lucarne à facettes ' s'accompagnent d'un
hangar à marchandises, à toit également en croupe, qui fut érigé par le
chemins de fer canadien du Nord, le successeur de la Pacifique du Nord.
En service jusqu'en 1973 et, de nos jours transformée en musée du chemin
de fer, cette gare est encore bien visible à Miami et elle symbolise
depuis longtemps la contribution essentielle des premiers chemins de fer
à l'essor économique et social de la région.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Édifice-de-l'Union Bank of Canada-et-Son-Annexe
Winnipeg, Manitoba
Le LHN de l'ancien immeuble de l'Union Bank et l'annexe est situé du
côté ouest de la rue Main, à l'endroit où la rue tourne vers le sud au
bâtiment historique de l'Hôtel de Ville de Winnipeg. Avec l'immeuble de
la Compagnie d'Assurance-Vie de La Confédération (également un
gratte-ciel et lieu historique national) de l'autre côté de la rue Main,
l'ancien immeuble de l'Union Bank forme la grande porte d'entrée sur le
district financier historique de Winnipeg.
Conçue par la firme torontoise d'architectes Darling et Pearson, cette
banque suit le modèle palazzo classique, l'une des deux formes inspirées
par le style Beaux-Arts utilisé dans la conception des premiers
gratte-ciel -immeubles de plus de 5 étages soutenus presque entièrement
par une charpente en fer ou en métal. Le gratte-ciel a été construit sur
une plate-forme flottante par la société George A. Fuller Construction
Co. de New York. En 1921, une annexe de plain-pied a été ajoutée à la
tour de 10 étages originale pour héberger le service d'épargne de
l'Union Bank. De 1925 à 1966, cet immeuble a été occupé par la
succursale principale de la Banque Royale de Winnipeg.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Allison Sarkar, 2019 |
Lieu historique national du Canada de l’ancien pensionnat indien de Portage La Prairie
Portage la Prairie, Manitoba
Construit en 1914-1915, l’ancien pensionnat indien de Portage La Prairie est
situé dans la réserve Keeshkeemaquah, laquelle fait partie des terres de réserve
de la Première Nation Long Plain. Une demande de désignation de ce bâtiment a
été faite par la Première Nation Long Plain. Parcs Canada et la Première Nation
ont collaboré pour déterminer les valeurs historiques de cet ancien pensionnat
et rédiger le rapport sur l’édifice préparé pour la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada.
Ce grand bâtiment en brique de trois étages est l’un des rares exemples
subsistants des pensionnats autochtones établis à travers le Canada. Il faisait
partie du système de pensionnats autochtones où le gouvernement fédéral et
certaines églises et organisations religieuses travaillaient ensemble afin
d’assimiler les enfants autochtones dans le cadre d’un vaste ensemble de
démarches visant à détruire les cultures et les identités autochtones et à
supprimer leurs histoires.
Les enfants envoyés au pensionnat indien de Portage La Prairie provenaient de
plusieurs Premières Nations et d’autres communautés autochtones au Manitoba et
ailleurs. Dans cet établissement, ils ont fait face à une discipline sévère, à
des abus, à du travail exténuant, à de la négligence affective, à des tentatives
d’anéantissement de leur langue et de leur culture ainsi qu’à l’isolement de
leur famille et de leur communauté. Plusieurs enfants se sont enfuient, dont
certains ont été ramenés de force. D’autres ont choisi la voie de la résistance,
notamment en continuant secrètement de parler leur langue. Les expériences des
survivants du pensionnat indien de Portage La Prairie et des autres pensionnats
ont eu des incidences sur les membres de ces Premières Nations pendant des
générations.
La conception de ce bâtiment de trois étages est typique des pensionnats
autochtones construits au début du XXe siècle et reflète les normes de
conception des écoles eurocanadiennes. Sa dimension imposante, son caractère
institutionnel et de confinement ainsi que son environnement restrictif
inspiraient un sentiment de désaffection, d’intimidation et de peur aux enfants
autochtones qui y étaient pensionnaires. Son architecture n’était pas adaptée
sur le plan culturel à des enfants habitués à vivre dans un milieu ouvert et
familier où ils étaient libres d’explorer.
Le pensionnat a fermé ses portes en 1975. Six ans plus tard, le bâtiment et les
terrains environnants ont été cédés à la Première Nation Long Plain afin de
remplir en partie leurs droits fonciers issus de traités. Depuis, la Première
Nation a adapté l’ancien pensionnat pour lui conférer plusieurs vocations
communautaires. Le bâtiment est maintenant connu sous le nom de l’édifice Rufus
Price, nommé en l’honneur d’un survivant du pensionnat qui a servi pendant la
Seconde Guerre mondiale et est plus tard devenu chef de la Première Nation Long
Plain et vice-président du Manitoba Indian Brotherhood. L’ancien pensionnat a
acquis un nouveau sens en tant que lieu de résilience et de commémoration qui
préserve l’héritage de l’ère des pensionnats autochtones et permet d’éduquer le
public.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1983 |
Lieu historique national du Canada Appartements Roslyn Court
Winnipeg, Manitoba
Le lieu historique national Appartements Roslyn Court est un immeuble
d'habitation en briques rouges de 5 étages qui compte 37 appartements et
qui est situé bien en vue à l'intersection du chemin Roslyn et de la rue
Osborne, dans le quartier Osborne Village de Winnipeg.
L'immeuble des Appartements Roslyn Court a été désigné comme lieu
historique national en 1991 parce que c'est une excellente illustration
du style néo-reine-Anne et de la conception architecturale des
appartements du tournant du siècle.
Ce lieu a une valeur patrimoniale parce qu'il illustre la façon dont le
dessin des immeubles d'habitation canadien du début du vingtième siècle
s'inspiraient du style néo-reine-Anne.
Construit en 1909, l'immeuble des Appartements Roslyn Court a été
dessiné par l'architecte de Winnipeg, William Wallace Blair. C'est l'un
des rares immeubles d¿habitation du début du XXe siècle qui a conservé
ses éléments intérieurs originaux.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Base-de-Lancement-de-Fusées-de-Recherche-de-Churchill
Churchill, Manitoba
Le lieu historique national du Canada de la
Base-de-Lancement-de-Fusées-de-Recherche-de-Churchill est situé sur le
59e parallèle, à quelques kilomètres à l’est de Churchill (Manitoba),
sur les rives de la baie d’Hudson. Il se compose d’un terrain
trapézoïdal immense avec des installations de lancement, de localisation
et de récupération de fusées. Jusqu’en 1985, année de la fermeture du
site, le territoire connu sous le nom de la station principale
fournissait la base de travail pour le lancement et la localisation des
fusées pour des recherches en haute atmosphère.
La valeur patrimoniale de la Base de lancement de fusées de recherche de
Churchill tient à l’intégralité du paysage culturel de la station
principale, qui illustre la nature et la technologie de la recherche sur
les fusées faite pendant la Guerre froide au Canada. La valeur réside
dans la conception, la composition, la répartition fonctionnelle,
l’équipement scientifique et technologique, l’emplacement et le cadre de
la station principale et de ses bâtiments et constructions.
La Base de lancement de fusées de recherche de Churchill a été
construite en 1956 par l’United States Army, sous l’égide du Conseil de
recherche pour la défense du Canada. En octobre 1956, elle a lancé sa
première fusée de recherche dans la haute atmosphère. Au fil des ans,
des programmes canadiens ont de plus en plus participé à la recherche
sur les fusées effectuée dans ce centre qui est devenu, en 1964, un des
centres du Conseil national de recherches de Canada (CNRC). C’est la
seule installation pour le lancement des fusées-sondes du Canada. C’est
de ce centre qu’a été lancée pour la première fois, en 1959, la fusée
Black Brant, qui avait été conçue et construite au Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1965 |
Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Seven Oaks
Winnipeg, Manitoba
Le lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Seven Oaks est
situé en milieu urbain, à l’intersection de la rue Main et du boulevard
Rupert’s Land, dans la ville de Winnipeg, au Manitoba. La bataille de
Seven Oaks s’est déroulée près de cet endroit le 19 juin 1816. Elle
opposait un groupe de Métis et un groupe de colons de la rivière Rouge.
Bien qu’il ne subsiste aucun vestige connu de la bataille, en 1951, la
Commission des lieux et monuments historiques du Canada a apposé une
plaque sur le monument érigé par la Manitoba Historical Society, près du
site de la bataille de 1816.
La bataille de Seven Oaks s’est déroulée le 19 juin 1816, au nord du
confluent des rivières Rouge et Assiniboine. Il s’agit d’une violente
escarmouche entre un groupe de Métis mené par Cuthbert Grant et un autre
formé d’hommes de la Compagnie de la Baie d’Hudson et de colons de
Selkirk, dirigé par le gouverneur Robert Semple. La bataille a marqué le
point culminant d’un conflit pour le contrôle du commerce de la fourrure
dans le Nord-Ouest qui opposait la Compagnie du Nord- Ouest, établie à
Montréal, et la Compagnie de la Baie d’Hudson, établie à Londres. Lord
Selkirk a tenté d’établir une colonie agricole sur la rivière Rouge, ce
qui a envenimé le conflit, car les Métis y voyaient une menace à leur
mode de vie traditionnel. La bataille a débuté à la suite de l’échec des
négociations sur l’approvisionnement en pemmican et s’est soldée par la
mort de Semple et de 20 de ses hommes. Grant, qui n’a perdu qu’un seul
homme, s’est emparé du fort Douglas et a expulsé les colons de la
région. Bien que les deux entreprises ennemies aient finalement
fusionnées, cet événement a contribué à éveiller la conscience nationale
à l’égard de la question touchant les Métis.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Fern Graham, 1998 |
Lieu historique national du Canada du Bâtiment d'exposition n° 2 de l'Exposition du Dominion
Brandon, Manitoba
Le Bâtiment d'exposition n° 2 de l'Exposition du Dominion est un
majestueux édifice d'exposition en bois situé au cœur du parc des
expositions de la ville de Brandon. L'échelle de l'ouvrage, ses
matériaux et ses éléments classiques attestent de ses origines du début
du XXe siècle.
Conçu par les architectes Shillinglaw et Marshall, ce bâtiment de style
Beaux-Arts a été construit en 1913, à l'initiative du ministère de
l'Agriculture, pour abriter une exposition agricole dans le cadre de
l'Exposition annuelle du Dominion.
|
|
Lieu historique national du Canada Brockinton
Melita, Manitoba
Le lieu historique national du Canada de Brockinton est un site
archéologique stratifié situé sur la rive est de la rivière Souris, près
de Melita, au Manitoba. Établi sur une pente abrupte entre la plaine
inondable et la prairie, le lieu consiste en une étroite bande de terre
basse en forme de croissant qui porte les traces de trois périodes
distinctes d’occupation, entre l’an 800 et l’an 1650 de notre ère. Le
côté terre du lieu est boisé. Le lieu comprend les traces d’un couloir
de rabattage de bisons et de l’occupation d’un peuple des plaines
inconnu, en plus de vestiges liés à la culture Duck Bay.
Brokinton est un site archéologique à composantes multiples qui comprend
trois couches principales d’occupation datant de la fin de la période
préeuropéenne, c’est-à-dire entre l’an 800 et l’an 1650 de notre ère. La
couche la plus ancienne, qui date environ de l’an 800, contient les
vestiges d’un couloir de rabattage de bisons abandonné. On y a trouvé un
nombre impressionnant d’ossements et d’outils, notamment un grand nombre
de petites pointes de flèches à encoches latérales. La deuxième couche,
datant de la période comprise entre l’an 1100 et l’an 1300 de notre ère,
témoigne de l’occupation d’un peuple associé à la culture Duck Bay,
variante régionale de la culture Blackduck dont le peuple a habité le
Nord de l’Ontario. Ce peuple ne fréquente habituellement pas les
plaines, mais plutôt la partie boisée du sud-est du Manitoba et les
régions adjacentes du Minnesota. La couche supérieure, datant de l’an
1600 de notre ère, contient des traces de l’occupation du territoire par
un peuple des plaines inconnu provenant des Dakotas. Il semble que ces
vestiges constituent la seule trace de ces peuples au Canada, qui sont
représentés par un riche assemblage de céramique fait de matériaux
divers et décoré dans un style qui leur est propre.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Grant Tyler, 1993 |
Lieu historique national du Canada du Camp Hughes
North Cypress, Manitoba
Le lieu historique national du Canada du Camp-Hughes est situé au sud de
la route Transcanadienne, à 10 km à l’ouest de Carberry, au Manitoba.
Ancien camp d’entraînement militaire durant la Première Guerre mondiale,
il est l’un des champs de bataille créés à des fins d’entraînement les
mieux préservés au Canada. Le lieu comporte de vastes champs herbeux
ondulés, des vestiges du camp militaire comprenant des zones destinées à
l’administration et à l’entraînement, un cimetière ainsi que des
vestiges archéologiques.
La valeur patrimoniale du Camp Hugues réside dans ses qualités
matérielles et ses associations historiques. C’est dans ce camp que des
dizaines de milliers de soldats canadiens ont reçu une instruction
concernant les tactiques et l’armement avant leur déploiement en Europe
pendant la Première Guerre mondiale. On y a créé des conditions
semblables à celles d’un champ de bataille, y compris un réseau de
tranchées, des fosses à grenades et un champ de tir, afin de représenter
la réalité d’une guerre de tranchées. Un grand nombre de soldats formés
au Camp Hughes ont participé aux batailles de la Crête de Vimy et de
Passchendaele, des batailles qui ont joué un rôle décisif dans
l’histoire du Canada. Le camp a servi d’installation d’entraînement
militaire jusqu’en 1934, année où il a été démantelé dans le cadre d’un
projet d’assistance aux chômeurs.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Richard Stuart, 1997 |
Lieu historique national du Canada du Canal-de-Dérivation-de-la-Rivière Rouge
Winnipeg, Manitoba
Le lieu historique national du Canada du
Canal-de-Dérivation-de-la-Rivière Rouge, qui fait partie d’un vaste
système de régulation des inondations, est situé à l’est de Winnipeg, au
Manitoba. La ville elle-même a été construite dans une plaine inondable,
à la confluence des rivières Rouge et Assiniboine, dans l’une des
régions les moins accidentées de l’Amérique du Nord. Construit entre
1962 et 1968 pour protéger Winnipeg des débordements de la rivière
Rouge, le canal de dérivation détourne sans danger le trop-plein d’eau
en contournant la ville vers l’est, puis rejoint la rivière en aval.
Au cours de son histoire, la rivière Rouge a inondé ses berges à de
nombreuses reprises, ce qui a souvent entraîné des conséquences
désastreuses pour les localités avoisinantes. Communément appelé «
Duff’s Ditch » en l’honneur de son promoteur, l’ancien Premier ministre
du Manitoba Duff Roblin, le canal de dérivation est devenu l’élément le
plus imposant d’un vaste projet d’ingénierie entrepris pendent les
années 1960 par le gouvernement du Manitoba dans le but de protéger les
habitants de la province. Le canal de dérivation de la rivière Rouge a
été construit à la suite de l’inondation catastrophique de 1950, qui a
recouvert presque le dixième de la superficie de la ville.
Les plans des ouvrages d’entrée et de sortie ont été dessinés par la
H.G. Acres & Company Ltd., firme d’ingénieurs-conseils de Niagara Falls,
en collaboration avec le conseil consultatif du canal de dérivation de
la rivière Rouge, Direction de la régularisation et de la conservation
des eaux du Manitoba. Puisqu’il s’agit du plus vaste projet d’excavation
jamais entrepris au Canada jusqu’à ce jour, la construction de l’ouvrage
a été effectuée par plusieurs entreprises, soit Northern Construction
Co. et J.W. Steward Ltd., de Vancouver, ainsi que Bird Construction
Ltd., de Winnipeg. La fabrication des vannes en acier et des pistons
hydrauliques a été assurée par Horton Steel Works, de Toronto.
Sa taille et sa conception sont imposantes, mais c’est la grande
efficacité de l’ingénierie du canal de dérivation de la rivière Rouge
qui lui confère toute sa valeur. Grâce à la technologie moderne de
l’hydraulique et un ambitieux travail d’excavation, ses concepteurs ont
été en mesure de détourner la force naturelle et destructrice de la
rivière Rouge, permettant ainsi à la ville de Winnipeg de s’étendre et
de se développer, à l’abri de la menace imprévisible des crues. Les eaux
de crue venant de l’amont de la rivière sont contrôlées par les
imposantes vannes de l’ouvrage de régulation de l’entrée du canal, au
sud de la ville, et par le canal lui-même, long de 47 kilomètres, qui
détourne sans danger le trop-plein d’eau en contournant la ville vers
l’est. Grâce à l’ouvrage de régulation de la sortie, situé au nord de la
ville, les eaux ainsi détournées rejoignent la rivière Rouge près de son
embouchure.
Même si les inondations extrêmes de l’ampleur de celles de 1950 et de
1997 sont rares, le canal de dérivation de la rivière Rouge a servi plus
d’une fois depuis son achèvement pour détourner les eaux et prévenir les
inondations, ce qui a permis de sauver les maisons et commerces de
Winnipeg des dommages importants que peuvent causer ces catastrophes
naturelles.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2001 |
Lieu historique national du Canada du Centre-d'Inscription-de-l'Entrée-Est-du-Parc-du-Mont-Riding
Parc national du Canada du Mont-Riding, Manitoba
Trois édifices de style Rustique construit à l'intérieur de programme de
relance économique consécutifs à la Crise.
Le LHNC du Centre-d’Inscription-de-l’Entrée-Est constitue un exemple
remarquable à l'échelon national du style rustique des années 1930 dans
les parcs nationaux du Canada. Des trois entrées du parc national du
Mont-Riding, il ne reste que celle-ci. Cette entrée a été construite à
l'aide de matériaux provenant de la région par des artisans qualifiés
locaux embauchés dans le cadre du programme de secours économique mis en
oeuvre pendant la grande dépression par le gouvernement fédéral.
Comprenant d'inscription et deux locaux pour le personnel, le complexe
de l'entrée est revêt d'une valeur symbolique inhérente à son
association au tout début du tourisme en automobile et des loisirs de
plein air. Pour les visiteurs du parc national du Mont-Riding
(PNMR).
Le lieu historique national du Canada du
Centre-d'Inscription-de-l'Entrée-Est-du-Parc-du-Mont-Riding comprend
trois édifices en billots de bois de style rustique exceptionnel, la
résidence des gardes du parc Whirlpool, le Bâtiment de l’entrée est, et
le chalet du gardien, ainsi que des vestiges de la route Norgate qui
traverse le complexe. Leur conception et leurs matériaux établissent
leur identité à titre d'entrée Est du parc national du Canada du
Mont-Riding. Plusieurs bâtiments de service à charpente de bois plus
récents existent à proximité.
La valeur patrimoniale de ce lieu réside dans le fait qu'il est un
exemple exceptionnel du style rustique dans un parc national du Canada.
Le Centre d'Inscription de l'Entrée Est du Parc du Mont-Riding a été
construit de 1933 à 1936 par le Service des parcs nationaux pour
permettre aux automobilistes circulant sur la route Norgate (route 19)
d'entrer dans le parc national du Canada du Mont-Riding par son côté
est. Les deux résidences ont des plans standards conçus par la Division
d'architecture de la Direction des Parcs nationaux.
|

©Parks Canada / Jeffrey Thorsteinson |
Lieu historique national du Canada du Cimetière Brookside
Winnipeg, Manitoba
Le cimetière Brookside, situé à Winnipeg, est l’un des plus anciens et
des plus vastes exemples de la tradition des cimetières-jardins dans
l’Ouest du Canada. Établi en 1878, il se trouve sur le territoire visé
par le Traité no 1 et sur le territoire ancestral de la Nation métisse.
Le cimetière, d’une superficie d’environ 70 hectares, est planifié et
réalisé dans un paysage de prairies. Il présente de nombreuses
caractéristiques du style des cimetières-jardins euro-américains, dont
des allées sinueuses, des îlots de formes irrégulières, un cours d’eau
et une conception qui rappelle les parcs. Il présente aussi un éventail
de plantations et une grande variété de monuments funéraires revêtant un
intérêt artistique. En outre, le cimetière Brookside compte l’un des
plus grands Champs d’honneur au Canada, un secteur qui témoigne de la
tradition des cimetières militaires. La forme et l’aménagement du
cimetière illustrent la préoccupation qui prévaut au Canada à la fin du
XIXe siècle et au début du XXe siècle à l’égard de la beauté des villes
et de l’offre d’espaces verts publics dans les villes.
Le cimetière Brookside est d’abord aménagé de 1877 à 1883 dans le style
des cimetières-jardins (ou ruraux) par l’arpenteur et architecte anglais
Thomas H. Parr. Toutefois, la transformation d’un paysage ouvert en un
site qui traduit cette approche pittoresque de la conception paysagère
prend réellement son élan en 1896, lors du transfert du cimetière au
conseil d’administration des parcs publics de Winnipeg, nouvellement
créé. Les responsables imaginent un endroit où tout le monde, sans égard
à la classe sociale, peut échapper aux foules et aux bruits de la ville
dans des lieux conçus de façon à rappeler un décor champêtre agréable.
De 1899 à 1904, David D. England, le premier surintendant des parcs
publics de Winnipeg, modifie et amplifie les plans de Parr et dirige la
plantation de milliers d’arbres à Brookside. Le surintendant des parcs
qui lui succède, George Champion, ajoute un étang et un pont, plante
d’autres arbres et aménage la partie nord du site en respectant le style
des cimetières-jardins.
Au début du XXe siècle, la partie nord du cimetière Brookside devient le
Champ d’honneur militaire. La section du Champ d’honneur datant de
l’époque de la Première Guerre mondiale est particulièrement importante
et présente une conception singulière de cimetière militaire qui est
antérieure à l’approche normalisée de la Commission des sépultures de
guerre du Commonwealth. Cette section témoigne des efforts d’un groupe
de service local voulant rendre hommage aux soldats tombés au combat. Le
cœur du Champ d’honneur est un îlot communément appelé « Tear Drop », où
les tombes sont placées de façon à former une larme, d’où son surnom en
anglais. En 1922, on installe au centre de la larme une Croix du
Sacrifice de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth.
Au-delà de cette section, l’aménagement axial normalisé de la Commission
est adopté et, en 1960, on y ajoute la Pierre du Souvenir de la
Commission. Cette pierre, la seule au pays, est dédiée à tous les
marins, soldats et aviateurs du Commonwealth qui sont enterrés au
Canada. Cet emplacement a été choisi puisque le cimetière,
symboliquement, se trouve près du centre du pays.
Le cimetière Brookside abrite d’autres monuments importants et éléments
historiques, notamment les portails en pierre calcaire et en fer forgé
du début du XXe siècle, un cairn dédié aux anciens combattants de la
guerre de Corée, un cairn dédié aux anciens combattants de la bataille
de Hong Kong, un monument à la mémoire des victimes de l’accident
ferroviaire de 1947 à Dugald, le monument commémoratif des pompiers de
Winnipeg, et le monument de l’Université du Manitoba à la mémoire des
personnes qui font don de leur corps à la science.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1986 |
Lieu historique national du Canada du Couvent-des-Sœurs-Grises
Winnipeg, Manitoba
Le lieu historique national du Canada du Couvent-des-Sœurs-Grises est un
édifice élégant de deux étages à toit en croupe présentant une influence
des techniques de construction de la Compagnie de la Baie d’Hudson par
sa construction en bois équarri et du classicisme européen dans sa
façade symétrique à neuf baies. Le couvent, qui fait face à la rivière
Rouge et au centre-ville de Winnipeg, est une composante importante du
complexe historique religieux, catholique romain, de St. Boniface. Le
bâtiment sert maintenant de musée de St. Boniface.
Ce couvent, dans lequel habitait le premier groupe de sœurs grises à
venir s'établir dans l'Ouest, a été érigé de 1846 à 1851. La conception
revient à sœur Marie-Louise Valade et à l'abbé Louis-François Richer
Laflèche qui ont travaillé en collaboration avec les constructeurs
locaux Louis Galarneau et Amable Nault. Construit en billots de chêne
blanc, le couvent a été par la suite réparé et agrandi pour répondre à
l'évolution des besoins. Il constitue un exemple exceptionnel de
construction à charpente de bois dite « de la rivière Rouge ». En tant
que mission, le couvent offrait les locaux nécessaires aux différentes
tâches des religieuses dans les domaines de la santé, de l’éducation et
de la charité, ce qui comprenait prendre soin des personnes âgées et des
orphelins, traiter les malades et instruire les enfants. Il s'agissait
du premier établissement de ce genre dans l'Ouest canadien. Les
religieuses ont quitté le couvent dans les années 1950, et la ville de
St-Boniface (maintenant Winnipeg) l'a loué pour le transformer en
musée.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, HRS 1101, 1995 |
Lieu historique national du Canada Dalnavert
Winnipeg, Manitoba
Le lieu historique national du Canada Dalnavert est une maison de la fin
du XIXe siècle, en brique rouge, de deux étages et demi, avec une grande
véranda de bois. Elle est située sur un grand terrain double dans un
secteur résidentiel, au centre-ville de Winnipeg. Une dépendance d'un
étage a été ajoutée à l'arrière de l'édifice pour servir de centre
d'orientation au Musée Dalnavert.
Dalnavert a été désigné lieu historique national en 1990 parce que c'est
un bel exemple du style néo-Queen Anne, dont s’inspire l’architecture
domestique.
Construite en 1895 pour Sir Hugh John Macdonald et sa jeune famille, la
maison est située sur un grand terrain double. Sir Hugh John Macdonald,
qui a été Premier ministre du Manitoba de 1899 à 1900 était le fils de
Sir John A. Macdonald. La composition asymétrique, la brique rouge et
les boiseries contrastantes, la masse variée et les ornements
éclectiques de la maison sont typiques du style néo-Queen Anne. Sa riche
décoration intérieure, tout comme la véranda qui ceinture la maison,
sont également représentatives de ce style. Le plan compact et la ligne
de toiture relativement simple illustrent l’adaptation de ce style à un
climat froid.
|
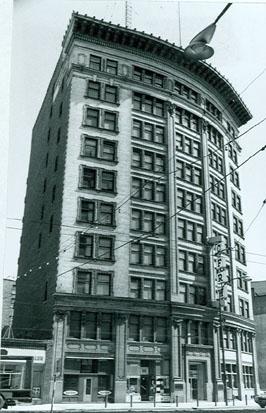
©Arch. J. Wilson Gray, 1912 |
Lieu historique national du Canada de l'Édifice-Confédération
Winnipeg, Manitoba
Haut de dix étages, l'édifice Confédération de Winnipeg a été construit
en 1912. Il est situé sur la rue Main, au coeur de l'ancien quartier des
affaires de la ville de Winnipeg. Le lieu désigné comprend le bâtiment
et la propriété sur laquelle il s'élevait au moment de la
reconnaissance.
L'édifice Confédération a été désigné lieu historique national en 1976
parce qu'il est un bon exemple des premiers gratte-ciels inspirés de
l'oeuvre de Louis Sullivan.
Conçu par l'architecte de Toronto, J. Wilson Grey, pour être le siège
social de la Confederation Life Association, cet édifice témoigne de
l'influence de Louis Sullivan, de l'école de Chicago. Respectant la
tradition de cette école, la façade de l'édifice révèle sa construction
à ossature d'acier et sa division en trois sections fonctionnelles
exprimées horizontalement.
|
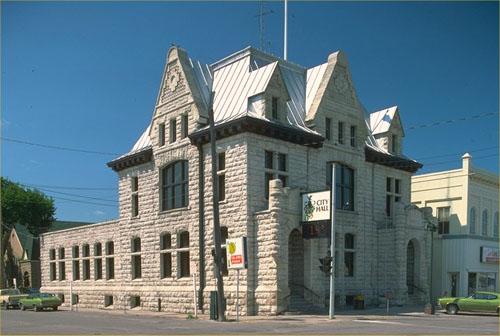
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1982 |
Lieu historique national du Canada de l'Édifice-Public-de Portage La Prairie
Portage La Prairie, Manitoba
L'édifice public de Portage la Prairie, qui est maintenant l'hôtel de
ville, est un imposant édifice public de deux étages et demi, en pierre
calcaire jaune, coiffé d'un toit en tôle galvanisée grise. Ce bâtiment,
construit de 1896 à 1898, est situé bien en vue sur la rue principale de
Portage la Prairie. Il servait de bureau de poste et de bureau pour les
ministères des Douanes et du Revenu de l'intérieur du Dominion, et
reflétait l'ambition de la ville. L'édifice, construit par Thomas
Fuller, l'architecte en chef du ministère des Travaux publics du
Dominion, se compose d'un mélange de styles architecturaux : second
Empire, néo-gothique de l’époque victorienne à son apogée, et néo-roman
à la Richardson.
À la fin du XVIIIe siècle, le Canada était une nation qui avait
récemment acquis son indépendance. À ce titre, son gouvernement devait
fournir, dans tout le continent en plein développement, les services de
base relevant de sa compétence. Le ministère des Travaux publics a donc
nommé un architecte en chef afin de superviser la construction
d'édifices dont le rôle consistait à abriter ces services tout en
assurant la visibilité du gouvernement fédéral. Thomas L. Fuller
(1823-1898), un architecte anglais, a occupé le mandat d'architecte en
chef de 1881 à 1898. Pendant son mandat, de nombreux édifices ont été
construits dans tous les coins du pays. Le bureau de poste de Portage la
Prairie, terminé en 1898, était un des 66 petits bureaux de poste
urbains construits pendant cette période, et seul celui-ci subsiste dans
l'Ouest du Canada.
Même si ces 66 bâtiments appartenaient tous à un genre spécifique, leur
conception individuelle et l'emploi de matériaux locaux assuraient
l'adaptation de chacun à son site. Leur plan standard comprenait un hall
ouvert au rez-de-chaussée, scindé en une salle et une zone de traitement
du courrier. Au deuxième étage, on trouvait les bureaux des ministères
des Douanes et du Revenu de l'intérieur. Le concierge habitait au
troisième étage, tandis qu'au sous-sol se trouvaient la chaudière, une
cave à charbon et une zone d'entreposage.
L'extérieur de l'édifice public de Portage la Prairie illustrait la
vision de Fuller, tout comme les autres édifices publics de tout le
pays. Le bâtiment est en pierre calcaire brute avec un cordon de pierre
de taille, sur une fondation en moellons de pierre des champs. La
charpente en bois des étages supérieurs est soutenue par des colonnes
intérieures en fonte. Comme les autres œuvres de Fuller, l'édifice
présente un mélange éclectique d'influences stylistiques. Les baies
symétriques et les entrées avant latérales, le toit mansardé et les
ornements classiques indiquent l'influence du style second Empire
français, alors que la ligne de toiture diversifiée, l'attention aux
couleurs et aux textures de la pierre et les volumes saillants et en
retrait trahissent l'influence du style néo-gothique de l’époque
victorienne à son apogée. De leur côté, la volumétrie diversifiée et les
garnitures des ouvertures ornées de larges voussoirs expriment
l'influence américaine du style néo-roman à la Richardson. Ces trois
styles sont typiques des édifices publics de l'époque.
Malgré son adaptation à l'évolution constante des procédures
gouvernementales, l'édifice public de Portage la Prairie a subi très peu
de modifications extérieures, mis à part le remplacement des fenêtres et
la construction d'un rajout de plain-pied à l'arrière pendant les
rénovations effectuées de 1920 à 1922. Les matériaux, les formes et les
ornements de cet ajout s'harmonisaient avec l'édifice qu'on agrandissait
pour répondre au besoin accru d'espace pour les bureaux de la douane. En
1960, l'édifice a été réaménagé et il est devenu l'hôtel de ville de
Portage la Prairie. Les bureaux municipaux et du maire occupent
maintenant le rez-de-chaussée, tandis que le deuxième étage a servi de
tribunal, de bibliothèque et de centre d'art. Deux cellules de prison
qui subsistent rappellent l'époque où un détachement de la GRC occupait
le sous-sol. En 2005, on a restauré les deux entrées d'origine,
l'escalier de la façade ouest et les boiseries des étages supérieurs
afin de préserver pour le futur la vie de l'hôtel de ville.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1994 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-Holy-Trinity
Winnipeg, Manitoba
Depuis sa construction en 1883-1884, le lieu historique national du
Canada de l'Église-Anglicane-Holy Trinity, qui est entouré des grands
édifices de verre et d'acier du centre ville de Winnipeg, a été témoin
de l'évolution de l'arrondissement qui est passé d'une prairie dégagée à
un centre commercial urbain. Cette pittoresque église en pierre calcaire
brute, qui évoque les églises paroissiales anglaises, est un bel exemple
du style néo-gothique de l'apogée victorien, attesté par l'interaction
dynamique des formes et des détails des faîteaux, contreforts, pignons
et lignes de toiture. L'édifice a conservé une quantité étonnante de ses
éléments d'origine. L'entrée principale de la rue Donald ayant été
condamnée, on accède maintenant à l'église en passant par la salle
paroissiale. Située dans un enclos paroissial paysager compact, l'église
Holy Trinity continue à être une paroisse très active du diocèse
anglican de Rupertsland.
Quand la paroisse Holy Trinity, constituée en 1867, n’eut plus assez de
sa deuxième église, la congrégation a organisé un concours
d'architecture, dont Charles H. Wheeler, architecte né en Angleterre et
membre actif de la congrégation, a remporté le prix de 300 dollars. Les
plans de Wheeler répondaient à merveille aux ambitions de cette petite
ville, mais, manquant de fonds, la paroisse finalement a dû renoncer à
construire le grand clocher et la flèche prévue dans le coin sud-est.
L'église Holy Trinity, terminée en 1884, a un plan cruciforme au contour
irrégulier, et un toit à pignon à pente raide avec de hautes lucarnes.
La pierre calcaire jaune-miel brute des murs est également employée avec
bonheur dans les larmiers de nombreuses fenêtres en ogive, et ceux,
terminés par des reliefs de visages humains qui coiffent les entrées. La
ligne de toiture descend en s'appuyant sur des contreforts jumeaux
surmontés chacun d'une tourelle extravagante. Diverses croix de pierre
placées au sommet des nombreux pignons et lucarnes attestent l'évolution
et la diversité culturelle de ce symbole chrétien.
À l'intérieur, on trouve un plafond à blochets ouvragé et de magnifiques
vitraux. Le remplage gothique ouvragé des fenêtres du chœur et de
l'entrée, avec ses ogives, est réduite à une forme plus simple dans les
fenêtres bordant la nef. Au-dessus, les fenêtres hautes présentent un
remplage trilobé qui symbolise judicieusement la Sainte Trinité. Le
plafond à blochets, fini en bois moiré noir, prolonge à une échelle plus
grande le remplage des fenêtres par des entrelacements ouvragés d'arches
reposant sur des piliers peints coiffés de toute une gamme d'ornements à
têtes humaines et d'animaux, de volutes et de feuilles. Un régime
d'entretien et de soins, appliqué depuis longtemps, a permis de
conserver intacte la plus grande partie de l’aménagement et de
l’ameublement d'origine de l'intérieur de l'église, si bien que celui-ci
a conservé un niveau d'intégrité remarquable.
En 1966, on a remplacé la salle paroissiale de 1912, qui masquait le
vitrail à l'arrière du chœur, par une structure plus basse qui cadre
davantage avec la conception de l'église tout en ménageant encore assez
d'espace pour les nombreuses activités de la paroisse.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1992 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. Andrew's
St. Andrews, Manitoba
Le lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. Andrew's
est une petite église en pierre de style néogothique, située dans la
communauté de St. Andrew's au Manitoba, à environ dix kilomètres au nord
de Winnipeg. L'église est située dans un enclos paroissial sur la rive
ouest de la rivière Rouge, au coin nord-ouest de l'intersection des
chemins River et St. Andrew's. Elle est entourée d'un mur de pierre en
moellons, datant au moins de 1858.
Cette église, construite à la place d'un bâtiment en bois plus ancien, a
été consacrée en décembre 1849 par la Société des missions de l'Église
anglicane, dans le cadre de sa mission dans la colonie de la rivière
Rouge.
Le style néogothique dans le contexte pionnier s’exprime ici dans
l’emploi d’éléments des plus fondamentaux : une forme rectangulaire
simple, un toit à pignon et une tour. L'église en pierre a été conçue
par son révérend, William Cockran, de la Société des missions de
l'Église anglicane. Le maçon hébridais Duncan McRae (1813-1898) a
supervisé la construction de l’édifice, tandis que le charpentier John
Tait a réalisé l’aménagement intérieur. Les paroissiens locaux ont
offert des dons, en plus de fournir la main d'œuvre et les pierres
calcaires provenant de carrières locales. Les trois cloches de fer de la
tour et la flèche de l'église appelaient les paroissiens à la prière.
Lorsque les fonctions de mission de St. Andrew's ont pris fin en 1886,
l'église est devenue ce qu'elle est encore aujourd'hui, le lieu de culte
d'une paroisse active, et un point d'intérêt de la province.
Suite à l'évolution de la liturgie au XIXe siècle, on a modifié
l'emplacement de l'autel. Une défaillance dans deux murs extérieurs en
pierre a entraîné d'importantes réparations en 1931 et 1932. On a
également dû entretenir régulièrement le bois des fenêtres et de la
flèche. En 1983 et dans les années 1990, on a effectué d'importantes
réparations aux murs, aux fondations, aux poutres du toit et au clocher
de l'église.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Catholique-Ukrainienne-Church of the Immaculate Conception
Cook's Creek, Manitoba
Le lieu historique national du Canada de
l'Église-Catholique-Ukrainienne-Church of the Immaculate Conception se
situe à un carrefour dans la localité rurale de Cook's Creek, au
Manitoba. Ses dimensions imposantes et son profil aux nombreux dômes
composent une silhouette unique dans un paysage plat qui se démarque
dans la prairie environnante. Il s’agit d’une église ukrainienne simple,
inspirée de l’architecture de Kiev, qui se distingue par sa volumétrie
byzantine complexe, ses matériaux de construction de l’ère de la Grande
Crise et ses détails de style populaire.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de
l'Église-Catholique-Ukrainienne-Church of the Immaculate Conception
réside dans son illustration de l'œuvre architecturale du révérend
Philip Ruh, typique de l'architecture religieuse ukraino-canadienne des
Prairies. La communauté de Cook’s Creek a été, de 1930 à 1962, la
paroisse du révérend Philip Ruh (1883-1962) qui a conçu 33 autres
églises ukrainiennes au Canada, dont plusieurs au Manitoba.
L’église, qui est l’une des conceptions les plus audacieuses de M. Ruh,
est dotée de neuf dômes ou structures en forme de dôme, d’un agencement
de volumes de hauteurs différentes ainsi que de grandes chapelles et
nefs latérales qui rappellent le style des églises à dômes multiples de
Kiev, qui ont inspiré le constructeur. Les murs extérieurs prennent
l’apparence du calcaire de Tyndall grâce à leur riche couleur dorée,
mise en valeur par des rangées d’étoiles rouges et vertes peintes sur la
corniche inférieure et autour des arches des portes. À l’intérieur, les
sections aux couleurs vives créent un véritable tableau par leur
juxtaposition d’orange brûlé, de pervenche, d’ocre et de vert foncé,
tandis que des bandes de marbrures de couleurs voyantes font ressortir
divers éléments architecturaux, comme les nervures des voûtes et les
arêtes des pilastres, ce qui confère à l’église une signature locale
charmante.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1996 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Catholique-Ukrainienne-de-la-Résurrection
Dauphin, Manitoba
Le lieu historique national du Canada de
l'Église-Catholique-Ukrainienne-de-la-Résurrection est une grande église
en béton à plusieurs dômes qui se situe dans la ville de Dauphin, au
Manitoba. Son extérieur exubérant et son intérieur très décoré expriment
de manière frappante la fierté et les valeurs culturelles de la
communauté ukraino-canadienne qui l'a construite au milieu du XXe
siècle.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de
l'Église-Catholique-Ukrainienne-de-la-Résurrection a trait au fait que
ses formes, sa conception et sa décoration, qui découlent du respect des
traditions iconographiques catholiques byzantines par la congrégation,
illustrent l'identité ukraino-canadienne. Les Ukrainiens de
l'établissement par îlots de Dauphin, arrivés dans la région en 1896,
ont construit cette église de 1936 à 1939. Ses plans ont été conçus par
le révérend Philip Ruh, pasteur de la congrégation ukrainienne voisine
de Cook's Creek. Pour économiser des frais de construction, Ruh a essayé
le béton pour produire des textures et des effets décoratifs
intéressants tout en étant suffisamment robustes et durables pour
résister au climat canadien. Theodore Baran, un artiste religieux
ukrainien immigré au Canada, a décoré l'intérieur de l'église en
1957-58.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Ukrainienne-St. Michael
Stuartburn, Manitoba
Le lieu historique national du Canada de l'Église-Ukrainienne-St.
Michael, situé à Gardenton, Manitoba, est une église blanche en bois
entourée de terres agricoles construite par le premier groupe de colons
à immigrer au Canada en provenance de Bucovine (située maintenant en
Ukraine de l’ouest). Sa masse, son dôme en bulbe reflètent le patrimoine
architectural ukrainien d'influence byzantine. Un clocher isolé en bois,
dont la forme évoque un empilement de cubes, a été ajouté à proximité en
1906.
Quarante-trois bénévoles de l'arrondissement ont construit l’église St.
Michael sous la supervision de Wasyl Kekof, un charpentier qualifié de
Bucovine. Ils ont adapté leurs techniques ancestrales aux outils simples
et matériaux dont ils disposaient. Ils ont commencé par couper les
billots au cours de l'hiver de 1897-1898. Ils venaient tout juste
d'arriver quelques mois auparavant, formant la première vague
d'immigration provenant de Bucovine et de Galicie, maintenant en Ukraine
de l'ouest. Lors de la consécration de l'église en octobre 1899,
l'arrondissement abritait 250 familles ukrainiennes qui suivaient les
rites orthodoxes ou catholiques grecs.
Pour préserver le patrimoine de l'église grecque orthodoxe, qui suit le
«rite de l'Est» lié à l'empire byzantin, ce groupe de colons a dû se
remémorer l'architecture des églises de leurs petits villages, élaborée
aux XIe siècle et XIIe siècles. Le plan de l'église concrétise ce lien
avec les traditions. Il contient en effet une série d'espaces, appelés
«cadres» qui mènent, à travers les trois zones principales, aux
iconostases. Dans le cadre central, le plus grand dôme est richement
peint d'étoiles dorées sur un fond bleu foncé pour inspirer des pensées
célestes. Les murs et les iconostases du dernier cadre sont richement
décorés par des icônes encadrées et du mobilier religieux, tous
d'excellente facture. L'intérieur est encore aujourd'hui pratiquement
tel qu'il était en 1915.
Même si l'église est construite en billots sur des fondations peu
profondes en pierre des champs, avec un colmatage de mousse et des coins
en queue d'aronde, les paroissiens ont recouvert les billots d'un
parement de bois en 1901. Un clocher isolé en bois en deux parties,
contenant trois cloches en fonte, a été construit en 1906 dans l'enclos
paroissial, également dans le style de Bucovine. En 1915, alors que
l'église avait besoin d'un nouveau toit, les paroissiens ont demandé à
Menholy Chalaturnyk, un jeune homme de l’endroit arrivé de Bucovine en
1905, de le construire. Un artisan voisin lui avait enseigné l'art de la
charpenterie traditionnelle ukrainienne. Chalaturny a donc conçu et
construit les trois coupoles en 1915, la plus grande coiffant le cadre
central, tandis que les deux autres plus petites recouvrent les cadres
est et ouest. St. Michael a pris son apparence actuelle lorsqu'on a
reconfiguré son toit de chaume en croupe d'origine pour lui donner son
apparence actuelle.
Alors qu'une deuxième église ouvre ses portes en 1934, l'ancienne église
ukrainienne orthodoxe St. Michael sera uniquement utilisée pour la
célébration annuelle au mois d'août. Elle rappelle le riche patrimoine
culturel et l'excellence de la main-d'œuvre que les premiers Ukrainiens
ont apportés avec eux au Canada.
|

©Heritage Recording and Technical Data Services, Heritage Conservation Program, RPS, "Designated Building Heritage Recording Report: Preliminary Record of 5 Grain Elevators, Inglis, Manitoba", September/October 1996

©Heritage Recording and Technical Data Services, HCP, RPS, "Preliminary Record of 5 Grain Elevators, Inglis, Manitoba", September/October 1996, photo 07526/23 |
Lieu historique national du Canada des Élévateurs-à-Grains-d'Inglis
Shellmouth-Boulton, Manitoba
Dans la petite ville d'Inglis, au Manitoba, une rangée de grands
élévateurs en bois est disposée le long de la voie ferrée. Il s'agit du
lieu historique national du Canada des Élévateurs-à-Grains-d'Inglis, une
des rares icônes de l'«âge d'or du grain» qui subsistent dans les villes
des Prairies. Ces élévateurs, qui ne servent plus, sont préservés à
titre de lieu historique.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada des
Élévateurs-à-Grains-d'Inglis a trait au fait qu'il représente
visuellement, symboliquement et réellement un phénomène typique du
paysage des villes des Prairies au début et au milieu du XXe siècle.
Ces cinq élévateurs à grains ont été construits le long de l'emprise
d'une voie du Canadien Pacifique desservant la ville nouvelle d'Inglis,
terminée en 1922. Quatre d'entre eux ont été bâtis pendant l'âge d'or du
grain, et le cinquième pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été
construits par des compagnies qui connaissaient bien ce type de localité
: N.M. Paterson & Son (1922), la Northern Elevator Company (1922),
Matheson-Lindsay (1922-23), Reliance (1941), et l'Union des producteurs
de grains Limitée (1925). Ces élévateurs ont plusieurs fois changé de
propriétaires au fil des ans, parmi eux figuraient d'autres compagnies
bien connues comme la Compagnie nationale des grains et le Syndicat du
blé du Manitoba. Depuis leur fermeture en 1995, ces élévateurs ont été
restaurés à des fins touristiques.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2006 |
Lieu historique national du Canada Fort-Dauphin
Winnipegosis, Manitoba
Durant l'automne de 1741, à la demande des Cris et Assiniboines, Pierre
de la Vérendrye construisit dans ce voisinage le fort Dauphin.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Fort-Dufferin
Emerson, Manitoba
Situé dans une zone rurale au nord de la ville d’Emerson, au Manitoba,
sur la rive ouest de la rivière Rouge, le lieu historique national du
Canada du Fort-Dufferin est composé des ruines du complexe central
construit pour la Commission des frontières nord-américaines (CFNA) à
partir de 1872. Il a ensuite été utilisé par la Police à cheval du
Nord-Ouest (P.C.N.-O) en préparation pour la Marche vers l’Ouest et il a
aussi servi de poste de police au cours de l’hiver 1875.
Dès 1872, le fort Dufferin a servi de base d’opérations sur le terrain à
la Commission des frontières nord-américaines qui a travaillé au cours
des deux années suivantes à définir et à baliser le 49e parallèle. Par
la suite, la Police à cheval du Nord-Ouest a utilisé le fort Dufferin à
deux reprises, la première fois en 1874 comme poste de maréchal de la
Marche vers l’Ouest, puis à l’hiver 1874-1875 comme quartier général de
la Division « D ». Entre 1875 et 1879, le fort Dufferin a servi de port
d’entrée au Manitoba et de portail vers l’ouest canadien. Le rôle du
fort Dufferin en tant que poste d’immigration n’a duré que le temps où
les bateaux de la rivière Rouge étaient le principal mode de transport
des immigrants vers le Manitoba. La propriété a ensuite servi d’aire de
quarantaine pour le bétail, avant d’être cédée à des propriétaires
privés, puis par la suite acquise par la province du Manitoba.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Blair Philpott, 2008 |
Lieu historique national du Canada Fort-La-Reine
Portage la Prairie, Manitoba
Le lieu historique national du Canada Fort-La-Reine est situé sur la
rive nord de la rivière Assiniboine, dans le secteur est de Portage La
Prairie, au Manitoba. Il n’existe aucun vestige connu lié au
Fort-La-Reine, mais un cairn de pierre et une plaque ont été érigés par
la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC) pour
commémorer le lieu.
La valeur patrimoniale de Fort-La-Reine réside dans ses associations
historiques avec les débuts de l’exploration de l’Ouest durant le Régime
français. Les premiers Européens à visiter l’emplacement du fort étaient
probablement les explorateurs français Radisson et Groseillers, qui
explorèrent la région entre 1658 et 1690 dans le but de récolter des
fourrures. En octobre 1738, Pierre Gaultier de Varennes, sieur de La
Vérendrye, établit Fort-La-Reine aux abords de la rivière Assiniboine.
Le fort servit alors de base en vue d’une exploration plus approfondie
des prairies canadiennes et constitua également l’un des principaux
postes français de traite des fourrures jusqu’à la fin de l’influence
française, en 1759. Certains signes donnent à penser que Fort-La-Reine
fut abandonné, brûlé et rebâti plusieurs fois, bien que les dates de ces
événements demeurent inconnues, tout comme les emplacements exacts
qu’aurait occupés le fort.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2014

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Fort-Prince-de-Galles
Churchill, Manitoba
Fort en pierres du XVIIIe siècle établi dans la baie d'Hudson et utilisé
pour le commerce des fourrures.
Outre les imposantes fortifications du fort Prince-de-Galles près de
Churchill, Manitoba, ce lieu historique national du Canada comprend les
installations du cap Merry et de l'anse Sloop. Vous pouvez y faire
l'expérience de la diversité de l'histoire de la Compagnie de la Baie
d'Hudson et de la traite des fourrures au début du XVIIIe siècle. Le
centre d'accueil de Parcs Canada, situé à Churchill au Manitoba, offre
une excellente introduction aux divers sites par ses expositions et ses
présentations spéciales.
Le lieu historique national du Canada du Fort-Prince-de-Galles est une
forteresse en ruines du début du XVIIIe siècle que la Compagnie de la
Baie d'Hudson a construite pour y faire la traite des fourrures. Les
murs de pierre subsistants se détachent de la toundra environnante sur
la rive de la baie d'Hudson, à l'embouchure de la rivière Churchill,
dans le nord du Manitoba.
La valeur patrimoniale du fort Prince-de-Galles a trait à ses liens
historiques, aux vestiges du fort et au paysage culturel du site. C'est
la Compagnie de la Baie d'Hudson qui l'a construit entre 1731 et 1771, à
une époque où sa principale route d'expédition et d'approvisionnement
partait de la baie d'Hudson et traversait les eaux arctiques. Les
Anglais ont voulu construire une forteresse imprenable, si bien
qu'aujourd'hui subsistent encore ses murs imposants de 12 m d'épaisseur
et ses quarante canons montés sur affûts, ainsi que la batterie, le
canon et la poudrière assurant la sécurité du cap Merry. En 1782,
l'explorateur Samuel Hearne, alors commandant du fort, a cédé le fort
aux Français, ce qui a mis fin à son occupation par la Compagnie de la
Baie d'Hudson et donc à l'utilité du fort. Entre 1935 et 1965, Parcs
Canada a effectué quelques minimes réparations aux murs de la
forteresse.
|

©Library and Archives Canada / Bibliothèque et Archives Canada, C-001932, 1821
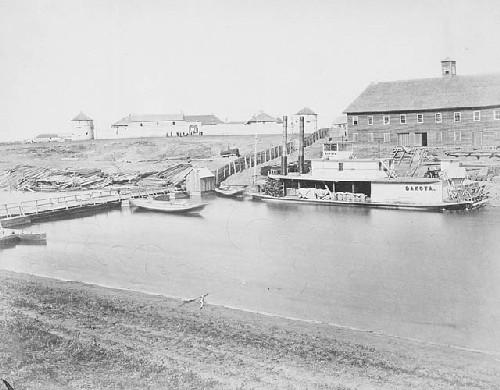
©Library and Archives Canada / Bibliothèque et Archives Canada, PA-011337, c. 1872. |
Lieu historique national du Canada Forts Rouge, Garry et Gibraltar
Winnipeg, Manitoba
Fort Rouge - La Vérendrye (1738); Fort Gibraltar - Compagnie du
Nord-Ouest (1810); Fort Garry - Compagnie de la Baie d'Hudson
(1822)
Le lieu historique national du Canada Forts Rouge, Garry et Gibraltar
est situé sur trois emplacements différents, au confluent des rivières
Rouge et Assiniboine, au centre-ville de Winnipeg, au Manitoba. L’unique
vestige encore visible au-dessus du sol à cet endroit est l’entrée nord
du fort Garry II, à Upper Fort Garry Park, dont les murs ont été
partiellement reconstruits. Les emplacements des deux forts Gibraltar et
du premier fort Garry ont été localisés près de l’endroit où se trouve
aujourd’hui la gare Union, alors qu’on croyait que le fort Rouge était
situé à South Point, tout juste au sud, de l’autre côté de la rivière
Assiniboine. La reconnaissance officielle fait référence au tracé au sol
du fort Garry II, aux vestiges archéologiques connus des forts Gibraltar
I et II et du fort Garry I, ainsi qu’à l’emplacement probable du fort
Rouge.
Situés à la rencontre des rivières Assiniboine et Rouge, les forts
Rouge, Garry et Gibraltar illustrent l’évolution de la traite des
fourrures dans l’Ouest, dès le début de l’expansion vers l’ouest et
jusqu’à la domination de la Compagnie du Nord-Ouest, puis de la
Compagnie de la Baie d'Hudson.
Érigé en 1738, le fort Rouge fait partie du plan d’expansion de la
traite des fourrures vers l’ouest prévu par Pierre Gaultier de Varennes
et de la Vérendrye au nom de la France. À cette époque, le fort sert de
poste de traite pour les échanges avec les Autochtones de la région. Il
reste ouvert seulement pendant une saison, et dès 1807, la Compagnie du
Nord Ouest commence la construction du fort Gibraltar sur un site à
proximité. Ce dernier devient le principal fort de la compagnie dans les
terres intérieures et sert au commerce du pemmican, permettant
d’approvisionner les autres localités de l’Ouest jusqu’à sa destruction,
en 1816, au cours d’un conflit avec la Compagnie de la Baie d’Hudson.
Lorsque les deux compagnies s’associent en 1821, le fort est reconstruit
sous le nom de fort Garry. Érigé sur le site même du fort Gibraltar, ou
près de celui-ci, le fort Garry devient le fort le plus important à
Winnipeg, même si sa position instable près des berges de la rivière
nécessite son déplacement vers des terres plus élevées en 1836. Le fort
Garry II est partiellement démoli en 1882, mais son entrée nord est
aujourd’hui le seul vestige visible au-dessus du sol qui subsiste de la
construction successive de forts au confluent des rivières Rouge et
Assiniboine.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |
Lieu historique national du Canada de la Gare du Canadian Northern à Miami
Miami, Manitoba
La Gare de Miami est une petite gare ferroviaire d'un étage et demi en
bois, jouxtant la voie ferrée dans la communauté agricole de Miami au
Manitoba.
La Gare de Miami a été désignée lieu historique national en 1976 pour
commémorer le développement du réseau ferroviaire du Canadian Northern,
et parce qu’elle est un des rares exemples préservés de gare du Canadian
Northern Railway (CNR) qui, fondé en 1899 par William Mackenzie et
Donald Mann suite à la fusion de deux petites voies d’embranchement du
Manitoba, est vite devenu un grand réseau ferroviaire transcontinental.
La gare actuelle, construite vers 1905, est représentative des nombreux
dépôts de conception simple construits par le CNR dans les Prairies.
Elle illustre la brève période de prospérité qu’a connue Miami lors de
l’essor de l’industrie du chemin de fer au début du XXe siècle.
Aujourd’hui, la gare sert de musée ferroviaire pendant la saison
estivale.
|

©Former Canadian Pacific Railway Station, Sean Marshall, 2003 |
Lieu historique national du Canada de la Gare-du-Canadien-Pacifique-à-Winnipeg
Winnipeg, Manitoba
Le lieu historique national du Canada de la
Gare-du-Canadien-Pacifique-à-Winnipeg est l'ancienne gare ferroviaire du
Canadien Pacifique située au 181, avenue Higgins, à Winnipeg. Ce
magnifique édifice de quatre étages de style Beaux-Arts présente un
contraste d'ornements en brique et en pierre calcaire de Tyndall.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la
Gare-du-Canadien-Pacifique-à-Winnipeg a trait à son impact à titre de
grande gare ferroviaire urbaine du XXe siècle. Elle est illustrée par le
style Beaux-Arts de la gare, ses dimensions monumentales, son intérieur
fonctionnel et expansif, ainsi que par l'excellente qualité de ses
matériaux et de sa réalisation. Elle s'exprime également dans la
disposition et l'emplacement de l'édifice.
Cette gare était la quatrième que le Canadien Pacifique a construite à
Winnipeg. Elle a été bâtie de 1904 à 1906 dans le cadre d'un monumental
complexe comprenant un hôtel de luxe, la gare elle-même et une aile
administrative en forme de U. Conçue par les architectes montréalais
W.S. et E. Maxwell, il s'agissait du premier édifice de style Beaux-Arts
construit au Canada. Ses installations ont été agrandies en 1915 par
l'ajout de six lignes principales supplémentaires, la surélévation du
talus, et l'addition d'une salle d'attente de deuxième classe plus
grande et d'installations de manutention des bagages. Le bâtiment a
continué à servir de gare jusqu'en 1978. Le Canadien Pacifique utilise
encore son aile administrative, bien que l'hôtel Royal Alexandra,
associé au complexe, ait été démoli en 1971.
|

©Green Winnipeg, Trevor, September 2010 |
Lieu historique national du Canada de la Gare-Union / Gare-du-Canadien-National-à-Winnipeg
Winnipeg, Manitoba
La Gare Union / gare du Canadien National à Winnipeg est un terminus
ferroviaire en pierre, de quatre étages et de style Beaux-Arts construit
dans la première décennie du XXe siècle. Elle est située au cœur du
centre ville de Winnipeg, à l’angle de la rue Main et de l’avenue
Broadway. Aujourd'hui, l'édifice abrite une gare ferroviaire qui assure
encore le transport de passagers, ainsi que des locaux à bureaux et
commerciaux.
La Gare Union / gare du Canadien National de Winnipeg a été désignée
lieu historique national du Canada en 1976 parce qu’elle compte parmi
les grandes gares de style Beaux-Arts construites dans l'Ouest du
Canada, par les compagnies de chemin de fer Grand Trunk Pacific Railway
(GTPR) et Canadian Northern Railway (CNoR).
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à la taille, à la disposition,
aux matériaux et à la conception de la gare. Sa construction, un projet
mené conjointement par le CNoR, le National Transcontinental Railway
(NTR), le GTPR et le gouvernement du Dominion, atteste la confiance de
l'industrie ferroviaire et du gouvernement fédéral en la croissance de
l'Ouest canadien.
La Gare Union, construite de 1908 à 1911 selon les plans de Warren and
Wetmore, une firme d’architectes sise à New York, est un des fleurons
des gares de style Beaux-Arts au Canada. Son emplacement illustre aussi
les principes de l’aménagement urbain de style Beaux-Arts, ainsi qu'une
sensibilisation à l'environnement physique s’inspirant du mouvement «
City Beautiful ».
|
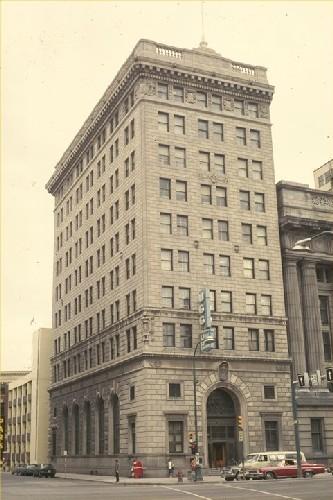
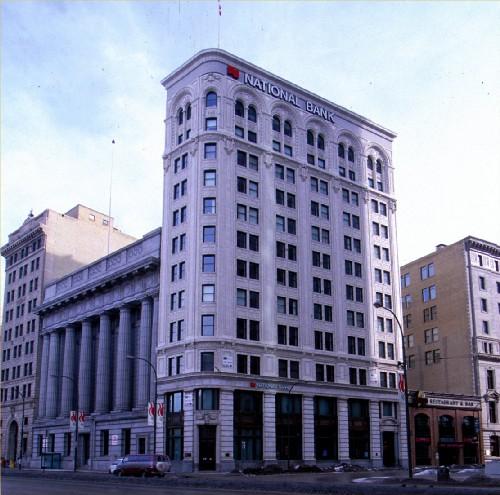
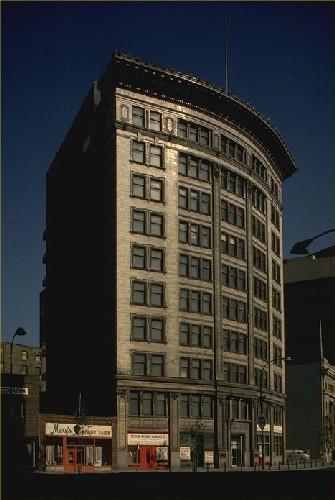
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada des Gratte-Ciel-de-Winnipeg
Winnipeg, Manitoba
Le lieu historique national du Canada des Gratte-Ciel-de-Winnipeg est un
groupe de trois immeubles commerciaux en hauteur situés au sein du lieu
historique national du Canada du Quartier-de-la-Bourse, qui est le noyau
commercial historique de la ville. Bien que présentant des ornements de
divers styles, ils sont dans l'ensemble conformes au style de l'École de
Chicago, qui prévalait à l'époque pour les nouveaux gratte-ciel
apparaissant dans les centres de plus en plus densément construits des
villes.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à l'impact de ce groupe
d’édifices monolithiques de grande hauteur, dont la disposition
découlait des nouvelles tendances technologiques et esthétiques
provenant de la métropole de Chicago, en Illinois. Au début du XXe
siècle, lors de l'émergence de ces immeubles de dix à treize étages, ils
établissaient une nouvelle norme de densité pour les
centres-villes.
|

©Stephen Hayter, Commonwealth Air Training Plan Museum, Inc., 1999 |
Lieu historique national du Canada du Hangar-Numéro-Un-du-PEACB
Brandon, Manitoba
Le hangar numéro un du PEACB est un hangar d’entretien et d’entreposage
des avions de la Deuxième Guerre mondiale situé sur le terrain
d’aviation de l’aéroport municipal de Brandon. Ce cube monumental vert
au toit plat, comprend une immense porte coulissante au centre de sa
façade, et des fenêtres de taille industrielle à vitres multiples
au-dessus des ailes basses du hangar de chaque côté.
La valeur patrimoniale du hangar numéro un du PEACB tient à son
association au BCATP en tant que type de construction conçue pour un
usage déterminé et à l’intégrité continue de sa conception, de sa
fonction, de ses matériaux, de sa technologie, de son site et de son
cadre comme représentation de double hangar d’avions terrestres. Le
hangar numéro un du PEACB est un double hangar d’avions terrestres conçu
par la Direction du Génie Construction de l’Aviation royale du Canada
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été construit en 1940-1941 et
a été le premier des 701 hangars construits selon des normes (de
dimensions, de configuration et de matériaux qui changent peu),
conformément au PEACB, pour soutenir la formation d’équipages du Canada
et du Commonwealth. Il a été rénové depuis 1987 et ses toits, son
armature et ses fenêtres du côté est ont été réparés. Il abrite à
présent le musée PEACB de l’aéroport de Brandon.
|

©Concord Aerial Photo |
Lieu historique national du Canada du Homestead-de-Wasyl Negrych
Gilbert Plains, Manitoba
On pense que le Lieu historique national du Canada du Homestead de Wasyl
Negrych est un des exemples les plus complets et les mieux préservés
d'ancienne propriété familiale ukrainienne au Canada. Il est situé près
de la ville de Dauphin, au Manitoba. Ce site, niché dans une vallée
abritée, se compose de dix bâtiments en billots de bois, entourés de
champs et de vergers disposés des deux côtés d'une ancienne route de
colonisation. Ses dix édifices présentent des caractéristiques rares,
comme un toit à longs bardeaux du style des Carpates et un «peech»
complètement préservé, qui est le massif four en bois et en argile qui
formait autrefois le cœur de toutes les maisons ukrainiennes.
Le Homestead de Wasyl Negrych a été désigné lieu historique national en
1966 car : il remonte aux débuts de l'établissement par îlots des
Ukrainiens de Dauphin, si bien qu'on pense qu'il s'agit de l'exemple le
plus ancien et le mieux préservé de ferme pionnière ukrainienne au
Canada; et la maison, son élément central, est le plus ancien logement
ukrainien connu du pays à être encore sur son emplacement d'origine.
La valeur patrimoniale du Homestead de Wasyl Negrych a trait à
l'intégrité de son paysage culturel exprimant l'expérience qu'ont vécue
les colons ukrainiens immigrants. Cette valeur s'exprime dans le paysage
et la disposition fonctionnelle du site, son emplacement, ainsi que la
nature et la composition des anciennes structures qu'il contient. La
famille de Wasyl et Anna Negrych a construit cette propriété de 1897 à
1910, peu après son arrivée au Canada, lorsqu'on lui a attribué sa terre
dans l'établissement par îlots de Dauphin. La propriété contient dix
bâtiments rustiques en billots, dont huit datent de la période initiale
de construction, y compris la maison, une baraque et des fours à cuire
les aliments. Ces ouvrages, en matériaux locaux, sont représentatifs des
traditions ukrainiennes de la famille Negrych. Cette ferme, et son
paysage bien préservé, constituent maintenant un site patrimonial où on
interprète l'expérience de colonisation des immigrants
ukrainiens.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, HRS 1026, 1985 |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-Fort Garry
Winnipeg, Manitoba
L'hôtel Fort Garry est un hôtel en pierre de style Château datant du
début du XXe siècle. Il est situé au centre-ville de Winnipeg, à une rue
à l'ouest de la gare ferroviaire Union..
L'hôtel Fort Garry a été désigné lieu historique national en 1980 parce
qu'il a été construit dans le style Château, un style d'architecture
reconnu d'importance nationale.
L'hôtel Fort Garry fait partie de la série d'hôtels de style Château qui
ont été construits par les compagnies de chemin de fer canadiennes au
début du XXe siècle pour encourager les touristes à emprunter leurs
routes transcontinentales. Recherchés par les voyageurs à cause de leur
décor élaboré et de leur élégance confortable, ces hôtels sont vite
devenus un symbole national de la qualité hôtelière.
Le style Château, qui a inspiré la conception des hôtels des compagnies
de chemin de fer, en est venu à constituer un type d'architecture
proprement canadien. Construit par Fuller Construction pour le Grand
Trunk Pacific Railway (GTPR), l'hôtel Fort Garry allie la ligne de toit
de style Château à la forme monolithique d'un édifice du XXe siècle. Les
architectes Ross et MacFarlane reprennent certains motifs des autres
hôtels des compagnies de chemin de fer, dont les murs en pierre à chaux
de l'Indiana, qui sont la signature du GTPR. Le cadre spectaculaire,
caractéristique des hôtels des compagnies de chemin de fer de style
Château, a été créé en construisant une structure de treize étages qui
domine le paysage plat des prairies et en plaçant les salles de
réception principales au 7e étage pour offrir une vue magnifique sur la
ville.
|

©St. Boniface City Hall, Lil Zebra, 2005 |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Saint-Boniface
Winnipeg, Manitoba
Situé à une intersection importante de St. Boniface, la mission
francophone devenue un quartier de Winnipeg métropolitain, l'Hôtel de
ville de St. Boniface est un édifice de trois étages en brique rouge, de
style classique, avec une tour centrale recouverte d'un dôme. Il a été
construit au début du XXe siècle.
Construit par la compagnie William Grace de Winnipeg en 1905, ce nouvel
hôtel de ville a été soigneusement conçu pour le distinguer de ceux des
municipalités avoisinantes, pour attirer des gens et des investissements
dans la localité. Ses dimensions imposantes et son style néo-classique
formel étaient faits pour symboliser le caractère dominant, stable et
optimiste de cette petite localité. Cédant à la pression du public après
la construction, l'architecte a remplacé la tour originale par la tour
actuelle, construite en 1911. Lors de la restauration de 1988, on a
ajouté une annexe arrière, et installé des horloges dans la tour. Après
la fusion de St. Boniface avec Winnipeg en 1972, on a transformé l'hôtel
de ville pour qu'il accueille l'administration municipale
centralisée.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de La Fourche
Winnipeg, Manitoba
Lieu de rencontre historique au confluent des rivières Rouge et
Assiniboine .
La Fourche revêt une importance historique nationale en raison de son
emplacement stratégique au confluent des rivières Rouge et Assiniboine,
jadis maillons d'un vaste réseau continental de voies fluviales.
L'importance du lieu découle du fait qu'il a toujours servi, au fil du
temps, pour le transport, le commerce et la colonisation. Lieu d'escale
traditionnel des autochtones, La Fourche s'est avérée ensuite un lieu de
choix pour la construction du fort Rouge, du fort Gibraltar et les deux
forts Garry.
Àl'opposé de la plupart des autres lieux historiques nationaux, on ne
commémore pas à La Fourche une période spécifique de l'histoire. Son
importance tient plutôt à son rôle de témoin des nombreux événements qui
ont faconné l'Ouest canadien tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Les premiers occupants ont campé ici, au confluent de deux grandes
rivières, et leur présence en a attiré d'autres au fil des siècles.
Aujourd'hui, La Fourche est le « lieu de rencontre » de Winnipeg. C'est
en effet là que les festivals, les manisfestations spéciales et le
paysage paisible attirent des milliers de personnes, au coeur historique
de la ville.
Le lieu historique national du Canada de La Fourche est une zone
accessible au public au cœur de la ville de Winnipeg, au Manitoba. La
Fourche se compose de secteurs connus sous les noms de Pointe sud et
Pointe nord, situés sur les rives opposées de la rivière Assiniboine,
sur la rive ouest de la rivière Rouge. Sur le plan historique, ce
confluent a été un lieu de transport important pour de nombreuses
générations. Aujourd'hui, La Fourche est un lieu de rassemblement à
diverses vocations, qui comprend des espaces verts, des zones de
loisirs, des opérations commerciales et un stationnement, suite au
réaménagement des anciennes gares de triage du Canadien National.
La Fourche a été désignée lieu historique national du Canada en 1974
parce qu'elle est située stratégiquement au confluent des rivières Rouge
et Assiniboine, si bien qu'elle a été témoin de nombreux événements clés
de l'histoire de l'Ouest canadien. La valeur patrimoniale de La Fourche
est liée au millénaire d'activité humaine dont son paysage culturel a
été le témoin. Elle a également trait à sa situation géographique, aux
signes de l'activité passée et de sa commémoration, ainsi qu'à son
impact stratégique sur l'environnement avoisinant.
Des peuples se sont servis de La Fourche comme lieu de rassemblement,
camp de pêche, lieu de commerce et colonie, pendant au moins six mille
ans. Sur le plan historique, les rivières Rouge et Assiniboine ont été
toutes les deux d'importants couloirs de transport dans l'Ouest
canadien. Au fil du temps, les rivières ont formé des méandres et leurs
cours ont changé. Le site commémoré sous le nom de «La Fourche» a eu de
nombreuses fonctions pendant deux périodes historiques : il y a 7600 à
3000 ans (soit de 5600 à 1000 avant J.C.), et d'il y a 1500 ans à
aujourd'hui (soit de 500 à 2000 après J.C.). À titre de zone
traditionnelle de transition entre les prairies et les terrains boisés,
elle servait de lieu de rassemblement et de commerce à un large éventail
de groupes culturels des Premières nations, et notamment aux peuples
Algonquiens du centre et du sud du Manitoba, du nord-ouest de l'Ontario
et du Minnesota, et peut-être de parties du Dakota du Nord.
Au XVIIIe siècle, elle servait de camp saisonnier provisoire aux peuples
Assiniboine, Ojibwa (Saulteaux), Cri et Dakota (Sioux). En outre, le
premier établissement européen dans l'Ouest du Canada (le Fort Rouge de
La Vérendrye, de 1736 aux années 1740) était également situé à
proximité. Aux XIXe et XXe siècles, La Fourche servait de point de
relais pour la colonisation et l'expansion vers l'Ouest. Elle était le
site du Fort Gibraltar I (1810-1816) et du Fort Gibraltar II (1817-1821)
pour la traite des fourrures, du Fort Garry I (1817-1852), d'une réserve
de la Compagnie de la Baie d'Hudson (1836-1907) et de gares de triage
d'un important chemin de fer (1888-1988). Des fouilles archéologiques
spécifiques effectuées à La Fourche en 1984, 1987 et 1988 ont permis de
récupérer 190 800 objets (mobiles et in situ) représentant notamment les
périodes préeuropéennes, du commerce de la fourrure et du chemin de
fer.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2014

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |
Lieu historique national du Canada de Lower Fort Garry
Selkirk, Manitoba
Important centre du commerce des fourrures au XIXe siècle, Compagnie de
la Baie d'Hudson.
Le lieu historique national du Canada de Lower Fort Garry est un ancien
poste de traite des fourrures. Situé près de Winnipeg, au Manitoba, à 30
km en aval du confluent des rivières Assiniboine et Rouge, il a été le
plus important poste de l'Ouest du Canada. Ce site de 85 acres contient
un fort de la Compagnie de la Baie d'Hudson d'une superficie de quatre
acres comprenant plusieurs bâtiments dans une enceinte murée, plusieurs
édifices restaurés ou reconstruits à proximité de l’enceinte, et une
partie des sites de campement occupés par les deux mille Ojibway et
Swampy Cree qui ont participé à la signature du traité n°1.
La Compagnie de la Baie d'Hudson a construit le Lower Fort Garry en
1830, et l'a exploité à titre de poste de traite jusqu'en 1911. La
construction du fort (de 1830 aux années 1850) a eu lieu principalement
sous la direction du gouverneur George Simpson. En 1870, après
l'acquisition des terres de la Compagnie de la Baie d'Hudson dans
l'Ouest par le gouvernement du Canada, divers représentants du
gouvernement, occupant différentes fonctions, ainsi que des
représentants du commerce de la fourrure ont occupé les installations du
fort. Le fort a donc été le témoin et le symbole d'événements qui ont
marqué l’histoire de l’Ouest du Canada à ses débuts. De 1913 à 1962, le
Motor Country Club a loué le fort. Puis, en 1951, la Compagnie de la
Baie d'Hudson a fait don du complexe et des terres avoisinantes à Parcs
Canada, qui de 1965 à 1982 a rénové bon nombre des structures y
attenant, afin d’adapter leur style à celui qui prévalait au cours de la
période 1850-1860 et d’y donner accès au public.
Le lieu historique national du Canada de Lower Fort Garry a une valeur
patrimoniale parce qu'il a été le siège des négociations et de la
signature du traité n°1, et témoin de plus d'un siècle d'activités
administratives et d'approvisionnement de la Compagnie de la Baie
d'Hudson. L’articulation, la conception, les matériaux, la technologie
de construction, et la disposition fonctionnelle et spatiale des
bâtiments du fort attestent leur importance particulière.
|

©Corporation Maison Gabrielle-Roy, 2007 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Gabrielle-Roy
Winnipeg, Manitoba
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Gabrielle-Roy est
situé sur un terrain étroit au sein d’un paisible quartier résidentiel
de Saint-Boniface, au Manitoba. Il s’agit d’une belle grande demeure en
bois en forme de « L », de type vernaculaire qui compte deux étages et
demi. Cette maison, restaurée pour reprendre son apparence des années
1918, a été le lieu de naissance de Gabrielle Roy, écrivaine canadienne,
qui l’a habité jusqu’en 1937.
La valeur historique de cette maison repose sur son association avec
Gabrielle Roy, l'une des grandes auteurs canadiennes du XXe siècle et
désignée personne d’importance nationale. Cette maison a été le lieu de
naissance, mais aussi le lieu associé à l’enfance, à la jeunesse et aux
années de formation de Gabrielle Roy. La maison fut également un lieu
d’inspiration pour cette auteure qui toute sa vie y est demeurée
profondément attachée, notamment au grenier si étroitement associé à une
époque de sa vie et aux débuts de son intérêt pour l’écriture. Tel qu’en
témoignent les références et les allusions présentes dans plusieurs de
ses récits, notamment Rue Deschambault et La Détresse et l’Enchantement,
non seulement la maison elle-même est une source d’inspiration, mais les
événements qui y sont associés et les environs le sont aussi. Ils lui
ont offert un microcosme qui l’a inspiré, qu’elle a idéalisé, et d’où
elle a puisé des thèmes à valeur universelle. Son attachement à cette
maison s’exprime dans plusieurs de ses écrits, mais aussi dans sa vie
personnelle par sa recherche de lieux similaires pour y vivre. Restaurée
entre 2001 et 2003, cette maison contribue à perpétuer la mémoire et
l’oeuvre de cette auteure canadienne.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Danielle Hamelin, 2008 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Ralph-Connor
Winnipeg, Manitoba
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Ralph-Connor est
situé au centre-ville de Winnipeg, au Manitoba, dans le quartier
résidentiel d’Armstrong’s Point. Il comprend une spacieuse maison de
trois étages en brique et en pierre, construite entre 1913 et 1914 pour
le révérend Charles Gordon, pasteur presbytérien bien connu qui, sous le
pseudonyme de Ralph Connor, a aussi écrit des romans à succès. Gordon a
vécu dans cette maison jusqu’à sa mort, en 1937. Par la suite, la
résidence est devenue la propriété du University Women’s Club de
Winnipeg. Le lieu comprend la maison principale, la remise, ainsi que le
l'espace paysager aux alentours.
La valeur patrimoniale de la maison Ralph Connor est directement liée à
la personnalité très publique de son propriétaire, le révérend Charles
Gordon, qui a écrit, sous le pseudonyme de Ralph Connor, de nombreux
romans à succès. Construite entre 1913 et 1914, la maison du 54 West
Gate est étroitement associée à la vie et à l’héritage du célèbre
pasteur et auteur, alors à l’apogée de sa carrière. Gordon a choisi
Armstrong's Point, quartier central exclusif réservé à l’élite sociale
et financière de Winnipeg, pour y construire sa résidence familiale.
Avec sa façade asymétrique, sa ligne de toiture irrégulière, ses
fenêtres en saillie et ses murs extérieurs en brique rouge foncé ornés
de pierre de Tyndall, la spacieuse maison de trois étages constitue un
bel exemple des résidences dans le quartier.
Bien que la maison du 54 West Gate ne fasse pas l’objet des récits de
Gordon, celui-ci y écrit 13 de ses 22 romans. Comme il est l’un des
écrivains les plus réputés du Canada, il joue un rôle proéminent au sein
de la Canadian Authors Association, fondée en 1921. À l’échelle
nationale, Gordon fait partie du premier conseil de l’association et
exerce les fonctions de président pendant deux mandats, au milieu des
années 1930. Il est aussi un membre actif de la section de Winnipeg qui,
pendant des années, tiendra ses réunions au 54 West Gate.
La maison, qui abrite aussi le presbytère pendant 25 ans, représente le
visage public du révérend Gordon, éminent ecclésiastique presbytérien et
militant social. L’aménagement du bâtiment témoigne d’ailleurs de ce
double rôle. L’entrée principale, qui sert à recevoir les paroissiens,
mène à un bureau et au cabinet de travail de Gordon. La porte cochère et
la terrasse de la façade sud servent d’entrée pour la famille et
conduisent aux pièces privées de la maison. La maison est conçue pour
accommoder les activités paroissiales et sociales de Gordon. C’est
d’ailleurs dans son cabinet de travail qu’il compose ses sermons et
qu’il s’occupe des affaires de la paroisse. L’entrée avant de la maison
mène à un vestibule où les paroissiens sont accueillis, et le corridor
au bureau du secrétaire puis au bureau de Gordon, meublé d’une grande
table de travail, de chaises confortables et d’étagères contenant des
dictionnaires et des ouvrages de référence. Cette partie du
rez-de-chaussée a été conçue pour préserver l’intimité de la
famille.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Riel
Winnipeg, Manitoba
Maison familiale du chef métis Louis Riel.
Comme son nom l'indique, ce lieu historique national du Canada est
étroitement lié à l'histoire de Louis Riel, chef des Métis et un des
fondateurs du Manitoba. Situé sur le lot 51 le long de la rivière Rouge,
le lieu historique national de la Maison-Riel a longtemps été habité par
la famille Riel; des descendants de la famille y sont restés jusqu'en
1969. Ici, dans le salon de la maison de sa mère, la dépouille de Louis
Riel a été exposée pendant deux jours en décembre 1885. La maison à
colombage pierroté, style de l'époque, a été restaurée à son apparence
au printemps 1886.
La maison Riel est une petite maison d'un étage et demi en billes
équarries, située sur un lot riverain, sur la rive est de la rivière
Rouge. Elle est située au 330 River Road, dans un arrondissement
résidentiel de St. Vital. Le développement urbain environnant a modifié
son caractère rural d'origine. La propriété est associée à la famille de
Louis Riel.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la
Maison-Riel a trait à son association avec Louis Riel et à son
illustration du type d'établissement de lot riverain métis. Le lot
riverain est particulièrement important parce qu'il est le symbole de
l'empreinte de la culture métis sur ces terres. Bâtie en 1880-1881 sur
l'emplacement d'une maison plus ancienne achetée en 1864 par la mère de
Louis Riel, la maison Riel a été occupée par la famille depuis cette
époque jusqu'en 1968. Louis Riel a fait une brève visite à la maison en
1883, et son corps y a reposé après son exécution en 1885. Depuis
qu'elle a été déclarée lieu historique national en 1968, la maison Riel
a été acquise par Parcs Canada qui l'a restaurée et meublée de façon à
ce qu'elle représente la situation qui régnait au printemps de 1886,
alors que la famille observait son deuil officiel après l'exécution de
Louis Riel.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1996 |
Lieu historique national du Canada des Monticules-Linéaires
Melita, Manitoba
Tumulus autochtones qui datent de 1000 à 1200 ans après J.-C.
Situé près de la rivière Souris dans le sud du Manitoba, le lieu
d’inhumation des Monticules Linéaires est une construction sophistiquée
composée de trois monticules de forme allongée se déployant sur une
vaste étendue terrestre. Le premier monticule, long d’environ 258 mètres
et s’étendant du nord au sud, est bordé à chaque extrémité de monticules
de forme arrondie. Le second est également de forme allongée ou
linéaire, il s’étend d’est en ouest sur 194 mètres et possède également
deux buttes rondes aux extrémités. Le troisième est de forme conique et
offre un diamètre de 22 mètres, et se trouve juste à l’ouest de
l’extrémité sud du monticule linéaire orienté nord-sud.
Ces tertres funéraires, remontant à une période de 900 à 1400 après
J.-C., sont des constructions complexes faites de terre, d’os et
d’autres matériaux. L’excellent état de conservation de ces tertres
funéraires a livré une solide récolte d’informations au sujet de la vie
dans les Prairies, révélant par la nature des biens découverts que les
gens de cette époque faisaient partie d’un réseau d’échange commercial
continental. Les tertres ont maintenant été attribués au complexe
d’inhumation de Sourisford à Devil’s Lake, un ensemble de lieux
d’inhumation comportant des buttes linéaires autant que coniques et
s’étendant du sud de la Saskatchewan et du Manitoba jusqu’au Montana et
aux Dakotas du sud et du nord, où des artefacts semblables ont été
retrouvés dans des monticules funéraires. Cet ensemble remonte à une
période allant de 900 à 1400 A.D., soit, durant le sylvicole
supérieur.
|

©Library and Archives Canada / Bibliothèque et Archives Canada, C-000652 |
Lieu historique national du Canada Norway House
Norway House, Manitoba
Le lieu historique national du Canada Norway House constitue des
vestiges d’un ancien fort de la Compagnie de la Baie d’Hudson au
Manitoba. Les trois bâtiments en bois, l’entrepôt à arcade, la prison et
la poudrière, sont érigés dans un paysage désolé, sur les rives du
fleuve Nelson, à l’extrémité nord du lac Winnipeg.
La valeur patrimoniale de Norway House tient principalement à ses
associations historiques avec le dépôt central intérieur de la Compagnie
de la Baie d’Hudson pour la traite des fourrures. Il est aussi le lieu
de signature en 1875 du Traité no. 5 entre la Première nation des
Saulteux (Ojibway) et la Première nation crie des Moskégons, ainsi que
la Couronne. Il est aussi le lieu de création de l’écriture syllabique
crie par le révérend James Evans. Norway House a été établi à cet
endroit en 1825-1826. Les vestiges de ces associations qui survivent
sont notamment l’entrepôt à arcade (1839-1841), la prison (1855-1856),
et la poudrière (1837-1838).
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2001 |
Lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-de-Neepawa / Palais-de-Justice-du-Comté-de-Beautiful Plains
Neepawa, Manitoba
Le lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-de-Neepawa /
Palais-de-Justice-du-Comté-de-Beautiful Plains est un imposant édifice
en brique jaune clair de deux étages et demi, situé à un jet de pierre
du cœur commercial de la ville de Neepawa, dans un vaste site. Cette
structure, construite en 1884 alors que le quartier environnant
commençait à peine à se bâtir, a servi de bureaux municipaux et de
comté, de tribunal de circuit, de poste de police et de théâtre,
assurant ainsi à Neepawa le rôle de ville la plus importante du
district. L'édifice abrite maintenant les bureaux de la municipalité de
Rosedale.
Après avoir obtenu en 1882 que le chemin de fer qui desserve le village,
Neepawa a été désigné le siège du comté de Beautiful Plains, qui
comprenait quatre municipalités. Même si on a mis fin au système de
comtés après 1890 parce qu'il n'était pas assez souple, le nouvel
édifice provincial a continué a en porter le nom, et ce bien, malgré que
la ville soit trouvé entre deux municipalités rurales, récemment crées,
Langford et Rosedale. En 1884, le gouvernement du Manitoba a accepté de
partager les coûts de construction de ce nouveau bâtiment municipal à
condition qu'on y ménage un tribunal des juges de circuit, la ville
devenant ainsi à la fois le centre civique et judiciaire du district.
Les édiles municipaux n'ont pas perdu de temps et ont immédiatement
engagé un architecte puis commencé la construction. Terminé en 1884, le
nouveau palais de justice, servant aussi de bureaux municipaux, est
demeuré la seule structure en brique de la ville au cours des cinq
années qui ont suivi, servant à la fois les fonctions de tribunal de
comté, de prison, d’hôtel de ville et de théâtre.
La conception a été confiée à l’un des architectes les plus renommés de
la jeune province, C. Osborn Wickenden, formé en Grande-Bretagne, qui a
bâti plusieurs édifices publics importants au Manitoba, et plus tard en
Colombie-Britannique. Une entreprise de construction de Portage la
Prairie a exécuté avec habileté le travail décoratif en brique du palais
de justice. En outre, les briques, d'excellente qualité, ont également
été fabriquées à Portage la Prairie, ce qui atteste les talents
sophistiqués des artisans des Prairies. En 1982, dans le cadre des fêtes
du centième anniversaire de la ville, un fort mouvement de soutien pour
la préservation du palais de justice de Neepawa / palais de justice du
comté de Beautiful Plains et bureaux municipaux, a démontré l'importance
que ce point d'intérêt avait conservé au sein du district.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1995 |
Lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-de-Winnipeg
Winnipeg, Manitoba
Le lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-de-Winnipeg
est situé en face du parlement provincial au sein de l'enceinte
parlementaire provinciale au centre ville de Winnipeg (Manitoba). Ce
palais de justice est un édifice de trois étages, de style Beaux-Arts,
en pierre calcaire grise sculptée. Sa taille monumentale et son
emplacement central reflètent son rôle important et constituent un
symbole du système judiciaire du Manitoba.
La valeur patrimoniale de ce lieu réside dans sa conception
d'inspiration classique et dans son illustration physique de sa vocation
judiciaire. Ce palais de justice a été bâti pendant une longue période
de grand optimisme pour la province. L'architecte provincial Victor W.
Horwood a conçu ce palais de justice en complément du nouvel édifice du
parlement, un bâtiment monumental de style néo-classique qu'on
construisait de l'autre côté de la rue. La construction de ce bâtiment à
ossature d'acier a commencé en 1912 et a duré quatre ans. Son ouverture
était prévue en même temps que celle du nouveau parlement.
La conception de style Beaux-Arts d’inspiration classique de l'édifice
lui confère une magnificence formelle reflétant la dignité des
tribunaux. Une coupole cornière ouvragée, coiffée d'un dôme de cuivre
surélevé, relie les pavillons à fronton du côté sud aux façades côté
est. De plus, cette coupole attire l'attention sur la «grande entrée» à
colonnes de la rue Kennedy. Une corniche dentelée et un parapet profond,
tous les deux en pierre calcaire gris crème, longent les façades. Les
principaux espaces intérieurs sont ornés de planchers en marbre gris et
d'un parement mural en marbre gris de Missisquoi veiné de subtils tons
de vert, de 2.7 mètres (9 pieds) de haut. Les plafonds, segmentés par
des panneaux coffrés carrés, présentent un contraste de feuilles d'or et
de vert pâle. Les salles d'audience des deux côtés sont parées de
panneaux de chêne.
La conception fonctionnelle du bâtiment est également reliée à son rôle
important. Chaque aile est traversée de corridors à double charge, et
une cour intérieure en forme de U éclaire l'intérieur de lumière
naturelle. Ce palais de justice, avec ses 70 mètres de long sur 60
mètres de large et ses trois étages complets, offre assez d'espace pour
les nombreux bureaux, salles d'audience et cabinets de juges, ainsi
qu'une grande bibliothèque. Les salles d'audience des cours inférieures
sont éclairées par de grandes fenêtres, tandis qu'on accédait aux cours
supérieures par des passages intérieurs permettant d'amener directement
les prisonniers depuis les zones de détention situées en dessous, et
procurant aux juges des entrées privées.
|

©Manitoba Archives, 1960 |
Lieu historique national du Canada du Pensionnat-de-Miss Davis / Twin Oaks
Miami, Manitoba
Lieu historique national du Canada du Pensionnat-de-Miss Davis / Twin
Oaks est situé sur un des lots riverains originaux longeant le chemin
River, à environ 10 kilomètres au nord de la ville de Winnipeg.
Construite entre 1851 et 1866, cette ancienne école est un grand
bâtiment en pierre calcaire de deux étages, située sur un grand
lotissement boisé colonisé dans le cadre du plus ancien établissement en
aval de la rivière Rouge. L’endroit a conservé son caractère
essentiellement rural, malgré les quelques développements résidentiels
avoisinants.
Le Pensionnat de Miss Davis / Twin Oaks a été construit par Duncan
MacRae, un maçon écossais qui a supervisé la plus grande partie de la
construction en pierre de la rivière Rouge. Même si les maisons de
plusieurs familles locales ont été construites dans ce style élaboré par
la Compagnie de la Baie d'Hudson pour des forts et des postes partout en
Amérique du Nord, seul un petit nombre d'entre elles ont survécu dans le
couloir de la rivière Rouge.
L'ouverture de l'école s'est réalisée en réponse aux pétitions de
familles locales et d'agents de la Compagnie de la Baie d'Husdon de
partout au Canada demandant une éducation pour leurs filles. La Société
des missions de l'Église anglicane a persuadé mademoiselle Matilda
Davis, fille d'un employé de la Compagnie de la Baie d'Hudson et éduquée
en Angleterre, d'ouvrir cette école conjointement à la mission de
l'église anglicane de St. Andrews. Même si certaines des élèves étaient
externes, la plupart étaient pensionnaires dans cette grande maison, où
elles suivaient des cours de français, de musique, de dessin, de danse,
de couture et de comportement convenant aux jeunes filles britanniques.
Deux cabanes en rondins de la propriété servaient aussi de salles de
classe, et on pense qu'une d'entre elles a survécu, et que, très
modifiée, elle sert maintenant de garage avec un bureau à l'étage.
L'école, connu sous le nom d'Oakfield, un établissement se chargeant de
l'éducation des jeunes filles, a fermé ses portes peu après le décès de
Miss Davis en 1873. L'école est devenue une résidence privée, peu
modifiée jusqu'à ce que ses nouveaux propriétaires se voient dans
l'obligation de la restaurer en 1935. On a rebaptisé la maison Twin
Oaks, réparé ses murs de pierre, ajouté un sous-sol, changé le vitrage
des fenêtres du rez-de-chaussée et l'imposte de la porte d'entrée, et
modifié son intérieur. Twin Oaks a subi une deuxième rénovation
importante à la fin des années 1990, et elle est encore une résidence
privée. L'intégrité de sa conception extérieure en pierre calcaire est
largement préservée, tout comme la masse, la forme et la conception
originales de son ancienne fonction en tant qu'école.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada 2004 |
Lieu historique national du Canada du Pont-Barrage-à-Rideaux-Caméré-St. Andrews
Lockport, Manitoba
Le pont-barrage à rideaux Caméré St. Andrews est un pont-barrage de 270
mètres qui enjambe la rivière Rouge à Lockport, au Manitoba. Le pont
soutient un barrage mobile composé d'une série de rideaux Caméré qui
maintiennent la rivière à un niveau navigable en été, et qui sont
repliés et enlevés à l'automne pour permettre aux eaux de la crue du
printemps de passer sans encombre sous le pont. Une écluse de
navigation, construite sur la rive ouest jouxtant le pont-barrage,
permet aux bateaux de traverser le barrage. Le pont-barrage est encore
en service aujourd'hui sur la route 44.
Le pont-barrage à rideaux Caméré St. Andrews a été désigné lieu
historique national du Canada parce que cet ouvrage d'ingénierie est
probablement le seul exemple préservé de barrage mobile de ce genre au
monde.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à la conception et aux
matériaux de la structure elle-même. Ce pont-barrage, construit de 1907
à 1910 par le ministère fédéral des Travaux publics, est le plus grand
de ce genre à avoir jamais été construit. En 1912-1913, on y a ajouté
des travées d'approche, ainsi qu'une route en travers du pont-barrage
St. Andrews. De 1947 à 1949, on a modifié ses approches et augmenté sa
capacité de chargement. En 1967, les châssis initiaux des grues de
rideaux ont été remplacés par de nouveaux. À cette époque, le transport
ferroviaire et routier avait remplacé en grande partie le transport
maritime, ce qui avait réduit de beaucoup l'exploitation commerciale de
la rivière et du réseau de canaux.
|
|
Lieu historique national du Canada des Postes-de-Traite-Souris-et-Assiniboine
Wawanesa, Manitoba
Au confluant des rivières Souris et Assiniboine, il exista un important
poste d'approvisionnement du commerce des fourrures. De 1793 à 1824, les
compagnie XY, de la Baie d'Hudson et du Nord-Ouest établirent des postes
de traite de pelleteries, de mais et de pemmican parmi les Indiens des
plains entre le lac Manitoba et la rivière Missouri. La piste Yellow
Quill, qui traversait la région servait au commerce entre les tribus et
la traite des fourrures. Les noms de maints trafiquants et explorateurs
célèbres comme John Macdonnell, Cuthbert Grant, Peter Fidler, David
Thompson, Alexander Henry et Daniel Harmon, restent associés à
l'histoire de ces postes.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Premier-homestead-de-l'Ouest-Canadien
Portage la Prairie, Manitoba
Le lieu historique national du Canada du
Premier-Homestead-de-l’Ouest-Canadien est situé sur une parcelle de
terrain plat au nord de Portage La Prairie près d’Oakland, au Manitoba.
Le lieu comprend le premier homestead de l’Ouest du Canada, établi en
vertu du nouveau système d’arpentage des terres adopté par le
gouvernement fédéral en 1871. Il ne subsiste aucun vestige apparent du
homestead d’origine, qui a d’abord appartenu à John Sutherland
Sanderson. En 1976, la Commission des lieux et monuments historiques du
Canada a érigé une plaque sur un cairn de pierre de Tyndall grise afin
de commémorer le lieu. La reconnaissance officielle vise la parcelle de
terrain située dans le quadrant nord-est de la section 35, canton 12,
rang 7, près de Portage La Prairie, au Manitoba.
La valeur patrimoniale du premier homestead de l’Ouest canadien repose
sur ses liens historiques avec la réglementation sur les homesteads de
l’Ouest du Canada mise en place par le gouvernement fédéral. En 1871, à
la suite de l’adoption du nouveau système d’arpentage, le gouvernement
du Canada instaura sa politique sur les homesteads en vertu de l’Acte
des terres fédérales de 1872. Cette politique favorisa l’établissement
d’immigrants du monde entier sur les terres de l’Ouest canadien. John
Sutherland Sanderson, un Écossais de la région du Lothians, fut la
première personne officiellement inscrite comme propriétaire à l’un de
ces lots; sa demande, qui porta le numéro « 1 », fut déposée le 2
juillet 1872.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Butterill, 1995 |
Lieu historique national du Canada du Presbytère-St. Andrew's
St. Andrews, Manitoba
Exemple de l'architecture pratiquée à la rivière Rouge au milieu du XIXe
siècle (1852-1854).
Le presbytère St. Andrew's est un excellent exemple de l'architecture
pièce sur pièce à tenon en coulisse propre à la région de la rivière
Rouge au milieu du XIXe siècle. Les expositions en plein air
interprètent l'architecture de la région de la rivière Rouge ainsi que
les rôles de la Church Missionary Society et de l'Église anglicane dans
la colonisation de la région de la rivière Rouge et de l'Ouest du
Canada.
Le lieu historique national du Canada du Presbytère-St. Andrew's est une
grande maison de campagne en pierre de deux étages, construite à
l'origine pour le pasteur anglican de la paroisse. Construit
initialement de 1851 à 1854, il a été reconstruit par Parcs Canada dans
les années 1980. Le presbytère est situé bien en vue en haut d'une
colline, à proximité du lieu historique national du Canada de
l'Église-Anglicane-St. Andrew's, et on y jouit d'une superbe vue sur la
rivière Rouge. Parcs Canada a restauré les terrains du presbytère dans
le style paysager de l'époque entre 1860 et 1870.
Le presbytère illustre le style d'architecture de la baie d'Hudson, qui
adaptait les méthodes de construction écossaises aux régions
canadiennes. La conception hardie du presbytère, ses lignes simples et
nettes, et sa construction en pierre à chaux sont typiques de ce style.
La véranda en bois est une variante canadienne française qu'on trouve
dans la région de la rivière Rouge. Le presbytère a été construit à
l'origine par la Church Missionary Society dans le cadre d'un complexe
de bâtiments de la mission anglicane, construits de 1830 à 1855. Sa
taille imposante et sa conception sobre donnent l'image respectable qui
convient à une mission anglicane. Le bâtiment a été démantelé au début
des années 1980, puis reconstruit selon les caractéristiques et le style
du bâtiment d'origine.
|
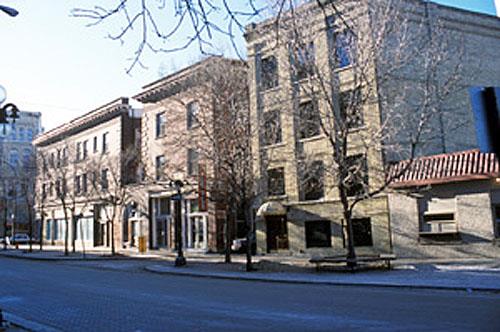
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, K. Dahlin, 2003 |
Lieu historique national du Canada du Quartier-de-la-Bourse
Winnipeg, Manitoba
Le lieu historique national du Canada du Quartier-de-la-Bourse est situé
au centre-ville der Winnipeg, au Manitoba. Le lieu comprend un centre
d=affaires et d=entreposage à construction dense qui date du tournant du
siècle et comprend environ 150 immeubles englobant 20 pâtés de maisons.
Il fut construit en grande partie de 1880 à 1913 et reflète des méthodes
de construction et des styles architecturaux modernes. Le caractère
intact de son plan quadrillé à construction dense, avec ses nombreuses
structures de maçonnerie compactes à hauteur limitée, l=aménagement
intensif des terrains urbains et l=utilisation des styles architecturaux
assez élaborés du tournant du siècle, donnent à ce quartier une identité
distincte au sein de la ville. La reconnaissance officielle vise les
bâtiments et le paysage contributifs situés dans les limites du
quartier.
La valeur patrimoniale du quartier, qui a été reconnue pour les raisons
décrites ci-dessus, réside dans le fait que le quartier illustre un
centre d’affaires et d’entreposage du tournant du siècle qui est
densément construit et reflète les méthodes de construction et les
styles architecturaux de l’époque.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |
Lieu historique national du Canada de la Résidence-d'Infirmières-de-l'Hôpital-de-St. Boniface
Winnipeg, Manitoba
Le lieu historique national du Canada de la
Résidence-d’infirmières-de-l’hôpital-de-Saint Boniface est situé dans le
quartier Saint-Boniface à Winnipeg. Completé en 1928, l’édifice sert
d’établissement d’enseignement et de résidence pour les infirmières
professionnelles en formation jusqu’à la fermeture de l’école en 1997.
Ce bâtiment en brique de cinq étages se distingue par sa conception
utilitaire, comme on peut l’observer dans sa volumétrie rectangulaire
symétrique, la disposition régulière de ses fenêtres et son toit plat.
La Résidence d’infirmières de l’hôpital de Saint-Boniface représente la
reconnaissance et l’évolution des sciences infirmières en tant que
profession. L’école des sciences infirmières est fondée par les Sœurs
Grises à Winnipeg en 1897. La résidence d’infirmières est construite
entre 1927 et 1928 pour les besoins de l’école et comprend des chambres,
des espaces récréatifs et des salles de classe. Dans les laboratoires,
bibliothèques et salles de classe modernes de l’école, les jeunes
étudiantes en sciences infirmières reçoivent une formation scientifique
et moderne qui est essentielle à leurs carrières professionnelles. À
l’époque, les infirmières sont souvent logées dans les hôpitaux, parfois
dans des conditions insalubres. Elles sont ainsi exposées à des maladies
infectieuses, et leur horaire de travail est souvent chargé. Les
résidences construites spécifiquement pour les infirmières, comme celle
de l’hôpital de Saint-Boniface, témoignent de la reconnaissance
croissante qu’on manifeste envers la profession et de l’autonomie qu’on
accorde aux femmes dans le domaine public. Séparée de l’hôpital et de
ses besoins, la résidence donne aux étudiantes l’occasion de se
perfectionner en tant que professionnelles et de créer une communauté
interne de femmes qui ont un travail et des intérêts sociaux en commun.
L’école des sciences infirmières de l’hôpital de Saint Boniface, l’une
des résidences d’infirmières les mieux préservées au Canada, a fermé ses
portes en 1997. Le bâtiment sert actuellement de résidence à l’hôpital
général Saint-Boniface, qui est associée à l’Université du
Manitoba.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Andrew Waldron, 2007 |
Lieu historique national du Canada du Royal Manitoba Theatre Centre
Winnipeg, Manitoba
Le lieu historique national du Canada du Royal Manitoba Theatre Centre
est situé au centre-ville de Winnipeg, au Manitoba, dans le lieu
historique national du Canada du Quartier-de-la-Bourse. Il s’agit d’un
édifice de style brutaliste, caractérisé par une structure en béton
armée apparent et une volumétrie imposante. Sa construction, en 1969 et
1970, dans le cadre d’un projet de renouveau urbain visant à créer un
complexe d’édifices publics modernes au centre-ville de Winnipeg,
découle de la nécessité de trouver un domicile pour la troupe du Royal
Manitoba Theatre Centre, fondée en 1958.
Le Royal Manitoba Theatre Centre, inauguré en novembre 1970, est le
dernier d’une longue liste de théâtres construits à Winnipeg. Le Royal
Manitoba Theatre Centre, qui s’inscrit dans le courant de renouveau des
installations artistiques de la ville qui prévalait dans les années
1960, accueille la première troupe de théâtre régionale professionnelle
du Canada. À une époque où d’imposants théâtres et salles de concert
modernes sont érigés partout au pays, le Royal Manitoba Theatre Centre
est conçu de façon à créer une ambiance intimiste favorisant une
relation étroite entre le public et les acteurs. De plus, la troupe du
Manitoba Theatre Centre est la première troupe de théâtre régionale
importante du pays à proposer un programme éducatif et des spectacles
itinérants dans les régions rurales du Manitoba. Le Conseil des Arts,
nouvellement fondé, finance la troupe et la cite en exemple à tous ceux
qui veulent savoir comment former une troupe de théâtre régionale
viable.
L’édifice du Royal Manitoba Theatre Centre est aussi un excellent
exemple d’architecture brutaliste utilisée à petite échelle au Canada.
Les formes sculpturales en béton armé apparent, le coffrage dépouillé et
la volumétrie solide de l’édifice sont caractéristiques de ce style. Les
façades nord et est présentent de majestueuses fenêtres en angle à
double hauteur, conçues de façon à laisser pénétrer la lumière du jour
dans le foyer. De plus, le côté nord de l’édifice est agrémenté de
quatre saillies semi-circulaires situées au niveau du rez-de-chaussée.
Le sentiment général de simplicité et d’asymétrie qui se dégage de
l’édifice est typique du brutalisme.
L’espace intérieur du Royal Manitoba Theatre Centre est tout aussi
important. À une époque où la conception moderne de l’architecture
brutaliste est bien accueillie par le public, le Royal Manitoba Theatre
Centre introduit un nouveau concept d’architecture brutaliste intimiste.
Plutôt que de concevoir une salle de spectacle conventionnelle, les
architectes et le directeur du théâtre collaborent pour créer un espace
où il n’y a pas de barrière entre les acteurs et le public. La
disposition asymétrique des fauteuils, la scène mobile composée de
l’avant scène et de l’« avant scène prolongée », ainsi que le foyer du
théâtre illustrent bien ce concept. Par une fenêtre, les spectateurs
peuvent voir la préparation des décors et l’arrière scène; ils ont ainsi
un aperçu de la vie en coulisse, ce qui les rapproche davantage des
acteurs.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2007 |
Lieu historique national du Canada du Temple-du-Travail-Ukrainien
Winnipeg, Manitoba
Le lieu historique national du Canada du Temple-du-Travail-Ukrainien est
situé dans le secteur nord de Winnipeg, au Manitoba, dans un quartier
essentiellement résidentiel composé de logements modestes. L’extérieur
de cet édifice sophistiqué du début du XXe siècle ressemble à un temple
avec ses détails néoclassiques sobres, notamment sa corniche imposante,
son bandeau en calcaire, ses plinthes, ses pilastres et ses énormes clés
de voûte. Son plan rectangulaire et son toit plat sont interrompus par
les cintres de l’auditorium principal qui s’élèvent de la partie arrière
de l’édifice.
Le Temple du travail ukrainien est construit par des ouvriers bénévoles
en 1918 pour le compte de l’Ukrainian Labour Temple Association,
nouvellement fondée, en tant que complément social, culturel et éducatif
du mouvement socialiste ukrainien au Canada. Officiellement,
l’association n’a de liens avec aucun parti politique, mais elle
entretient des relations non officielles avec le Parti Communiste du
Canada. Son temple héberge les presses de plusieurs journaux, brochures
et périodiques ukrainiens, et de nombreux ouvrages d’auteurs ukrainiens
bien connus y sont imprimés. De plus, presque immédiatement après sa
construction, le temple est plongé dans la grève générale de Winnipeg,
servant de lieu de rassemblement nocturne aux dirigeants de la grève,
qui y décrivent le déroulement de la grève aux membres de la communauté
ukrainienne. Mis à part les convictions politiques, le Temple du travail
offre aux Ukrainiens un milieu social familier où ils peuvent rencontrer
des amis et obtenir un soutien affectif dans leur langue
maternelle.
|

©Manitoba Archives, 1959 |
Lieu historique national du Canada Théâtre Metropolitan
Winnipeg, Manitoba
Le Théâtre Metropolitan à Winnipeg est un cinéma construit au début du
XXe siècle au cœur du centre-ville de Winnipeg.
Le Théâtre Metropolitan a été désigné lieu historique national en 1991
parce que : c’est un bel exemple du travail de l’éminent architecte de
théâtre américain C. Howard Crane; il représente l’impact culturel du
cinéma dans les années 1920; il atteste la concurrence entre les chaînes
de théâtres Allen et Famous Players pour la suprématie dans l’industrie
de la distribution des films au Canada.
Le Metropolitan est l’un des trois édifices conçus par Crane subsistant
au Canada, et qui symbolise le début de sa carrière internationale. Sa
façade extérieure est typique des théâtres Allen conçus par Crane. Son
intérieur, remodelé dans les années 1930, est l'oeuvre du décorateur
Emmanuel Briffa.
Au début du XXe siècle, la chaîne de cinémas Allen est la plus prospère
au Canada et l’une des plus grandes au monde. Parmi les quatre cinémas
construits par les frères Allen, Jay et Jules, et leur père Bernard
subsistant au Canada, le Metropolitan, autrefois connu sous le nom de
Allen Theatre, est la première grande salle de cinéma au pays. Il
témoigne de l’impact de la chaîne de cinémas Allen sur notre société et
de sa contribution à notre industrie cinématographique. La famille
Allen, grâce à la promotion des films et des sorties au cinéma, et à la
construction d’autres grandes salles de cinéma partout au pays, a
contribué à faire du cinéma un divertissement fiable, accessible et
abordable, ainsi qu’à la promotion du contenu canadien.
Situé à Winnipeg, sur la même rue qu’un cinéma Famous Players
aujourd’hui démoli, de dimensions et d’opulence comparables, sa
construction marquait le début de la concurrence pour la suprématie
entre les chaînes de cinémas Allen et Famous Players. Ainsi, au début
des années 1920, cette concurrence s’est intensifiée, grâce à la
réalisation de grandes campagnes publicitaires, à l’augmentation de la
fréquentation cinématographique, et à la construction d’autres cinémas
Allen et Famous Players ailleurs au pays. Ce n’est qu’en 1923, suite à
l’effondrement de l’empire Allen, que cette concurrence touchera à sa
fin. On assistera donc à l’acquisition d’un bon nombre de théâtres Allen
par Famous Players, notamment du Metropolitan.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada 1995. |
Lieu historique national du Canada du Théâtre-Pantages-Playhouse
Winnipeg, Manitoba
Le lieu historique national du Canada du Théâtre-Pantages-Playhouse est
un ancien théâtre de vaudeville construit au début du XXe siècle au
centre ville de Winnipeg, Manitoba. Sa façade de style baroque
édouardien, avec ses ornements d'inspiration classique et la marquise
s'étendant sur toute sa longueur, attestent le prestige que cet édifice
public avait à l'origine.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du
Théâtre-Pantages-Playhouse réside dans son integrité, et
particulièrement dans ses éléments caractéristiques des théâtres de
vaudeville de la période 1913-1930. Le théâtre Pantages Playhouse de
Winnipeg, conçu par les architectes George W. Northwood et B. Marcus
Priteca, a été construit en 1913-1914 pour la compagnie Pantages, une
importante chaîne américaine de vaudeville, qui y a présenté des pièces
de théâtre, des comédies musicales et des vaudevilles. Les théâtres de
ce type figurent parmi les plus grandioses jamais construits au Canada.
La ville de Winnipeg a acheté le Pantages Playhouse en 1923 et elle l'a
exploité sans interruption depuis.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Mattie, 1991. |
Lieu historique national du Canada du Théâtre-Walker
Winnipeg, Manitoba
Le théâtre Walker est un cube de maçonnerie de trois étages dans lequel
se trouve un théâtre datant du début du 20e siècle qui préserve de
nombreuses caractéristiques originales intactes. Le théâtre principal
donne sur la rue par une avancée de deux étages à la façade ornée
distinctive. Situé au carrefour de nombreuses rues animées, c'est un
site très en évidence.
La valeur patrimoniale de ce site réside dans son caractère d'auditorium
riche, sûr, facilement accessible et efficace du point de vue acoustique
et visuel pour sa clientèle, son excellent environnement de scène de
travail, dans les éléments du plan inspiré par l'Auditorium de Chicago,
et dans ses associations historiques avec les rassemblements politiques,
notamment ceux des mouvements ouvriers et des mouvements en faveur du
droit de vote des femmes.
C.P. (Corliss Powers) Walker (1853-1942) a construit le théâtre Walker
en 1906-1907, et l'a dirigé comme un théâtre actif jusqu'en 1933. Walker
a retenu les services de l'architecte de Montréal Howard C. Stone et lui
a demandé de dessiner un théâtre à l'épreuve du feu, selon les principes
de l'Auditorium de Chicago (Adler et Sullivan architectes, 1889) qui
était situé en plein coeur d'un complexe commercial multifonctionnel
très animé. À Winnipeg, le théâtre Walker est demeuré le seul élément
complété d'un complexe prévu d'hôtels, de bureaux et de commerces au
détail. À une certaine époque, les environs immédiats étaient connus
pour leur concentration de bâtiments de théâtre. Les deux cinémas en
concurrence du Metropolitan Theatre et du Capitol Theatre, aujourd'hui
démolis, étaient situés tout près, respectivement au numéro 281, et au
numéro 13 de la rue Donald.
Le théâtre Walker a été également le lieu de rassemblements d'importance
nationale, comme les réunions du mouvement en faveur du droit de vote
des femmes, notamment le Parlement des femmes de 1914, et des mouvements
ouvriers.
Une bonne partie des surfaces d'origine du théâtre ont été masquées
lorsqu'Odeon l'a transformé en cinéma (1945-1991). Acheté par le Walker
Theatre Performing Arts Group en 1991, le bâtiment a été restauré comme
lieu de représentations en direct. En 2002, il a reçu le nouveau nom de
Burton Cummings Theatre for the Performing Arts.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Vestiges-du-Ravin-des-Morses
Churchill, Manitoba
Le lieu historique national du Canada des Vestiges-du-Ravin-des-Morses
se situe sur une péninsule qui constitue le côté ouest de la rivière
Churchill, directement à l’opposé de la ville de Churchill, au Manitoba.
Il occupe le segment le plus au nord d’une crête rocheuse et est
recouvert d’une couche de gravelle, de pierres et de sable. Le lieu
comprend deux composantes archéologiques : le site du ravin des Morses,
qui court sur 1,8 kilomètre le long d’une crête rocheuse, en plein coeur
de la péninsule, à 30 mètres au dessus du niveau de la mer, et le site
de l’anse Dorset, qui se trouve du côté ouest de la péninsule, près de
la baie Button, qui mesure 400 mètres par 300 et qui s’élève de 18 à 22
mètres au-dessus du niveau de la mer.
Le site du ravin des Morses est découvert en 1966 par Joe Bighead, un
Ojibway de la région. Dans la même année, au cours de l’été, un incendie
détruit le tapis de toundra qui recouvre l’endroit, révélant des
artéfacts et le tracé rocheux de structures visibles à la surface. Un an
plus tard, d’autres travaux d’excavation permettent la découverte de
vingt-quatre habitations prédorsétiennes, ainsi qu’un important
assemblage d’outils, des artéfacts domestiques et d’autres objets au
sol. Les divers gros outils trouvés dans le ravin des Morses sont
pratiquement uniques, puisque le site de Twin Lakes, au sud-est de
Churchill, est le seul autre endroit où des outils similaires ont été
découverts. On croit que le site aurait été occupé à une période
s’étendant entre 500 ans et 130 ans avant notre ère. Il s’agit de l’un
des plus importants sites prédorsétien et dorsétien en ce qui concerne
le nombre d’artéfacts.
|
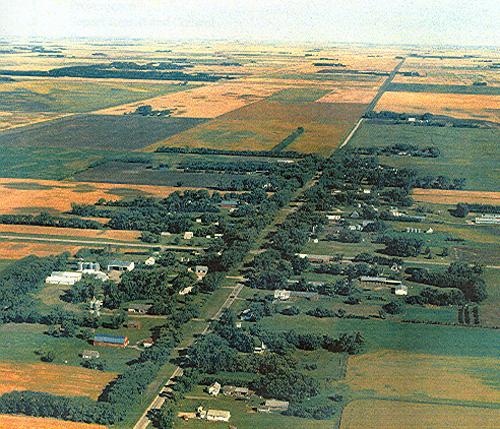
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Village-de-Neubergthal
Rhineland, Manitoba
Le lieu historique national du Canada Village-de-Neubergthal, fondé en
1876 sur les plaines du sud du Manitoba par un groupe de familles
mennonites apparentées, est aujourd’hui entouré de terres agricoles. Il
occupe six parcelles de terrain où les résidences, les fermes, ainsi que
les terres arables et les pâturages détenus en communauté s’étirent en
d’étroites bandes de terres. Ces fermes qui composent le village sont
positionnées de façon traditionnelle, derrière des clôtures aménagées le
long d’une rue unique bordée d’arbres, lui conférant ainsi un caractère
particulier.
Le village de Neubergthal est l’illustration vivante du village
mennonite des Prairies canadiennes. Sa valeur patrimoniale réside dans
sa forme de colonisation particulière, qu’il a connue en raison des
traditions mennonites de sa communauté, et dans ses éléments
architecturaux qui expriment la foi en une structure sociale égalitaire,
communautaire et autonome. Un groupe de familles apparentées, les
enfants de Johann et Margaretha Klippenstein, fonde le village en 1876.
Ils s’établissent sur ces terres et, avec d’autres familles, ils en
commencent l’exploitation entre 1876 et les années 1880. Le village est
un bon modèle d’établissement, parce qu’il nécessite une interaction et
une collaboration entre les résidents. Les villageois s’entraident en
effet pour les récoltes, le battage et la construction ainsi que pour «
faire boucherie ». L’église, l’institution centrale de la vie du
village, régit la façon dont les résidents vivent et se gouvernent, et
détermine leurs valeurs et leur comportement.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2014

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1992 |
Lieu historique national du Canada York Factory
York Factory, Manitoba
Principal dépôt de traite des fourrures de la Compagnie de la Baie
d'Hudson de 1684 à 1870.
Le lieu historique national du Canada York Factory est un poste de
traite des fourrures établi au XVIIe siècle par la Compagnie de la Baie
d'Hudson (CBH), à proximité de l'embouchure de la rivière Hayes, sur la
baie d'Hudson, à 250 km au sud-est de Churchill, au Manitoba. Entouré de
marais et d'une forêt boréale, ce site isolé de 250 hectares contient
les ruines d'un complexe de la CBH qui abrite maintenant un des grands
entrepôts de la compagnie.
La valeur patrimoniale de la York Factory a trait à la lisibilité de son
élément paysager et de ses ressources subsistantes attestant son rôle en
tant qu’important poste de traite des fourrures de la CBH. Ce poste,
établi en 1684 et brièvement géré par les Français de 1697 à 1714, était
devenu en 1730 le plus important poste de traite des fourrures de la
baie d'Hudson. À la fin du XVIIIe siècle, il était le principal centre
d'entreposage, de fabrication et de distribution de la Compagnie vers
ses nombreux autres postes de traite du nord-ouest. Au fil des ans,
trois York Factories se sont succédées dans la région. York Factory I
(de 1684 à 1715) et York Factory II (de 1715 à 1788) étaient situées sur
la rive nord de la rivière Hayes, mais elles ont disparu suite à
l'érosion des rives. Quant à York Factory III (de 1788 à 1957), établie
par Joseph Colen en 1788 en amont sur un terrain plus élevé que les deux
précédentes, elle est le complexe qui subsiste aujourd’hui. Bien
qu’imposant au XIXe siècle, avec ses cinquante et quelque bâtiments,
aujourd’hui il n'en reste que deux bâtiments, ainsi que deux ruines et
un cimetière. En 1957, le poste de traite des fourrures York Factory
ferma ses portes et devint par la suite un lieu historique national géré
par Parcs Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada du Mont-Riding
Siège social: Wasagaming, Manitoba
Aire protégée formant un « îlot » sur l'escarpement du Manitoba.
Parc national du Canada du Mont-Riding un endroit offrant 3 000 km2 de
possibilités, où la forêt boréale, la forêt-parc à trembles et les
prairies de fétuque accueillent des visiteurs de tous âges aux capacités
variées. Notre communauté accueillante et nos étendues de nature sauvage
vous aideront à tisser des liens avec ce que le Manitoba et le Canada
ont de plus beau en vous offrant toute une gamme de moyens pour
explorer, vous détendre, rire et vous amuser.
Le pittoresque lotissement urbain de Wasagaming, plein d’animation en
été, offre depuis des générations des souvenirs impérissables aux
familles. Le lieu historique national du Centred’Inscription-
de-l’Entrée-Est rappelle les premiers temps de l’existence du réseau de
parcs nationaux du Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada Wapusk
Siège social: Churchill, Manitoba
Une des plus vastes aires de mise bas des ours polaires du
monde.
Wapusk signifie "ours blanc" en langue crie. Le nom donné au parc lui
convient tout à fait étant donné qu'il protège l'une des plus vastes
aires connues de mise bas des ours polaires du monde. Il représente la
région naturelle des basses-terres d'Hudson et de James, qui borde la
baie d'Hudson. Le parc se trouve à la limite de la forêt boréale et de
la toundra arctique. La géologie, la biodiversité et l'histoire
culturelle de la région confèrent au parc national du Canada Wapusk son
caractère sauvage distinctif.
|
|