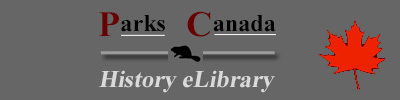|
Résumés parc
Nouvelle-Écosse
Tous les textes et photos sont la propriété de Parcs Canada ou le Répertoire canadien des lieux patrimoniaux
(Sauf indication contraire) et ont été extraites de l'une ou l'autre Parcs
Canada ou Lieux patrimoniaux du Canada. Les parcs avec un fond
gris sont gérés par Parcs Canada.

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Acacia Grove/ Maison-Prescott
Starr's Point, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada Acacia Grove / Maison-Prescott est
un grand domaine situé dans la vallée de la rivière Annapolis en
Nouvelle-Écosse. Trônant au milieu de jardins et de vergers cette belle
maison géorgienne du début du XIXe siècle présente une volumétrie
rectangulaire, une façade avec ouvertures régulièrement espacées, un
toit en croupe bas tronqué, des cheminées massives à chaque extrémité et
un petit fronton au-dessus de l'entrée principale. Cette grande
résidence en brique de deux étages et demi est un excellent exemple
d'architecture domestique s'inspirant de la tradition classique
britannique.
Acacia Grove, une résidence en brique, empreinte de dignité, respecte
les règles architecturales du style géorgien (le style classique
britannique), qui combine la forme compacte issue de la tradition
classique britannique a une ornementation dérivée de la tradition
classique britannique et du style palladien. Ses proportions symétriques
et équilibrées sont agrémentées de détails classiques discrets. Lorsque
Charles Ramage Prescott a pris sa retraite du monde des affaires à
Halifax, il a déménagé dans son domaine rural de la vallée de
l'Annapolis où il avait fait construire une belle maison d'inspiration
classique britannique au milieu de dépendances, de grands jardins et de
vergers. Prescott est renommé pour avoir introduit de nouvelles variétés
améliorées de pommes dans la région, ainsi que pour avoir créé la Fruit
Growers Association. Comme il a planté des bosquets d'acacias et de faux
acacias dans le domaine, ce dernier fut connu sous le nom d'Acacia
Grove. Au fil des ans, le domaine a eu plusieurs propriétaires, et il
s'est finalement dégradé faute de soins. L'arrière-petite-fille de
Prescott l'a restauré dans les années 1930. Le Musée de la
Nouvelle-Écosse le gère à présent à titre de maison-musée.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Académie-de-Lunenburg
Lunenburg, Nouvelle-Écosse
L'Académie de Lunenburg est un grand édifice scolaire du XIXe siècle,
situé à Lunenburg (Nouvelle-Écosse). Il s'agit d'un édifice en bois de
trois étages de style Second Empire, entouré d'un grand terrain de jeux
ouvert. Son emplacement clé, sur Gallows Hill, est visible de presque
tous les endroits à la périphérie de Lunenburg. La propriété est
adjacente au lieu historique national du Canada de
l'Arrondissement-Historique-du-Vieux-Lunenburg.
L'Académie de Lunenburg illustre une étape importante dans l'évolution
du système éducatif de la Nouvelle-Écosse au XIXe siècle, qui est passé
du système d'école à classe unique à un système académique. Les écoles
du comté, qui étaient financées par l'État, offraient un enseignement
secondaire de qualité à l'intérieur du système public. Ceci se reflétait
dans leur conception, leur programme d'études et la qualité des
enseignants et des établissements. L'Académie de Lunenburg a été
construite en 1894-1895 selon les plans de Harry H. Mott, éminent
architecte du lieu.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2007 |
Lieu historique national du Canada de l'Académie-de-Pictou
Pictou, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de l'Académie de Pictou, dont il
ne subsiste plus rien, est marqué d'une plaque de la Commission des
lieux et monuments historiques du Canada, fixée à un cairn, situé au
coin des rues Church et Willow, à Pictou, en Nouvelle-Écosse. Un sentier
mène au monument qui est entouré d'une clôture de fer et est installé
dans le coin sud-est de la propriété.
En 1803, le mauvais temps oblige Thomas McCulloch, ministre du culte
presbytérien, en route vers l'Île du Prince Édouard, à s'arrêter à
Pictou. On le convainc de rester et de devenir le pasteur de la
congrégation écossaise locale. Dans le but d'ouvrir une école pour les
membres de la communauté écossaise, le pasteur fonde une école
secondaire, puis l'Académie de Pictou en 1816. Dans les années 1820, il
se débat pour obtenir un financement du gouvernement provincial afin que
l'Académie puisse décerner des diplômes. Il cherche aussi à gagner
l'appui de la population à l'endroit de tous les établissements
d'enseignement. Enfin, en 1831, l'Angleterre octroie à l'Académie un
fonds permanent pour l'enseignement des matières de niveaux secondaire
et collégial. À partir de ce moment, l'Académie de Pictou est en mesure
d'offrir un cour classique et scientifique, mais par la suite elle
abandonne l'enseignement collégial. En 1880, l'Académie de Pictou
emménage dans un bâtiment plus vaste, et cède l'ancien à la West End
School, jusqu'à ce qu'il soit démoli en 1932. L'Académie de Pictou
compte parmi ses diplômés de nombreux professionnels et gens d'affaires
renommés du Canada.
|

©Public Archives of Nova Scotia/ Archives publiques de la Nouvelle-Écosse, Bob Brooks Collection/ Collection Bob Brooks |
Lieu historique national du Canada Africville
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada Africville est un lieu de
commémoration pour la collectivité afro-canadienne de Halifax. Une
communauté noire d'importance historique y habitait, mais les maisons
ont été démolies dans les années 1960 et le terrain, qui est une
propriété municipale, a été réaménagé pour en faire le parc Seaview.
Africville est située à l'extrémité nord de la rue Barrington qui donne
sur le bassin Bedford, au-dessous du pont A. Murray MacKay. Elle
constitue un symbole de l'organisation communautaire des Afro-Canadiens,
si bien que les gens qui honorent la lutte contre le racisme y vont en
pèlerinage. Un monument en forme de cadran solaire commémorant
l'ancienne collectivité trône au milieu de ce terrain dégagé. La
désignation a trait au paysage et aux ressources associées, y compris
quelques vestiges de fondations.
À l'origine, Africville était peuplée par des Afro-Canadiens qui
cherchaient un emploi à Halifax dans les années 1830 et 1840. Au cours
du XIXe siècle, cette communauté a grandi, jusqu'à disposer de sa propre
école et de sa propre église, l'Église baptiste africaine unifiée de
Seaview. Au fil des ans, la ville de Halifax a constamment refusé de
fournir à cette collectivité les services municipaux communautaires, et
elle a profité du mouvement de rénovation urbaine des années 1960 pour
raser le site. Malgré les protestations de la collectivité, elle a été
démantelée et ses membres ont été relogés ailleurs dans la ville. Mais
une campagne demandant réparation a finalement été organisée, si bien
qu'Africville a pris une connotation symbolique qui persiste encore de
nos jours et représente pour les Afro-Canadiens la nécessité de défendre
fièrement et avec vigilance leurs institutions et leurs traditions. À ce
titre, Africville a servi d'inspiration à d'autres collectivités
afro-canadiennes. Elle a aussi engendré des chefs, comme les membres de
la famille Carvery et Burnley «Rocky» Jones, le renommé défenseur des
droits de la personne. Le terrain a été aménagé par la ville en parc
municipal, le parc Seaview, qui est devenu un lieu de pèlerinage annuel
pour la Société généalogique d'Africville, un organisme composé
d'anciens résidents et de leurs descendants.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Steeves, 1981 |
Lieu historique national du Canada Alexander-Graham-Bell
Baddeck, Nouvelle-Écosse
Évocation du célèbre inventeur.
Le lieu historique national Alexander-Graham-Bell est un musée du 20e
siècle, contenant des objets ayant appartenu à M. Bell, situé sur une
propriété de 10 hectares ayant une vue sur la baie de Baddeck, sur une
partie du lac Bras d'Or et sur Beinn Bhreagh, la maison d'été
d'Alexander Graham Bell.
Le lieu historique national Alexander-Graham-Bell a été établi à titre
de musée historique en 1954 afin d'abriter les objets liés à la vie
d'Alexander Graham Bell. L'importance nationale de ce lieu a été
reconnue, car les objets qui s'y trouvent sont liés à la vie d'Alexander
Graham Bell, enseignant, scientifique et inventeur, une personne
d'importance historique nationale.
La valeur patrimoniale de ce lieu se trouve dans l'association des
artefacts avec Alexander Graham Bell et dans le lieu à proximité de la
maison d'été de Bell qu'il a construite à Baddeck, Nouvelle-Écosse, en
1886 et qu'il a occupée de façon régulière pendant un certain temps
chaque année, jusqu'à sa mort en 1922. Il a réalisé à cet endroit des
expériences scientifiques sur la transmission du son, la médecine,
l'aéronautique, le génie maritime et la construction de structures
tridimensionnelles.
La CLMHC a également décidé de commémorer Frederick Walker "Casey"
Baldwin et Douglas McCurdy pour leurs expériences de vols à Baddeck, en
collaboration avec Bell.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |
Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Cimetière
Halifax, Nouvelle-Écosse
Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Cimetière de Halifax, en
Nouvelle-Écosse, contient plus de 1 200 monuments et pierres tombales,
ce qui en fait une concentration unique d'art funéraire des 18e et 19e
siècles au Canada. L'ancien cimetière est un rectangle boisé de 0,91
hectares séparé de son environnement urbain par un mur de pierre portant
une clôture de fer forgé décorative. Du côté sud, un important monument
commémoratif de la guerre de Crimée fait face à la rue Barrington. Le
cimetière sert maintenant d'espace vert urbain d'importance.
La valeur patrimoniale de ce site réside dans sa localisation en
périphérie, dans son étendue, dans son aménagement et dans les matériaux
du cimetière ainsi que dans la richesse de la variété de styles et
l'adresse saisissante des images et sculptures de la vaste collection de
monuments funéraires. Utilisé par plusieurs sectes chrétiennes, l'ancien
cimetière était à l'origine géré par l'Église anglicane St. Paul et a
servi la collectivité d'Halifax de 1749 à sa fermeture en 1844. Le
monument commémoratif de Welsford-Parker, hommage à deux ressortissants
de Halifax pour leur service héroïque en Crimée, a été érigé à l'entrée
en 1860, alors que les terrains étaient clôturés et aménagés.
|
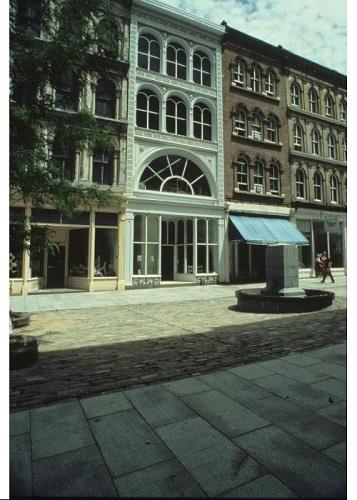
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Magasin-de-Chaussures-Anglaises-Coombs
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le Coombs Old English Shoe Store à façade en fonte est un bâtiment
commercial érigé au milieu du XIXe siècle sur la rue Granville, dans le
centre-ville d'Halifax. Il fait partie d'un ensemble de bâtiments
commerciaux d'importance historique et architecturale.
L'Ancier magasin de chaussures anglaise Coombs a la façade en fonte et a
été désigné lieu historique national en 1980 parce qu'il est associé à
un des premiers exemples des façades en fonte pleine hauteur construites
au Canada.
Érigé en 1860, le bâtiment Coombs est une des premières structures à
façade en fonte construites au Canada et le seul bâtiment d'Halifax doté
d'une façade faite entièrement de fonte. Cette façade de quatre étages a
été conçue et fabriquée par Architectural Iron Works de New York, un des
principaux fournisseurs et artisans de l'architecture en fonte en
Amérique du Nord.
|

©Soeurs de la Charité, Halifax, Archives de la congrégation |
Lieu historique national du Canada de l'ancien pensionnat indien de Shubenacadie en Nouvelle-Écosse
Shubenacadie, Nouvelle-Écosse
L’ancien pensionnat indien de Shubenacadie a été construit en 1928-1929 dans le
district Sipekni’katik de Mi’kma’ki, au sommet d’une petite colline entre la
route 2 et la rivière Shubenacadie. Le site surplombe le village de
Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse, et se situe à sept kilomètres de la Première
Nation Sipekne’katik (Indian Brook). Laissé à l’abandon, l’édifice principal a
été démoli en 1986 et une usine a été construite sur le site.
La demande de désignation de l’ancien pensionnat indien de Shubenacadie a été
soumise à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada par le
coprésident du groupe de travail sur la culture et le patrimoine du Forum
tripartite Mi’kmaq-Nouvelle-Écosse-Canada au nom des survivants du pensionnat de
Shubenacadie et de leurs descendants. Parcs Canada et le demandeur ont collaboré
pour déterminer les valeurs historiques de cet ancien pensionnat et rédiger le
rapport de recherche historique préparé pour la Commission.
Ouvert de 1930 à 1967, cet établissement était le seul pensionnat autochtone des
Maritimes. Il faisait partie du système des pensionnats autochtones où le
gouvernement fédéral et certaines églises et organisations religieuses
travaillaient ensemble afin d’assimiler les enfants autochtones dans le cadre
d’un vaste ensemble de démarches visant à détruire les cultures et les identités
autochtones et à supprimer leurs histoires. Le pensionnat indien de Shubenacadie
a d’abord été géré par l’archidiocèse catholique romain d’Halifax, puis par les
missionnaires Oblats de Marie-Immaculée, tandis que les Sœurs de la Charité de
Saint-Vincent de Paul d’Halifax se sont chargées de l’enseignement aux enfants.
Des enfants mi’kmaw et wolastoqkew de la Nouvelle-Écosse, de
l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et du Québec ont fréquenté ce
pensionnat. Il est aussi possible que des enfants d’autres communautés
autochtones y aient également été envoyés. Ils y ont été soumis à une discipline
sévère, à la malnutrition et à la famine, à de mauvais soins de santé, à des
abus physiques, émotionnels et sexuels, à l’expérimentation médicale, à la
négligence et à la suppression délibérée de leurs cultures et de leurs langues ;
certains y sont morts. Dès les premiers jours du pensionnat, les élèves, leurs
familles et les dirigeants de la communauté ont exprimé des objections et ont
protesté contre tout ce qui s’y rattachait, notamment la fréquentation forcée,
les conditions pitoyables, les mauvais traitements et la piètre qualité de
l’enseignement. Plusieurs enfants ont lutté contre le système en refusant de
renoncer à leur langue et à leur identité. Certains enfants se sont enfuis pour
tenter de rentrer chez eux.
Bien que le bâtiment scolaire ne soit plus en place, le site de l’ancien
pensionnat est un lieu de mémoire et de guérison pour certains survivants et
leurs descendants qui souhaitent préserver l’histoire des pensionnats
autochtones dans les Maritimes. D’autres, pour qui le site ne détient aucun
statut commémoratif ou de guérison, considèrent que l’édifice et le site
témoignent de l’expérience des enfants qui y résidaient et de l’héritage de ces
expériences à travers Mi’kma’ki. Plusieurs craignent que les répercussions
intergénérationnelles de ces expériences sur les survivants, leurs familles et
leurs communautés ne soient oubliées. L’histoire du pensionnat indien de
Shubenacadie est très délicate et difficile à élaborer compte tenu du
traumatisme qui était, et demeure inhérent à son histoire. De nombreux
survivants n’arrivent toujours pas à parler de leurs expériences.
|

©C. Boucher, Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2017 |
Lieu historique national du Canada de l’Ancienne école normale de Truro
Truro, Nouvelle-Écosse
Point de repère majeur au centre-ville de Truro, ce bâtiment monumental
de trois étages en brique constitue un excellent exemple d’architecture
de style Second Empire. Conçu selon les plans de l’architecte
néo-écossais Henry Frederick Busch, il expose un toit en mansarde, un
pavillon central équilibré, des lucarnes pignons à fronton, des
avant-toits accentués soutenus par des consoles ouvragées et des
fenêtres en plein cintre. Construit en 1877 pour remplacer la première
école normale de Truro, il a servi de collège normal jusqu’en 1961. Il
témoigne du mouvement implanté au pays au cours de la seconde moitié du
XIXe siècle pour normaliser et améliorer la formation des enseignants en
plus d’être directement associé au développement du système d’éducation
publique de la Nouvelle-Écosse au cours du XIXe et du XXe
siècle.
L’ancienne école normale de Truro est située au cœur du centre-ville de
Truro (752, rue Prince), ville localisée au centre de la
Nouvelle-Écosse, à moins de 100 km au nord-est de Halifax. En tant qu’«
école normale », sa fonction est de former les enseignants. Elle est
construite par le ministère de l’Éducation provincial afin de remplacer
la première école normale de Truro, établie en 1855, mais devenue trop
petite dès les années 1870. Les écoles normales de Truro furent établies
lors d’une période de changement dramatique en éducation en Amérique du
Nord britannique. Au cours des années 1840 à 1870, les gouvernements
consacrent des ressources sans précédent à la construction et à la
régulation des écoles et établissent des législations concernant
l’éducation. Ceci inclut la standardisation et la certification de la
formation des enseignants. L’ancienne école normale de Truro sert à la
formation des enseignants jusqu’en 1961, constituant la seule école du
genre dans la province pendant de nombreuses années. À la suite de sa
fermeture, le bâtiment est occupé par le YMCA puis temporairement par
les bureaux de la Ville de Truro.
Sur le plan architectural, l’ancien collège normal de Truro constitue un
très bel exemple d’édifices conçus dans le style Second Empire. Cet
imposant édifice de trois étages en brique avec sous bassement surélevé
est doté d’un plan symétrique, en forme de « T ». Son revêtement
extérieur de brique rouge comporte des motifs géométriques contrastants
en brique blanche, lesquels ajoutent à l’originalité du bâtiment et sont
caractéristiques du travail de son concepteur, l’architecte Henry
Frederick Busch. Dotée d’une grande symétrie, sa façade comporte une
entrée centrale de même que de deux entrées latérales. La présence des
nombreuses fenêtres permet d’assurer un apport de lumière naturelle
abondant à l’intérieur.
En 2006, un plan de réaménagement de l’îlot incluait une recommandation
de restaurer l’ancien collège normal. Le bâtiment fut ainsi rénové et
agrandi avec l’ajout d’une annexe contemporaine pour loger la succursale
de Truro de la bibliothèque publique de Colchester – East Hants. Les
récents travaux de réhabilitation ont conservé l’essentiel des
caractéristiques architecturales extérieures du bâtiment, alors que
l’intérieur a été complètement réaménagé pour répondre aux besoins
actuels de la nouvelle bibliothèque municipale. Néanmoins, quelques
éléments significatifs ont été mis en valeur tels des vitraux, certaines
fenêtres d’origine et des moulures. La nouvelle bibliothèque, complétée
en mai 2016, et le réaménagement des jardins adjacents ont contribué à
redonner au bâtiment sa visibilité d’antan et son rôle de point de
repère au sein du centre-ville de Truro.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Ian Doull

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Ian Doull |
Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Historique-d'Annapolis Royal
Annapolis Royal, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de
l'Arrondissement-Historique-d'Annapolis Royal est situé au croisement
des rivières Annapolis et Allain, dans la vallée de l'Annapolis en
Nouvelle Écosse. Le cœur historique de l'arrondissement, qui comprend
des secteurs commerciaux, militaires et résidentiels, se trouve sur le
site d'établissement initial des Acadiens au début du XVIIe siècle.
L'arrondissement s'étend depuis le bord de l'eau et englobe une
concentration de bâtiments qui datent du XVIIIe aux début du XXe siècle
et témoignent de l'interprétation vernaculaire, de plusieurs styles
architecturaux, dans les Maritimes. L'emplacement stratégique de la
ville, en bordure du bassin protégé de l'Annapolis avec accès à la baie
de Fundy, en fait le centre d'événements importants tout au long des
premières années de la colonisation au Canada.
En 1605, les colons français ont commencé à travailler la terre dans
l'arrondissement historique d'Annapolis Royal, alors connu sous le nom
de Port-Royal, mais en 1613, les Britanniques se sont emparés de la
colonie. En 1632, l'Acadie a été rendue à la France par traité,
l'endroit a été fortifié et est devenu le principal établissement des
colons acadiens. En 1643, un remblai à quatre bastions a été construit
au fort Anne, et en 1650, un lotissement urbain était implanté. La rue
St. George, une artère principale de l'arrondissement, était déjà bien
aménagée en 1686. L'Acadie a été cédée à l'Angleterre en 1713 et
Port-Royal pris le nom d'Annapolis Royal. La ville a servi de centre des
opérations militaires et administratives de la nouvelle colonie
britannique de la Nouvelle-Écosse, jusqu'à ce que Halifax devienne la
capitale de la province en 1749. En raison de son emplacement au bord de
l'eau, Annapolis Royal a bien été établie en terme de construction de
navires, de fabrication de brique et de coupe de bois, ce qui a fait
croître l'économie locale.
Annapolis Royal se caractérise par son développement continu qui a donné
lieu à toutes sortes de styles architecturaux et le développement de
cinq sous-districts. Le premier sous-district se distingue par ses
grandes résidences et parcelles de terrain, témoins de la prospérité des
propriétaires de navires marchands. Le deuxième, aire de transition
entre les quartiers résidentiels et commerciaux, se distingue par des
maisons de moindre envergure, avec un moindre retrait de la route. Les
paysages tels que le vieux cimetière et le fort Anne font le lien avec
les premières décennies de l'établissement européen permanent. Le
troisième sous-district est devenu le centre commercial et présente
diverses influences architecturales, harmonisées par l'utilisation de
matériaux de construction semblables. Le quatrième sous-district, situé
sur la rue Lower St. George, a compté certaines entreprises commerciales
et industrielles de la ville qui utilisaient la rivière et, comme en
témoignent les imposantes résidences, certains des citoyens les plus
éminents l'ont habité. Le cinquième sous-district est un quartier
résidentiel, caractérisé par des constructions de taille et de
conception modestes où habitaient les artisans, les commerçants et les
propriétaires de petites entreprises.
La ville conserve des bâtiments et des structures de toutes ces
périodes, sauf les toutes premières; on peut ainsi y voir un inventaire
détaillé des traditions de construction dans les Maritimes et au Canada.
Considéré comme comme l'établissement permanent continuellement habité
et le plus ancien au pays, cet ensemble exceptionnel de bâtiments
reflète les thèmes du peuplement acadien, de même que la construction
des capitales coloniales, des villes loyalistes et des centres
commerciaux du XIXe siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, C. Reardon, 1995 |
Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Historique-du-Vieux-Lunenburg
Lunenburg, Nouvelle-Écosse
L'Arrondissement historique du Vieux-Lunenburg correspond à la zone
centrale de la ville de Lunenburg qui est un exemple bien préservé des
types de colonisation et de peuplement du XVIIIe siècle. Il présente de
nombreux exemples exceptionnels d'architecture vernaculaire couvrant une
période de plus de 240 ans. Il occupe le versant d'une colline ainsi
qu'une bande étroite située le long d'un port naturel. Il comprend le
terrain de parade original de la ville, ainsi qu'une zone de front de
mer associée aux industries de la pêche et de la construction navale. Le
Vieux-Lunenburg a également été désigné site du patrimoine
mondial.
L'Arrondissement historique du Vieux-Lunenburg a été désigné lieu
historique national en 1991 en raison de son plan en damier reflétant un
des modèles de plan britanniques les plus anciens et les mieux préservés
du Canada, de ses liens historiques étroits, particulièrement avec les
pêcheries de l'Atlantique, et de son architecture riche et équilibrée.
La valeur patrimoniale de l'Arrondissement historique du Vieux-Lunenburg
a trait à son plan original, aux éléments volumétriques et aux espaces
libres qu'il renferme, aux manifestations physiques et culturelles des
industries de la pêche en haute mer et de la construction navale, et à
l'intégration harmonieuse de la ville au paysage marin. Le plan du
Vieux-Lunenburg, conçu par Charles Morris, lors de son débarquement le 8
juin 1753, était le second « plan-type » britannique créé dans ce qui
est maintenant le Canada. Ce plan en damier a été directement et
étroitement associé à la politique de colonisation impériale
britannique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |
Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Hydrostone
Halifax, Nouvelle-Écosse
Cette banlieue-jardin à l'anglaise, d'une profondeur de un pâté de
maisons et d'une largeur de dix pâtés, est située dans la partie nord
d'Halifax. Ses courtes rues orthogonales sont bordées par des maisons en
rangée homogènes disposées de façon à faire face à de larges
cours-parcs. Du côté de la rue Young se trouve une courte rangée
commerciale, dans le même style néo-Tudor discret que la zone
résidentielle.
L'Arrondissement Hydrostone a été désigné lieu historique national du
Canada parce que c'est un excellent exemple de la banlieue-jardin à
l'anglaise au Canada qui a conservé un degré élevé d'authenticité. Sa
série de cours rectangulaires plantées d'arbres, bordées des deux côtés
d'un ensemble répétitif d'immeubles résidentiels construits en «
Hydro-stone », crée une impression remarquable de retour dans le temps
et l'espace, avec très peu d'éléments discordants ou étrangers, et c'est
le premier projet public d'habitation au pays, en même temps qu'un
exemple important des travaux de l'influent urbaniste que fut Thomas
Adams.
Construits pour remplacer les habitations détruites par l'Explosion
d'Halifax de 1917, les édifices en blocs de béton (Hydro-stone) ont été
dessinés par Ross et Macdonald pour s'inscrire dans le plan dressé par
Thomas Adams.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Rural-Historique-de-Grand-Pré
Kings County, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de
l'Arrondissement-Rural-Historique-de-Grand-Pré est un paysage culturel
d'approximativement 1000 acres (405 hectares) qui englobe les villages
de Grand Pré et d'Hortonville, les terres agricoles qui les entourent,
de vastes étendues de marais littoral, dont une bonne partie a été
poldérisée pour créer des terres arables, et les vergers s'étendant sur
les hautes terres. Un paysage rural distinct s'est développé à partir
des traditions d'utilisation des terres des Acadiens et des planteurs de
la Nouvelle-Angleterre.
La valeur patrimoniale de ce paysage culturel réside dans
l'harmonisation des éléments naturels et bâties, dans la rétention et
l'élaboration des modèles d'utilisation des terres provenant des
Acadiens, en particulier dans la distribution spatiale des terres
arables, des vergers, des polders et des hameaux résidentiels.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Auberge-Sinclair / Hôtel-Farmer's
Annapolis Royal, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de l'Auberge-Sinclair /
Hôtel-Farmer's, un édifice en bois de deux étages et demi, est situé
dans la zone commerciale d'Annapolis Royal, en Nouvelle-Écosse. Son
volume rectangulaire et sa façade arrangée de façon symétrique, avec un
fronton central et une entrée principale, évoquent le style vernaculaire
classique de nombre de ses voisins et masquent ses origines plus
anciennes. Cette structure, connue autrefois sous le nom d'hôtel
Farmer's, a été modifiée par la regroupement d'au moins deux édifices,
dont un datant de l'époque acadienne. L'édifice, qui a été stabilisé
dans les années 1980, abrite à présent un musée.
La valeur patrimoniale de ce lieu tient au fait qu'il est l'illustration
de techniques de construction et de matériaux allant de la fin du XVIIe
siècle à la fin du XIXe siècle. La structure, qui est composée de plus
d'un édifice original, fait appel à des techniques de construction
acadiennes très anciennes ainsi qu'à d'autres plus récentes du style
vernaculaire anglais. Il a cessé d'être une auberge en 1950, après 150
ans d'activité. L'édifice a conservé beaucoup de ses matériaux
d'origine.
|

©St. Mary's Basilica, Glenn Euloth, 2009 |
Lieu historique national du Canada de la Basilique-St. Mary
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de la Basilique-St. Mary est une
grande église située bien en vue au centre ville d'Halifax, en
Nouvelle-Écosse. L'église est un des points d'intérêts importants de la
ville grâce à sa conception de style néogothique, avec un impressionnant
portail d'entrée et une haute flèche centrale.
La valeur patrimoniale de la basilique St. Mary réside dans ses liens
historiques avec le catholicisme romain en Nouvelle-Écosse, et au rôle
capital qu'elle a joué dans son histoire, tels qu'attestés par les
qualités physiques et conceptuelles de l'église elle-même. Cette église,
qui est une des premières cathédrales catholiques romaines du Canada,
constitue également un imposant exemple du style architectural
néogothique arrivé à maturité. L'évolution de son architecture reflète
sa longue histoire. Sa construction a commencé en 1820, sous l'égide de
l'évêque Edmund Burke. Il s'agissait de la première cathédrale
catholique romaine en Nouvelle-Écosse. Elle a permis aux catholiques de
faire d'importants progrès sur les plans juridique et social.
L'archevêque Thomas Conolly a supervisé d'importants travaux
d'agrandissement et de redécoration, réalisés de 1860 à 1874 d'après des
plans de l'architecte américain d'origine irlandaise Patrick C. Keely.
Ces travaux reflétaient la confiance et l'importance grandissantes du
diocèse. St. Mary a été élevée au rang de basilique en 1950.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2008 |
Lieu historique national du Canada de la Batterie-Royale
Louisbourg, Nouvelle-Écosse
Rôle dans les sièges de Louisbourg en 1745 et en 1758.
Le lieu historique national du Canada de la Batterie-Royale, situé à
l'emplacement de la Forteresse-de-Louisbourg en Nouvelle-Écosse, est un
site archéologique qui domine la rive nord du port de Louisbourg.
Apparaissant comme un long talus herbeux, les contours de la tranchée et
du glacis sont toujours apparents, tout comme les monticules qui
marquent les vestiges des tours latérales.
La Batterie royale faisait partie du système défensif du port de
Louisbourg. Les Français avaient commencé à l'édifier en 1724 sur la
rive nord du port face à son entrée étroite. Elle fut essentiellement
complétée en 1728, mais des additions y furent apportées au cours des
années suivantes et elle atteignit sa forme finale tôt en 1732. Une fois
complétée, ses canons pouvaient, en théorie, atteindre directement les
navires ennemis pénétrant dans la rade et se dirigeant vers la ville de
Louisbourg. La batterie se composait de deux surfaces formant un angle
obtus, percées chacune de 15 créneaux pour les canons. On trouvait
derrière les remparts des baraquements protégés par un fossé, une brève
avenue couverte et un glacis. Enfin, deux tours défendaient les flancs
de l'ouvrage.
En 1745, les Français abandonnèrent la batterie aux forces coloniales et
britanniques attaquantes qui utilisèrent alors les armes françaises pour
canonner la ville. Retournée aux Français en 1758, ces derniers
démantelèrent la batterie avant de la céder un autre fois aux
britanniques en 1758. Les Britanniques la détruirent finalement en 1760
en même temps qu'ils détruisaient systématiquement toutes les
fortifications de Louisbourg. Les habitants de la ville ont poursuivi le
démantèlement de l'emplacement lorsqu'ils l'ont utilisé comme carrière
pour des pierres de construction. De nos jours, ce lieu est devenu un
site archéologique à l'intérieur du lieu historique national du Canada
de la Forteresse-de-Louisbourg.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de Beaubassin
Fort Lawrence, Nouvelle-Écosse
Important établissement acadien; point central de la lutte géopolitique
qui opposa les empires français et britannique aux XVIIe et XVIIIe
siècles en Amérique du Nord.
Le lieu historique national du Canada de Beaubassin est situé en
Nouvelle-Écosse, sur la crête sud-ouest du mont Fort-Lawrence, appelé
autrefois mont Beaubassin. Le lieu, principalement composé de prairies
de fauche, de pâturages et de marais, est séparé en deux par la voie
principale du chemins de fer nationaux du Canada, et comprend aussi le
lieu historique national du Canada du Fort Lawrence.
Important établissement acadien fondé en 1671 et 1672 sur l'isthme de
Chignectou, Beaubassin est au cœur des affrontements territoriaux entre
les Britanniques et les Français, aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les
résidents du village, centre d'un vaste réseau commercial constitué de
l'île Royale, de la Nouvelle-Écosse et de la Nouvelle-Angleterre, vivent
de l'agriculture, de l'élevage et de la construction navale. Au
printemps de 1750, le gouverneur de la Nouvelle-Écosse, le général
Edward Cornwallis, ordonne au major Charles Lawrence de repousser les
troupes françaises hors de la région de Chignectou. À la fin du
printemps, le major Lawrence débarque avec 400 hommes dans les marécages
à l'ouest de Beaubassin. Il est incapable de prendre le chaînon
Beaubassin, mais il assiste tout de même à la destruction du village par
le feu, vraisemblablement allumé par les Français eux-mêmes. L'incendie
de Beaubassin et la militarisation de l'isthme par les Français et les
les Britanniques allaient considérablement changer la situation
géopolitique de la région. En effet, peu après, les Acadiens fuient en
masse vers des territoires français ou se réfugient sur le mont
Beauséjour. Même si les bâtiments agricoles et résidentiels modernes ont
endommagé les vestiges archéologiques, la majeure partie de la propriété
est toujours parsemée de terres agricoles et de marécages. Les pâturages
de l'ancien village contiennent de nombreuses traces archéologiques de
l'occupation par les Acadiens.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de Beinn Bhreagh Hall
Baddeck, Nouvelle-Écosse
Construit en 1892-1893, Beinn Bhreagh Hall (BBH) est la résidence d'été, le
domaine et le laboratoire de l'inventeur et chercheur, Alexander Graham Bell,
et de son épouse, Mabel Bell. Cette grande résidence de style néo-Queen
Anne/Shingle est un très bel exemple de ce style architectural alors en vogue
en Nouvelle-Angleterre et prisé sur le littoral américain. Il se distingue
par ses foyers en pierre d'origine, la finesse d'exécution de son intérieur
et les jardins luxuriants créés par Mabel Bell. Vers la fin de sa carrière,
BBH est une inspiration pour Alexander Graham Bell qui l'utilise comme
résidence privée et comme centre névralgique de ses expériences novatrices
avec des cerfs-volants, des structures tétraèdres et des hydroptères, ainsi
que pour l'élevage de moutons.
Les Bell sont alors une famille américaine renommée dont la résidence
permanente se trouve à Washington, DC. Ils passent leur premier été en
Nouvelle-Écosse, en 1885, et amorcent la construction de BBH en 1892 pour en
faire leur résidence estivale. En fait, ils aiment tant Baddeck qu'ils y
restent souvent une grande partie de l'année, construisant même des
laboratoires de recherche à proximité. Ils accueillent volontiers les
scientifiques et les résidents locaux qui viennent y prendre part à des
discussions animées. Alexander Graham Bell a toujours l'esprit en éveil et
explore constamment de nouvelles idées. Il retient souvent les services de
gens du coin pour l'aider dans ses expériences. À BBH, il mène des recherches
dans différents domaines, dont la transmission sonore, la médecine,
l'aéronautique, le génie maritime et les structures en treillis. C'est ici
qu'en 1907, Mabel et Alexander Bell fondent l'Aerial Experiment Association
qui met au point quatre prototypes d'aéronef, notamment le Silver Dart, qui
survole le lac Bras d'Or en février 1909.
Située à l'extrémité de la péninsule Red Head, entre le mont Beinn Bhreagh et
le lac Bras d'Or, BBH offre des vues imprenables sur le lac et la ville de
Baddeck. Cette résidence à deux étages de style Queen Anne est dotée d'une
énorme cheminée étagée en pierre, ainsi que d'un grand solarium central avec
balustrade en bois et grandes fenêtres; elle est flanquée de deux imposantes
tourelles qui enveloppent ses angles. Ses 28,9 acres de jardins paysagers
profitent d'un microclimat particulièrement chaud et comptent un certain
nombre d'espèces rares, dont des cyprès et des épines-vinettes du Japon. Le
côté nord de la maison donne sur un jardin à trois niveaux où poussent des
plantes annuelles, des plantes vivaces et un magnolia planté en 1913. Conçu
par Arthur G. Everett avec la participation des Bell, BBH est l'un des
quelques exemples qui subsistent de résidences d'été du Canada atlantique
construites par un Américain renommé. Il conserve la plupart de ses éléments
d'origine qui témoignent de son rôle de pivot du « laboratoire » scientifique
et technique exceptionnel créé par Bell, son épouse et leurs associés.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Mainland Nova Scotia Field Unit / Unité de gestion de la Nouvelle-Écosse continentale |
Lieu historique national du Canada Bloody Creek
Bridgetown, Nouvelle-Écosse
Lieu où Français et Anglais se sont livré bataille deux fois, d'abord en
1711, puis en 1757.
Le lieu historique national du Canada Bloody Creek est situé sur des
terres agricoles en pente à Bridgetown, en Nouvelle Écosse. Deux zones
circulaires marquent l'emplacement de deux batailles pour la possession
de l'Acadie qui ont eu lieu en 1711 et en 1757 et opposant les forces
britanniques aux forces françaises et à leurs alliés autochtones.
L'emplacement de première bataille a pour point central la rive nord
ouest de la rivière Annapolis, et celui de la deuxième bataille, la rive
est du ruisseau Bloody. Ils se composent de terres et d'étendues d'eau.
Un cairn de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada,
installé près du champ de bataille de 1757, marque l'emplacement.
Bloody Creek a été désigné lieu historique national du Canada parce
qu'il commémore: les deux batailles entre les troupes britanniques
d'Annapolis Royal et les Français et leurs alliés autochtones qui se
sont déroulées pendant le demi-siècle de conflits ayant pour but la
possession de l'Acadie.
Les Britanniques ont capturé Annapolis Royal, appelé Port Royal sous le
Régime français, en 1710. Le 9 juin 1711, une soixantaine de soldats
britanniques d'une garnison de 500 hommes quittent les fortifications
d'Annapolis Royal afin de découvrir pourquoi les Acadiens locaux ne
fournissent que la moitié du quota d'arbres nécessaires aux réparations
du fort et pour les contraindre de répondre à la demande. Le lendemain,
les troupes britanniques se déplaçant à bord de trois vaisseaux, sont
tombés sur une embuscade préparée par les forces françaises prévenues,
près d'un passage étroit de la rivière LaHave, et sont tués ou faits
prisonniers.
La deuxième attaque contre la garnison britannique d'Annapolis Royal à
Bloody Creek est une conséquence de la Déportation des Acadiens en 1755.
Des groupes itinérants d'Acadiens dépossédés apparaissent régulièrement
autour des fortifications britanniques pour abattre des soldats
lorsqu'ils le peuvent. En 1757, les 130 soldats britanniques envoyés
détruire des bandes d'Acadiens tombent de nouveau dans une embuscade,
cette fois du côté ouest du pont qui enjambe le ruisseau Renne Forest,
ultérieurement rebaptisé Bloody Creek. Les Acadiens ouvrent le feu alors
que les troupes britanniques tentent de traverser le pont et tuent 18
soldats. Ils perdent également sept des leurs. Les deux batailles
témoignent des tactiques de guérilla utilisées par les soldats français
et leurs alliés au cours de la période d'instabilité allant de la moitié
à la fin du XVIIIe siècle en Acadie.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1982 |
Lieu historique national du Canada du Bureau-de-Poste-de-Truro
Truro, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada du Bureau-de-Poste-de-Truro est un
immeuble en brique de deux étages et demi qui a été construit à la fin
du XIXe siècle. Il est situé sur un terrain d'angle bien en vue au
centre-ville de Truro.
Le bureau de poste de Truro a été désigné lieu historique national en
1983 parce qu'il est représentatif des petits bureaux de poste urbains
conçus par Thomas Fuller; il se caractérise par sa valeur
architecturale, c'est-à-dire que son extérieur n'a pas subi de
changements importants, et il est en harmonie avec son environnement.
Le bureau de poste de Truro, érigé entre 1883 et 1886, est un bon
exemple des bureaux de poste construits par le ministère des Travaux
publics dans les petits centres urbains à l'époque où Thomas Fuller
était architecte en chef (1881-1886.) Il est représentatif des bureaux
de poste conçus par Thomas Fuller à cause de ses deux étages et demi, de
ses matériaux de haute qualité, de son mélange d'éléments gothiques et
romans, et de son implantation bien en vue sur un terrain
d'angle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada>

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Canal-de-St. Peters
St. Peter's, Nouvelle-Écosse
Canal ouvert à la navigation; constructions datant du XIXe
siècle.
Le canal de St. Peters (800 m de long) relie l'océan Atlantique au lacs
Bras d'Or. Son aménagement, commencé en 1854, a été terminé en 1869.
Venez découvrir les expositions d'interprétation, déguster un
pique-nique, ou encore faire de la navigation de plaisance sur le canal.
St. Peters est à l'emplacement du fort Saint-Pierre, un poste de traite
fortifié du XVIIe siècle acquis par Nicolas Denys en 1650 pour commercer
avec les Mi'kmaq. St. Peters est aussi à l'emplacement de Port Toulouse,
une colonie française avec une présence militaire témoignant de la
rivalité entre les Anglais et les Français de 1713 à 1758.
Le lieu historique national du Canada du Canal-de-St. Peters est une
voie d'eau artificielle qui relie les lacs Bras D'Or à la baie de St.
Peter's dans l'océan Atlantique, à St. Peter's en Nouvelle-Écosse, et
les paysages associés.
Le canal de St. Peters a été désigné lieu historique national du Canada
parce qu'il fait partie du système de canaux du Canada.
La valeur patrimoniale du canal de St. Peters a trait au paysage
culturel directement associé à la construction et à l'exploitation du
canal, y compris les zones continentales et les nappes d'eau qui ont été
modifiées, creusées à l'explosif, étagées ou draguées, pendant toutes
les étapes de construction et d'exploitation du canal.
Le canal de St. Peters a été construit en plusieurs phases entre 1854 et
1869, puis il a été élargi deux fois. Il est exploité, sans
interruption, depuis sa construction à titre d'installation de transport
de marchandises commerciales et industrielles au XIXe siècle et au début
du XXe siècle. Plus récemment, il a été consacré à la navigation de
plaisance.
|

©Canadian Navy, Department of National Defence / Marine canadienne, ministère de la Défense nationale |
Lieu historique national du Canada du Chantier-Naval-d'Halifax
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada du Chantier-Naval-d'Halifax est
situé sur le littoral de l'océan Atlantique à la limite nord du port
d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Il est composé principalement de quais,
d'entrepôts d'emmagasinage, ainsi que d'installations de réparation,
d'entretien et de radoubage. Composante de la Base des Forces
canadiennes (BFC) Halifax, le site est toujours utilisé à titre de dépôt
naval, pour l'accostage et l'entretien des navires militaires.
Créé en 1758, sous la supervision du capitaine James Cook, le chantier
naval d'Halifax a été le premier chantier naval royal en Amérique du
Nord. De 1760 à 1815, la Grande-Bretagne était presque continuellement
en guerre, et le chantier naval a pris de l'ampleur de façon constante
pour répondre aux besoins de la Royal Navy. Il a servi comme le dépôt
principal de l'escadron de l'Amérique du Nord jusqu'à 1819, lorsqu'il
fut remplacé par les Bermudes, et est devenu le lieu de rendez-vous
estival pour les escadres des Antilles et de l'Amérique du Nord. En
1905, les Britanniques ont quitté le chantier naval qui a été cédé au
Dominion du Canada cinq ans plus tard.
Suite à la Révolution américaine, le chantier naval d'Halifax est devenu
par défaut le plus ancien port militaire en Amérique du Nord
britannique. Occupé par la Marine royale du Canada, sa fonction
militaire a été maintenue activement et s'est révélée essentiel dans la
défense stratégique notamment pendant la Révolution américaine, la
guerre de 1812 et la Première Guerre mondiale. Malgré la construction
sur le site de plusieurs nouveaux bâtiments pendant la Première Guerre
mondiale, l'explosion du Mont-Blanc, en 1917, à Halifax, a détruit un
grand nombre de structures. Sous l'administration des Forces maritimes
de l'Atlantique (FMAR), le Chantier Naval d'Halifax continue à être
utilisé par la Marine canadienne.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Citadelle-d'Halifax
Halifax, Nouvelle-Écosse
Fort britannique en maçonnerie construit entre 1828-56; ouvrage
restauré.
La citadelle d'Halifax, vaste fortification britannique en pierre datant
du début du XIXe siècle, est située au sommet de la colline de la
citadelle à Halifax, Nouvelle-Écosse. L'enceinte est entourée d'un vaste
glacis gazonné qui descend jusqu'au terrain communal, du côté ouest, et
jusqu'au centre ville, du côté est. Il s''git de la principale
fortification d'un réseau d'ouvrages défensifs qui, à travers
l'histoire, ont protégé Halifax, son chantier naval et son port.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la
Citadelle-d'Halifax se reflète dans son emplacement imposant, dans la
lisibilité de son paysage culturel (tel que trouvé) comme fortification
importante du XIXe siècle et dans l'intégrité des vestiges des XVIIIe,
XIXe et XXe siècles de ce paysage. Ces caractéristiques comprennent
toutes les ressources historiques liées à la défense de la ville du côté
terrestre et aux défenses portuaires protégeant la base navale.
Bien que la citadelle d'Halifax ait été établie en 1749 en tant que
poste britannique, le fort actuel date de la période de 1828-1856 et
constitue une quatrième génération d'ouvrages défensifs. La citadelle a
été occupée par les forces britanniques jusqu'en 1906, puis par l'armée
canadienne pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'elle servait de
camp de détention, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'elle
était le quartier général des opérations de défense anti-aérienne pour
Halifax. Désignée lieu historique national en 1956, elle a depuis été
restaurée et ouverte au public.
|

©Kate MacFarlane, Parcs Canada, 2018 |
Lieu historique national du Canada de Gannes-Cosby House National Historic Site
Annapolis Royal, Nouvelle-Écosse
La maison de Gannes-Cosby est située au 477, rue St. George, dans le quartier
historique d'Annapolis Royal. La maison d'origine, construite en 1708, est un
rare exemple subsistant encore de nos jours de l'architecture résidentielle
acadienne d'avant l'expulsion et en reflète des caractéristiques typiques comme
la charpente de bois, le remblai en clayonnage et torchis, et la fondation en
pierre des champs. Elle a été soigneusement restaurée, et plusieurs de ses
caractéristiques intérieures et extérieures d'origine – y compris les planches
massives au sol, les poutres, les panneaux muraux, les cheminées et les sections
de remblai en clayonnage et torchis – sont intactes. En tant que résidence de
deux figures militaires éminentes et influentes, le major Louis de Gannes de la
Falaise et le major Alexander Cosby, qui a servi en tant que
lieutenant-gouverneur du fort et de la ville d'Annapolis Royal, cette maison
témoigne des Régimes français et britannique et illustre le type de résidences
construites puis habitées par la classe d'officiers coloniaux lors des débuts de
cet établissement.
Fondée au sein du Mi'kma'ki, les terres traditionnelles des Mi'kmaq, Annapolis
Royal était autrefois connue sous le nom de Port-Royal, et était la capitale de
la colonie française d'Acadie entre 1605 et 1710. À une ère où les empires
français et britannique luttent pour la suprématie en Amérique du Nord,
Port-Royal a été assiégée et capturée plusieurs fois par les Britanniques. La
maison est construite en 1708 par le major Louis-Joseph de Gannes de Falaise, un
noble français et officier de garnison arrivé à Port-Royal en 1701. La maison
est reconstruite sur l'ancienne fondation d'une première maison qui fut rasée
lors du siège de Port-Royal par les Britanniques en 1707. Après la prise
définitive de Port-Royal par les Britanniques en 1710, de Gannes de Falaise
retourne en France et la maison est confisquée par la Couronne britannique. Elle
sert ensuite de résidence au lieutenant-gouverneur de la ville et du fort, en
commençant par le major Alexander Cosby. Cosby vit dans la maison avec sa femme
à partir de 1727, puis elle y vit seule après la mort de son mari jusqu'en 1788.
Aujourd'hui, la maison de Gannes-Cosby est un bâtiment rectangulaire d'un étage
et demi avec une aile en retour. Les murs, dont la construction est faite de
poteaux et de poutres, sont à l'origine finis avec de l'argile et du torchis. La
maison repose sur une fondation en moellons, et elle est revêtue de bardeaux de
bois. La maison est dotée d'une toiture en mansarde distinctive avec deux
lucarnes latérales à fronton (ajoutées au XXe siècle). L'aile, construite vers
1870, comporte trois lucarnes à pignon avec surplombs. Elle est
intentionnellement peinte d'une couleur différente et plus claire pour la
distinguer de la partie principale (1708) de la maison. La maison de 1708 est
conçue en fonction d'un hall central, avec un salon de pleine longueur du côté
sud et deux pièces du côté nord. Au deuxième étage se trouvent trois chambres
(une grande du côté sud et deux plus petites au nord) et une salle de bain
moderne. L'annexe, à l'arrière de la maison, comporte une salle à manger
officielle avec une cuisine d'été et un garde-manger au rez-de-chaussée, ainsi
que deux chambres et une salle de bain à l'étage.
Depuis 1788, la maison a été louée, puis vendue, de nombreuses fois. Les
propriétaires actuels ont passé des années à restaurer la maison et à la meubler
avec des articles d'époque. Aujourd'hui, l'importance de cette maison est bien
reconnue par la communauté.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, David Henderson, 2005 |
Lieu historique national du Canada du Débarquement-de-Wolfe
Kennington Cove, Nouvelle-Écosse
Débarquement réussi qui a entraîné la prise de Louisbourg, 1758.
Le lieu historique national du Canada du Débarquement-de-Wolfe est situé
à Kennington Cove, sur la côte est de l'île du Cap-Breton, en
Nouvelle-Écosse. Entièrement compris dans les limites du lieu historique
national du Canada de la Forteresse-de-Louisbourg, le lieu est bordé au
sud par une plage rocheuse, tandis qu'il est ceinturé au nord, à l'est
et à l'ouest par une région onduleuse d'herbe et de forêt. Durant la
guerre de Sept Ans, les forces britanniques ont lancé une attaque
réussie à partir de ce lieu sur les forces françaises basées à
Louisbourg. Le lieu comprend l'anse et ses deux plages modernes, de
nombreux sentiers, ainsi que le cairn de la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada.
La bataille de la forteresse française de Louisbourg est l'un des
affrontements décisifs entre les Britanniques et les Français pour la
possession du territoire nord-américain. La guerre de Sept Ans fait rage
depuis deux ans lorsque les forces britanniques assiègent la forteresse
de l'île du Cap Breton. Le 8 juin 1758, le Brigadier-général James
Wolfe, sous les tirs intenses des troupes françaises, réussit à faire
débarquer un groupe d'infanterie légère sur la plage rocheuse non
protégée de Kennington Cove, que les Français appellent anse de la
Cormorandière. Ce débarquement permet à Wolfe et à ses troupes de lancer
une attaque surprise contre les Français, qui par crainte devant cette
attaque et ignorant le nombre d'hommes qu'ils rencontreraient, battent
rapidement en retrait vers la forteresse de Louisbourg. Pendant des
semaines, les troupes britanniques débarquent, puis chassent les troupes
françaises des ouvrages défensifs, ce qui leur permet d'assiéger
Louisbourg. La forteresse française capitule vers la fin de juillet
1758, mettant ainsi fin à la période de domination française au
Cap-Breton.
|
|
Lieu historique national du Canada des Défenses-Côtières-de-la-Seconde-Guerre-Mondiale-d'Halifax
Halifax, Nouvelle-Écosse
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Marine et l'Aviation royales du
Canada protégèrent les navires marchands qui ravitaillaient les Alliés
par la voie de l'Atlantique-Nord. Des unités de l'Armée de terre
participèrent à la défense des ports essentiels à ce trafic. En dépit de
l'acharnement des sous-marins allemands et de lourdes pertes, les routes
de l'Atlantique demeurèrent ouvertes. Le mieux défendu du Canada, le
port d'Halifax fut le principal lieu de rassemblement des convois à
destination de l'Europe et joua un rôle clé dans la livraison des
matériaux indispensables à l'effort de guerre.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, HRS #, 2006 |
Lieu historique national du Canada des Défenses-Côtières-de-la-Seconde-Guerre-Mondiale-de-Sydney
Sydney, Nouvelle-Écosse
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Marine et l'Aviation royales du
Canada protégèrent les navires marchands qui ravitaillaient les Alliés
par la voie de l'Atlantique-Nord. Des unités de l'Armée de terre
participèrent à la défense des ports essentiels à ce trafic. En dépit de
l'acharnement des sous-marins allemands et de lourdes pertes, les routes
de l'Atlantique demeurèrent ouvertes. Lieu de rassemblement des convois,
Sydney joua un rôle important dans cette lutte. Sept batteries côtières
protégeaient ses vastes chantiers navals, son hydrobase et son terrain
d'aviation.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Édifice-de-l'Amirauté
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de l'Édifice de l'Amirauté est une
imposante maison bourgeoise en pierre de deux étages située dans
l'enceinte du site Stadacona, dans la base des Forces canadiennes de
Halifax. Ses origines britanniques ressortent dans l'austérité de ses
matériaux de pierre et sa conception néo-classique sobre. Il fut
autrefois la résidence du commandant en chef du poste nord-américain de
la Marine royale. Aujourd'hui, il abrite le Musée du Commandement
maritime.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à ses liens historiques avec
la Marine royale, ainsi qu'aux éléments physiques et conceptuels qui
attestent son style britannique classique. Cette maison, bâtie de 1815 à
1819 pour héberger le commandant en chef du poste nord-américain de la
Marine britannique, a été achetée en 1904 par le gouvernement canadien
pour abriter ses forces militaires de Halifax. Depuis, il a servi à
différentes fins. En 1917, il a été endommagé lors de l'explosion dans
le port de Halifax, puis réparé. Pendant de nombreuses années, on y
trouvait encore le mess des officiers et des bureaux.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Édifices-des-Quais-d'Halifax
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le LHNC des Édifices des quais de Halifax comprend les anciens entrepôts
en pierre et en bois situés sur les quais qui, réhabilités à des fins
commerciales et administratives, abritent des bureaux, des boutiques et
des restaurants.
Les Édifices des quais de Halifax ont été désignés lieu historique
national du Canada, car il s'agit du site le plus important du complexe
de la pré-Confédération des bâtiments commerciaux maritimes du Canada.
La valeur patrimoniale du lieu réside dans les bâtiments, de style
entrepôt, regroupés sur les quais; dans leur plan irrégulier de nature
fonctionnelle et dans leurs matériaux et techniques de construction qui
sont respectivement massifs et simples. La construction de ces bâtiments
remonte au début du XIXe siècle. Toutefois, tout au long de ce siècle,
des modifications et des ajouts y ont été effectués. Les édifices, par
leurs dimensions modestes et leurs matériaux de construction durables,
témoignent de la richesse commerciale de la société haligonienne au XIXe
siècle. La réhabilitation des bâtiments effectuée en 1972-1973 a permis
de redonner, en grande partie, à l'extérieur des bâtiments leur
apparence des années 1900, ainsi que de réaménager leur intérieur à de
nouvelles fins commerciales et d'assainir les lieux.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1984 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. George / Église-Ronde
Halifax, Nouvelle-Écosse
L'Église anglicane St. George est une église circulaire en bois de style
palladien, avec des ouvertures simples et élégantes et une finition
polie. Situé au centre-ville de Halifax, ce bel édifice a des liens avec
cette l'histoire de ville et avec la Royauté.
La construction de l'église St. George, connue davantage sous le nom d'«
église ronde », a commencé en 1800. Sa construction permet d'offrir plus
d'espace de culte alors que jusque là, c'est l'église "Little Dutch",
située à proximité, qui recevait les fidèles. St. George est le seul
exemple d'église ronde du XIXe siècle au Canada. Son architecture
sophistiquée atteint un niveau d'excellence inégalé au Canada. Elle doit
sa conception inhabituelle au Duc de Kent, commandant militaire de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick de 1794 à 1800, et son plan est
attribué au maître-charpentier de marine William Hughes. Endommagée par
l'explosion du port de Halifax en 1917, puis par un incendie dévastateur
en 1994, l'église a subi d'importantes restaurations, mais elle conserve
ses lignes classiques et ses proportions harmonieuses.
|
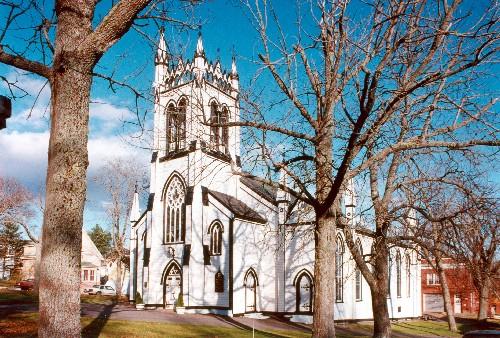
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1998 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. John
Lunenburg, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. John est
une imposante église en bois peint en blanc, de style gothique «
Carpenter », située au cœur de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse. Cette
église, considérée comme un symbole important de la ville, a constamment
évolué au cours d'une période d'environ 250 ans. Elle a été très
récemment remise en état, suite à un incendie désastreux en 2001.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à ses liens avec l'histoire de
la Nouvelle-Écosse, la ville de Lunenburg et son architecture. Sa
disposition, son emplacement et les éléments de sa conception, ainsi que
les articles ayant survécu à l'incendie de 2001, reflètent ces valeurs.
L'église anglicane St. John a été construite initialement de 1754 à
1763, puis agrandie en 1840, au cours des années 1870 et à nouveau en
1889. Suite à un incendie désastreux en 2001, l'ouvrage a été
reconstruit sur les ruines de l'édifice.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1994 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. Paul
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. Paul est
situé bien en évidence en face de la place Grand Parade, dans le cœur
historique d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Il s'agit d'une petite église
en bois de conception classique avec un toit à pignon et un clocher
central. Sa conception et ses magnifiques ornements classiques évoquent
ses liens avec l'établissement de la ville par les Britanniques au
XVIIIe siècle.
L'église anglicane St. Paul, achevée en 1750, a été la cathédrale du
diocèse de la Nouvelle-Écosse de 1787 à 1864 et Charles Inglis en devint
le premier évêque. Elle a également été pendant 96 ans l'église
officielle de la garnison des forces locales de l'armée et de la marine
britannique. Sa conception, qui provient probablement d'un catalogue de
plans, s'inspire de celui de St. Peters, église conçue par James Gibbs
située sur Vere Street, à Londres, en Angleterre. À ce titre, l'église
anglicane St. Paul est représentative du début et de l'évolution du
style palladien au Canada. Malgré son agrandissement en 1812, et l'ajout
ultérieur d'ailes latérales en 1868 et du chœur en 1873, l'ossature de
bois d'origine (pré-coupée à Boston) constitue toujours le corps
principal de l'église. En 1926, on a reconstruit le porche nord, et paré
le clocher de cuivre. De 1984 à 1990, l'église a été méticuleusement
restaurée.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-Trinity
Digby, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-Trinity est
une grande église de bois située dans un lotissement boisé, à côté d'un
cimetière, à Digby en Nouvelle-Écosse. Cette église à la conception
hardie présente le rationalisme fonctionnel et structural du mouvement
néogothique religieux. La disposition des espaces intérieurs est
clairement reflétée à l'extérieur par un empilement pyramidal de formes
menant à un toit très pentu et à une flèche proéminente. La structure de
bois de l'édifice se révèle grâce à un treillis de bois apparaissant
autour des portes et des fenêtres, ainsi que sur sa surface.
Conçue par l'architecte américain Stephen C. Earle, cette église, bâtie
en 1878, constitue un très bel exemple du style néogothique dans son
interprétation en bois. Sa configuration extérieure, inspirée de celle
des églises paroissiales britanniques du Moyen-Âge, définit clairement
les principaux espaces intérieurs, à savoir la nef, le chœur et les nefs
latérales. Un motif attrayant formé de planches verticales et
horizontales, utilisé aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, souligne
la charpente de bois de l'église. L'Église anglicane Trinity a remplacé
l'église originelle bâtie sur ce site en 1788 par les Loyalistes.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada 1993 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-des-Covenantaires
Grand-Pré, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de l'Église-des-Covenantaires est
un charmant bâtiment de bois bien proportionné de style classique,
représentatif des temples érigés en Nouvelle-Angleterre au XVIIIe
siècle. Une tour carré coiffée d'un petit clocher et d'une flèche
agrémente les proportions harmonieuses de cette église modeste de deux
étages à structure rectangulaire. Sa symétrie, son fenêtrage régulier et
l'entrée centrale témoignent du souci accordé aux détails lors de sa
construction. Son parement sobre et modeste est en harmonie avec son
emplacement dans un enclos paroissial boisé bien entretenu et ceint d'un
petit mur de pierre. Située sur une colline qui surplombe Grand-Pré en
Nouvelle-Écosse, l'église fait aussi partie du lieu historique national
du Canada de l'Arrondissement-Rural-Historique-de-Grand-Pré.
La valeur patrimoniale de l'église des covenantaires tient au fait
qu'elle ressemble aux temples de la Nouvelle-Angleterre. Construite
entre 1804 et 1811, à l'origine, la petite église ne comportait pas de
tour comme les temples presbytériens. Elle a reçu l'appellation de «
covenantaire » quelques décennies plus tard, lorsque la congrégation a
renouvelé le covenant conclu par ses ancêtres. La structure
rectangulaire et la façade latérale à cinq baies avec l'entrée
principale sont caractéristiques des temples érigés en
Nouvelle-Angleterre au XVIIIe siècle, même si les fenêtres du deuxième
étage et les galeries intérieures sont plus ouvragées qu'à l'habitude.
L'aménagement intérieur comporte une chaire haute et un abat-voix
octogonal ainsi que de magnifiques boiseries et lambris. Cette chapelle
au plan latéral a été surmontée d'une tour et d'une flèche sur une des
façades à pignon.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1965 |
Lieu historique national du Canada de l'Église « Little Dutch »
Halifax, Nouvelle-Écosse
Situé à l'extrémité nord d'Halifax, le lieu historique national du
Canada de l'Église « Little Dutch » se trouve sur un cimetière évocateur
du XVIIIe siècle entouré d'un mur de pierre. L'église, un bâtiment de
bois de dimension modeste, représente un vestige de la période ayant
suivi la fondation de la ville d'Halifax. Sa forme rectangulaire simple,
son toit à deux versants et son clocher à flèche contrastent avec
l'architecture des manoirs du XIXe siècle et celle des édifices en
hauteur du XXe siècle.
L'église « Little Dutch » est située sur un cimetière qui avait été
réservé en 1752 aux immigrants d'origine allemande, un groupe uni par
leur langue et leur foi, qui venaient d'arriver à Halifax. En 1756, ce
groupe achète un bâtiment qui est déplacé sur le cimetière et converti
en église. En 1758, les paroissiens, sous la direction du menuisier
Christopher Cleestattel, terminent l'aménagement intérieur du bâtiment.
En 1760, l'église est agrandie au nord pour accueillir un clocher dans
lequel résonne une cloche provenant de Louisbourg. Le cimetière continue
d'accueillir des défunts pendant la plus grande partie du XIXe siècle,
et un mur de pierre est érigé sur son pourtour en 1919.
Même si l'église offre des services religieux luthériens, elle fait
officiellement partie de la paroisse anglicane de St. George's.
Cependant, l'augmentation des colons anglophones dans la région et la
construction de l'église ronde de St. George's en 1800 amène la petite
église à jouer un rôle religieux de moins en moins important. Elle sert
d'école et de centre communautaire pour les Canadiens d'origine
allemande au cours du XIXe siècle et, à l'exception de quelques
réparations et rénovations, demeure essentiellement dans son état
d'origine.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Miriam Walls, 2006 |
Lieu historique national du Canada de l'Encampement-d'Anville
Halifax, Nouvelle-Écosse
Campement en expédition française échouée pour récupérer l'Acadia,
1746.
Le lieu historique national du Canada de l'Encampement-d'Anville est
situé sur une petite parcelle de terrain, dans le parc du centenaire,
dans le Bedford Basin, à Halifax, en Nouvelle Écosse. C'est à cet
endroit, sur la plage, en 1746, que le duc d'Anville a établi son
campement lors de l'expédition infructueuse lancée par la France pour
reprendre l'Acadie. Le lieu comprend une plaque et un cairn de la
Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC) au parc
du centenaire, ainsi qu'à la parcelle de cinq mètres de rayon dont ils
occupent le centre. À ce jour, il n'y a aucun vestige connu associé au
campement établi par le duc d'Anville en 1746 et dont d'ailleurs
l'emplacement précis demeure inconnue.
Une année après la prise de Louisbourg par les Britanniques en 1745, la
France commande une flotte de navires de guerre de traverser
l'Atlantique afin de reprendre et détruire la forteresse, s'emparer
d'Annapolis et attaquer Boston. Cette expédition est dirigée par Jean
Baptiste Louis Frédéric de La Rochefoucauld de Roye, marquis de Roucy et
duc d'Anville, aussi connu sous le nom de duc d'Anville ou simplement
d'Anville. Au départ, l'imposante flotte comprend 70 navires, 10 000
matelots et plus de 3 000 soldats. À son arrivée à Chebucto (port de
Halifax) le 10 septembre 1746, la flotte d'Anville ne compte plus que
trois navires de guerre et quelques transporteurs, les autres navires
ayant été mis en déroute ou coulé en raison de tempêtes violentes.
Beaucoup d'hommes ont péri principalement à cause du manque de vivres,
du typhus, de la dysenterie et du scorbut. Le reste de l'équipage campe
sur la plage où nombre d'entre eux succombent encore à la maladie. Le 27
septembre, d'Anville meurt à son tour, et le commandement de la flotte
revient à Jacques-Pierre de Taffanel de la Jonquière, Marquis de La
Jonquière, qui deviendra gouverneur du Canada quelques années plus tard.
En octobre, La Jonquière retourne en France avec le reste de l'équipage
tout en perdant d'autres navires et hommes à la suite de tempêtes et de
la maladie.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, S. Quon, 2001 |
Lieu historique national du Canada de l'Établissement-Melanson
Lower Granville, Nouvelle-Écosse
Collectivité agricole acadienne d'avant la déportation
(1664-1755).
Le lieu historique national du Canada de l'Établissement-Melanson est
constitué des vestiges d'un établissement agricole familial acadien des
XVIIe et XVIIIe siècles, installés sur le bord de la rivière Annapolis.
Il se compose d'une terrasse endiguée comportant des vestiges
archéologiques enfouis, située dans les marais salés de la rivière
Annapolis.
L'établissement Melanson a été désigné lieu historique national du
Canada en 1986 en raison de la présence à cet endroit de ressources
associées aux communautés familiales fondées par les Acadiens le long de
la rivière Dauphin (aujourd'hui la rivière Annapolis) et au
développement de pratiques agricoles uniques en Amérique du Nord.
La valeur patrimoniale réside dans l'esprit des lieux – les liens
visuels immédiats entre les particularités géographiques et la vie à cet
endroit à l'époque des Acadiens, la clarté et la perspective d'ensemble
de la vue, de même que les ressources sur place qui datent de la période
acadienne.
L'établissement a été aménagé sur le cours inférieur de la rivière
Annapolis par Charles Melanson et Marie Dugas, après leur mariage en
1664. Il a par la suite été occupé par quatre générations de la même
famille, avant la déportation des Acadiens en 1755. À l'époque, il était
composé du village familial installé sur une terrasse et de champs
cultivés sur de vastes marais salés endigués.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Exploitation-Houillère-de-Springhill
Springhill, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de
l'Exploitation-Houillère-de-Springhill est une ancienne mine de charbon
située dans un parc industriel de Springhill, en Nouvelle-Écosse. On y
trouve en surface et sous terre des installations minières propres à la
Nouvelle-Écosse, dont les entrées des tristement célèbres mines nos 2 et
4, une série de bâtiments en briques ainsi qu'un bassin et un système de
déversoir ayant servi au fonctionnement des moteurs à vapeur employés
pour le levage. Le principal attrait du lieu demeure cependant le
bâtiment d'un étage en briques rouges appelé la lampisterie et datant du
début du XXe siècle.
La valeur patrimoniale de l'Exploitation-Houillère-de-Springhill réside
dans ses associations historiques à l'industrie du charbonnage en
Nouvelle-Écosse, de la fin du XIXe siècle jusque dans les années 1940.
L'extraction du charbon à Springhill commença en 1873, année marquant le
début d'intensives activités de charbonnage au Canada. Entre 1867 et
1914, la Nouvelle-Écosse fut est la plus grande productrice de charbon,
profitant de débouchés favorables pour le combustible domestique et
industriel ainsi que des mesures de protection des tarifs adoptées après
la Confédération, qui favorisèrent l'expansion de l'activité
industrielle en Nouvelle-Écosse. Les terrains houillers de Springhill
jouèrent un rôle prépondérant dans l'approvisionnement des provinces
maritimes, du Québec, de l'industrie ferroviaire et des usines au début
du XXe siècle. Les ressources in situ minières présentes sur le site
témoignent des thèmes importants de l'exploitation houillère, y compris
les rôles de l'entrepreneuriat, de la main d'œuvre, de la technologie et
l'importance des communautés minières.
La question de la sécurité fut cruciale pour les mineurs. En effet, le
métier de mineur fut à l'époque l'un des plus dangereux au Canada pour
toutes sortes de raisons : présence de roches tendres, émanation de gaz,
difficulté de ventiler les espaces de travail, exiguïté des lieux de
travail et utilisation d'explosifs. À mesure que s'accroissait le nombre
de travailleurs, de grandes catastrophes commencèrent à se produire dans
les mines, comme par exemple celle qui, en 1891, fit 125 victimes dans
une mine de Springhill. Par la suite, les mines nos 2 et 4 de Springhill
devinrent tristement célèbres à la suite de deux grandes tragédies qui
s'y produisirent en 1956 et en 1958.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Fernwood
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada Fernwood est une villa de style
néo-gothique avec dépendances, bâtie sur un vaste terrain paysager au
flanc d'une colline menant au bras Nord-Ouest, à Halifax,
Nouvelle-Écosse.
La villa Fernwood a été désignée lieu historique national en 1990 parce
qu'elle est un bel exemple de villa néo-gothique.
La valeur patrimoniale du lieu réside dans son expression du style
néo-gothique appliqué aux résidences de banlieue à la fin du XIXe
siècle. La villa constitue un type particulier de résidence :
suffisamment grande pour exiger la présence de domestiques, mais pas
assez pour paraître prétentieuse, elle était en outre bâtie sur un lot
paysager. Conçue dans un style choisi avec soin, la villa proposait un
mode de vie associé au confort, au calme bucolique, à l'existence sans
conteste privilégiée d'un gentleman-farmer.
Fernwood a été conçue par l'architecte David Stirling et construite à
Halifax vers 1860.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, P. McCloskey, 1974

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1994

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, T. Grant, 1977 |
Lieu historique national du Canada du Fort-Anne
Annapolis Royal, Nouvelle-Écosse
Fortifications construites entre 1695 et 1708.
Le lieu historique national du Fort-Anne est un site fortifié situé dans
la ville d'Annapolis Royal, au confluent des rivières Annapolis et
Allain. Érigé en 1629, le fort est constitué de vestiges de divers
édifices et fortifications des XVIIIe et XIXe siècles. Il est entouré de
terres et offre des vues sur les marais salants, la rivière et la ville
adjacents. On y trouve les ressources suivantes : la poudrière (1708);
les vestiges d'un fort français de style Vauban (1702-1708) et sa
poudrière souterraine, le puits de son terrain de parade, le puits et le
terrassement du chemin couvert; un mur de soutènement en pierres sèches
(1760); une entrée des véhicules du XIXe siècle; des caissons à
claire-voie sur le littoral et les ruines du quai de la Reine (des
années 1740); les quartiers des officiers anglais (construits de 1797 à
1799 et reconstruits en 1934-35); un cimetière acadien, et un cimetière
de garnison anglaise.
Le Fort Anne a une importance historique nationale à cause du rôle qu'il
a joué au début de la colonisation par les Européens, dans
l'établissement des colons et le gouvernement de l'Acadie et de la
Nouvelle-Écosse; dans la lutte pour le pouvoir qui marqua les XVIIe et
XVIIIe siècles; en tant que carrefour de l'évolution des relations
sociales, politiques et militaires entre les Mi'kmaqs, les Acadiens et
les Anglais vivant dans la région aux XVIIe et XVIIIe siècles, et
exemple de fortifications de style Vauban qui ont survécu à l'épreuve du
temps en grande partie grâce à des générations successives de Canadiens
qui ont su conserver précieusement les paysages culturels du pays.
De 1629 à 1632, des colons menés par Sir William Alexander ont érigé le
fort Charles sur ce site, dans le cadre de son plan d'établissement
d'une nouvelle Écosse. Des colons acadiens se sont installés dans la
région en 1636, avec leur chef Charles de Menou d'Aulnay, qui a fait du
site son quartier général de Port-Royal. Ils n'ont pas tardé à pratiquer
une agriculture particulière qui consistait à assécher les marais au
moyen de digues. Les Français ont alors, depuis des forts érigés
successivement sur le site, gouverné l'Acadie jusqu'en 1710. De 1713 à
1749, les Anglais ont gouverné la Nouvelle-Écosse depuis le fort qu'ils
renomment Annapolis Royal. Au cours du XVIIIe siècle, le fort est témoin
de la déportation des Acadiens et de l'établissement de planteurs de la
Nouvelle-Angleterre et de Loyalistes à Annapolis Royal.
Capitale et centre militaire de l'Acadie et de la Nouvelle-Écosse, le
site a joué un rôle important dans la vie des habitants de la région.
Les Mi'kmaqs y venaient pour faire du commerce, échanger des cadeaux et
signer des traités. Ils y ont été emprisonnés pendant les « guerres
indiennes » des années 1720.
Port-Royal et ses forts successifs ont constitué un point central des
luttes impériales opposant l'Angleterre et la France pour le contrôle du
pouvoir en Amérique du Nord. Après chacune de ces confrontations, la
Nouvelle-Angleterre lançait des expéditions contre Port-Royal dont elle
s'est emparée en 1654, en 1690 et, pour la dernière fois, en 1710.
Pendant la guerre de la Succession d'Autriche (1744-1748), Québec et
Louisbourg ont tenté de reconquérir le fort, mais leurs expéditions se
sont avérées infructueuses.
Fort Anne est un exemple classique du style architectural Vauban. Il a
été conçu et construit par un ingénieur qui s'est inspiré des œuvres de
Sébastien Le Prestre de Vauban, architecte européen connu pour ses
forts. Les habitants de la région, avec l'aide du gouvernement fédéral,
ont commencé à préserver les fortifications dès le début du XIXe siècle.
Le site a été désigné parc du Dominion en 1917, devenant ainsi le
premier lieu historique national géré par le Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |
Lieu historique national du Canada du Fort-Charles
Annapolis Royal, Nouvelle-Écosse
Le fort Charles (anciennement appelé fort Scots) fut érigé en 1629 par
le fils de sir William Alexander.
Situé sous le site restauré du lieu historique national du Canada du
Fort-Anne, aucun élément en surface ne montre où fort Charles était
jadis érigé. Néanmoins, à l'emplacement autrefois occupé par le fort, on
peut y apercevoir le confluent des rivières Annapolis et Allain.
Fort Charles fut érigé par Sir William Alexander en 1629 comme base de
sa colonie de Nouvelle-Écosse, en latin Nova Scotia, pour laquelle le
roi Jacques 1er d'Angleterre et VI d'Écosse lui avaient accordé une
charte en 1621. Cette charte couvrait un territoire géographique composé
aujourd'hui des provinces maritimes et de la péninsule de Gaspé. Au même
moment, les Français appelaient ce territoire Acadie et les Autochtones,
Mi'kmaki. Les colons écossais ont occupé le fort entre 1629 et 1632,
moment où la Nouvelle-Écosse remise à la France dans le cadre d'un
traité de paix. Fort Charles représente un épisode important de
l'histoire des débuts de la colonisation européenne au Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. P. Jérôme, 1991 |
Lieu historique national du Canada du Fort-Edward
Windsor, Nouvelle-Écosse
A joué un rôle dans la lutte pour l'exercice de la suprématie en
Amérique du Nord entre 1750 et 1812; le plus ancien blockhaus au Canada,
1750.
Le lieu historique national du Canada du Fort-Edward se compose d'un
blockhaus en bois, des vestiges des bâtiments défensifs et des éléments
du paysage, caractéristiques d'une fortification du XVIIIe siècle. Le
fort est situé aux abords de Windsor, en Nouvelle-Écosse, à l'embouchure
de la rivière St. Croix dans le lac Pesaquid.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du
Fort-Edward réside dans son témoignage de la présence britannique durant
ce conflit, exprimé notamment par les vestiges du paysage culturel de la
forteresse. Le fort Edward, construit par le major britannique Charles
Lawrence en 1750, était composé à l'origine de plusieurs bâtiments en
bois entourés d'une palissade carrée et de quatre bastions, des
remparts, un fossé, une contrescarpe et un glacis. Les bâtiments
comprenaient un blockhaus, deux baraquements et un magasin pour les
provisions. Le fort Edward fait partie des lieux historiques nationaux
depuis 1922. Son blockhaus a été restauré et ouvert aux
visiteurs.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, P. Kell, 2001 |
Lieu historique national du Canada du Fort-de-l'Île-Grassy
Canso, Nouvelle-Écosse
Centre de pêche britannique au XVIIIe siècle.
Le lieu historique national du Canada du Fort-de-l'Île-Grassy, vestige
de fortifications britanniques du XVIIIe siècle, est situé sur l'île
Grassy, qui fait partie du groupe d'îles au large de la pointe orientale
de la partie continentale de la Nouvelle-Écosse, connu comme étant le
lieu historique national du Canada des Îles-Canso.
La valeur patrimoniale du fort de l'Île Grassy réside dans ses
associations historiques avec l'industrie de la pêche de l'époque
pré-européenne et avec les batailles entre les Français et les Anglais
pour le contrôle du Canada, comme le montrent le lieu et les vestiges
archéologiques. À partir du moment où les îles Canso sont devenues un
centre de lieux de pêche riches, des fortifications ont été construites
deux fois sur le fort de l'île Grassy, pour les protéger. Aucune n'a
subsisté très longtemps. Une petite redoute (1720) et un fort
(1723-1724) ont été construits sur l'ordre du gouverneur de la
Nouvelle-Angleterre Richard Philipps, mais sont tombés en ruine dans les
années 1730. Edward Howe a construit un blockhaus en 1735, qui a été
brûlé par les Français lors d'une attaque en mai 1744.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Philip Goldring, 2003 |
Lieu historique national du Canada du Fort-Lawrence
Fort Lawrence, Nouvelle-Écosse
Fort anglais, 1750-1755.
Le lieu historique national du Canada du Fort-Lawrence, situé sur le
chemin Fort Lawrence, dans le comté de Cumberland, Nouvelle-Écosse, est
un site archéologique se trouvant sur une arête douce entourée par des
terrains de pâturages, du côté est de la rivière Missaguash. L'ensemble
duquel on a construit une ferme laitière. Des éléments archéologiques
concernant ce fort du XVIIIe siècle, anciens remblais et fossés, qui
étaient visibles jusqu'en 1991, pourraient encore subsister sous
l'étable et la cour. On retrouve d'autres vestiges archéologiques sur
l'ensemble de la propriété administrée par Parcs Canada.
Sa région hautement stratégique, le site a été occupé pendant presque un
siècle avant la construction du Fort Lawrence. En 1672, Jacques
Bourgeois et d'autres colons venus de Port-Royal fondèrent le village
acadien de Beaubassin, qui s'est développé dans un village prospère, et
qui fut l'un des plus grands établissements acadiens. En 1750, les
Français mirent le feu au village devant l'avance des troupes anglaises
dirigées par le Major Charles Lawrence et, sous Louis de la Corne,
Chevalier de la Corne, se replièrent sur l'autre rive de la rivière, où
ils s'appliquèrent à sécuriser le territoire. Bien que le Major Lawrence
ait été mandaté pour sécuriser le territoire à l'est de la rivière, ses
forces, incapable de sécuriser l'arête de l'est, furent défaites par les
forces françaises avec ses alliés Acadiens et autochtones. Les
Britanniques replièrent vers Halifax pour revenir à l'automne 1750 du
côté est de la rivière Missaguash, où ils construisirent le Fort
Lawrence, lequel était composé de trois grandes casernes à ossatures de
bois et de deux blockhaus de bois. L'année suivante, les Français
répondirent en construisant le Fort Beauséjour sur la rive d'en face. En
1755, une expédition britannique captura le Fort Beauséjour. Ce dernier
fut rebaptisé Fort Cumberland et devint la garnison britannique. Fort
Lawrence fut abandonné.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Fort-McNab
Halifax, Nouvelle-Écosse
Fort construit en 1889 pour défendre le port de Halifax.
Le lieu historique national du Canada du Fort-McNab est situé sur la
côte sud-ouest de l'île McNabs, à l'entrée du port d'Halifax. Le lieu se
compose des vestiges d'ouvrages défensifs de la fin du XIXe siècle et du
début du XXe siècle, notamment un fort entouré d'une zone tampon et deux
enclaves adjacentes comprenant les projecteurs sud et les appareils de
pointage 1 à 3. Le fort McNab comprend aussi les points de vue
historiques associés à la surveillance et la défense.
La valeur patrimoniale du Fort McNab se reflète dans son emplacement
stratégique sur une île à l'entrée du port d'Halifax et dans ses
vestiges dispersés et variés des ouvrages militaires des années 1880 à
1945 destinés à défendre l'avant-port. Le paysage culturel de l'île
témoigne des changements importants survenus dans la technologie et la
stratégie militaire, montré par l'emplacement, la forme, les matériaux
tels que trouvés et les composantes du fort, les structures associées
aux emplacements des projecteurs, vestiges archéologiques, éléments de
paysage et objets historiques connexes.
Fort McNab a été construit entre 1888 et 1892 pour tenir compte de
l'évolution de la technologie militaire, qui obligeait le déplacement
des ouvrages de défense stratégique d'Halifax de l'arrière-port vers
l'avant-port. Les installations ont été modifiées à plusieurs reprises
afin de suivre les changements technologiques : 1906 (canons plus
puissants), 1914 (projecteurs et changements dans la technologie des
canons), 1914-1918 (batteries de contre-bombardement), 1940-1941
(nouveau poste de commandement de batteries, remplacement de pièces
d'artillerie), 1948 (remise en fonction pendant la guerre froide), 1953
(remplacement de pièces d'artillerie). Le fort a cessé de servir en
1959.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Andrew Waldron, 2010 |
Lieu historique national du Canada du Fort-Sainte-Marie-de-Grâce
LaHave, Nouvelle-Écosse
Premier établissement français permanent en Acadie (1632).
Le lieu historique national du Canada du Fort-Sainte-Marie-de-Grâce est
situé dans une position stratégique à LaHave, en Nouvelle-Écosse, sur
une pointe de terre où la rivière LaHave devient plus étroite. Le
terrain sur lequel le fort d'origine a été construit est maintenant
disparu en raison de l'érosion. Un cairn de la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada, qui marque le lieu, est situé à
proximité de l'emplacement du fort d'origine.
À la suite de la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye, en 1632,
la région entourant la rivière LaHave est rendue aux colons français,
qui décident de fonder des établissements permanents en Acadie, où les
ressources liées à la pêche et à la traite des fourrures sont
abondantes. Le commandant Isaac de Razilly, premier vice-roi et
lieutenant-général de l'Acadie et chevalier de Malte, construit un fort
et fonde la capitale de la colonie. Le fort devient une colonie agricole
d'environ 40 habitants comportant un moulin et une chapelle. Après la
mort soudaine de Razilly en 1636, la plupart des colons partent
s'établir à Port-Royal. Le fort est détruit par un incendie dans les
années 1650.
|

©Mr. Ivan Smith, 2003 |
Lieu historique national du Canada Fort-St-Louis
Port La Tour, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada du Fort-Saint-Louis se trouve à un
kilomètre au sud-est de Port La Tour, un village situé sur la pointe
sud-est de la Nouvelle-Écosse. Il ne subsiste aucun vestige visible de
ce fort construit sous le Régime français dans les années 1620 sur la
pointe Fort, qui donne sur une petite baie de la côte atlantique. En
1629, le fort Saint-Louis représente le tout dernier poste militaire
d'importance dans l'ancienne Acadie. Les Anglais ont tenté de capturer
le fort, sans succès. Le lieu consiste maintenant en un petit terrain
gazonné, où se trouvent un cairn et une plaque de la CLMHC, qui est
entouré d'arbres et de broussailles et qui est bordé à l'ouest et à
l'est par la laisse des hautes eaux de la côte.
Le fort Saint-Louis, un fort français situé près de la pointe sud-est de
la Nouvelle-Écosse, est construit en 1623 par Charles de La Tour pour
servir à la traite des fourrures. En 1629, le fort représente le dernier
fort français en Acadie et est menacé par les colons écossais établis à
Port Royal. En 1630, Claude de La Tour, le père de Charles, a formé une
alliance avec les Anglais et débarque au fort Saint-Louis à la tête
d'une expédition anglo-écossaise qui comprend deux navires de guerre.
Après avoir tenté de convaincre son fils d'abandonner ce dernier
établissement français en Acadie, il lance l'assaut contre le fort, mais
il subit la défaite. Ayant perdu sa réputation auprès des Anglais de
Port Royal, Claude de La Tour et sa femme, d'origine anglaise, sont
autorisés par Charles à vivre sur les terres entourant le fort
Saint-Louis. En 1632, la France reprend le contrôle de l'Acadie.
Certains des vestiges archéologiques qui ont été mis au jour dans le
lieu datent des premières années de l'occupation française.
|


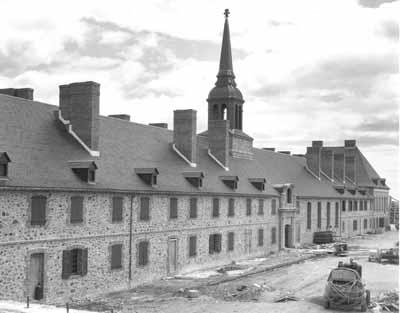
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Forteresse-de-Louisbourg
Louisbourg, Nouvelle-Écosse
Forteresse française du XVIIIe siècle; reconstruction.
Le lieu historique national du Canada de la Forteresse-de-Louisbourg est
la plus grande reconstruction de ville fortifiée française du XVIIIe
siècle en Amérique du Nord, située à l'extrémité sud-est du port de
Louisbourg, près de l'océan Atlantique, et du Cap-Breton, en
Nouvelle-Écosse. Ce lieu se compose du site de la forteresse d'origine,
ainsi que des terres et des îles avoisinantes. Il contient des vestiges
rares attestant le mode de vie des Français et Britanniques venus en
Amérique du Nord au XVIIIe siècle. La forteresse et la ville de
Louisbourg ont été reconstituées en partie pour aider les visiteurs à en
comprendre l'échelle, la complexité et la dimension.
Les Français ont construit la forteresse de Louisbourg pour en faire un
port de pêche, de transbordement et d'approvisionnement, essentiel à
leur empire maritime. À titre de capitale administrative des colonies
françaises établies à l'Île Royale et à l'Île-Saint-Jean, elle abritait
le gouvernement local, une garnison militaire et une population civile.
Il s'agissait aussi d'un important centre commercial pour les bateaux
français sillonnant le monde, et pour le développement d'un empire
commercial nord-américain basé sur les pêches. Ainsi, Louisbourg était
une ville fortifiée qui servait de base stratégique visant à protéger la
lucrative industrie des pêches et le commerce hauturier des Français, et
à surveiller les voies d'accès au golfe du Saint-Laurent, principale
route d'approvisionnement vers le Québec et l'intérieur de l'Amérique du
Nord. Les gouvernements français et britannique se disputaient ce
fleuron de l'établissement français. En 1745 et 1758, les Britanniques
l'ont assiégé et capturé, puis ont systématiquement démoli ses
fortifications de 1760 à 1768, avant d'abandonner la ville au milieu des
années 1780. Parcs Canada a reconstruit environ un quart de la ville
fortifiée (de 1961 à 1981).
La valeur patrimoniale de la forteresse de Louisbourg a trait à ses
liens historiques attestés par les vestiges préservés du paysage
culturel du XVIIIe siècle, ainsi que par l'impressionnante collection
archéologique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1985 |
Lieu historique national du Canada de la Gare de l'Intercolonial à Pictou
Pictou, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de la Gare de l'Intercolonial à
Pictou est une ancienne gare de voyageurs située dans la ville de
Pictou, en Nouvelle-Écosse. Cet édifice rectangulaire en brique de deux
étages présente des éléments du style Château, y compris une maçonnerie
en pierre très ornée, des pignons de style élisabéthain et une serlienne
dans l'ouverture principale. Une marquise court le long de l'édifice
côté quai et sur les élévations côté rue.
La Gare de l'Intercolonial à Pictou a été désignée lieu historique
national du Canada en 1976 parce qu'il s'agit d'une gare conçue par une
compagnie et construite en 1904 pour remplacer le terminus de 1867, qui
avait été construit pour la compagnie du chemin de fer Intercolonial,
ligne publique qui assurait la liaison entre les provinces Maritimes et
le centre du Canada.
La Gare de l'Intercolonial à Pictou est associée à l'expansion et à la
modernisation du chemin de fer Intercolonial au début du XXe siècle,
avant son intégration dans la Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada. Cette période de croissance et de prospérité du chemin de fer
Intercolonial correspondait à un redressement économique général et à
l'augmentation des budgets de l'État. La ligne de Pictou desservait les
installations portuaires de Pictou, qui comprenaient le terminal
ferroviaire pour le trafic à destination de l'Île-du-Prince-Édouard. Le
service pour les voyageurs a été interrompu en 1963. L'ancienne gare de
Pictou a été endommagée par un incendie en 1996, mais elle a été réparée
depuis. Le rez-de-chaussée abrite un musée, une maison de jeunes et des
bureaux pour des activités communautaires.
La valeur patrimoniale de ce lieu tient aux éléments de l'édifice qui
illustrent sa construction originale de terminal de « première classe »
du chemin de fer Intercolonial, notamment le plan, les matériaux et la
décoration qui subsistent encore.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de Grand-Pré
Grand Pré, Nouvelle-Écosse
Rappel du peuplement de la région par les Acadiens et de leur
déportation.
Le lieu historique national du Canada de Grand-Pré est situé dans
l'ancien village acadien de Grand-Pré, près du fond de la baie de Fundy,
au nord de Wolfville, en Nouvelle-Écosse. Le lieu comprend un parc
commémoratif créé pour rappeler la déportation des Acadiens qui s'y
étaient établis entre 1682 et 1755. La désignation comprend des
bâtiments commémoratifs, des vestiges archéologiques, des éléments
paysagers ainsi qu'une collection d'objets témoignant de la présence des
Acadiens sur place.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de
Grand-Pré réside dans le rôle de cet endroit dans l'histoire du peuple
acadien et dans la place centrale qu'il continue d'occuper pour la
diaspora acadienne. Cette valeur se traduit par l'aménagement paysager,
par l'architecture et l'art qui caractérisent les monuments
commémoratifs, et par les preuves tangibles de la présence des premiers
Acadiens.
De 1682 à 1755, le village de Grand-Pré a été le centre de peuplement
par les Acadiens dans la région des Mines, située autour du bassin du
même nom. En 1755, l'endroit servit de quartier général lors de la
déportation de plus de six mille Acadiens en Nouvelle-Écosse, par le
gouvernement britannique. John Frederic Herbin acheta le terrain en 1907
en vue d'y créer un parc commémoratif à la mémoire des Acadiens. En
1917, il a vendu le lieu à la Dominion Atlantic Railway, à l'exception
d'une parcelle qu'il destine à la construction d'une chapelle
commémorative. En 1922, les architectes Percy Nobbs et René Fréchet ont
été respectivement engagés par la compagnie ferroviaire et la Société
Nationale l'Assomption, une société acadienne, pour concevoir un parc
commémoratif et construire une chapelle commémorant la première Église
Saint-Charles. En plus, le sculpteur Philippe Hébert réalise une statue
représentant Évangéline, l'héroïne acadienne du poète Henry Wadsworth
Longfellow. Bien que l'expulsion des Acadiens s'organisa depuis
plusieurs endroits en Nouvelle-écosse, cette région continue d'exercer
un profond attachement auprès des Acadiens à travers le monde. En fait,
depuis des décennies des Acadiens se rendent au lieu, soit seuls soit en
groupes, d'aussi loin que la Louisiane, pour renouer avec leur histoire
et leur patrie ancestrale.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada des Hautes-Terres-du-Cap-Breton
Siège social: Ingonish Beach, Nouvelle-Écosse
Pays de la route Cabot Trail, bordée de falaises spectaculaires.
Le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton est reconnu pour ses
hautes terres et ses paysages côtiers d'une beauté spectaculaire. Des
falaises abruptes et de profondes vallées fluviales découpent le plateau
boisé qui borde l'océan Atlantique. Un tiers du fameux Cabot Trail,
route panoramique de réputation internationale, traverse le parc
national le long de la côte et domine les hautes terres.
En raison du climat maritime frais et du paysage accidenté, le parc
renferme une association unique d'habitats de forêts acadienne, boréale
et taïga, incluant des forêts anciennes d'importance
internationale.
|

©Government House, Jimmy Emerson, 2010 |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-du-Gouverneur
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de l'Hôtel-du-Gouverneur est situé
sur la rue Barrington, dans le centre-ville d'Halifax, près d'autres
lieux d'intérêt du début du XIXe siècle, dont le lieu historique
national du Canada de l'Ancien-Cimetière et le lieu historique national
du Canada Province House. Il s'agit d'un manoir imposant en pierre de
trois étages construit dans le style palladien, au début du XIXe siècle
qui se distingue par la symétrie de son ensemble, les fenêtres à
guillotine double régulièrement disposées, et son pavillon central à
trois étages flanqué d'ailes à deux étages. Il sert de résidence
officielle du lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse. La
reconnaissance officielle concerne l'édifice sur le terrain paysager.
Construit entre 1799 et 1805 pour Sir John Wentworth, gouverneur
colonial de Nouvelle-Écosse, il a servi de résidence officielle pendant
plus de 175 ans. Sir John Wentworth, qui cherchait à faire construire
une résidence qui convienne à son rang, a encouragé le constructeur et
arpenteur Isaac Hildrith à dessiner un édifice qui ressemble davantage
au manoir d'un gentilhomme anglais qu'à la résidence officielle d'un
avant-poste colonial. De style palladien très prisé pour les maisons de
campagne du XVIIIe siècle, l'hôtel du gouverneur présente les formes,
les proportions et les éléments classiques typiques de ce style. Il sert
maintenant de résidence officielle au lieutenant-gouverneur de la
Nouvelle-Écosse.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-d'Halifax
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-d'Halifax est
un édifice monumental municipal de trois étages en pierre, construit de
1887 à 1890. Conçue dans une version victorienne éclectique tardive du
style Second Empire, cette composition élaborée présente une
tour-clocher de sept étages. L'hôtel de ville d'Halifax est situé bien
en vue au centre ville d'Halifax, à l'extrémité nord d'une grande
esplanade, en face de l'église anglicane St. Paul.
L'hôtel de ville d'Halifax est le plus grand exemple d'un bâtiment
municipal administratif des provinces de l'Atlantique. Il illustre le
professionnalisme accru des gouvernements municipaux à la fin du XIXe
siècle. Il est un des rares édifices municipaux à fonction unique
construits avant 1900 dans les centres urbains en pleine évolution du
pays. Les bureaux du premier étage ont été réservés aux employés
municipaux dont les fonctions nécessitaient un large accès public,
tandis que d'autres bureaux, des salles de comités et des salles du
conseil étaient placés au deuxième étage, reflétant le fait qu'on ne
devait pas déranger les réunions du conseil. L'édifice ménageait aussi
des espaces au sous-sol pour le poste de police, la prison et le
tribunal, et au deuxième étage pour une bibliothèque. La présence de
cette dernière signifiait qu'on reconnaissait l'importance d'éduquer les
citoyens.
L'architecture municipale de cette époque reflétait la vision
progressiste des habitants de la ville. La volumétrie horizontale, la
maçonnerie et la haute tour centrale de l'hôtel de ville d'Halifax
soulignent son caractère monumental. Sa conception élégante s'inspire du
style Second Empire, populaire à l'époque pour les édifices municipaux,
et elle présente un mélange éclectique d'ornements classiques fréquent
en architecture victorienne.
L'hôtel de ville, situé à une extrémité d'une grande esplanade, revêt
pour les habitants d'Halifax un caractère central à la fois réel et
symbolique. Dans les plans d'origine de la ville, cet espace public
situé au cœur de la ville d'Halifax a été conçu à titre de place
publique et de terrain d'exercice militaire. L'hôtel de ville occupe
l'extrémité nord de la place, tandis que le lieu historique national du
Canada de l'Église-Anglicane-St. Paul (1750) en borde l'extrémité
opposée. Le Cénotaphe, situé entre les deux édifices, complète cette
place publique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1984 |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-ville-de-Liverpool
Queens, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Liverpool
est un grand édifice de bois de style néoclassique. Il se compose d'un
bloc rectangulaire central de deux étages et demi, avec des rajouts à
l'arrière. Cet ancien hôtel de ville, qui sert maintenant de musée et de
théâtre, est situé sur la rue Main à Liverpool, en Nouvelle-Écosse. Il
est relativement en retrait de la rue, si bien qu'on a pu installer
devant l'édifice un monument aux morts de guerre et un mât
porte-drapeau.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à ses liens historiques avec
la ville de Liverpool, tels qu'illustrés par son site, son emplacement,
sa conception, sa forme et ses matériaux. L'hôtel de ville de Liverpool
a été conçu pour contenir toute une gamme de fonctions communautaires, y
compris non seulement des bureaux municipaux, mais aussi la bibliothèque
municipale, le registre des actes du comté de Queens, et un opéra. Sa
taille et sa conception formelle illustrent la pérennité de l'importance
de Liverpool comme centre commercial au tournant du siècle. L'édifice se
caractérise par sa décoration d'inspiration classique et ses
proportions, ainsi que par sa construction en bois, rare pour les hôtels
de ville de cette taille du début du XXe siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada des Îles-Canso
Canso, Nouvelle-Écosse
Emplacement d'un centre de pêche, du XVIe au XVIIIe siècle.
Le lieu historique national du Canada des Îles-Canso comprend un groupe
d'îles situées au large de la pointe orientale de la partie continentale
de la Nouvelle-Écosse, avec un accès facile aux bancs de pêche
hauturière. Le lieu se compose de l'île Grassy, qui est reliée à l'île
George par une plage de galets. Il comprend également l'île Picatiqui
qui était reliée à l'île George jusqu'en 1779, année où un chenal a été
ouvert entre les deux îles. Ces trois îles ont été, à diverses époques,
connues sous le nom d'île Canso, Grande Île de Canso, îles Canso,
Petites et Grandes Îles Canso, île Canso et cap Ann, îles Canso et
Binney. Plusieurs îlots sont aussi inclus dans le site. Ils se trouvent
au nord des trois plus grandes îles dans un secteur que l'on appelait «
Back of the islands ». Les eaux entre les îles offrent des mouillages
abrités. Le lieu comprend le lieu historique national du Canada du
Fort-de-l'Île-Grassy, situé sur l'île Grassy.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada des
Îles-Canso tient à ses associations historiques avec l'industrie de la
pêche depuis l'époque pré-européenne, et avec les batailles que se sont
livrées les Français et les Anglais pour le contrôle du Canada, comme le
montre la combinaison des éléments naturels et des vestiges des
activités militaires et halieutiques qu'on y trouve.
Les îles du port de Canso ont été un grand centre de pêche de
l'Atlantique nord depuis le XVIe siècle, comme ils ont offert un havre
sûr aux pêcheurs. Les îles Canso, d'abord fréquentée par les Français et
les Basques dans les années 1550, devint un site de pêche prospère pour
la Nouvelle Angleterre durant la première moitié du XVIIIe siècle. Les
pêcheurs y séchaient leurs prises avant de les envoyer en Europe et dans
les Antilles. Jusqu'à sa destruction par les Français en 1744, Canso fut
une des bases économiques de la Nouvelle Écosse et, pour les Anglais, le
centre de la pêche à la morue. La ville de Canso perpétue cette
tradition.
Les îles Canso ont aussi joué un rôle important dans les batailles entre
les Français et les Anglais pour le contrôle du Canada. Par exemple,
dans la première moitié du XVIIIe siècle, elle fut le théâtre de
plusieurs escarmouches entre les Britanniques et les Français avec leurs
alliés les Mi'kmaq. Elle fut aussi la zone d'étape de l'expédition
lancée par les Britanniques contre la place forte française de
Louisbourg en 1745, expédition menée par sir William Pepperrell et sir
Peter Warren.
|

©Clara Dennis, Nova Scotion Museum, Halifax, William Dennis Collection, 1930 |
Lieu historique national du Canada de l'Île Chapel
Chapel Island First Nation, Nouvelle-Écosse
L'île Chapel, qui mesure environ 2 km de long sur 1 km de large, est
située à l'extrémité sud-est du lac Bras D'Or, sur l'île du Cap Breton.
Elle constitue une partie de la plus importante Réserve des Premières
nations de l'île Chapel. Bien avant la colonisation, elle était déjà un
lieu traditionnel de rassemblement et un site sacré pour la nation
Mi'kmaw. La désignation a trait au paysage culturel qui comprend l'île
toute entière, sur laquelle on pense qu'il y a de nombreux vestiges
archéologiques et sépultures anonymes, ainsi que des signes manifestes
d'une activité humaine dans sa partie sud. On y trouve de nombreuses
tombes identifiées, un rocher associé à l'abbé Maillard du XVIIIe
siècle, deux dépressions circulaires, un chemin de croix, des douzaines
de cabines d'été et une petite église.
L'île Chapel est un des principaux lieux de rassemblement des Mi'kmaq
des provinces de l'Atlantique du Canada. Selon la tradition orale
mikmaw, elle a assumé cette fonction depuis bien avant les premiers
contacts avec les Européens. Au XVIIIe siècle, les missionnaires
français ont établi des missions catholiques romaines. Le plus connu
d'entre eux était l'abbé Maillard. Les missions encore en activité sur
l'île Chapel sont au centre de l'importance spirituelle de l'île. Le
rassemblement annuel de la fin juillet pour la fête de Sainte-Anne
attire des Mi'kmaq venant de tous les coins des provinces de
l'Atlantique. On considère toujours que l'île Chapel est un endroit
d'une grande spiritualité qui est le berceau culturel des peuples
Mi'kmaq.
|
 > >
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada
 > >
©Georges Island, Geordie Lounsbury, 2007

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Île-Georges
Halifax, Nouvelle-Écosse
Ouvrages de défense du port de Halifax; comprenant le fort
Charlotte.
Le lieu historique national du Canada de l'Île-Georges est un labyrinthe
d'ouvrages militaires constituant un élément essentiel de la défense
navale du port d'Halifax. Ces ouvrages s'élèvent sur une petite île
située en plein coeur du port, directement face à ce qui est aujourd'hui
le secteur riverain d'Halifax.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de
l'Île-Georges se reflète dans son emplacement géographique et
stratégique au coeur de l'un des plus beaux ports naturels au monde
ainsi que dans la diversité des ouvrages militaires réalisés aux XVIIIe,
XIXe et XXe siècles pour la défense du port intérieur. Le paysage
culturel de l'île témoigne des changements importants survenus dans la
stratégie et la technologie défensives par l'emplacement, la forme et
les matériaux tels que trouvés des ensembles de bâtiments historiques,
des ouvrages du génie, des fortifications, des sentiers, des éléments de
paysage et des vestiges au-dessus et au-dessous du sol et dans l'eau.
La construction des ouvrages défensifs sur l'île Georges a débuté à la
fondation d'Halifax en 1749. D'importants travaux de réfection ont eu
lieu, entre autres, de 1794 à 1812 (escarpe en maçonnerie reliant les
batteries nord et sud, tour Martello en pierre - pièces à âme lisse), de
1864 à 1869 (construction du fort Charlotte, doté de canons-bouches
rayés), de 1870 à 1879 (période de la mine sous-marine) et en 1902
(période des munitions à charge séparée). L'île a continué de jouer un
rôle militaire dans les efforts de guerre du Canada pendant les deux
guerres mondiales. L'île Georges a été désignée lieu historique national
en 1960 et a depuis fait l'objet de travaux de conservation.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |
Lieu historique national du Canada de l'Îlot-Granville
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de l'Îlot Granville est situé dans
la partie sud du centre ville d'Halifax, en Nouvelle Écosse. Il consiste
en un ensemble de 19 bâtiments, la plupart datant de la fin du XIXe
siècle, construits et aménagés sensiblement de la même manière et
présentant une façade de brique ou de pierre et des finitions de stuc.
La majorité de ces bâtiments hébergent un commerce au rez de chaussée,
et la façade de certains d'entre eux est agrémentée d'ornementations en
fonte. De nos jours, les bâtiments font partie du Nova Scotia College of
Art and Design (NSCAD).
Au XVIIIe siècle et pendant la majeure partie du XIXe siècle, à l'époque
où Halifax est au cœur de la distribution et de l'échange des
marchandises, la rue Granville est une importante voie commerçante. En
septembre 1859, un incendie ravage une grande partie du centre ville.
Les bâtiments détruits sont rapidement reconstruits, et l'endroit
commence à se faire connaître pour sa concentration de magasins de
fantaisies, de merceries et d'autres commerces spécialisés
principalement dans les tissus et articles de mercerie.
Reconnues pour leur style d'inspiration italienne, les façades de l'îlot
Granville sont souvent recouvertes de brique ou de pierre, mais parfois
de stuc, ou sont mêmes parées d'ornementations en fonte. Les bâtiments,
généralement de quatre ou cinq étages, comportent des éléments
architecturaux d'inspiration italienne comme des fenêtres cintrées, des
avant toits, des surfaces travaillées avec soin et des bas reliefs. Un
bâtiment composé exclusivement de béton (l'édifice Bell) a été érigé sur
la rue Granville vers 1904; il constitue l'un des plus anciens bâtiments
en béton en Nouvelle Écosse.
Ce lieu a une valeur patrimoniale en raison du rôle qu'il a joué dans
l'histoire de la revitalisation et de la conservation urbaines dans les
années 1970. En 1971 et 1972, une vaste initiative de rénovation
urbaine, visant à créer des espaces pour les commerces et le NSCAD, a
remodelé le centre ville d'Halifax. L'objectif était de moderniser
l'endroit tout en assurant son authenticité, notamment en conservant de
nombreux escaliers d'époque et éléments architecturaux, ainsi qu'en
préservant les murs de lattes et le béton apparent de l'édifice
Bell.
|

©Halifax Public Gardens, Ndh, 2007 |
Lieu historique national du Canada des Jardins-Publics-d'Halifax
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada des Jardins publics de Halifax est
l'un des rares jardins de style victorien préservés au Canada. Il est
situé au centre-ville de Halifax, en Nouvelle-Écosse, et les habitants
de la ville aiment s'y promener pour se détendre. Malgré l'évolution de
la végétation et les dommages causés par les intempéries, la conception
d'origine du XIXe siècle demeure pratiquement intacte, notamment les
massifs du type mosaïque, les feuillages exotiques, les magnifiques
fleurs victoriennes, les espèces subtropicales et les essences d'arbres,
les allées en zigzags, les plates-bandes géométriques, les statues
commémoratives, ainsi qu'un kiosque à musique qui perpétuent les
traditions de cette époque.
Les Jardins publics de Halifax ont été désignés lieu historique national
parce qu'ils constituent un des rares exemples préservés de jardin
public de style victorien. La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à
sa vocation inchangée de jardin public, et au fait qu'il est un exemple
de l'architecture paysagère de type « jardinesque » de l'ère victorienne
et de ses traditions en matière de plantation.
Les Jardins publics de Halifax ont été créés en 1874, suite à la fusion
de deux jardins : le jardin de la Nova Scotia Horticultural Society
(conçu en 1837) et un parc public adjacent (ouvert en 1866). Robert
Power a été engagé en 1872 à titre de surintendant du parc. Il a dessiné
un plan axial symétrique dont s'inspire la conception globale du site.
Au fil des ans, il a supervisé l'installation d'un kiosque à musique
(conçu par l'architecte Henry Busch), de fontaines, de statues et de
portes en fer forgé. En outre, il a créé une mosaïculture, composée
principalement de fleurs annuelles, et a réaménagé l'étang Griffin pour
qu'il serve d'habitat à la sauvagine. Il a également commencé à planter
des essences remarquables, notamment beaucoup d'espèces exotiques et
semi-tropicales. Tous les éléments du jardin sont reliés par des allées
sinueuses recouvertes de gravier et encadrées par des arbres matures et
de larges trottoirs servant de zone tampon entre le parc et la
ville.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Kejimkujik
Kejimkujik National Park of Canada, Nouvelle-Écosse
Important paysage culturel mi'kmaq.
Le lieu historique national du Canada Kejimkujik est une aire protégée
au centre du grand paysage culturel mi'kmaq de Kespukwitk, un des sept
districts traditionnels des Mi'kmaq. Il comprend 404 kilomètres carrés
de terres et d'eau dans la partie sud-ouest centrale du parc national du
Canada Kejimkujik, en Nouvelle-Écosse. Ce paysage culturel associé au
peuple mi'kmaq renferme 38 sites autochtones, quatre sites de
pétroglyphes, trois villages et un cimetière.
La valeur patrimoniale de Kejimkujik réside dans sa vaste gamme
d'éléments culturels qui témoignent du lien de longue date unissant les
Mi'kmaq et l'environnement naturel de leur territoire.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2007

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2007

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2007 |
Lieu historique national du Canada King's College
Windsor, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada King's College est situé au sud de
la rivière Avon à Windsor, en Nouvelle-Écosse. L'emplacement a été
choisi en raison de sa situation à l'écart des grandes villes, et en
raison de la présence de nombreux Néo-Écossais influent qui étaient
propriétaires de maisons dans les environs. King's College est désigné
en 1923 et abrite, encore aujourd'hui, un établissement d'enseignement
composé de la King's-Edgehill School, de quelques éléments paysagers, de
bâtiments scolaires de l'époque, des bâtiments pour le personnel, et des
résidences d'étudiants. Le site comprend le pavillon Alexandra, la
chapelle commémorative Hensley, le Convocation Hall ainsi que les
maisons Buckle et Marshall.
L'Université King's College a été fondée par le révérend Charles Inglis,
le premier évêque de la Nouvelle-Écosse, de même que par d'autres
Loyalistes de l'Empire-Uni anglicans à Windsor, en Nouvelle-Écosse, en
1789. Il s'agit de la première université établie dans un dominion
britannique étranger. Après la Révolution américaine, la question de
l'éducation soulevait de grandes inquiétudes. Alors qu'il y avait à New
York, en Nouvelle-Angleterre et dans d'autres États américains plusieurs
universités, il n'existait aucun établissement d'enseignement supérieur
dans les autres colonies britanniques. King's College a été établi afin
d'éviter que les jeunes hommes doivent quitter et poursuivent leurs
études à l'étranger. En 1802, King's College a obtenu une charte royale
du roi George III. Les diplômés de l'université occupaient alors des
postes privilégiés au sein du gouvernement ou de l'armée, en droit, dans
la vie politique et dans le monde littéraire. Depuis sa fondation, le
collège a également été l'établissement d'enseignement principal pour
les membres du clergé dans les provinces Maritimes.
Construit entre 1861 et 1863, Convocation Hall est le plus vieux
bâtiment subsistant sur le campus d'origine. Il est situé dans un lieu
isolé, afin d'être à l'abri des incendies. Le bâtiment a abrité le musée
et la bibliothèque du King's College de 1863, jusqu'en 1923, année du
déménagement de l'établissement vers Halifax.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1970 |
Lieu historique national du Canada Ladies' Seminary
Wolfville, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada Ladies' Seminary, aussi connu sous
le nom de Seminary House, est situé au coeur du campus de l'Université
Acadia à Wolfville, en Nouvelle-Écosse. Le site est constitué d'un
bâtiment en forme de « L » de trois étages et demi, de style Second
Empire, qui comporte un haut toit en mansarde agrémentée de pignons et
de lucarnes ainsi que des façades légèrement en saillie. Construit en
1878, le Ladies' Seminary est le plus vieil établissement au pays lié à
l'éducation supérieure des femmes. Avant l'inauguration en 1914 d'une
résidence universitaire réservée aux femmes, il accueillait toutes les
étudiantes de l'Université Acadia.
Le Ladies' Seminary, aujourd'hui appelé Seminary House, illustre une
étape clé de la lutte pour l'égalité des femmes au Canada et leur
admission aux études universitaires. Inauguré en 1878, le bâtiment a
logé les femmes qui étudiaient à l'Université Acadia dès leur admission
aux programmes d'études postsecondaires en 1881, et ce, jusqu'à
l'ouverture, en 1914, d'une résidence séparée réservée aux femmes. À
l'origine, le Ladies' Seminary a été construit pour abriter l'Acadia
Ladies' Seminary, une école secondaire destinée aux jeunes filles et
affiliée à l'Université Acadia. C'est aussi à cet endroit que
s'enseignaient certains programmes – tels que les arts et la musique –
qui, à l'Université Acadia, étaient considérés comme des disciplines
nettement « féminines ». Le Ladies' Seminary témoigne également des
balbutiements de l'éducation des femmes, notamment en raison de
l'emplacement du bâtiment sur le campus, de la qualité de ses
aménagements intérieur et extérieur, et de la nature de ses
installations. Ces trois éléments traduisent le caractère distinct de
l'éducation postsecondaire des femmes au Canada dans le dernier quart du
XIXe siècle.
Au XIXe siècle, les campus étaient aménagés de manière à ce que
l'emplacement et l'importance visuelle des bâtiments reflètent
fidèlement les rôles sociaux traditionnels de l'époque. C'est pourquoi
le Ladies' Seminary a été placé, derrière le bâtiment principal de
l'université et au sud de celui-ci, où il a été largement caché du
public par des arbres. Cette façon d'organiser les bâtiments illustrait
les points de vue contemporains quant à l'importance relative de
l'éducation des hommes et des femmes. De plus, l'extérieur du séminaire
a été conçu dans une version du style second Empire adaptée aux
bâtiments résidentiels; ce traitement architectural vernaculaire lie les
vocations résidentielle et officielle du Ladies' Seminary. En effet, le
bâtiment principal de l'université se compose d'une vaste salle
polyvalente, de salles d'enseignement et de bureaux tandis que le plan à
hall central du séminaire compte une salle à manger, une cuisine et une
buanderie au rez-de-chaussée; des salles de réception, une salle de
musique, neuf chambres et six salons au premier étage; ainsi que douze
chambres, sept salons et trois salles de musique à chacun des deux
étages supérieurs.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Akins
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Akins est une maison
de dimensions modestes qui occupe un lot urbain au centre-ville de
Halifax, en Nouvelle-Écosse. Le bâtiment d'un étage et demi en bardeaux
de bois, construit vers 1815, évoque le style Cap Cod des maisons
typiques de la région de l'Atlantique. Outre ses bardeaux de bois, la
maison se caractérise par sa façade peu élevée à quatre ouvertures,
surmontée de deux lucarnes et de deux grandes cheminées en brique. La
maison Akins représente l'un des derniers exemples de maison du début du
XIXe siècle à Halifax et, à ce titre, elle constitue l'une des plus
vieilles maisons de la ville.
La valeur patrimoniale de ce lieu réside dans son association avec
Thomas Beamish Akins, ainsi que dans ses éléments physiques, qui datent
de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe.
La Maison Akins se distingue par sa longévité et par la conservation de
ses caractéristiques originales jusqu'à aujourd'hui. Elle est
représentative de la période attribuée à sa construction de par ses
caractéristiques intérieures et extérieures, dont plusieurs datent de
son origine et sont remarquables par leurs détails, tels que les
garnitures et les éléments sculptés, plus communs dans les grandes
demeures de l'époque. De plus, son revêtement extérieur en bardeaux de
bois, ses lucarnes et son plan d'étage carré font de la Maison Akins
l'un des premiers exemples du style architectural vernaculaire des
Maritimes.
Érigée au cours du premier quart du XIXe siècle, la Maison Akins est la
résidence de Thomas Beamish Akins, premier archiviste et commissaire des
archives de la Nouvelle Écosse. Akins y habite de 1858 à 1891, période
pendant laquelle il apporte une immense contribution à l'histoire locale
et provinciale. Il recueille, à l'intention de la bibliothèque de
l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse, de nombreux ouvrages sur
l'histoire coloniale et participe à la rédaction de deux ouvrages sur
l'histoire de la province. Akins figure en outre parmi les fondateurs de
la Nova Scotia Historical Society, qu'il préside en 1882 et 1883. À sa
mort, en 1891, l'assemblée de la Nouvelle-Écosse reconnaissait son
importante contribution à la culture et à la recherche, ainsi que les
services qu'il a rendus aux historiens grâce à son dévouement à
l'endroit des archives historiques de la province.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2006 |
Lieu historique national du Canada de la Maison Black-Binney
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Black-Binney et une
maison en pierre de trois étages, simple et élégante. Elle est située
près du trottoir sur une rue du centre-ville d'Halifax
(Nouvelle-Écosse). Sa conception symétrique et ses finitions décoratives
simples reflètent la tradition des demeures d'inspiration palladienne de
la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle dans l'est du Canada.
Plusieurs résidents importants, y compris l'honorable James Boyle
Uniacke, Premier ministre de la Nouvelle-Écosse de 1848 à 1854, et
l'évêque anglican de la province, le très révérend père Hibbert Binney,
d'environ 1855 à 1887, ont été les occupants successifs de la Maison
Black-Binney construite aux alentours de 1819 pour le marchand et
politicien John Black. Cette maison était grande pour l'époque et ses
finitions étaient d'un très haut niveau, avec du granite finement taillé
sur la façade, une rampe en fer forgé le long de l'escalier de l'entrée,
les petits carreaux de la porte d'entrée et, à l'intérieur, les ouvrages
de bois fin et de plâtre de belle exécution. Ses fenêtres à guillotine
et placées de façon symétrique, le toit bas à quatre versants et
l'entrée centrale la situent dans la tradition des interprétations
vernaculaires du style palladien, populaire dans les demeures des
classes moyennes et supérieures de l'époque.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1980 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Chapman
Fort Lawrence, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Chapman consiste en
une maison à deux étages en brique rouge, de forme géorgienne typique
des fermes prospères de la côte est du XVIIIe siècle.
La maison, qui est située au Fort Lawrence (Nouvelle-Écosse), se dresse
sur une butte qui donne sur le marais du Havre-Aubert et sur la rivière
LaPlanche.
La Maison Chapman a été désignée lieu historique national du Canada
parce qu'elle conserve sa forme de base et beaucoup des détails des
fermes prospères de la fin du XVIIIe siècle.
La maison, construite par Charles Dixon et William Chapman Junior pour
le major Thomas Chapman, s'inscrit dans un style vernaculaire classique
et britannique de la fin du XVIIIe siècle. Chapman, qui comptait parmi
les immigrants anglais à s'être installés dans cette région dans les
années 1770, se livrait à l'agriculture dans les marais fertiles déjà
mis en valeur par les Acadiens.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2006 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Henry
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Henry est une maison
en pierre de deux étages et demi, bâtie au début du XIXe siècle. Située
à la limite avant du lot, à l'extrémité du centre-ville d'Halifax, la
maison Henry se distingue par son toit à pignon avec une cheminée, son
portique d'entrée couvert d'un côté, la variété de fenêtres à guillotine
à multiples carreaux ainsi que la pierre de taille en granite de la
façade et le grès ferrugineux d'aspect brut sur les murs pignons.
Avec son hall latéral et son parement extérieur de granite et de grès
ferrugineux, la maison Henry est typique des résidences construites pour
l'élite au début du XIXe siècle en Amérique du Nord britannique. William
A. Henry, favorable à l'unification des provinces de l'Amérique du Nord
britannique, et l'un des cinq délégués désignés pour représenter la
Nouvelle-Écosse à la Conférence de Charlottetown, a habité cette maison
à l'époque de la Confédération canadienne.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national de la Maison Jonathan McCully
Halifax, Nouvelle-Écosse
La Maison Jonathan-McCully est une belle maison en rangée de deux étages
et demi, à revêtement en stucco et d'inspiration italienne, située sur
un étroit lotissement urbain du centre-ville de Halifax, en
Nouvelle-Écosse.
La Maison Jonathan-McCully a été désignée lieu historique national du
Canada parce que Jonathan McCully (1809-1877), un Père de la
Confédération, y a habité de 1863 à sa mort survenue le 2 janvier 1877;
elle constitue un exemple bien préservé de maison en rangée construite
au milieu du XIXe siècle, et atteste la vie urbaine à l'époque précédant
la Confédération.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à ses liens historiques avec
Jonathan McCully et aux caractéristiques physiques qui attestent sa
conception simple d'inspiration italienne et qui en font un modèle de
maison en rangée urbaine de la haute bourgeoisie au XIXe siècle. Cet
édifice, construit à la fin des années 1850, a été soigneusement
restauré dans les années 1990.
|

©Tourism, Culture and Heritage, Province of NS/Province de N-É, 2004 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Knaut-Rhuland
Lunenburg, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Knaut-Rhuland est
situé au cœur de la ville de Lunenburg. Il s'agit d'une maison très
formelle à ossature de bois d'inspiration classique. Cet édifice
vernaculaire revêtu de planches à clins affleure la rue. L'escalier
double qui accède à l'entrée centrale lui confère un air de grandeur.
Cette maison attrayante, construite aux environs de 1793, est un des
premiers excellents exemples au Canada de classicisme britannique
exprimé dans une résidence. Ses proportions équilibrées et ses ornements
formels annoncent les maisons plus ouvragées bâties au cours des
décennies suivantes. Le plan avec une entrée centrale et les motifs
classiques de l'intérieur reflètent l'harmonie extérieure de la maison.
Ses deux premiers propriétaires, le marchand Benjamin Knaut, et le marin
Conrad Rhuland, lui ont donné son nom. Au fil des ans, son aménagement a
été légèrement modifié pour tenir compte de l'évolution des besoins, et
elle a notamment été subdivisée en deux appartements pendant une courte
période. Mis à part la modernisation de l'électricité et de la
plomberie, la maison a été remise dans son état initial dans les années
1980. La maison est maintenant un site historique ouvert au
public.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Marconi
Table Head, Nouvelle-Écosse
Emplacement de la première station de radiotélégraphie au Canada
utilisée par Marconi.
Le lieu historique national du Canada Marconi marque l'endroit isolé, où
Guglielmo Marconi a reçu le premier message télégraphique
transatlantique, à Table Head, dans la municipalité régionale du
Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Il est situé sur un plateau, au-dessus
de hautes falaises qui surplombent l'océan Atlantique et on y trouve les
vestiges de deux tours télégraphiques qui soutenaient alors l'antenne de
Guglielmo Marconi ainsi que les murs de fondation de son local de
réception et de la centrale.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada Marconi
tient à son association historique avec les travaux de Guglielmo
Marconi, comme le montre le paysage culturel qui subsiste encore. Cette
valeur réside dans l'aménagement et la disposition du site et dans les
vestiges archéologiques des activités de Guglielmo Marconi qu'il
contient toujours.
Guglielmo Marconi s'est servi de ce site pour sa première installation
de recherches et de transmissions commerciales, de 1902 à 1904, avant
d'aller installer son siège ailleurs. C'est à cet endroit qu'il a reçu
et envoyé le premier échange de messages radio au-dessus de l'océan
Atlantique. La station construite en 1902 comprend quatre tours en bois
hautes de 64 mètres, disposées sur une étendue de terrain de 64 mètres
carrés de forme carrée, soutenant une antenne en fils de cuivre de forme
pyramidale inversée. Au milieu de la place, une salle de réponse et une
centrale ont été construites ainsi qu'une résidence pour les cadres
supérieurs, à l'extrémité sud du site. En 1904, ces installations ont
été démontées et transférées dans un endroit plus grand situé entre
Glace Bay et Port Morien.
|

©Canadian Register of Historic Places, 2006 |
Lieu historique national du Canada du N.C.S.M Sackville
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada du N.C.S.M. Sackville est une
corvette de classe Flower de construction canadienne, actuellement à
quai dans le centre-ville d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Il s'agit d'un
bateau à vapeur, armé, à une seule hélice. Pendant la Deuxième Guerre
mondiale, les alliés ont utilisé ces petits navires de combat comme
navires d'escorte de convoi. La reconnaissance officielle fait référence
au navire lui-même.
Le N.C.S.M. Sackville est une des dernières corvettes de classe Flower
connues. Ces corvettes conçues pour une production en série dans de
petits chantiers navals furent créés selon le plan de l'Amirauté
britannique qui s'inspirait d'un baleinier. Les navires de cette
catégorie ont joué un rôle important dans la bataille de l'Atlantique.
En décembre 1941, le N.C.S.M. Sackville a été mis en service pour
escorter des convois entre Terre-Neuve et l'Irlande du Nord. Dans la
nuit du 3 au 4 août 1942, alors qu'il escortait un convoi faisant route
vers l'est dans un brouillard épais, le N.C.S.M. Sackville a engagé le
combat avec trois U-boots allemands. Le lieutenant Alan Easton et son
équipage ont gravement endommagé un sous-marin, en ont touché un autre
et en ont attaqué un troisième aux grenades sous-marines. Cet exploit a
valu la Croix du service distingué (DSC) au lieutenant Easton et une
mention élogieuse à l'équipage. Après d'autres combats en septembre
1943, le N.C.S.M. Sackville a été redéployé comme navire-école pour
officiers en 1944, et désarmé pour être mis en réserve en 1945. Il a
repris du service en 1952 et a appuyé la recherche océanographique,
hydrographique et halieutique pendant les 30 années suivantes. En 1982,
le bateau a cessé son service dans la Marine royale du Canada et, en
1983, il a été transféré à la Canadian Naval Corvette Trust. Il a été
restauré selon sa configuration de 1944 et il est maintenant ouvert au
public.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-du-Comté-d'Annapolis
Annapolis Royal, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada du
Palais-de-Justice-du-Comté-d'Annapolis est un élégant immeuble de style
palladien. Situé bien en vue sur une des deux artères importantes
d'Annapolis Royal, il s'érige sur une fondation surélevée en pierre
rustiquée. Il possède une façade symétrique ornée d'un imposant portique
central et est recouvert d'un toit en croupe élégamment incurvé.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à ses liens historiques tels
que l'attestent sa conception et sa teneur historique. Cet édifice, un
des plus anciens palais de justice du Canada, a été construit en 1837,
puis agrandi en 1922-1923. Ayant conservé sa vocation originale, il
perpétue la présence locale de la justice britannique, qui remonte à
1721. Son constructeur, Francis LeCain, l'a conçu en collaboration avec
le grand jury du comté, une pratique courante en Nouvelle-Écosse au
début du XIXe siècle. Sa façade symétrique, avec portique central à
colonnes surélevé, est un trait du style palladien, et typique des
palais de justice construit à cette époque dans l'Empire britannique. Il
est situé bien en évidence dans le voisinage de bâtiments des XVIIIe et
XIXe siècles, et rehausse le cachet historique d'Annapolis Royal.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1987 |
Lieu historique national du Canada du Palais de justice du comté d'Antigonish
Antigonish, Nouvelle-Écosse
Le palais de justice du Comté d'Antigonish est situé dans la ville
d'Antigonish, sur le rivage nord-est de la partie continentale de la
Nouvelle-Écosse. Conçu selon un style vernaculaire simple, le palais de
justice consiste en un bâtiment à charpente en bois symétrique. Il se
distingue par sa façade qui ressemble à celle d'un temple néo-grec,
constitué d'un portique à fronton soutenu par quatre grandes colonnes
cannelées. La prison du comté, en pierre, est attenante à l'arrière.
En 1981, le palais de justice du Comté d'Antigonish a été désigné « lieu
historique national » du Canada parce qu'il est un des meilleurs
exemples néo-écossais des palais de justice typiques des provinces
maritimes du milieu du XIXe siècle.
Les palais de justice érigés en Nouvelle-Écosse vers le milieu du XIXe
siècle étaient de petits édifices en bois composés d'une grande salle
d'audience, du cabinet d'un juge, du bureau de l'avocat, ainsi que des
pièces pour les petits et les grands jurys. Il s'agissait de petits
bâtiments à charpente de bois, avec des motifs décoratifs néo-classiques
qui leur conféraient la majesté monumentale qui sied aux tribunaux. Le
palais de justice d'Antigonish en est un bon exemple. Il a été dessiné
et construit en 1855 par Alexander McDonald, charpentier local. Le
bâtiment, qui a survécu à un gros incendie en 1945, a fait l'objet de
modifications et de rénovations. Il abrite toujours un palais de
justice.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-d'Halifax
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-d'Halifax est
un édifice imposant en pierre de style néo-classique, qui date du milieu
du XIXe siècle. Il est situé sur le chemin Spring Garden, au cœur du
centre ville historique d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Légèrement en
retrait de la rue, le bâtiment symétrique en grès de trois étages se
distingue par son toit à pente faible, sa partie centrale en saillie
avec de riches décorations et des colonnes toscanes.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à son emplacement, à sa
situation géographique et au fait que son architecture imposante évoque
physiquement le système judiciaire. Le palais de justice est situé au
cœur du centre ville d'Halifax, près de plusieurs autres édifices
historiques, y compris l'Hôtel du gouverneur, la Basilique St. Mary et
l'Ancien cimetière, tous des lieux historiques nationaux du Canada.
Conçu par l'architecte de Toronto Williams Thomas, ce palais de justice
est une imposante structure en grès, de style néo-classique, avec des
ornements à l'italienne. La sélection de Thomas, architecte de renom à
l'époque, montre le désir d'ériger un bâtiment digne de la ville, de la
province et de l'institution judiciaire qu'il représente. Ce bâtiment,
construit de 1858 à 1860, abritait de façon permanente la Cour suprême
de la Nouvelle-Écosse, avec deux salles d'audience, des cabinets de
juges, un bureau d'enregistrement des actes et une bibliothèque de
droit. Suite à l'établissement des cours de comté en 1875, une nouvelle
aile a été ajoutée au bâtiment en 1881 pour y accueillir la Cour du
comté d'Halifax. D'autres ailes ont été ajoutées en 1908 et en 1930 pour
abriter d'autres salles d'audience et des espaces à bureaux. Lors de la
construction de nouveaux tribunaux en 1971, l'édifice est devenu la
bibliothèque du gouvernement provincial. Il a été restauré en 1985 pour
servir de palais de justice à la Cour provinciale de la
Nouvelle-Écosse.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, P. Muise, 1999 |
Lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-et-Prison-du-Canton-d'Argyle
Tusket, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada du
Palais-de-Justice-et-Prison-du-Canton-d'Argyle est un édifice en bois de
deux étages, simple mais élégant, construit de 1802 à 1805 d'après les
temples de la Nouvelle-Angleterre. L'édifice, qui est situé à
l'intersection de l'autoroute 3 et de la rue Court à Tusket, en
Nouvelle-Écosse, abrite maintenant un musée et des archives.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du
Palais-de-Justice-et-Prison-du-Canton-d'Argyle réside dans son âge, la
représentation de ses fonctions d'origine et la qualité de son
architecture.
Le palais de justice et prison du canton d'Argyle a été construit de
1802 à 1805 pour qu'on y tienne les séances générales sur la paix pour
le district de Yarmouth et d'Argyle. Agrandi en 1833, puis en 1870,
l'édifice a atteint trois fois sa taille d'origine. La prison a fermé
ses portes en 1924, et le palais de justice en 1944. De 1945 à 1976, le
bâtiment a abrité les bureaux de la municipalité d'Argyle, jusqu'à sa
restauration en 1982. Depuis 1983, il est géré à titre de lieu
patrimonial, de musée et d'archives.
|

©Nova Scotia Museum/ Musée de Nouvelle-Écosse, |
Lieu historique national du Canada des Pétroglyphes-de-Bedford
Halifax, Nouvelle-Écosse
Site de pétroglyphes d'importance spirituelle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J.P. Jérôme, 1991 |
Lieu historique national du Canada de Port-Royal
Port Royal, Nouvelle-Écosse
Établissement français datant de 1605; édifices reconstruits.
Ce lieu est une reconstruction de bâtiments datant du début du XVIIe
siècle qui évoquent l'ancienne colonie de Français qui ont longtemps
habité la côte. Par le biais d'interprètes en costume et de
démonstrations, les visiteurs peuvent découvrir Port-Royal, un des
premiers établissements européens de l'Amerique du Nord. Les visiteurs
peuvent aussi admirer le paysage splendide de la rivière Annapolis et du
bassin.
Le lieu historique national du Canada de Port-Royal, groupe d'édifices
en bois entouré d'une palissade, est une réplique historique d'un fort
français du début du XVIIe siècle. L'habitation est située sur la rive
nord du bassin d'Annapolis, de l'autre côté de l'île Goat.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de
Port-Royal tient aux édifices reconstruits qui illustrent une première
tentative de colonisation par les Français et qui sont un exemple d'une
approche de la conservation du patrimoine datant du début du XXe siècle.
Le lieu historique national du Canada de Port-Royal a été construit en
1939.
|

©Province House, Jimmy Emerson, 2010 |
Lieu historique national du Canada Province House
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada Province House est un imposant
édifice public de trois étages en grès situé sur un terrain paysager
clôturé comprenant un jardin et des monuments, dans le coeur historique
de Halifax, en Nouvelle-Écosse. Cet édifice, construit de 1811 à 1819
pour servir de siège au gouvernement de la Nouvelle-Écosse, est un des
plus beaux bâtiments de style palladien du Canada. Sa composition
symétrique, ses proportions harmonieuses et ses ornements intérieurs
raffinés sont des caractéristiques typiques de l'architecture classique
de l'Angleterre géorgienne. L'édifice a toujours une fonction
législative au sein de la province de la Nouvelle-Écosse.
À titre de plus ancien édifice législatif au Canada, Province House a
été le siège d'importants débats politiques et juridiques, y compris la
défense de Joseph Howe, rédacteur en chef d'un journal, contre une
plainte en diffamation, qui a mené à l'instauration de la liberté de la
presse, ainsi qu'à l'obtention d'un gouvernement responsable. Nous
devons sa conception à l'architecte John Merrick et l'interprétation
détaillée de ses plans d'inspiration palladienne au maître constructeur
Richard Scott. Des armoiries royales sculptées dans la pierre par David
Kinnear ont été placées au-dessus de l'entrée principale en 1819. Les
chambres d'origine de la Cour suprême ont été réaménagées en 1861-1862
par l'architecte Henry F. Busch pour y loger la bibliothèque
législative. Edward Elliott a effectué d'autres travaux de rénovation
intérieure en 1886-1888.
Province House est un exemple sophistiqué de formule composite du style
palladien adapté aux bâtiments publics du début du XIXe siècle. Sa
volumétrie rectangulaire avec des façades principales au fronton et aux
ailes latérales en saillie, la division tripartite de ses étages et
l'emploi de l'ordre ionique romain pour accentuer l'importance de
l'étage principal sont organisés dans une composition symétrique à
l'échelle et aux proportions classiques. Les concepts d'ordre du style
palladien se transposent également dans l'organisation spatiale
intérieure et dans le programme décoratif limité et harmonieux culminant
par le plâtre de l'étage principal.
|

©Pier 21, Jennyrotten, 2010 |
Lieu historique national du Canada du Quai 21
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada du Quai 21 fait partie du quai de
débarquement des immenses terminaux océaniques situés aux quais 20 à 22
du port de Halifax, près du côté ville de la route Terminal. Il comprend
l'entrepôt de transit sur le quai 21, qui constitue la partie centrale
de l'édifice de transit des terminaux océaniques intégrés qui, avec le
Bureau Central en brique, sépare les quais 21 et 22 et sert de pavillon
d'entrée aux installations. Le quai 21 est situé à l'extrémité nord de
la jetée et des quais qui constituent le port public de Halifax, juste
derrière l'hôtel Nova Scotian et la gare ferroviaire VIA Rail, à
laquelle il a été lié à travers l'histoire. Le quai 21 sert à présent de
musée de l'immigration.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du Quai 21
tient à son association avec l'immigration au milieu du XXe siècle et au
fait qu'il est un exemple du type d'édifice conçu pour les formalités
d'immigration des arrivants à cette époque. Le quai 21 a été construit
en 1928 pour donner au port de Halifax de nouveaux quais intégrés pour
le débarquement des voyageurs. Il a été en grande partie détruit par un
incendie et reconstruit en 1944. Les nouveaux locaux correspondent à une
nouvelle rationalisation des formalités d'immigration au milieu du XXe
siècle. De 1945 à 1960, il a été témoin de la vague massive
d'immigration européenne au Canada après la Deuxième Guerre mondiale, y
compris l'arrivée des épouses de guerre, événement d'importance
historique nationale commémoré par une plaque à cet endroit. Le quai 21
a été fermé en 1971 et, depuis, il a été réhabilité par la Pier 21
Society, qui en a fait un musée de l'immigration.
|


©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Redoute-York
Halifax, Nouvelle-Écosse
Pricipale défense côtiere du port de Halifax, de la Révolution
américaine jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
Construite en 1793 sur un promontoire surplombant l'entrée du port, et
agrandie aux XIX e et XX e siècles, la redoute York était un élément clé
des ouvrages défensifs du port de Halifax. Visitez le centre du
commandement de la Seconde Guerre mondiale et admirez la beauté de
l'entrée du port et du littoral adjacent.
Ce lieu historique national du Canada fait partie du Complexe de défense
d'Halifax.
Le lieu historique national du Canada de la Redoute-York comprend un
vaste plateau dégagé du côté ouest du port intérieur de Halifax, en face
de l'île McNabs, ainsi qu'une batterie de tir et des projecteurs situés
près du niveau de la mer et accessibles par un sentier. La redoute
renferme quelque 27 bâtiments et structures connexes ainsi que de
l'armement mis en place sur plus de 150 ans. La partie supérieure de la
redoute surplombe les falaises boisées et domine l'entrée du port
d'Halifax qu'elle protège depuis la fin du XVIIIe siècle.
La redoute York a été déclarée lieu historique national pour son rôle
évolutif dans le cadre du système de défense d'Halifax assurant la
protection des principales stations navales de l'Empire britannique et
du Canada de la fin du XVIIIe siècle à la Deuxième Guerre mondiale.
La valeur patrimoniale de la redoute York réside dans sa représentation
matérielle de l'évolution historique du système de défense du port
d'Halifax. Le gouvernement britannique a fait construire la redoute en
1793 comme élément des fortifications d'Halifax. Ses installations ont
subi des transformations majeures en 1794, 1812-1814, 1863-1875,
1890-1899, 1940-1943. La redoute a été ouverte aux visiteurs comme lieu
historique national en 1968.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1983 |
Lieu historique national du Canada de la Résidence-de-sir-Frederick-Borden
Canning, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de la
Résidence-de-sir-Frederick-Borden est une vaste maison de style
néo-Queen Anne située sur un terrain aménagé en parc à Canning,
Nouvelle-Écosse.
Le lieu historique national du Canada de la
Résidence-de-sir-Frederick-Borden a été désigné en 1990 parce qu'il est
un exemple exceptionnel d'expression du style néo-Queen Anne dans
l'architecture domestique.
La valeur patrimoniale du lieu réside dans son expression matérielle du
style néo-Queen Anne, et notamment dans sa composition esthétique
réussie réunissant les formes fantaisistes, la masse asymétrique et les
surfaces polychromes caractéristiques du style. Entièrement revêtue de
bardeaux, la résidence de sir Frederick Borden représente une variante
américaine du néo-Queen Anne, soit le style «shingle», souvent associé
aux bâtiments domestiques des Maritimes.
Construite en 1864, la maison est rénovée en 1902 dans le style
néo-Queen Anne par la firme d'architectes Harris and Horton (William
Critchlow Harris et William T. Horton) pour devenir la demeure de
l'homme politique sir Frederick Borden.
|
|
Lieu historique national du Canada Sainte-Anne / Port Dauphin
Englishtown, Nouvelle-Écosse
Fondée en 1629 par le capitaine Charles Daniel, Sainte-Anne fut l'une
des premières missions jésuites. Base navale fortifiée sous le nom de
Port-Dauphin (1713) et chef-lien de l'Ile Royale, son importance
s'effaça devant Louisbourg devenue capitale en 1719.
|

©Department of National Defence / Ministère de la Défence nationale, 1990 |
Lieu historique national du Canada de la salle d'exercices de Halifax
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de la salle d'exercices de Halifax
est un édifice imposant situé en face du terrain communal du centre nord
de Halifax, en Nouvelle-Écosse. La façade de cette salle d'exercices, en
pierre rouge à parement brut, reprend le style roman richardsonien et se
distingue par une grande porte d'entrée voûtée surmontée d'une grande
fenêtre cintrée et flanquée de fenêtres cintrées plus petites ainsi que
de tours d'angle de la même facture. L'intérieur de cet édifice se
caractérise par une grande salle d'exercices non cloisonnée.
La salle d'exercices de Halifax, qui se distingue par son architecture
imposante et fonctionnelle ainsi que son style roman richardsonien
empreint d'austérité, a été conçu par Thomas Fuller, architecte
principal du ministère des Travaux publics du Canada à cette époque. Ses
réalisations, y compris la salle d'exercices de Halifax, ont donné aux
salles d'exercices canadiennes des caractéristiques architecturales
traduisant si bien leur vocation militaire qu'on les retrouve dans les
plans de nombreuses installations conçues longtemps après le départ de
Fuller.
La construction de la salle d'exercices de Halifax, une des plus grandes
au Canada, fait suite aux demandes de la milice de Halifax qui manque
d'espace pour l'entraînement d'un nombre croissant de miliciens. Les
dimensions exceptionnelles du manège permettent à la milice de disposer
d'un des plus grands espaces non cloisonnés au Canada. Afin de créer ce
grand espace intérieur ouvert, Fuller a recours à des fermes
triangulaires Fink en acier, une conception d'avant-garde puisqu'il
s'agit de la première fois où des fermes entièrement métalliques sont
utilisées dans la structure d'une salle d'exercices au Canada. Ce
système de fermes, qui se révèle très efficace, est d'ailleurs
privilégié par le gouvernement fédéral pour la plupart des grands
manèges militaires construits avant la Première Guerre mondiale.
L'aménagement d'un stand de tir intérieur, de bibliothèques et de salles
de cours, autre caractéristique novatrice, permettent aux miliciens de
suivre des cours d'instruction en classe qui complètent les exercices et
l'entraînement au tir. La salle d'exercices de Halifax comprend
également une salle de billard pour les officiers ainsi que des allées
de quilles pour les subalternes, et sert ainsi à la fois de centre
d'entraînement complet et de cercle récréatif.
La salle d'exercices de Halifax est liée aux Princess Louise Fusiliers,
formés en 1869, qui participent à l'écrasement de la rébellion de Louis
Riel, de même qu'à la guerre d'Afrique du Sud et aux deux guerres
mondiales.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Site-Paléo-Indien-de-Debert
Debert, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada du Site-Paléo-Indien-de-Debert est
composé de cinq sites archéologiques situés dans des niches écologiques
et topographiques semblables. Ils se trouvent le long du sommet de
crêtes glaciaires entre des vallées de petits cours d'eau allant de la
plaine Coquebid aux hautes terres Coquebid, dans le comté de Colchester,
en Nouvelle-Écosse. Les lieux étaient utilisés par des chasseurs
paléo-indiens entre 8 500 et 9 000 avant notre ère comme camps
saisonniers où ils ont surveillé le mouvement des troupeaux de caribou
et fabriqué des outils.
La valeur patrimoniale du site paléo-indien de Debert a trait à
l'emplacement géographique que partagent ses sites archéologiques, à la
nature des artéfacts qu'ils contiennent, ainsi qu'au fait qu'ils aident
à comprendre les cultures paléo-indiennes nord-américaines. Des sites
paléo-indiens sont présents à travers l'Amérique du Nord. Les
paléo-indiens de Debert, de lointains ancêtres des Micmacs et d'autres
populations autochtones de l'Est canadien, sont les descendants de
peuples autochtones qui ont traversé le détroit de Béring possiblement
pendant et après le Wesconsinien et se sont établis dans la région
méridionale de l'Amérique du Nord. Depuis cette zone centrale, ils se
sont dispersés ensuite vers l'est et le nord, dans les Maritimes. Les
sites archéologiques de Debert, utilisés à titre de camps saisonniers
par les chasseurs nomades de gros gibier, représentent l'établissement
humain initial dans le Canada atlantique, vers 8500 à 9000 avant notre
ère. L'occupation relativement intensive et l'indication de
l'utilisation du site à des activités variées font que le site
paléo-indien de Debert en est un particulier.
Le site a fait l'objet d'importantes fouilles dans les années 1960 et a
été agrandi, suite à la découverte de deux autres sites d'habitation
paléo-indiens. Depuis, deux sites additionnels ont été repérés, portant
à cinq le nombre de sites archéologiques paléo-indiens connus sur ces
terrains. Certains de ces sites ont été considérablement perturbés par
les travaux de construction entrepris au XXe siècle. Faisant partie de
collections remarquables en terme de dimension et de diversité, les
artéfacts issus de Debert ont mené à la définition de l'expression
orientale de la culture paléo-indien dans le nord-est de l'Amérique du
Nord. Les sites archéologiques à Debert, présente les sites
paléo-indiens les plus anciens connus et les mieux documentés du Canada
Atlantique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2006 |
Lieu historique national du Canada S.S. Acadia
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada S.S. Acadia est un navire d'acier
conçu spécialement pour la prise de relevés hydrographiques et
actuellement amarré à un quai du centre-ville d'Halifax, en
Nouvelle-Écosse. Mis à l'eau en 1913, ce vapeur à deux mâts comporte une
seule cheminée et une seule hélice et présente une belle coque rivetée,
une étrave verticale et un arrière à voûte aux formes arrondies.
Spécialement conçu pour le service hydrographique dans les eaux
nordiques, le S.S. Acadia, après sa mise à l'eau en 1913, a pour
première mission d'amorcer les travaux visant à cartographier la route
maritime longeant la côte ouest de la baie d'Hudson. Sa construction
marque un tournant dans la conception et l'aménagement des navires
hydrographiques. Reconnu comme étant la « bête de somme » du Service
hydrographique du Canada, le S.S. Acadia effectue par la suite
différents travaux de cartographie marine dans le port de Churchill,
puis sur la côte de la Nouvelle-Écosse, où il effectue par la même
occasion une étude sur la marée dans la baie de Fundy. Ses travaux de
cartographie inlcuent également le golfe du Saint-Laurent. La prise de
relevés hydrographiques sur la côte de Terre-Neuve et Labrador marquera
la fin de sa carrière en 1949, année d'adhésion de cette province à la
Confédération. En établissant des corridors sûrs pour la navigation sur
des eaux souvent sournoises, le S.S. Acadia a contribué au développement
économique des régions qu'il a visitées. Par ailleurs, il a longtemps
été une référence en matière d'océanographie au Canada, ayant toujours à
son bord pendant ses années de service l'équipement de navigation et de
sondage le plus sophistiqué disponible. Le S.S. Acadia a été mis hors
service en 1969 et fait maintenant partie du Musée maritime de
l'Atlantique à Halifax.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada St. Peters
St. Peter's, Nouvelle-Écosse
Poste de traite et fort français, 1650-1758.
De grandes dimensions, le lieu historique national du Canada St. Peters
renferme des preuves archéologiques des XVIIe et XVIIIe siècles associés
à des communautés mi'kmaq et acadiennes. St. Peter's est situé sur la
rive sud-est du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, sur l'isthme séparant la
baie St. Peters, sur l'Atlantique, et le lac Bras d'Or.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada St. Peters
réside dans sa situation stratégique et dans les preuves d'anciennes
communautés mi'kmaq et acadiennes dont il recèle. Le lieu souligne
l'importance stratégique à long terme de l'isthme étroit reliant la baie
St. Peters et le lac Bras d'Or en tant que voie de transport, et
commémore les preuves des établissements se trouvant le long de cette
voie et qui témoignent de son importance comme point de contact entre
les Mi'kmaq et les Français ainsi que comme poste français dans le cadre
de la rivalité entre les nations européennes aux XVIIe et XVIIIe
siècles.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Aynsley MacFarlane |
Lieu historique national du Canada de la Station-de-Radiotélégraphie-Marconi
Cape Breton Regional Municipality, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de la
Station-de-Radiotélégraphie-Marconi est situé sur la ligne de côte
rocheuse du nord-est de la Nouvelle-Écosse, soit entre Glace Bay et Port
Morien, dans la municipalité régionale du Cap-Breton. Formé d'un
promontoire de près de 350 hectares (800 acres) de terres infertiles, le
lieu fut l'emplacement de la première station offrant un service
intercontinental régulier de radiotélégraphie.
La station de radiotélégraphie Marconi, fonctionnant avec une station
sœur située à Clifden, en Irlande, a été la première à offrir un service
public intercontinental régulier en 1908. Construite en 1905 et 1907,
elle devenait alors la station principale, où Marconi a pu perfectionner
la technologie de la télégraphie sans fil.
Il s'agissait d'une alternative au site de la première station
permanente devenu trop restreignant. La station d'origine a été érigée
par Gugliemo Marconi en 1902, à Table Head, sur l'île du Cap-Breton
après qu'ait été démontrée, en 1901, la faisabilité de la communication
transatlantique sans fil. Située plus au sud, entre Glace Bay et Port
Morien, la station radiotélégraphique Marconi a cessé ses activités en
1946.
|

©The Canadian Mining Manual, 1896 |
Lieu historique national du Canada Terrains-Houillers-de-la-Nouvelle-Écosse
Stellarton, Nova Scotia
|

©NAC, PC 29313, c.1914 |
Lieu historique national du Canada Terrains-Houillers-de-la-Nouvelle-Écosse
Sydney, Nouvelle-Écosse
Groupes de ressources demeurées sur place et associées à l'industrie houillère.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Danielle Hamelin, 2007. |
Lieu historique national du Canada Thinkers' Lodge
Pugwash, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique du Canada Thinkers' Lodge est situé sur une vaste
propriété qui s'avance dans le détroit de Northumberland, dans le petit
village de Pugwash, en Nouvelle-Écosse. C'est dans cette villa que naît
le mouvement transnational Pugwash, qui prône le désarmement nucléaire
et la paix mondiale. En effet, en 1957, alors que la guerre froide
atteint son point culminant, la première Conférence Pugwash sur la
science et les affaires mondiales se tient à Thinkers' Lodge, résidence
d'été d'un riche homme d'affaires du nom de Cyrus Eaton.
Thinkers' Lodge doit sa reconnaissance mondiale à la volonté d'un riche
homme d'affaires et mécène, Cyrus Eaton, et à l'urgence d'aborder
certains des enjeux les plus importants de notre époque. Après avoir
fait l'acquisition de Thinkers' Lodge, Cyrus Eaton la réaménage en
auberge d'été dans le but de revitaliser l'économie du village de
Pugwash, qui a connu des moments difficiles dans les années 1920. Mécène
visionnaire, Cyrus Eaton voit dans le village isolé de Pugwash un
endroit idéal où les gens de tous les horizons pourraient prendre un
moment de repos, échapper à la pression du quotidien, se détendre et se
ressourcer. Dans les années 1950, misant sur l'atmosphère paisible de
Thinkers' Lodge, il commence à organiser et à financer des rencontres
propices à la discussion sur un large éventail de sujets, de la crise du
canal de Suez au désarmement nucléaire.
En juillet 1957 se tient à Thinkers' Lodge la Conférence Pugwash.
Réunissant des scientifiques provenant de part et d'autre du Rideau de
fer, cette rencontre avait pour objectif d'encourager le dialogue et la
compréhension entre l'Est et l'Ouest quant à l'utilisation de la force
nucléaire à des fins pacifiques et non à des fins guerrières. À défaut
d'être nombreux, les participants, au nombre de vingt-deux et en
provenance de dix pays, étaient extrêmement prestigieux. Trois lauréats
du prix Nobel se sont rencontrés à Thinkers' Lodge, le vice-président de
l'Académie des sciences de l'U.R.S.S., un ex-directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé et l'éditeur de l'influent Bulletin
of the Atomic Sciences. Certains volets non officiels de la rencontre,
par exemple les repas pris au pavillon de la salle à manger et les
parties de croquet sur les terrains de la propriété, ont contribué tout
autant que les séances plénières au succès de l'événement. L'ambiance
conviviale et détendue de Pugwash favorisa des discussions et des
échanges fructueux et amèna les scientifiques à se mobiliser et à
s'engager à l'égard des enjeux mondiaux et des responsabilités
sociales.
|

©Halifax Regional Municipality / Region Municipal de Halifax, 2007 |
Lieu historique national du Canada de la Tour-Commémorative
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le lieu historique national du Canada de la Tour-Commémorative, qui
profite d'un emplacement spectaculaire au sommet d'une colline dans le
parc sir Sandford Fleming, surplombe le centre-ville de Halifax, en
Nouvelle-Écosse. L'accès à la tour de 34 mètres se fait par un escalier
monumental flanqué de deux grands lions de bronze. La base de la tour
est faite de moellons de grès ferrugineux de couleur grise, tandis que
l'étage supérieur est paré d'un granite gris et agrémenté de fenêtres
palladiennes.
Érigée en 1908, la tour commémore l'établissement du premier
gouvernement représentatif dans une colonie britannique, soit celui de
la Nouvelle-Écosse, en 1758. La base monolithique de la tour et les
fenêtres palladiennes de l'étage supérieur illustrent à la fois le style
victorien à son apogée et le classicisme édouardien, et donnent à la
tour son architecture unique. Cette combinaison de styles architecturaux
témoigne, à l'aube de la Première Guerre mondiale, d'une période
transitoire dans les relations entre l'Empire britannique et le Canada
qui veut accéder à une plus grande indépendance.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Tour-Prince-de-Galles
Halifax, Nouvelle-Écosse
Fortification en pierre de la fin du XVIIIe siècle (1796-1799).
Érigée en 1796-1797 pour protéger les batteries britanniques des
Français, la tour Prince-de-Galles fut la première du genre à être
construite en Amérique du Nord. L'exposition relate l'histoire de la
tour et explique ses caractéristiques architecturales et son importance
comme ouvrage défensif.
Ce lieu historique national du Canada fait partie du Complexe de défense
de Halifax.
Le lieu historique national du Canada de la Tour Prince-de-Galles est
une imposante tour ronde en pierre située dans le parc Point Pleasant, à
Halifax, Nouvelle-Écosse.
La valeur patrimoniale de la tour Prince-de-Galles réside dans le fait
qu'elle illustre bien un type de structure de défense, et tient à sa
situation et à ses rapports avec d'autres éléments (XVIIIe-XXe siècles)
des ouvrages de défense côtière du port d'Halifax. Elle a été construite
par le gouvernement britannique sur les ordres d'Édouard, prince de
Galles (1796-1799) pour défendre les batteries côtières de la pointe
Pleasant. La tour a cessé de servir à des fins militaires au XIXe siècle
et elle a été transférée aux Parcs nationaux et lieux historiques
nationaux en 1936. Elle a été déclarée lieu historique national en 1943,
puis restaurée et ouverte au public en 1978.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Vieux-Temple-de-Barrington
Barrington Head, Nouvelle-Écosse
Le Lieu historique national du Canada du Vieux-Temple-de-Barrington est
un exemple exceptionnel préservé d'un temple érigé en
Nouvelle-Angleterre et dans les provinces atlantiques du Canada à la fin
du XVIIIe et au début du XIXe siècles. Cet édifice, situé à Barrington
en Nouvelle-Écosse, sert à la fois à des fonctions religieuses et à des
fonctions civiles. L'ossature de bois de cet édifice, simple mais
magnifiquement construite, est dans le style classique vernaculaire de
l'époque. Malgré les modifications qui y ont été apportées au fil des
ans, il a conservé une excellente intégrité.
Construit en 1765 par des colons de Nouvelle-Angleterre, ce temple a
servi de centre religieux et civique du comté de Barrington pendant près
d'un siècle, accueillant toutes les confessions chrétiennes. Par la
suite, il a servi essentiellement à des fins religieuses jusqu'à ce
qu'on le transforme en musée à la fin du XXe siècle. Son extérieur,
recouvert de planches à clins, tout comme son intérieur, avec sa chaire
faisant face à la porte centrale, entourée de bancs et d'une tribune,
imitent les temples très répandus en Nouvelle-Angleterre. Son apparence
simple reflétait volontairement le rejet puritain des richesses de ce
monde.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada des Hautes-Terres-du-Cap-Breton
Siège social: Ingonish Beach, Nouvelle-Écosse
Pays de la route Cabot Trail, bordée de falaises spectaculaires.
Le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton est reconnu pour ses
hautes terres et ses paysages côtiers d'une beauté spectaculaire. Des
falaises abruptes et de profondes vallées fluviales découpent le plateau
boisé qui borde l'océan Atlantique. Un tiers du fameux Cabot Trail,
route panoramique de réputation internationale, traverse le parc
national le long de la côte et domine les hautes terres.
En raison du climat maritime frais et du paysage accidenté, le parc
renferme une association unique d'habitats de forêts acadienne, boréale
et taïga, incluant des forêts anciennes d'importance
internationale.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada Kejimkujik
Siège social: Annapolis County, Nouvelle-Écosse
Parcours et portages historiques de canot à l'intérieur des terres en
Nouvelle-Écosse.
Un monde de merveilles naturelles et culturelles vous attend au parc
national et lieu historique national Kejimkujik de Parcs Canada, le seul
site de Parcs Canada portant la double désignation de parc national et
lieu historique national.
À Kejimkujik, la nature est à son meilleur. Campez dans un magnifique
emplacement de camping boisé ou en milieu sauvage éloigné, et écoutez le
chant du huard. Découvrez les parcours de canot traditionnels et les
pétroglyphes des Mi'kmaw, et nagez dans les eaux chaudes du lac
Kejimkujik. N'oubliez pas de visiter Kejimkujik Bord de mer. Vous serez
charmé par l'eau turquoise, le sable blanc et les phoques lézardant au
soleil sur les rochers tout près.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Réserve de parc national du Canada de l'Île de Sable
Sable Island, Nouvelle-Écosse
Une île sablonneuse sauvage, balayée par le vent, se trouve au large
dans l'Atlantique Nord, sa forme de croissant caractéristique émergeant
du vaste océan. Isolée et lointaine, l'île de Sable est l'une des îles
les plus distantes des côtes du Canada. Des dunes mouvantes, parmi les
plus grandes dans l'est du Canada, dominent le paysage. Les célèbres
chevaux sauvages de l'île de Sable errent librement, alors que la plus
grosse colonie de reproduction de phoques gris au monde fréquente les
longues plages. Des étangs témoignent de la présence d'une lentille
d'eau douce, essentielle au maintien de la vie, flottant sous l'île. Des
plantes, oiseaux et insectes, dont certains ne se trouvent nulle part
ailleurs sur terre, se sont adaptés à la vie sur l'île de Sable.
L'île de Sable a une longue et fascinante histoire humaine qui couvre
plus que quatre siècles. Plus de 350 navires s'y sont échoués en raison
de la mer agitée, du brouillard et des barres de sable submergées qui
entourent l'île, ce qui a valu à cette dernière le surnom de « cimetière
de l'Atlantique ». La première station de sauvetage au Canada, établie
en 1801, a été construite sur l'île de Sable. C'est un endroit où
s'émerveiller devant la survie dans un environnement
inhospitalier.
|
|