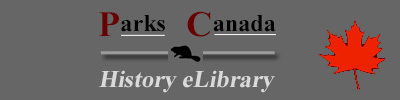|
Résumés parc
Nunavut
Tous les textes et photos sont la propriété de Parcs Canada ou le Répertoire canadien des lieux patrimoniaux
(Sauf indication contraire) et ont été extraites de l'une ou l'autre Parcs
Canada ou Lieux patrimoniaux du Canada. Les parcs avec un fond
gris sont gérés par Parcs Canada.

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Arvia'juaq et Qikiqtaarjuk
Arviat and Sentry Islands, Nunavut
Ce lieu historique est divisé en deux parties, Arvia'juaq et
Qikiqtaarjuk. Arvia'juaq est un camp d'été traditionnel des Inuits
Paallirmiut. Cette île de 5 km de long comporte deux sections jointes
par un isthme et est située à 8 km du village d'Arviat, sur la côte
ouest de la baie d'Hudson. Elle est entourée d'une zone riche en
ressources marines et fauniques et possède de nombreux sites rituels et
spirituels.
Qikiqtaarjuk est une pointe de terre qui part du continent et avance
dans la baie d'Hudson. Située immédiatement en face de l'île Arvia'juaq,
cette petite île est maintenant reliée au continent par une étroite
bande de terre. On y trouve de nombreux vestiges d'habitation, notamment
des cercles de tente, des caches pour la nourriture, des supports à
kayak et des tombes appartenant aux générations de Paallirmiut qui y ont
séjourné durant l’été, ainsi qu’un site sacré associé à la légende de
Kiviuq, à l'extrémité de la péninsule.
La valeur patrimoniale du lieu historique national Arvia'juaq et
Qikiqtaarjuk a trait au fait que ce paysage culturel constitue une
entité en soi, que des hommes y ont vécu pendant longtemps, et qu'il
joue un rôle culturel, spirituel et économique très riche dans la vie
des Inuits de la région d'Arviat. Les caractéristiques et les ressources
naturelles de cette terre attestent également sa valeur patrimoniale,
notamment les vestiges et le mode d’occupation de l’île par les Inuits,
et les propriétés rituelles et spirituelles de ses nombreux sites
sacrés.
Pendant des siècles, les Inuits de la région d'Arviat revinrent chaque
été s'établir à Arvia'juaq et Qikiqtaarjuk pour profiter de ses
abondantes ressources marines. Ces rassemblements étaient une occasion
d’apprentissage pour les jeunes, de célébration, d’affirmation et de
renouvellement des valeurs de la société inuit. Les générations futures
trouveront à Arvia'juaq et Qikiqtaarjuk un foyer culturel concrétisé par
des histoires orales, des connaissances traditionnelles et des sites
archéologiques, car ces deux lieux continuent d'être des centres où on
célèbre, pratique et régénère la culture inuit. Ce sont les gens
d'Arviat qui ont recommandé qu'on accorde la désignation à ces
sites.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Bloody Falls
Kugluk/Bloody Falls Territorial Park, Nunavut
Le lieu historique national du Canada Bloody Falls est situé dans le
parc territorial Kugluk/Bloody Falls, sur la rive ouest de la rivière
Coppermine, au Nunavut. Le lieu entoure des campements autochtones de
l’époque préeuropéenne établis sur des terrasses fluviales le long de la
large rivière au débit rapide. Ces campements, dont l’existence remonte
à 1 700 avant notre ère et dont il ne subsiste aucun visible, ont servi
de campements de chasse et de pêche pendant plus de trois millénaires.
Les vestiges archéologiques découverts à Bloody Falls témoignent de
l’occupation du lieu, qui s’étale sur des milliers d’années, par
plusieurs peuples autochtones et inuits. Les vestiges archéologiques qui
ont été étudiés remontent à l’occupation thuléenne (1 000 -1 500 avant
notre ère). Sous la couche la plus profonde des vestiges culturels de
Thulé, des objets de la culture matérielle de la période prédorsétienne
(également mentionnée comme la tradition arctique des petits outils),
ont été découverts entre 1 700 et 1 500 avant notre ère. L’emplacement,
qui est éloigné de la côte et qui se trouve à l’intérieur des terres, a
servi ainsi de lieu de rassemblement pour les visiteurs venus chasser,
pêcher et chercher du cuivre natif.
En plus des habitations des autochtones de Thulé, dix campements
autochtones remontant aux périodes préeuropéenne et européenne ont été
repérés à l’extrémité nord du lieu. Ces campements ont permis la
découverte d’artefacts de pierre et d’ossements datant de la période
préeuropéenne, certains remontant à l’année 160 de notre ère. Des
matériels associés aux premières années d’occupation du lieu par les
Inuits du cuivre ont également été documenté sur place.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror
Erebus Bay, King William Island, Nunavut
En 1845, le capitaine sir John Franklin a quitté le Royaume-Uni à la
tête d’une expédition visant à trouver le passage du Nord-Ouest pour
traverser la région qui constitue aujourd’hui l’Arctique canadien. Son
équipage et lui ont voyagé à bord du HMS Erebus (370 tonnes) et du HMS
Terror (340 tonnes), qui avaient été rénovés et renforcés afin de
naviguer en milieu polaire, et transportaient l’équipement nécessaire
pour effectuer des recherches en zoologie, en botanique, en magnétisme
et en géologie. D’abord conçus comme des bombardes, ces navires de bois
étaient très résistants. En vue de l’expédition Franklin, les vaisseaux
avaient été renforcés à la proue au moyen de plaques de fer et munis
d’un moteur à vapeur de 20 chevaux actionnant une seule hélice,
permettant aux navires d’atteindre une vitesse de 4 noeuds.
Hormis un baleinier, croisé par hasard en 1845, nul n’a revu ni le
capitaine Franklin, ni son équipage, ni leurs navires. Les nombreuses
expéditions de recherche et de sauvetage menées à la suite de leur
disparition n’ont pas connu de succès, et il a fallu attendre quinze ans
avant d’apprendre des nouvelles au sujet des membres de l’équipage. En
1859, le capitaine William Hobson du HMS Fox, a trouvé un message dans
un cairn, sur King William Island. Le message précisait l’emplacement du
HMS Erebus et du HMS Terror a indiquait qu’en 1846, l’équipage se
préparait à passer l’hiver à bord des deux vaisseaux prisonniers des
glaces. Une autre inscription, rédigée 17 mois plus tard de la main du
capitaine du Terror, indiquait que les navires avaient été coincés dans
les glaces depuis un an et demi, et que Franklin et plusieurs autres
membres de l’équipage avaient péri. Les survivants étaient en direction
de la rivière Back au sud-est, mais on n’a jamais entendu parler d’eux.
En 1945, le capitaine sir John Franklin a été désigné personne
d’importance historique nationale en raison des explorations qu’il a
menées dans l’Arctique canadien au XIXe siècle.
En 2014, les restes du HMS Erebus ont été trouvés dans l'est étendues de
la Reine-Maud au large de la côte occidentale de l'Adelaide Péninsule. En 2016,
la Fondation de recherche de l'Arctique a découvert les restes du HMS
Terror in Terror Bay sur la côte sud-ouest du Roi William Island,
Nunavut.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la HMS Breadalbane
Beechey Island, Nunavut
Le lieu historique national du Canada de
l'Épave-du-NSM-Breadalbane est situé bien au-dessus du Cercle
Arctique et représente le naufrage le plus nordique qui soit connu. Le
lieu comprend l’épave du NSM Breadalbane, un voilier de 500
tonnes du 19e siècle, incluant la coque, des fragments du navire et le
champ de débris résultant du naufrage. Le naufrage fait également partie
du lieu historique national du Canada des Sites-de-l'Île-Beechey.
NSM Breadalbane a été construit en 1843 dans les chantiers
maritimes de la rivière Clyde, en Écosse. Il a passé les premières
années de son existence comme navire marchand, naviguant aussi loin qu’à
Calcutta. Après la disparition de l’expédition de Sir John Franklin, qui
cherchait le passage du Nord-Ouest, NSM Breadalbane fut
réquisitionné par l’Amirauté britannique pour approvisionner les navires
qui exploraient l’Arctique, à la recherche de Franklin et de son
équipage. Il quitta la rivière Tamise en 1853, de concert avec le NSM
Phoenix, et atteignit le point de ralliement des recherches, près de
l’île Beechey, plus tard dans l’année. Cependant, le temps dans
l’Arctique se montra peu clément et NSM Breadalbane se trouva
bientôt entouré d’épaisses banquises dérivant lentement. On vida en hâte
le navire de la plus grande quantité possible de provisions et d’effets
personnels. Durant la nuit du 20 au 21 août, la glace perça finalement
la coque, coulant NSM Breadalbane au fond du détroit de
Barrow.
|

©Lee Narraway, Summer 2008 |
Lieu historique national du Canada Inuksuk
Enukso Point, Nunavut
Le lieu historique national du Canada Inuksuk est situé à la péninsule
Foxe, à environ 88,5 km de Cape Dorset, dans la partie sud-ouest de
l’île de Baffin, au Nunavut. Il occupe un littoral longeant le passage
du Nord Ouest, au-dessus de la laisse de marée haute des côtés est et
ouest de la pointe Enukso. Les inuksuit, qui sont en fait des cairns de
pierres, se dressent sur un promontoire rocheux et dépourvu d’arbres qui
descend en pente vers la mer. Ils sont répartis en deux groupes situés à
environ 142 m l’un de l’autre, et celui de l’extrême sud s’étend sur 61
mètres. Parmi les inuksuit, environ 100 sont toujours debout. Ils
consistent en des pierres soigneusement empilées formant des cairns
parfois complexes pouvant atteindre six ou sept pieds de haut. Ils ont
parfois une forme humaine, et les plus petits inuksuit peuvent avoir
comme base deux pierres de même hauteur ou consister en un simple
empilement de pierres. Les groupes de cairns ont peut-être été érigés il
y a jusqu’à deux milles ans.
La valeur patrimoniale d’Inuksuk découle de son importance sur les plans
scientifique, social et spirituel. Le mot « inuksuk » peut se traduire
par « comme l’homme ». Appelés « inuksuit » au pluriel, ces cairns sont
composés de pierres soigneusement sélectionnées et placées. On trouve
ces constructions dans tout le Nord, seules ou en groupes. Les inuksuit
sont érigés dans un but particulier et peuvent jouer divers rôles, selon
leur taille et l’endroit où ils sont situés. Par exemple, ils peuvent
servir de points de repère lorsqu’érigés sur le sommet d’une colline,
d’indicateurs de cache de viande, de monuments, de supports à kayak, de
piliers supportant des cordes à séchage ou de composantes de clôtures à
caribous, et ils peuvent aussi avoir un rôle cérémoniel ou spirituel.
Leur composition peut varier, allant d’une seule pierre posée
verticalement à des monuments complexes pouvant atteindre, sur le lieu
en question, jusqu’à sept pieds de haut. Il y a près de 100 cairns sur
ce lieu. Les inuksuit témoignent de l’assiduité au travail et de la
créativité des Inuits qui ont vécu dans le Nord et qui ont été capables
d’utiliser les ressources de leur environnement de façon ingénieuse et
artistique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2000 |
Lieu historique national du Canada du Passage-de-Caribous-en-Automne
Kivalliq Region, Nunavut
Le lieu historique national du Canada du Passage-de-Caribous-en-Automne
est un tronçon du cours inférieur de la rivière Kazan (Harvaqtuuq) situé
entre les chutes Kazan et le passage du lac Thirty Mile (Quukilruq),
dans le territoire du Nunavut. Dans cette zone, avec ses rivages
légèrement en pente, la rivière a une orientation est-ouest et est
relativement étroite. On y trouve de nombreux sentiers tracés par les
caribous.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du
Passage-de-Caribous-en-Automne a trait au fait que, depuis des siècles,
les Inuits de l'intérieur y chassent le caribou dans un paysage culturel
présentant des caractéristiques géographiques naturelles particulières;
on y trouve de nombreux vestiges d’objets ayant servi à la chasse au
caribou qui attestent l’occupation humaine de la région, et il est animé
par des histoires orales, des traditions culturelles et des parcours
archéologiques liés à son utilisation, à son entretien par les Inuits de
l’intérieur ainsi qu’aux activités qu’ils y ont pratiqué. Pendant des
siècles, le caribou fournissait aux Inuits de l’intérieur tous les
éléments nécessaires à leurs besoins quotidiens en plus des moyens pour
survivre à l’hiver rigoureux. Lorsque les caribous traversaient la
rivière Kazan à cet endroit, ils s’exposaient aux lances des chasseurs
en kayak qui pouvaient alors les capturer et les tuer en très grand
nombre. Les Inuits avaient un grand respect et un amour de la terre et
des passages utilisés par le caribou, conformément à leurs croyances et
leurs pratiques traditionnelles; ils s’assuraient ainsi que le caribou
reviendrait chaque année au cours de sa migration vers le sud. Le
caribou était au cœur de la vie des Inuits de l’intérieur, qui
utilisaient précieusement toutes les parties de l’animal dont ils
tiraient de la nourriture, du combustible, des outils, des vêtements et
des abris.
|
|
Lieu historique national du Canada de Port Refuge
Grinnell Peninsula, Nunavut
Le lieu historique national du Canada de Port Refuge est situé dans une
petite baie de la côte sud de Grinnell Peninsula à l’île Devon, au
Nunavut. Le lieu comprend deux parcelles de terrain : la première est
située sur des terrasses fluviales des rives ouest et nord du port, et
la seconde au cap Hornby, sur la rive est du port. Ces parcelles
contiennent une série de sites archéologiques qui datent de l’occupation
préhistorique, notamment un village d’hiver thuléen situé près de
l’entrée de la baie et des vestiges d’habitations datant de la période
prédorsétienne. On trouve des marqueurs et des cairns plus récents ici
et là sur les plages de gravier.
Port Refuge contient des vestiges archéologiques bien préservés des
débuts de l’occupation humaine du Haut-Arctique, sur des plages
soulevées de 15 à 25 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tout autour
de la baie, on peut voir en surface des vestiges archéologiques répartis
de façon irrégulière dans une zone d’environ 900 hectares. La région
renferme une série très riche de vestiges d’occupations antérieures à
l’arrivée des Européens, de l’occupation indépendancienne I (2000 avant
notre ère) jusqu’à l’occupation par les Inuits de Thulé (1200 à 1500 de
notre ère).
Les structures dégagées offrent des renseignements précieux sur les
groupements spatiaux et altitudinaux. En outre, la diversité des
caractéristiques, qui comprennent des objets d’origine norse et
asiatique découverts dans le village d’hiver thuléen près de l’entrée de
la baie, témoigne des échanges commerciaux avec les colonies médiévales
norses du Groenland.
Les vestiges d’occupation les plus récents datent du voyage de sir
Edward Belcher, parti en 1852-1853 à la recherche de l’expédition
disparue de Franklin. Forcé de rester dans la baie pendant plusieurs
jours en raison des glaces, il a érigé plusieurs cairns et repères
d’arpentage qui prennent aujourd’hui la forme de petites buttes.
|

©Library and Archives Canada / Bibliothèque et Archives Canada, A.P. Low, 3406600, 1903 |
Lieu historique national du Canada du Poste-de-Pêche-à-la-Baleine-de-l'Île-Blacklead
Blacklead Island, Nunavut
Le lieu historique national du Canada du
Poste-de-Pêche-à-la-Baleine-de-l’Île Blacklead est situé sur l’île
Blacklead dans l’archipel arctique du Nunavut. L’île Blacklead sert de
camp d’hiver aux Inuits et aussi de poste de pêche à la baleine; les
Européens occuperont l’île ultérieurement. Le lieu, qui s’étend au sud
de la baie Cumberland, comprend trois sites archéologiques sur les îles
Blacklead, Niantilik et Cemetery, les épaves au large de l’île
Aagotirpazask et le site archéologique du fjord Ptarmigan.
Le poste de pêche à la baleine de l’île Blacklead comprend deux postes
d’observation des baleines datant du milieu du XIXe siècle. Des postes
semblables sont établis sensiblement à la même époque sur l’île Kekerten
et dans la péninsule Hall, sur l’île de Baffin. Une mission anglicane
est construite sur l’île Blacklead en 1895. En 1921, la Compagnie de la
Baie d’Hudson construit un poste à Pangnirtung et, deux ans plus tard,
la Gendarmerie royale du Canada y établit un poste fixe. Les postes de
pêche à la baleine sont graduellement abandonnés à mesure que les
communautés inuites des îles Blacklead et Kekerten se regroupent à
Pangnirtung.
|

©Library and Archives Canada / Bibliothèque et Archives Canada, G. Drinkwater, C-084687, 1897 |
Lieu historique national du Canada du Poste-de-Pêche-à-la-Baleine-de-l'Île Kekerten
Cumberland Sound, Nunavut
Le lieu historique national du Canada du
Poste-de-Pêche-à-la-Baleine-de-l'Île Kekerten est situé au nord de la
baie Cumberland, à Kekerten Harbour, au Nunavut. Le lieu, situé dans
l’archipel Arctique canadien, comprend trois îles et est composé des
vestiges d’un poste de pêche à la baleine, d’un cimetière et d’une
épave. Les pentes herbeuses des trois collines adjacentes au port
abrité, et situées entre le rivage et le terrain surélevé et rocheux au
sud, servaient jadis de postes d’observation des baleines.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’île Kekerten abrite deux postes
adjacents d’observation de la baleine, exploités respectivement par les
Américains et les Écossais. De 1860 à 1880, à l’apogée de la chasse à la
baleine boréale, l’île accueille l’une des deux plus importantes
stations de baleiniers de la baie Cumberland, l’autre station se
trouvant sur l’île Blacklead. Le terrain en pente et les plateaux
rocheux de l’endroit forment d’excellents postes d’observation à partir
desquels les chasseurs peuvent surveiller la présence de baleines dans
la baie. Les marins qui décèdent dans la station sont enterrés au «
Penny’s Burying Ground », situé à proximité.
L’endroit constitue également un poste d’hivernage qui accueille de
nombreux Autochtones de la région, qui adaptent graduellement leur mode
de vie à celui des chasseurs de baleine. Les capitaines de baleiniers
ont la responsabilité d’importer des vivres pour les inuit embauchés sur
place et pour leur famille. L’échange d’armes, de munitions, de
télescopes et même de baleinières devient un événement important à la
fin de la saison de chasse. Les marins et les inuit délaissent
graduellement la station de l’île Kekerten avant de l’abandonner
complètement vers 1923 au profit du poste de Pangnirtung, établi à
proximité par la Gendarmerie royale du Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada des Sites-Archéologiques-de-l'Île Igloolik
Igloolik Island, Nunavut
Le lieu historique national du Canada des
Sites-Archéologiques-de-Igloolik Island est formé de neuf sites
archéologiques situés sur la rive nord-ouest du Foxe Basin, sur Igloolik
Island, au Nunavut. Ces sites, qui se trouvent sur les plages surélevées
de l’île, datent des périodes dorsétienne et prédorsétienne et remontent
à aussi loin que l’an 2000 avant notre ère.
Igloolik Island abrite les peuples de l’Arctique depuis des milliers
d’années. Selon les vestiges archéologiques, l’activité humaine sur
l’île remonte à aussi loin que l’an 2000 avant notre ère, période durant
laquelle les peuples prédorsétiens ont été attirés par les excellentes
occasions de chasse et pêche aux mammifères marins que présente la
région. Par la suite, la région est notamment occupée par les Dorsets et
les Thulés. Les recherches archéologiques effectuées sur l’île ont
permis de trouver l’une des séquences archéologiques les plus complètes
de l’Arctique canadien. De nos jours, le village d’Igloolik occupe une
partie du secteur ouest de l’île.
Au début des années 1800, Igloolik Island a servi de campement d’hiver à
l’explorateur Edward Parry. Comme plusieurs autres explorateurs, Parry,
le capitaine du Fury, chercha un passage vers l’ouest à travers
l’Arctique. Au cours de la deuxième année de leur voyage d’exploration
des confins nordiques de la baie d’Hudson, Parry et son équipage
passèrent l’hiver à Igloolik, où ils entrèrent en contact avec la
population inuite de l’île. Plus d’un siècle plus tard, l’anthropologue
Knud Rasmussen y établit le camp de base de la cinquième expédition de
Thulé (1921-1924). Cette expédition anthropologique se voulait une vaste
étude de plusieurs groupes culturels de l’Arctique, et les monographies
rédigées à partir des recherches de Rasmussen sont considérées, encore
aujourd’hui, comme certains des meilleurs ouvrages de référence dans les
domaines de l’archéologie arctique, de l’anthropologie physique et de
l’ethnographie.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada des Sites-de-l'Île-Beechey
Beechey and Devon Islands, Nunavut
Le lieu historique national du Canada des Sites-de-Beechey Island est
principalement situé sur Beechey Island, une péninsule reliée à Devon
Island, dans l’archipel Arctique, au Nunavut. Cette île dénudée et
balayée par les vents se compose d’une petite colline entourée d’une
étroite plage. Sa topographie en faisait un lieu suffisamment plat et
abrité pour servir lors des expéditions dans l’Arctique. Le lieu
comprend cinq sites archéologiques, situés sur Beechey Island et Devon
Island et dans les eaux environnantes, à savoir le camp d’hivernage
utilisé en 1845-1846 par les membres de l’expédition de Franklin, la
maison Northumberland, le site archéologique de Devon Island, situé au
Cape Riley, deux cairns portant des inscriptions et le lieu historique
national du Canada de la HMS Breadalbane.
Les Sites de Beechey Island est associé à l’exploration du Haut-Arctique
canadien. Au fil des ans, de nombreux équipages hivernèrent sur l’île, à
commencer par l’équipe de sir John Franklin, en 1846-1847. Les membres
de l’expédition passèrent l’hiver à cet endroit, durant leurs recherches
du passage du Nord Ouest, mais se retrouvèrent pris dans les glaces
l’hiver suivant, au large de King William Island. Ils finissent tous par
périr, laissant ainsi très peu de traces de leur travail d’exploration.
Les recherches lancées à la suite de la disparition de Franklin et de
son équipe donnèrent lieu à l’exploration d’une grande partie de
l’Arctique canadien et à des travaux importants de cartographie de la
région. Pendant les dix années qui suivirent, Beechey Island fût utilisé
comme base et dépôt de vivres pour ces expéditions de recherche, qui
menèrent aussi à d’autres avancées significatives, y compris la
découverte de trois passages du Nord-Ouest et la cartographie de la
moitié de l’Arctique canadien. En raison de ces activités intensives, de
nombreuses ressources archéologiques furent retrouvées sur l’île et dans
les eaux avoisinantes, notamment des cairns, des tombes, des ruines de
bâtiments en bois et l’épave du HMS Breadalbane.
|

©Canadian Museum of History / Musée canadien de l'histoire |
Lieu historique national du Canada de l'Île-Kodlunarn
Frobisher Bay, Nunavut
Le lieu historique national du Canada de l'Île-Kodlunarn est situé sur
l'île Kodlunarn, dans la baie Frobisher, à 190 km d'Iqualuit. On peut
voir sur le rivage les ruines d'une maison de pierre, des ouvrages en
terre et des excavations minières datant des voyages où l'explorateur
élisabéthain Martin Frobisher cherchait de l'or.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de
l'Île-Kodlunarn réside dans ses liens avec les tentatives d'exploitation
minière de Martin Frobisher, attestées par le site et par les signes
archéologiques confirmant la présence et les activités de Frobisher au
XVIe siècle. Les traditions orales inuites relatent encore aujourd'hui
cette première tentative européenne d'exploiter les ressources
naturelles de l'Arctique.
L'île Kodlunarn a été le site des expéditions minières de l'explorateur
britannique Martin Frobisher au cours des étés de 1576, 1577 et 1578.
Comme son prédécesseur John Cabot, Frobisher recherchait un passage au
nord-ouest, lorsqu'il a découvert ce qu'il pensait être de l'or. Il est
retourné dans l'Arctique trois années de suite, avec son équipage, pour
extraire de plusieurs mines quelque 1 400 tonnes de minerais sans
valeur. Ils sont restés chaque été pendant quatre à cinq semaines pour
explorer la région, et ont débarqué à divers endroits pour extraire des
minerais. L'île Kodlunarn, aussi appelé Quallunaat, l'île de l'Homme
blanc, et l’île de la comtesse de Warwick, est un des principaux sites
qu'ils ont visité. Frobisher prévoyait y laisser un important contingent
pendant l'hiver de 1578-1579 pour exploiter les mines. Mais, même si son
plan ne s'est jamais réalisé, il a néanmoins construit une maison de
pierre pour s'y loger. On trouve encore aujourd'hui sur l'île les
vestiges de cette maison, ainsi que diverses fouilles, ouvrages de terre
et objets dispersés. Des expéditions archéologiques effectuées dans les
années 1970 et 1980 ont fait des levés préliminaires des sites associés
à Frobisher sur cette île.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada Auyuittuq
Siège social: Pangnirtung, Nunavut and Qikiqtarjuaq, Nunavut
Paysages de l'île de Baffin, à l'extrémité nord du Bouclier
canadien.
Auyuittuq offre un paysage arctique composé de sommets de montagnes
déchiquetés, de vallées profondes, de fjords aux parois verticales et de
glaces éternelles. Au coeur se trouve l'imposante calotte glaciaire
Penny dont les glaciers continuent de façonner le paysage. Dans les
vallées sans arbres qui entourent la calotte, les glaciers donnent
naissance à des torrents qui dévalent vers l'océan dans le fond des
vallées, sur la roche et la toundra. Ici, dans le cercle arctique,
l'hiver cède la place au court été arctique : l'obscurité et la lumière
dominent tour à tour la région. Ce paysage imposant symbolise la
croyance inuite selon laquelle le temps est éternel. Que vous escaladiez
les montagnes du parc Auyuittuq, que vous skiiez sur ses champs de glace
ou que vous traversiez, sac au dos, le col d'Akshayuk (autrefois appelé
col de Pangnirtung), prenez un peu de cette éternité pour explorer le
parc et goûter à la beauté majestueuse de l'Arctique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada Qausuittuq
Siège social: Resolute, Nunavut
Haute parc national de l'Arctique, consacrant ainsi officiellement le
nord de l'île Bathurst.
Les quelque 11 000 kilomètres carrés de terres et d'eaux arctiques
protégées dans le parc national Qausuittuq englobent la partie nord de
l'île Bathurst ainsi que les îles du gouverneur général à l’ouest et de
petites îles à l'ouest et au nord de l'île Bathurst. Le Refuge d’oiseaux
migrateurs de l’île Seymour se trouve au nord, tandis que la limite sud
du parc national de Qausuittuq touche la réserve nationale de faune de
Polar Bear Pass.
Le parc national comprend les eaux des bras de mer May et Young ainsi
que de majestueux promontoires qui surgissent de la mer. Le relief
comporte des zones humides, des plaines, des plateaux et des collines
pouvant atteindre 411 mètres d’altitude. Les traces de glaciations
passées, comme des eskers, des moraines et des plages soulevées,
reposent sur des roches sédimentaires comme le calcaire, le grès et la
dolomie.
À 76° de latitude nord, l’île Bathurst se trouve dans l’une des régions
les plus froides et les plus arides du monde, avec des températures
moyennes de moins 32° C en janvier et de seulement 5° en juillet. Les
précipitations annuelles sont inférieures à 130 mm. Ce climat rude
limite le développement du sol sur lequel pousse une végétation
clairsemée. Çà et là, on trouve de la saxifrage à feuilles opposées, des
saules nains, du carex, des herbes, du lichen et de la mousse, qui
constituent une source de nourriture précieuse pour la faune.
Malgré la haute latitude et les conditions difficiles, on y trouve un
nombre étonnant d’espèces fauniques. Le parc national Qausuittuq protège
des habitats essentiels pour la faune, y compris les voies de
déplacement, les zones de mise bas et d’hivernage du caribou de Peary.
Le parc est également une zone importante pour les bœufs musqués. Parmi
les autres espèces qu’on retrouve dans cet environnement, il y a l’ours
polaire, le loup arctique, le renard arctique et de nombreux oiseaux
comme le harfang des neiges, l'oie des neiges, l'eider à tête grise, les
labbes, des goélands et des oiseaux de rivage. Les espèces marines de la
région comptent le phoque annelé, le phoque barbu, le morse, la baleine
boréale, le béluga et le narval.
Des fouilles archéologiques ont permis d’établir la preuve de la
présence de l’homme sur l'île Bathurst depuis 4 500 années. Les cultures
inuites pré-Dorset, Dorset et Thule ont fréquenté la région, bien que la
plupart des sites se trouvent au sud ou à l'est du parc national. Dans
le parc national Qausuittuq, il y a plusieurs sites archéologiques du
Dorsétien récent (vers 500 à 1 200, après J.‑C.) près des eaux du
passage Bracebridge.
À partir de 1819, une série d’expéditions navales britanniques à la
recherche du passage du Nord‑Ouest ont exploré la région de l’île
Bathurst. Plus tard, d’autres expéditions s’y sont aventurées à la
recherche du HMS Erebus et du HMS Terror, les navires de sir John
Franklin qui ont disparu après 1845. Entre 1850 et 1854, des expéditions
de recherche maritimes ont mis en place des cairns et des dépôts de
provisions sur les îles au nord de l’île Bathurst, dans le parc national
Qausuittuq, dont un cairn impressionnant sur l’île Helena.
L’exploration de la région de l'île Bathurst a continué jusqu'au
vingtième siècle. Le capitaine Joseph‑Elzéar Bernier a mené trois
expéditions entre 1906 et 1911 dans le but d’établir la souveraineté
canadienne dans les îles de l’Arctique. D’autres expéditions du
gouvernement canadien ont suivi, y compris des patrouilles de la
Gendarmerie royale du Canada, des vols effectués par l’Aviation royale
canadienne pour étudier le pôle magnétique, faire de la photographie
aérienne, ainsi que des études de la faune, des levés géologiques et des
études hydrologiques. Des forages d’exploration ont été effectués dans
les années 1960 et 1970 pour trouver du pétrole, du gaz et des minéraux
dans la région. Divers projets de recherche se poursuivent à ce jour et
beaucoup sont appuyés par le Programme du plateau continental
polaire.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada Quttinirpaaq
Siège social: Iqaluit, Nunavut
Terres isolées, fragiles et rudes, les plus septentrionales d'Amérique
du Nord.
À Quttinirpaaq, durant le court été arctique, le soleil demeure haut
dans le ciel, inondant les terres d'une lumière continuelle. Il n'y a
pas de nuits pour marquer le passage du temps et vous dire quand dormir
et quand vous réveiller, ni d'arbres pour évoquer les terres plus au
sud. Le terrain donne à la fois une impression d'immensité et
d'intimité. Des configurations rocheuses très complexes, le sol fissuré
par le gel, les saules et les fleurs sauvages s'étendent à perte de vue
tout autour de vous, offrant un panorama infini dans l'air clair et sec.
Les glaciers accrochés au versant d'une montagne à quinze kilomètres
d'ici semblent insignifiants dans le paysage environnant.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada Sirmilik
Siège social: Pond Inlet, Nunavut
Paysages du nord de l'Île de Baffin, contenant des aspects des
Basses-Terres de l'Arctique Est et du détroit de Lancaster.
Élément du réseau de parcs nationaux du Canada, le parc national
Sirmilik représente la région naturelle des Basses-Terres de l'Arctique
Est et certaines parties de la région marine du Détroit de Lancaster.
Cette aire protégée est formée de trois secteurs distincts. L'île Bylot
est une étendue de terre spectaculaire où se côtoient des montagnes aux
contours déchiquetés, des champs de glace et des glaciers, des basses
terres côtières et des colonies d'oiseaux marins. La baie Oliver est un
fjord long et étroit qui offre d'excellentes possibilités de navigation
de plaisance, de randonnée et de camping. La péninsule Borden consiste
en un vaste plateau sillonné de larges vallées de rivière. Véritable
paradis des excursionnistes et des campeurs, le parc protège divers
éléments topographiques dignes d'intérêt et abrite une importante
colonie d'oiseaux marins dans les environs de la baie Baillarge.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada Ukkusiksalik
Siège social: Repulse Bay, Nunavut
Le lieu où la pierre peut servir à fabriquer des casseroles et des
lampes à huile.
Le parc national du Canada Ukkusiksalik est situé juste à l’ouest de la
localité de Repulse Bay et au sud du cercle polaire. Le parc entoure la
baie Wager, bras de mer de 100 km de long sur la côte nord ouest de la
baie d’Hudson au Nunavut. Désigné parc national le 23 août 2003,
Ukkusiksalik est devenu le 41e parc national du Canada. Le parc, qui
tire son nom de la stéatite trouvée sur son territoire, s’étend sur 20
500 km2 d’eskers, de vasières, de falaises, d’une succession de berges
de toundra et de régions côtières uniques en leur genre. Bien que les
Inuits pratiquent la chasse dans la région, le territoire du parc est
inhabité. Les Inuits ont habité la région à partir du XIe siècle
jusqu’aux années 1960, et la Compagnie de la Baie d’Hudson y a exploité
un poste de traite de 1925 à 1947. Plus de 500 sites archéologiques ont
été répertoriés dans le parc, et on y trouve notamment des pièges à
renard, des cercles de tente et des caches de vivres. Le parc national
Ukkusiksalik protège un échantillon représentatif de la région naturelle
de la toundra centrale.
|
|