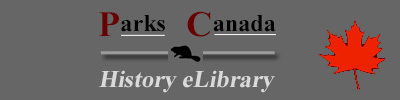|
Résumés parc
Ontario
Tous les textes et photos sont la propriété de Parcs Canada ou le Répertoire canadien des lieux patrimoniaux
(Sauf indication contraire) et ont été extraites de l'une ou l'autre Parcs
Canada ou Lieux patrimoniaux du Canada. Les parcs avec un fond
gris sont gérés par Parcs Canada.

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Aire marine nationale de conservation du Canada du Lac-Supérieur
Siège social: Nipigon, Ontario
Présentation d'une portion du plus grand lac d'eau douce du monde
abritant poissons, oiseaux, épaves, géologie, plantes et histoire de
l'humanité.
Imaginez un endroit où le vent et les vagues caressent le rivage de
baies abritées et un littoral accidenté qui s'étire à l'infini. Un
endroit où une myriade d'épaves jonchent le fond du lac, témoignage
silencieux de la puissance de la nature environnante. Les tempêtes du
lac Supérieur sont légendaires et sans pitié aux dires du peuple
Anishinabek, qui connaît l'endroit depuis des milliers d'années et l'a
baptisé « Gitchi Gumme » ou « le grand lac ». Dans l'aire marine
nationale de conservation du Lac Supérieur, vous pouvez à la fois vous
perdre et vous retrouver, car cet endroit est si vaste qu'une fois
l'aire marine créée, elle constituera l'aire protégée d'eau douce la
plus importante au monde en superficie.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Aérogare-de-l'Île-de-Toronto
Toronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada de l'Aérogare-de-l'Île-de-Toronto,
construit en 1938-1939, comprend un édifice en bois de deux étages avec
une tour de contrôle centrale. Elle est située à l'extrémité ouest des
îles de Toronto, de l'autre côté d'un canal étroit, par rapport au
centre-ville de Toronto. L'édifice, qui fait partie d'un aéroport en
exploitation, est entouré de pistes, de hangars et d'autres édifices de
soutien.
Conçue et construite par la Toronto Harbour Commission en 1938-1939,
l'aérogare de l'île de Toronto faisait partie du premier groupe
d'aérogares financées et approuvées par le ministère des Transports tout
nouvellement créé comme une partie du programme de développement du
Trans-Canada Airway, financé par l'État. Elle est l'une des toutes
premières aérogares qui existe encore et la plus vieille de ce type
toujours en exploitation au Canada.
L'aérogare de l'île de Toronto est typique des premières installations
aéroportuaires dans son plan linéaire, sa masse, son orientation et la
combinaison de fonctions multiples sous un même toit. Sa masse
rectangulaire basse, son fenêtrage et ses éléments décoratifs minimaux
révèlent l'influence du mouvement moderne. L'aérogare offre des
installations pour les passagers et les bagages (y compris un service
aéropostal, des bureaux de douanes et d'immigration), et abrite le
contrôle de la circulation aérienne et l'administration aéroportuaire.
Sa conception et son orientation permettent aux passagers comme au
personnel de contrôle de l'aérogare d'avoir une vue dégagée des pistes
d'atterrissage. Son plan axial facilite la circulation des passagers et
des bagages par l'aérogare et entre le transport aérien et les
traversiers.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1998 |
Lieu historique national du Canada de l'Aménagement-Hydroélectrique-de-Queenston-Chippawa
Queenston, Ontario
Le lieu historique national du Canada de
l'Aménagement-Hydroélectrique-de-Queenston-Chippawa est situé à
Queenston, en Ontario, aux chutes Niagara. Construit entre 1917 et 1925
à l'instigation de la Commission d'énergie hydro électrique (CEHE) de
l'Ontario, il s'agissait de la première grande centrale hydroélectrique
au monde. La CEHE avait alors créé ce projet pour répondre à
l'augmentation des besoins en énergie électrique des installations
urbaines et industrielles de Toronto et du Sud Ouest de l'Ontario. Le
lieu est composé d'un très vaste terrain en forme de croissant
s'étendant sur près de 22 kilomètres, à partir de la jonction de la
rivière Welland et de la rivière Niagara jusqu'à la centrale
hydroélectrique située sur la rivière Niagara entre le « Whirlpool » et
Queenston, après avoir traversé la ville de Niagara Falls.
En 1913, les infrastructures urbaines et industrielles de Toronto et du
Sud Ouest de l'Ontario avaient des besoins grandissants en énergie
électrique. Pour répondre à cette demande, la Commission d'énergie
hydroélectrique de l'Ontario a examiné les propositions de projets pour
une éventuelle centrale électrique à Niagara Falls. Après mûre
réflexion, la CEHE a accepté un projet proposant l'utilisation du cours
d'eau de la rivière Welland, la construction d'un canal d'énergie autour
de la ville de Niagara Falls et la construction d'une centrale
électrique située sur la rivière Niagara entre le « Whirlpool » et
Queenston. Les travaux ont commencé en 1917 à la suite de l'adoption de
l'Ontario Niagara Development Act et les premières installations sont
mises en marche en 1922.
La conception de l'aménagement hydroélectrique de Queenston-Chippawa a
entraîné de nombreux défis uniques. La taille de l'aménagement a
nécessité l'utilisation de matériaux de construction et d'appareils de
conversion de l'énergie d'une dimension jamais vue auparavant. De plus,
le canal d'énergie de 13,2 kilomètres a du être adapté pour répondre à
des caractéristiques particulières rarement retrouvées dans les canaux
maritimes. En 1925, une fois la construction terminée, l'aménagement
hydroélectrique de Queenston-Chippawa constituait la plus grande
centrale hydroélectrique du monde.
|
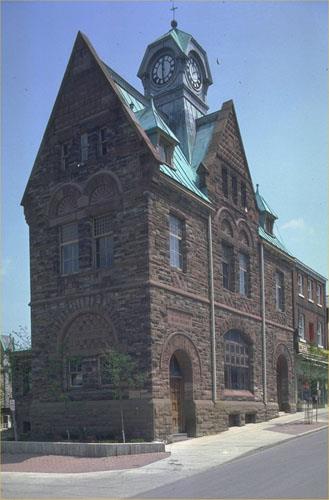
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1999 |
Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Bureau-de-Poste-d'Almonte
Almonte, Ontario
Le lieu historique national du Canada de
l'Ancien-Bureau-de-Poste-d'Almonte est situé bien en vue sur un terrain
triangulaire à l'intersection des rues Little Bridge et Mill, au
centre-ville d'Almonte, en Ontario. L'immeuble en pierres de deux étages
et demi date de la fin du XIXe siècle et est représentatif des bureaux
de poste à usages multiples conçus par Thomas Fuller.
L'ancien bureau de poste d'Almonte est l'exemple même des petits bureaux
de poste à usages multiples construits par le ministère des Travaux
publics dans les petits centres urbains quand Thomas Fuller était
architecte en chef (1881-1886). II est représentatif des bureaux de
poste à cause de sa hauteur, soit deux étages et demi, de ses matériaux
de haute qualité, de son style néo roman, de son implantation bien en
vue et de son aménagement intérieur. Le bureau de poste possède des
qualités architecturales, c'est- à-dire que sa structure extérieure n'a
pas subi de modifications importantes.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1980 |
Lieu historique national du Canada de l'Ancien bureau de poste de Brockville
Brockville, Ontario
L'ancien bureau de poste de Brockville est un bâtiment en pierre de deux
étages et demi datant de la fin du XIXe siècle. Il est situé bien en vue
au coeur de Brockville dans un groupe d'édifices gouvernementaux du XIXe
siècle.
L'ancien bureau de poste de Brockville a été désigné lieu historique
national en 1983 parce qu'il est représentatif des petits bureaux de
poste urbains conçus par Thomas Fuller; il a une valeur architecturale,
c'est-à-dire qu'il n'a pas subi de modifications extérieures
importantes; il se caractérise par son intégrité, c'est-à-dire que son
emplacement est compatible.
Le bureau de poste de Brockville est un bon exemple des bureaux de poste
construits par le ministère des Travaux publics dans les petits centres
urbains pendant le mandat de Thomas Fuller au poste d'architecte en chef
(1881-1886).
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Bureau-de-Poste-de-Galt
Cambridge, Ontario
Le lieu historique national du Canada de
l'Ancien-Bureau-de-Poste-de-Galt est situé sur un terrain d'angle qui
surplombe la rivière Grand, dans le centre-ville de Cambridge, en
Ontario. Ce superbe édifice en pierre de deux étages et demi, complété
en 1887, est recouvert de pierre calcaire de Guelph et comporte des
façades jumelles symétriques. Il est également doté d'éléments
architecturaux exceptionnels, notamment d'une tour d'horloge
remarquable. Son style, un mélange de roman, de gothique et de Second
Empire, confère à l'édifice une facture unique et éclectique, typique
des réalisations de Thomas Fuller, architecte en chef au gouvernement
fédéral.
L'ancien bureau de poste de Galt, construit entre 1884 et 1887, est un
édifice d'importance qui abrite le bureau de poste, les douanes et
d'autres services gouvernementaux. Il compte parmi les nombreux
bâtiments érigés dans le cadre d'un programme de construction d'édifices
publics dans les petites villes et localités canadiennes, placé sous la
direction de Thomas Fuller, architecte principal en chef du ministère
des Travaux publics de 1881 à 1896. Il est d'ailleurs facile de
constater dans l'architecture du bâtiment les normes élevées
d'esthétisme imposées par Fuller. Comme un grand nombre de ses
réalisations, l'ancien bureau de poste comporte un portique d'entrée
voûté, des façades jumelles symétriques ainsi qu'une tour d'horloge,
dont l'architecture unique a été conçue de manière à être visible autant
de la rue que de la rivière Grand. Par ailleurs, le toit en mansarde
fortement incliné, les couleurs et les textures contrastantes ainsi que
le travail de maçonnerie remarquable créent un mélange spectaculaire
d'architectures gothique, romane et Second Empire.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Bureau-de-Poste-de-Kingston
Kingston, Ontario
Le lieu historique national du Canada de
l'Ancien-Bureau-de-Poste-de-Kingston est un élégant édifice de deux
étages de style néo-classique, en pierre calcaire. Il est situé au
centre ville de Kingston, dans un quartier où on trouve d'imposants
bâtiments du milieu du XIXe siècle, construits en pierre calcaire.
L'ancien bureau de poste de Kingston illustre l'éclectisme des débuts de
l'architecture victorienne au Canada, alors que les architectes
abandonnaient progressivement les aspects rigides et formels du
néo-classicisme pour adopter la richesse et la diversité d'autres
vocabulaires architecturaux. L'ancien bureau de poste de Kingston est
représentatif de la pérennité du style néo-classique, ainsi que de
l'utilisation croissante d'éléments de style Renaissance dans
l'architecture des édifices commerciaux et publics. Ses proportions de
base et sa composition, ainsi que plusieurs de ses caractéristiques
ornementales, sont caractéristiques du style classique. L'influence de
la Renaissance italienne est évidente dans la richesse de la maçonnerie
et les ouvertures en plein cintre.
L'ancien bureau de poste de Kingston a été construit entre 1856 et 1859
par des entrepreneurs locaux, Overend and Matthews, sur un plan carré à
cinq baies du cabinet d'architectes montréalais Hopkins, Lawford and
Nelson. L'extension de 1912 de trois baies sur sa longueur a été conçue
par le ministère des Travaux publics et réalisés par les entrepreneurs
McKelvey & Birch.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Bureau-de-Poste-de-Toronto / Ancienne-Banque-du-Canada
Toronto, Ontario
L'Ancien bureau de poste de Toronto/Ancienne Banque du Canada est un
immeuble en pierre de trois étages de style néo-grec, datant du milieu
du XIXe siècle. Il est situé du côté ouest de la rue Toronto, entre les
rues King et Adelaide, au centre ville de Toronto.
L'Ancien bureau de poste de Toronto/Ancienne Banque du Canada a été
désigné lieu historique national du Canada en 1958 parce qu'il est un
bel exemple d'architecture de style néo-grec.
Le bâtiment a été conçu par les architectes torontois de renom,
Frederick Cumberland et William Storm, à qui l'on doit la conception,
dans divers styles « renouveau », de plusieurs autres immeubles de
Toronto datant du milieu du XIXe siècle.
|

©National Archives of Canada / Archives nationales du Canada, PA-34242 |
Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Édifice-des-Archives-Fédérales
Ottawa, Ontario
Le lieu historique national du Canada de
l'Ancien-Édifice-des-Archives-Fédérales est un imposant édifice de
pierre de style gothique Tudor fédéral. L'édifice est en retrait de la
promenade Sussex, à Ottawa, sur laquelle se trouvent plusieurs autres
importantes institutions fédérales situés à proximité dont le lieu
historique national du Canada de la Monnaie-Royale-Canadienne et le
Musée des beaux-arts du Canada. Il se compose d'un bloc original de
trois étages à sept baies, avec une entrée centrale, construit de 1904 à
1906, et d'un ajout perpendiculaire plus important de trois étages
construit en 1924 à 1925.
L'Ancien édifice des Archives fédérales a abrité les archives nationales
du Canada de 1906 à 1967. La construction d'une installation permanente,
à l'épreuve du feu, où on recueille, préserve et étudie les documents de
la nation traduisait le sentiment grandissant d'identité canadienne et
l'intérêt accru pour l'histoire du pays chez les Canadiens. Son
emplacement sur la promenade Sussex a contribué à la vision de l'ancien
Premier ministre Wilfred Laurier de transformer Ottawa d'une ville
industrieuse de travail du bois en une capitale prestigieuse munie des
aménagements et institutions culturelles et civiques appropriés. Sous la
direction de Laurier, David Ewart, ingénieur en chef du ministère des
Travaux publics (de 1897 à 1914) a supervisé la conception de quatre
importants édifices publics fédéraux, y compris l'Ancien édifice des
Archives fédérales, qui ont contribué à créer un sentiment d'identité
fédérale au sein de la capitale du Canada. Ces édifices ont été conçus
dans le style gothique Tudor qui cadrait avec celui des édifices de la
Colline du Parlement. Ce style convenait à une capitale associée à
l'Empire britannique, et on pouvait facilement l'adapter aux principes
de planification du style Beaux-Arts.
Sir Arthur Doughty, archiviste du Dominion de 1904 à 1935, qui a été
désigné personnage d'importance nationale, est étroitement associé à la
fois à l'évolution de la structure physique du l'Ancien édifice des
Archives fédérales et au développement des archives à titre
d'institution publique. Nommé l'année même où la construction du
bâtiment des archives a commencé, il a servi pendant plus de trois
décennies, et notamment pendant la période d'expansion du bâtiment entre
1924 et 1925.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national de l'Ancien-Édifice-de-la-Commission-Géologique-du-Canada
Ottawa, Ontario
L'Ancien édifice de la Commission géologique du Canada est un bâtiment
simple en pierre à trois étages, situé en évidence sur un coin de rue du
Marché By à Ottawa.
L'Ancien édifice de la Commission géologique du Canada a été désigné
lieu historique national en 1955 parce qu'il est l'un des plus anciens
édifices préservés de la capitale, et a abrité des services publics et
des institutions culturelles à différentes époques.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à ses liens avec la haute
fonction publique, tels qu'exprimés par son emplacement, sa forme, ses
matériaux et sa masse. L'Ancien édifice de la Commission géologique a
été fondé dans les années 1860 et faisait partie d'un ensemble de trois
bâtiments contigus, qui avaient servi, ensemble ou séparément, d'hôtel,
de caserne, de musée, de bureaux du gouvernement, de bureaux d'affaires
ou de boutiques. La partie la plus ancienne de l'édifice a été
construite en 1863 par James Skead, un homme d'affaires local, pour
agrandir ce qui était à l'époque le British Hotel. Une fois ces
agrandissements terminés, les propriétaires ont essayé de vendre
l'édifice qu'ils renommèrent Hôtel Clarendon. La Couronne l'a loué de
1864 à 1871 pour en faire une caserne. Il a retrouvé sa vocation d'hôtel
en 1874, puis acheté par le gouvernement fédéral en 1879.
L'édifice du 541, promenade Sussex, devenu propriété de la Couronne, a
d'abord abrité les bureaux de la Commission géologique du Canada, fondée
à Montréal en 1842 par la Province du Canada. En 1877, en vertu d'une
nouvelle loi, le statut d'institution fédérale relevant du ministère de
l'Intérieur fut reconnu à la Commission géologique. En 1879, le
gouvernement fédéral acheta l'hôtel Clarendon et le rénova pour qu'il
abrite les bureaux ainsi que le musée de la Commission géologique et
d'histoire naturelle du Canada. La Commission a joué un rôle important
dans la découverte et l'exploitation des vastes richesses minérales du
Canada, et la collection de son musée est devenue la fondation des
musées nationaux du Canada.
Avant que la Commission déménage dans l'ancien hôtel, l'édifice abritait
l'exposition inaugurale de la Canadian Academy of Arts. Les oeuvres qui
y étaient exposées constitueront la première collection du Musée des
beaux-arts du Canada.
La Commission offrait des services à ceux qui s'intéressaient à la
géologie et à l'histoire naturelle pour des motifs professionnels,
éducatifs ou d'affaires, ainsi qu'au grand public. Par conséquent, on y
trouvait à son siège social situé au 541, promenade Sussex des pièces
muséographiques, une bibliothèque, un bureau de cartographie et des
laboratoires où on préparait des spécimens d'histoire naturelle,
analysait des matériaux géologiques, et dessinait et reproduisait des
cartes. Le musée occupait les trois étages de l'aile de l'édifice située
sur la rue George qui a été rénovée plusieurs fois, particulièrement
grâce à l'aide financière du fondateur de la Commission, William Logan.
La partie donnant sur la promenade Sussex a été reconstruite en 1881 sur
son contour au sol initial, sous la direction du ministère des Travaux
publics, par Thomas Askwith, un éminent constructeur local, pour abriter
les bureaux de la Commission. Celle-ci a été dirigée par Dr Alfred
Selwyn de 1869 à 1894, et elle est demeurée à la même adresse jusqu'en
1911, année à laquelle elle a déménagé dans le Musée commémoratif
Victoria.
Après le déménagement du musée et des bureaux de la Commission,
l'édifice du 541, promenade Sussex a été rénové pour abriter le
ministère des Mines. En 1917, une annexe fut ajoutée au côté est de
l'aile donnant sur la rue George pour servir de laboratoire.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, HRS 0918, 1998 |
Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Édifice-de-la-Douane-de-Hamilton
Hamilton, Ontario
Le lieu historique national du Canada de
l'Ancien-Édifice-de-la-Douane-de-Hamilton est un élégant édifice de deux
étages, d'inspiration italienne, situé au centre-ville de Hamilton, en
Ontario. Cet édifice en pierre brettelée présente une riche
ornementation puisée dans le vocabulaire architectural de l'époque
classique, notamment un portique à colonnes, des bandeaux et une
corniche en saillie ainsi que des moulures de finition intérieure et des
gypseries décoratives. Il abrite maintenant le centre culturel "Workers
Arts and Heritage Centre".
L'Ancien édifice de la douane a été désigné lieu historique national,
car il est un bel exemple de l'architecture d'inspiration italienne au
Canada, et parce que son parement de pierre est d'une qualité
exceptionnelle.
L'Ancien édifice de la douane (1858-1860) est un excellent exemple de
l'architecture d'inspiration italienne qui, de 1840 à 1870, était très
populaire au Canada. Les édifices d'inspiration italienne, dont
l'architecture rappelait celle des palais de style renaissance de Rome
et de Florence, étaient caractérisés par un premier étage élevé en
pierre rustiquée et un second en pierre lissée, de nombreux ornements
classiques et une corniche massive. La diversité des finitions et la
qualité supérieure du parement en pierre rehaussent la conception de
l'Ancien édifice de la douane.
L'Ancien édifice de la douane a été construit par la Commission des
travaux publics de la province de l'Ontario préconfédérale, selon les
plans de l'architecte F.P. Rubidge. Il illustrait la prospérité de
Hamilton à titre d'important centre ferroviaire et port des Grands Lacs.
Depuis 1915, l'édifice ne sert plus de poste de douane. Il a changé de
vocation à plusieurs reprises et abrite maintenant un centre
culturel.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Butterill, 1995 |
Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Hangar-d'Exercices-d'Elora
Elora, Ontario
Lieu historique national du Canada de
l'Ancien-Hangar-d'Exercices-d'Elora consiste en un simple édifice en
pierre d'un seul étage du milieu du XIXe siècle, surmonté d'un toit
incliné. Il a été construit dans la ville d'Elora, en Ontario pour les
exercices militaires et pour l'usage de la communauté. Il comprend un
grand hall ouvert.
L'ancien hangar d'exercices d'Elora est un exemple particulièrement bien
construit du type de manèges érigés au Canada par les unités de milice
rurales avant que le ministère de la Défense n'introduise un modèle type
pour ce genre d'édifice. Il a été construit selon un plan de hall ouvert
simple, mais sa construction en pierre et les finis soignés dépassent
les normes de l'époque. Abritant aujourd'hui la Régie des alcools de
l'Ontario (RAO), il continue de jouer un rôle actif dans la communauté
d'Elora.
|

©County of Brant Public Library |
Lieu historique national du Canada de l’ancien hôtel de ville de Paris
Paris, Ontario
Construit en 1854 selon les plans de l'architecte John Maxwell, cet ancien hôtel
de ville constitue un rare exemple canadien de bâtiment civil de style
néo-gothique. Il se distingue par la présence de détails architecturaux
s'inspirant d'exemples médiévaux, notamment la structure de bois exceptionnelle
de la grande salle de son second étage. Servant à la fois d'hôtel de ville et de
marché, à l'instar de plusieurs autres bâtiments de même typologie construits au
Canada au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, l'ancien hôtel de ville de
Paris s'inspire de bâtiments britanniques datant de la fin du XVIIIe et du début
du XIXe siècle. Érigé au cours d'une période de croissance et d'ambition pour
cette ville industrielle émergente, il constitue un monument à la fierté civile
pour la petite communauté de Paris.
Connu comme le Bawcutt Centre, l'ancien hôtel de ville de Paris est situé au 13,
rue Burwell, dans un secteur qui était autrefois considéré comme le centre de la
petite ville ontarienne de Paris. Le style médiéval néo-gothique anglais de ce
bâtiment, souvent observé dans les églises, constituait un choix inhabituel pour
un édifice civil du genre, où la tradition classique prévalait au XIXe siècle.
Cet édifice de deux étages et demi recouvert de brique comporte une tour,
laquelle était à l'origine surmontée d'un clocher, des contreforts en angle,
dont certains étaient autrefois surmontés de tourelles, ainsi qu'une combinaison
de fenêtres en ogive de style néo-gothique et de fenêtres rectangulaires de
style Tudor.
À l'instar de son extérieur, l'intérieur du bâtiment est doté de plusieurs de
ses éléments caractéristiques d'origine. La salle du second étage, avec ses
plafonds voûtés et ses portes cintrées, constitue la pièce maîtresse du
bâtiment. Le toit à poutres de bois apparentes de la salle comprend six fermes
gothiques très bien conservées. Le rez-de-chaussée abritait à l'époque un marché
couvert à une extrémité et une salle du conseil, ainsi que des bureaux de
magistrat et de trésorier à l'autre extrémité. Le sous-sol servait quant à lui
de « marché inférieur » et abritait également des cellules pour deux
prisonniers, lesquelles sont toujours présentes.
Pendant 50 ans, le bâtiment a servi d'hôtel de ville et de marché, avec sa salle
de réunion située au deuxième étage, laquelle servait d'espace de divertissement
pour le théâtre, l'opéra, les concerts, les conférences et les projections de
films. Après que le conseil municipal de Paris eut libéré le bâtiment en 1904,
celui-ci fut utilisé pour diverses fonctions, notamment comme usine de
fabrication d'aiguille, comme résidence privée, comme siège du détaillant de
fournitures d'artisanat Mary Maxim et finalement comme maison de vente aux
enchères.
|
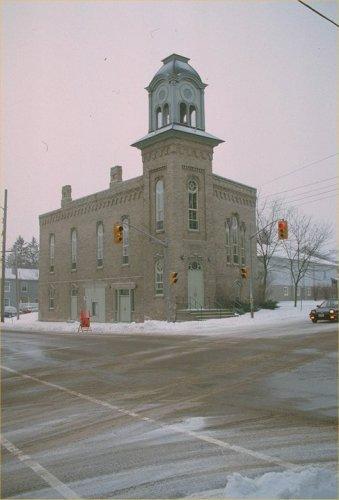
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national du Canada de l'Ancien hôtel de ville de Port Perry
Port Perry, Ontario
L'Ancien hôtel de ville de Port Perry est un édifice de trois étages de
style à l'italienne, construit en 1873. Il est situé bien en vue au coin
d'une importante intersection de la ville de Port Perry.
L'Ancien hôtel de ville de Port Perry a été désigné lieu historique
national en 1984 parce que c'est un extraordinaire exemple de salle de
réunion municipale ayant servi de centre communautaire politique et
social. Son site dominant, et la qualité de sa conception et de sa
finition intérieure, sont également remarquables.
Cet hôtel de ville, bâti en 1873 suite à la constitution du village de
Port Perry et à l'arrivée du chemin de fer, concrétisait la confiance de
cette communauté en sa prospérité future. À l'instar de nombreuses
petites localités de l'Ontario, Port Perry a érigé un édifice
multi-fonctionnel conçu pour diverses vocations communautaires. La salle
inférieure, décorée simplement, servait aux réunions du conseil du
village. L'ouvragée salle d'opéra avec balcon située au deuxième étage
est devenue le centre social de la collectivité. Même si l'édifice ne
sert plus de bureaux municipaux, il est toujours utilisé comme centre
communautaire et comme théâtre.
L'hôtel de ville est situé bien en vue à un important carrefour de Port
Perry. Sa tour cornière est un point de repère de son quartier
commercial. Son style à l'italienne était au goût du jour pour les
édifices municipaux construits en Ontario au milieu du XIXe
siècle.
|
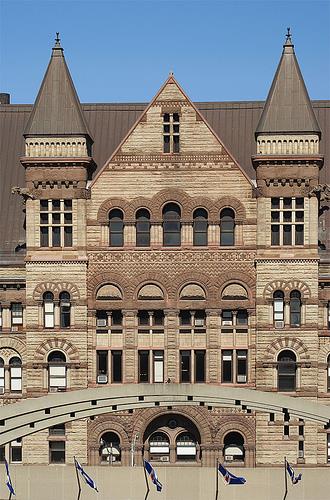
©Old Toronto City Hall and York County Court House, deymosD, June 2007

©Old Toronto City Hall and York County Court House, deymosD, June 2007 |
Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Hôtel-de-Ville-de-Toronto et Palais-de-Justice-du-Comté-de-York
Toronto, Ontario
L'Ancien hôtel de ville de Toronto et palais de justice du comté de York
est un édifice de grès massif de style romanesque à la Richardson.
Construit de 1889 à 1899, il est situé au coeur de Toronto, à côté de
l'hôtel de ville actuel qui l'a remplacé en 1965.
L'Ancien hôtel de ville de Toronto et palais de justice du comté de York
a été désigné lieu historique national en 1984 parce que, de style
romanesque à la Richardson, il figure parmi les hôtels de ville aux
dimensions monumentales les plus importants au Canada. De plus, son
superbe emplacement au centre-ville, ses revêtements en grès richement
sculpté, et ses différentes couleurs et textures se combinent pour
exprimer clairement la fierté de cette région à la fin du XIXe siècle.
L'Ancien hôtel de ville de Toronto et palais de justice du comté de York
est l'un des plus beaux exemples d'architecture de style romanesque à la
Richardson au Canada. Ses dimensions et conception monumentales
reflètent sa double vocation d'hôtel de ville et de palais de justice,
la complexité croissante de l'administration municipale, et la volonté
des élus municipaux de contribuer à la prospérité et à l'urbanisation
rapide de Toronto au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il a
été conçu entre 1883 et 1886 par l'architecte local E.J. Lennox, mais sa
construction s'est échelonnée sur une période de onze ans, soit de 1889
à 1899. Sa conception s'inspire d'une tendance du style romanesque,
élaborée par l'architecte américain H.H. Richardson, qui était très
prisée pour les édifices publics dans les années 1880. De nombreux
artisans ont participé à sa construction, notamment la compagnie Robert
McCausland Ltd. et George Agnew Reid qui ont respectivement réalisé les
vitraux et les murales. Le style romanesque à la Richardson est
clairement illustré par les dimensions et proportions monumentales du
bâtiment, ses revêtements en grès richement coloré et sculpté, et les
nombreux tours, ouvertures en plein cintre, et motifs des arches et des
tympans. Une haute tour d'horloge décentrée dominant l'édifice est
située dans l'axe de la rue Bay, artère principale du centre financier
de la ville.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1990 |
Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Hôtel-de-Ville-de-Woodstock
Woodstock, Ontario
L'ancien hôtel de ville de Woodstock est un hôtel de ville de deux
étages en brique jaune, de style à l'italienne, construit en 1853. Il
est situé bien en vue à l'avant d'un square gazonné, au cœur de la ville
de Woodstock.
L'ancien hôtel de ville de Woodstock a été désigné lieu historique
national du Canada en 1955 parce qu'il est un excellent exemple de
l'adaptation coloniale d'un hôtel de ville britannique, et à cause de sa
longue association avec la vie politique et sociale du comté d'Oxford.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à sa forme, à ses matériaux et
à sa conception fonctionnelle. C'est un exemple subsistant des premiers
hôtels de ville bâtis en Ontario au milieu du XIXe siècle. À l'origine,
il combinait les fonctions d'hôtel de ville et de marché. C'était un des
nombreux édifices municipaux à fonctions multiples construits au milieu
du XIXe siècle dans le Haut-Canada. Sa haute forme à deux étages,
d'inspiration classique, sa conception pluri-fonctionnelle, et la
coupole sur le toit, sont typiques de l'architecture des hôtels de ville
du milieu du XIXe siècle. Les proportions classiques et les ornements à
l'italienne du bâtiment reflètent l'adaptation des tendances
architecturales britanniques aux besoins et aux contraintes financières
du Haut-Canada. L'édifice a conservé une grande partie de son
aménagement et de sa finition intérieurs d'origine. Il s'agit sans doute
de l'hôtel de ville pluri-fonctionnel de ce type le mieux conservé en
Ontario.
La vocation multiple de cet hôtel de ville illustre l'évolution des
responsabilités des municipalités ontariennes pendant la deuxième moitié
du XIXe siècle. À l'origine, il était conçu pour abriter un marché au
rez-de-chaussée et une salle de réunion ainsi que le bureau du maire à
l'étage. Il a aussi servi de temps en temps de salle de concert ou de
conférence, de salle de danse, de salle d'opéra, de caserne de pompiers,
de poste de police, de cour d'assises, de salle du conseil et de bureaux
municipaux. En 1865, une caserne de pompiers a été ajoutée à l'arrière
de l'édifice. Puis, en 1870, on a déménagé le marché ailleurs, ce qui a
permis d'installer une salle du conseil et des bureaux municipaux au
rez-de-chaussée, tandis qu'on a agrandi l'étage supérieur pour y
installer une grande salle de réunions pouvant accueillir des événements
sociaux et des spectacles publics. Un troisième rajout a été effectué en
1977, mais il a été démoli par la suite. L'édifice a eu des fonctions
municipales et communautaires pendant plus d'un siècle, jusqu'à ce qu'on
le convertisse en musée en 1968. En 1994, on a restauré le bâtiment et
on lui a ajouté une quatrième annexe, sur le contour au sol de la
troisième, pour y installer des ascenseurs et des toilettes.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |
Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Ottawa Teachers' College
Ottawa, Ontario
Le lieu historique national du Canada de l'Ancien-Ottawa Teachers'
College est situé sur la rue Elgin, au centre-ville d'Ottawa. Bel
exemple d'une conception éclectique de la fin du XIXe siècle, l'édifice
de deux étages et demi offre une composition balancée d'une
interprétation éclectique du style néo-gothique. Le toit, de style
Second Empire, avec un beffroi en pointe central, présente un pignon et
une série de tourelles vives. L'édifice fait à présent partie de
l'ensemble de l'hôtel de ville d'Ottawa.
L'ancien Ottawa Teachers' College a été désigné lieu historique national
du Canada en 1974, parce qu'il s'agit d'un exemple important sur le plan
national du style néo-gothique au Canada qui utilise des éléments
architecturaux divers, reflétant un esprit éclectique.
Le Ottawa Teacher's College ou École normale, conçu par l'architecte
W.R. Strickland et construit, entre 1874 et 1875, par J. Forin, sous la
direction de l'architecte James Mather, était le deuxième établissement
de ce type à être construit en Ontario. Le Collège a continué de former
des enseignants pour l'Ontario jusqu'en 1974. Il a été acheté par le
gouvernement régional et un ensemble de bureaux a été construit à
l'arrière. Après la fusion municipale, l'édifice s'est intégré à l'hôtel
de ville d'Ottawa.
La masse rectangulaire et le pavillon central du bloc principal suivent
un format accepté pour les institutions académiques du XIXe siècle,
alors que l'utilisation d'éléments architecturaux divers, tel le mélange
de fenêtres en ogive, semi-circulaires, à haut plat de style gothique,
des colonnes de style roman et un toit de style Second Empire, reflètent
un esprit éclectique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Nathalie Ouellette. |
Lieu historique national du Canada de l’ancien pensionnat indien de Shingwauk
Sault Ste. Marie, Ontario
Établi en 1875 par l’Église anglicane, le pensionnat de Shingwauk fait
partie du système de pensionnats indiens soutenu par le gouvernement
canadien et certaines églises et organisations religieuses qui, dans un
effort concerté et délibéré, visent à assimiler les enfants autochtones,
les convertir au christianisme et les isoler de leurs familles, de leur
culture, de leur langue et de leurs traditions. Le pensionnat est
administré par le gouvernement fédéral à partir de 1935, mais demeure
sous la gestion de l’Église anglicane jusqu’en 1969. Le gouvernement
fédéral en aura l’entière responsabilité jusqu’à sa fermeture en 1970.
Le pensionnat doit son nom à l’éminent chef anishinaabe Shingwaukonse
dont la vision d’une école où les élèves anishinaabe pourraient acquérir
des connaissances et habiletés qui leur permettraient de s’épanouir dans
une société évoluant rapidement tout en préservant leur culture et leur
langue. Au cours de ses 96 années d’existence, le pensionnat de
Shingwauk ne conserve toutefois du chef Shingwaukonse que son nom, car
sa véritable vision est perdue.
Construit en 1934-1935 pour remplacer le bâtiment d’origine datant de la
fin du XIXe siècle, Shingwauk Hall, est l’un des derniers édifices ayant
servi de pensionnat indien qui subsiste toujours au Canada. De plus, le
site du pensionnat est l’un des rares qui existent encore aujourd’hui.
Ce dernier se compose d’un ensemble notable d’éléments bâtis et de
paysages préservés qui témoigne de la longue histoire des pensionnats au
Canada, notamment le cimetière commémoratif Shingwauk (1876), la
chapelle commémorative de l’évêque Fauquier (1883), l’ancienne résidence
du directeur (1935), l’ancien atelier de menuiserie (1951) et l’école
publique Anna McCrea (1956). Le cimetière Shingwaulk compte 109
sépultures, dont 72 étudiants décédés entre 1875 et 1956.
Plus de mille enfants autochtones de l’Ontario, du Québec, des Prairies
et des Territoires du Nord-Ouest fréquentent ce pensionnat. Les élèves
sont soumis chaque jour à un emploi du temps très strict marqué par des
tâches d’entretien, une discipline sévère et des abus, du travail
pénible et de la négligence émotionnelle. Les frères et sœurs sont
séparés selon leur sexe et leur âge, et les langues autochtones sont
interdites. De nombreux élèves y passent toute leur enfance, et certains
ne sont jamais rentrés à la maison. Les séquelles durables des
expériences vécues dans les pensionnats ont encore aujourd’hui des
répercussions importantes sur les anciens élèves, leurs familles et leur
communauté.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Jennifer Cousineau

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Jennifer Cousineau |
Lieu historique national du Canada de l'Ancienne-École-de-Formation-pour-Garçons-de-Bowmanville — Camp 30
Bowmanville, Ontario
L'ensemble de bâtiments, qui a d'abord servi de centre d'éducation pour
garçons à Bowmanville, est un exemple rare et remarquable d'ensemble de
style Prairie au Canada. Le style est aussi fortement influencé par la
tradition Arts and Crafts. Les six bâtiments proposés sont faits de
maçonnerie, leur enveloppe étant recouverte de brique et de stuc, et ils
sont coiffés d'une toiture en bardeaux d'amiante. Ce sont les quatre
bâtiments les plus anciens — la cafétéria, la maison Jury, la maison
Kiwanis et le gymnase — qui sont les plus caractéristiques du style
vernaculaire des Prairies. Ils exposent des plans ouverts, des volumes
fragmentés, des matériaux naturels, une horizontalité rappelant le
paysage plat des Prairies, des ornements géométriques et des toits
plats. Ces bâtiments sont d'allure étonnamment moderne. Bien qu'il
s'agisse techniquement de bâtiments institutionnels, la maison Jury, la
maison Kiwanis et la cafétéria sont relativement petites et, de ce fait,
rappellent plus que les autres bâtiments l'architecture domestique à
partir de laquelle Frank Lloyd Wright a d'abord structuré le style
Prairie au tournant du XXe siècle. Le dortoir triple et
l'infirmerie/maison du général présentent des éléments qui illustrent
une approche traditionnelle de l'esthétique. Ces bâtiments adaptent des
éléments provenant du style Prairie et de la tradition Arts and Crafts,
notamment les espaces intérieurs ouverts et les volumes fragmentés, les
matériaux naturels et les ornements géométriques, mais ils conservent
les toits inclinés et les fenêtres à guillotine, des éléments qui ont
été abandonnés dans l'architecture institutionnelle après que le style
international s'est répandu au Canada (plusieurs décennies plus tard).
Le Centre d'éducation pour garçons de Bowmanville/Camp 30 est
d'importance historique pour les raisons suivantes :
son ouverture au milieu des années 1920, l'école de formation pour
garçons de Bowmanville était généralement considérée comme l'école la
plus progressiste du genre au Canada. Rare spécimen du mouvement
architectural « Prairie School » au Canada, cet établissement s'est
retrouvé à l'avant-garde du courant de réforme de la jeunesse grâce à
son architecture moderne, à son aménagement en campus, à son personnel
qualifié, à son milieu ouvert, semi-familial, et à son vaste programme
d'enseignement destiné aux garçons de 8 à 14 ans;
endant la Seconde Guerre mondiale, l'école a été adaptée pour devenir
un camp d'internement, le camp 30, destiné à accueillir des Allemands
faits prisonniers de guerre par les Alliés. Ses principaux bâtiments,
qui servirent à l'internement des prisonniers de 1941 à 1945, sont
toujours debout, bien que les tours de garde, les clôtures et les
casernes provisoires aient été démantelées après la guerre, lorsque le
camp a été reconverti en école. Le camp 30 a été le théâtre d'une petite
émeute, malgré tout tristement célèbre, communément appelée la «
bataille de Bowmanville ».
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2002 |
Lieu historique national du Canada de l'Ancienne-Église Hay Bay
Greater Napanee, Ontario
Le lieu historique national du Canada de l'Ancienne-Église Hay Bay est
une salle paroissiale et communale remontant aux premiers jours du
peuplement du Haut-Canada. On accède à cette propriété rurale de deux
acres et au cimetière adjacent par des chemins de campagne. Le lieu
surplombe Hay Bay, près d'Adolphustown, en Ontario. L'édifice de facture
simple, en forme de boîte, coiffé d'un toit en pignon, est constitué
d'une solide charpente et de revêtements en clin de planches. Haut de
deux étages, garni de trois baies, le bâtiment à pignon utilise un
langage décoratif dérivé du classicisme. L'intérieur présente une chaire
et un jubé. L'édifice est aujourd'hui utilisé comme musée.
L'ancienne église de Hay Bay de conception simple fut d'abord construite
en 1792 comme salle de réunion, durant les premiers jours de la
colonisation du Haut-Canada, à une époque où les établissements étaient
isolés et de petite taille et les communications difficiles, les voies
d'eau demeurant les principaux axes de transport. Le caractère de cette
salle de réunion de pionniers est accentué par l'emplacement choisi dans
un cadre rural préservé. L'église a été conçue comme lieu de rencontre
tant séculier que religieux quoique l'organisation intérieure donne
priorité au caractère religieux. En dépit de quelques changements,
l'église conserve les caractéristiques essentielles des salles de
réunion évangéliques pré-1840 telles qu'élaborées en Angleterre, en
Nouvelle-Angleterre, et adaptées au Haut-Canada. Agrandie en 1835,
l'ancienne église de Hay Bay cessa d'être un lieu de prière en 1860,
devenant un espace d'entreposage de ferme. En 1910, elle fut acquise de
nouveau et restaurée par l'Église méthodiste. Elle abrite actuellement
un musée et sert encore chaque année à des cérémonies annuelles de
l'Église Unie du Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Hucker, 1999. |
Lieu historique national du Canada de l'Ancienne-Gare-du-Canadien-National-à-Hamilton
Hamilton, Ontario
L'ancienne gare du Canadien National à Hamilton consiste en un ensemble
de bâtiments ferroviaires interreliés, construits entre 1929 et 1931.
L'élément principal est la gare, un bâtiment ferroviaire monumental de
deux étages, d'inspiration classique, avec une façade en pierre. Devant
la gare, se trouve une grande place ouverte. Derrière la gare, le
terrain descend brusquement jusqu'au niveau de l'ancienne voie ferrée et
la station devient un bâtiment à quatre étages. La salle des pas perdus
vitrée s'étend de l'arrière de la gare jusqu'à l'ancienne voie ferrée.
Un bâtiment de messagerie en brique, long et bas, s'étend d'un côté du
bâtiment principal de la gare, parallèlement à l'ancienne voie ferrée.
La gare est située près du centre ville d'Hamilton, dans une zone plutôt
résidentielle que l'on appelle «North End».
Construite entre 1929 et 1931 selon les plans de l'architecte en chef de
la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, John Schofield,
l'ancienne gare du Canadien National à Hamilton est un exemple rare d'un
ensemble de gare ferroviaire. Il respecte une approche très rationnelle
pour la circulation des passagers et des bagages, selon laquelle le
passager et les fonctions opérationnelles sont parfaitement séparées, au
niveau horizontal ou vertical. La configuration de la salle des pas
perdus surélevée par rapport aux rails en contrebas était très fréquente
aux États-Unis, mais rare au Canada. Malgré le fait que la gare ne soit
plus utilisée comme gare de chemin de fer, il est encore possible de
discerner les tracés de circulation originaux dans l'aménagement du
bâtiment, la salle des pas perdus en saillie, les rails en contrebas, et
le bâtiment de messagerie.
La façade de la gare d'inspiration classique, la composition Beaux-Arts
et la grande place ouverte qui lui fait face, sont des éléments typiques
du mouvement City Beautiful. Mouvement urbain conservateur qui vit le
jour à la fin du XIXe siècle, le mouvement City Beautiful cherchait à
contrer les conséquences physiques et morales d'aspect négatif de
l'industrialisation rapide en embellissant les espaces urbains. Dans les
années 1920, la ville d'Hamilton s'est finalement engagée dans un plan
de rationalisation et d'embellissement. Ce plan comprenait la
construction d'une gare ferroviaire plus centrale et l'amélioration des
transports et de la circulation, ainsi que des paysages urbains en
éliminant les passages à niveau par des tunnels et des ponts
ferroviaires. C'est ainsi que l'ancienne gare du Canadien National à
Hamilton a été construite par la Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada.
Après la Deuxième Guerre mondiale, la gare a été un lieu d'accès
important pour les immigrants au Canada. Dans la période d'après-guerre,
les politiques d'immigration canadiennes s'étant assouplies, des
immigrants italiens et allemands ont soudainement afflué à Hamilton. Un
bon nombre d'entre eux sont arrivés au Canada par bateau, puis ont pris
le train pour arriver à Hamilton pour la première fois par la gare de
chemin de fer, voie que les immigrants grecs, yougoslaves et portugais,
emprunteront dans les années 1960.
Réaménagé par l'Union internationale des journaliers d'Amérique du Nord
(UIJAN) en l'an 2000 comme centre de formation et de récréation, le
complexe est demeuré intact à l'extérieur et dans la plupart des espaces
publics.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J Butterill, 1994 |
Lieu historique national du Canada Annesley Hall
Toronto, Ontario
Annesley Hall est une belle résidence d'étudiantes en brique rouge,
située sur le campus de l'Université de Toronto, au centre-ville de
Toronto. L'édifice reflète les caractéristiques du style néo-Queen Anne,
par sa conception institutionnelle, attestée par les toits fortement
inclinés, les pignons proéminents, les matériaux richement colorés et
texturés, et le large éventail d'ornements à caractère historique qui
rendent les grandes maisons institutionnelles attrayantes et
chaleureuses.
Annesley Hall a été désigné lieu historique national du Canada parce
qu'il est un bel exemple du style néo-Queen Anne dont s'inspire
l'architecture institutionnelle.
Construit en 1902-1903, selon les plans de l'architecte G.M. Miller, il
était la première résidence conçue spécifiquement pour des étudiantes
sur un campus universitaire canadien. Il a été rénové en 1988 et a
conservé sa vocation d'origine.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2001 |
Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement de l'exploitation minière de Cobalt
Cobalt, Ontario
Le Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement de
l'exploitation minière de Cobalt se compose de sections de la ville de
Cobalt et d'une partie du canton de Coleman dans l'arrondissement de
Timiskaming. Il contient des éléments paysagers, des mines et des
bâtiments associés aux mines d'argent et au peuplement urbain du début
du XXe siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2003 |
Lieu historique national du Canada de la Banque-du-Haut-Canada
Toronto, Ontario
L'édifice de la Banque du Haut-Canada date du début du 19e siècle. De
style néo-classique, cet immeuble de pierre, de deux étages et demi est
situé sur la rue Adelaide dans le centre ville de Toronto.
L'édifice de la Banque du Haut-Canada a été désigné lieu historique
national en 1977. Les motifs de sa désignation sont le rôle que la
Banque du Haut-Canada a joué dans le développement du Haut-Canada et
dans l'évolution de Toronto pour devenir le centre commercial de la
colonie, ainsi que la conception de l'édifice, qui projette l'image
d'opulence conservatrice tant prisée par les institutions financières de
l'époque.
La valeur patrimoniale de cet endroit correspond au rôle qu'il a joué
dans l'émergence des banques au Canada, comme en témoignent son
classicisme de bon goût et ses matériaux résistants.
Ajouté en 1844, le portique conçu par l'architecte John G. Howard
confère à l'édifice une sobriété classique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Jim Molnar, 2003 |
Lieu historique national du Canada des Barrages-de-Pêche-Mnjikaning
Atherley, Ontario
Les barrages de pêche en bois les plus gros et les mieux conservés dont
on connaisse l'existence dans l'est de l'Amérique du Nord, ces barrages
ayant servi d'environ 3300 av. J.-C.
Le lieu historique national du Canada des Barrages-de-Pêche-Mnjikaning
est situé sur des portions inférieures du défilé entre les lacs Simcoe
et Couchiching, une partie de la voie navigable Trent-Severn. Il
comprend le canal navigable balisé, l'ancien canal qui coule vers le
nord-est et le marais entourant ces canaux. La constriction du défilé
rend possible la prise de poissons qui se déplacent entre les lacs et la
faible profondeur des canaux permet d'y enfoncer des pieux en fascines.
De nos jours, le canal se divise en deux : le canal d'origine s'incurve
vers le nord-est et le canal navigable file plein nord. Le canal
navigable a été dragué en 1856-57, et le canal d'origine a aussi été
dragué au sud de la jonction. Une île linéaire a été créée le long de la
rive est du canal navigable. Une levée empierrée pour le lit d'une
ancienne voie ferrée du chemin de fer Canadien Pacifique longe la
portion nord du défilé. Des marécages occupent l'espace entre les
canaux, de même que l'est de l'ancien canal. Un troisième canal semble
avoir existé autrefois, s'incurvant vers l'ouest à partir du canal
navigable et a été en grande partie comblé au fil du développement
moderne.
Les plus anciens pieux de bois sont enfoncés dans le canal est, et une
datation au carbone a permis d'évaluer l'âge de certains d'entre eux à
5000 ans, ce qui correspond à la période déterminée par les archéologues
comme étant archaïque supérieure. On connaît peu de choses de cette
région au cours de la période mentionnée, et, par conséquent, les
archéologues sont impuissants à décrire les affiliations culturelles des
plus anciens occupants ayant utilisé les fascines. Une autre série de 12
datations au radiocarbone pointe vers l'époque où les Hurons-Wendats et
leurs proches ancêtres peuplaient la région environnante du
défilé.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, W. Duford, 1989 |
Lieu historique national du Canada de la Basilique-Catholique-Notre-Dame
Ottawa, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la
Basilique-Catholique-Notre-Dame est une cathédrale de style
néo-gothique, construite en pierre calcaire de taille, dont les deux
tours jumelles marquent l'entrée de Lowertown, un des plus anciens
quartiers d'Ottawa. Elle est située bien en vue sur la promenade Sussex,
entre les rues Saint-Patrick et Guigues, en face du Musée des Beaux-Arts
du Canada, dans le secteur Lowertown d'Ottawa. Centre physique et
spirituel de la communauté catholique d'Ottawa, la cathédrale est bordée
du côté sud par l'Archevêché et au nord par le Collège de Bytown et la
Maison-mère des Sœurs Grises.
La valeur patrimoniale de la basilique réside dans son aménagement, ses
matériaux, sa décoration intérieure et sa qualité de construction. Dans
sa conception et sa construction, la basilique catholique Notre-Dame
intègre le classicisme, l'architecture religieuse québécoise et le style
néo-gothique d'inspiration française. Elle est remarquable pour la
continuité de sa conception dans l'ensemble de sa structure, en dépit du
nombre de rénovations et d'ajouts. Elle est aussi reconnue pour ses
finis intérieurs, sa décoration, ses œuvres d'art et ses ornements. Elle
tire aussi son importance de sa précinction ecclésiastique et de son
rôle important en tant que symbole de la capitale nationale.
La conception originale néoclassique de cette église a débuté en 1842
sous la gouverne du curé de la paroisse, Jean-François Cannon, puis fut
modifiée en 1843 par des plans préparés par le père jésuite Félix
Martin. En 1844, la structure partiellement complétée a été transformée
selon le style néo-gothique par les pères oblats Adrien Telmon et Damase
Dandurand. Les flèches ont été ajoutées en 1858 selon les plans de
Dandurand. En 1862-1863, une abside de style néo-gothique a été ajoutée
aux plans du prêtre-architecte montréalais Victor Bourgeau. La
décoration intérieure a été substantiellement complétée à la fin du 19e
siècle par le sculpteur québécois Louis-Philippe Hébert et l'artiste du
vitrail Harwood, et une série de vitraux a été exécutée au cours des
années 1960 par Guido Nincheri. La cathédrale héberge aussi un orgue
construit par Joseph Casavant.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |
Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Beaver Dams
Thorold, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Beaver Dams est
un vaste terrain industriel ouvert qui comprend une partie du canal
Welland du côté est de la ville de Thorold, en Ontario. Situé au sud de
l'escarpement du Niagara, ce lieu a été le théâtre d'une victoire
décisive des troupes britanniques, soutenues par un important contingent
d'Iroquois, contre les Américains durant la guerre de 1812. Le lieu
comprend diverses propriétés, notamment des propriétés résidentielles
urbaines à Thorold, des parties du canal Welland, un cimetière et des
terrains industriels.
La Bataille de Beaver Dams, qui a eu lieu le 24 juin 1813, constitue une
bataille déterminante de la guerre de 1812. Après leur défaite à Stoney
Creek, les Américains envoient des troupes, sous la conduite du
lieutenant-colonel Charles G. Boerstler, du fort George à Beaver Dams
pour y détruire un avant-poste britannique. Afin de ne pas révéler la
véritable destination de leur mission, ils envoient une force constituée
d'environ 600 soldats de l'infanterie et de la cavalerie depuis le fort
George jusqu'à Queenston qui est alors sous leur contrôle. À Queenston,
Laura Secord, femme d'un loyaliste blessé, apprend les plans des
Américains et se rend elle-même à Beaver Dams, accompagnée d'un
éclaireur iroquois, pour aviser les Britanniques de l'assaut prévu.
Avertie à temps, une force composée d'Iroquois de Caughnawaga et de la
rivière Grand, sous la conduite des capitaines Dominique Ducharme et
William Kerr, tendent une embuscade aux forces américaines et les
obligent à se rendre au lieutenant britannique James Fitzgibbon de
l'armée britannique régulière. La région de Niagara sera contrôlée par
les Britanniques pour le reste de l'année 1813.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |
Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Chippawa
Niagara Falls, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Chippawa est
situé au sud de la ville de Chippawa, en Ontario, sur la rive ouest de
la promenade de la rivière Niagara. Durant la guerre de 1812, la
dernière grande tentative d'invasion du Canada par les Américains en
1814 a donné lieu à la bataille qui s'est déroulée sur ce terrain. Aucun
vestige visible de la bataille ne subsiste aujourd'hui. La Commission
des lieux et monuments historiques du Canada a reconnu ce lieu en 1923
en y faisant installer un monument et une plaque. Le lieu comprend une
section boisée au nord, un champ agricole abandonné ainsi qu'une portion
entremêlée de champs et de forêts au sud.
La bataille de Chippawa a lieu le 5 juillet 1814, au cours de la
dernière grande invasion américaine du Canada, durant la guerre de 1812.
Sous le commandement de Jacob Brown, le brigadier-général américain
Winfield Scott quitte le fort Érié le 4 juillet, en compagnie d'une
troupe de 1 300 hommes. Ils installent leur campement à quelques
centaines de verges de la rivière Chippawa et attendent les renforts.
Jacob Brown arrive vers minuit avec 2 000 hommes supplémentaires.
Au matin du 5 juillet, le major-général Phineas Riall envoie un petit
contingent de tireurs embusqués pour attaquer les Américains et avoir
une idée de leur nombre. À leur retour, les soldats informent le général
Riall que les Américains semblent être des miliciens, et non pas des
membres de la force régulière entraînés, puisqu'ils portent des manteaux
gris plutôt que l'uniforme. En se basant sur cette hypothèse erronée, le
général Riall décide d'attaquer avec 1 400 membres de la force
régulière, 70 membres de cavalerie et 300 alliés autochtones. Lorsqu'ils
entrent dans les bois pour se cacher, le général et ses hommes
rencontrent 56 des soldats de la force régulière de Jacob Brown qui s'y
cachent déjà. Une bataille éclate, et les Britanniques arrivent à
repousser les troupes américaines vers leur campement.
Au moment où les deux armées s'apprêtent à s'affronter et avancent sur
le champ Street, le général Riall s'aperçoit que les Américains qui se
dirigent calmement dans sa direction ne sont pas des miliciens, comme il
l'a d'abord pensé, mais plutôt des membres de la force régulière
entraînés. Reconnaissant que ces troupes sont très bien entraînées et en
nombre supérieur, le général Riall est forcé de se replier de l'autre
côté de la rivière Chippawa.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |
Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Cook's Mills
Cook's Mills, Ontario
Lieu où les Anglais ont remporté une victoire pendant la guerre de
1812.
Le lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Cook's Mills est
constitué d'un paysage vallonné semi-rural situé à l'est du canal
Welland et immédiatement au nord du ruisseau Lyon, dans la ville de
Welland, en Ontario. Il marque l'endroit où a eu lieu un affrontement
entre les troupes britanniques et canadiennes, d'une part, et les
troupes américaines, d'autre part, durant la guerre de 1812. Il n'existe
aucun vestige connu de la bataille, mais la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada a érigé un monument et installé une
plaque commémorative en 1977 dans le coin sud-ouest du lieu de bataille.
La bataille de Cook's Mills a été une escarmouche importante pour les
troupes britanniques et canadiennes durant la guerre de 1812. Après
l'échec du siège du fort Érié, le lieutenant général Gordon Drummond se
retire vers le nord et rassemble son armée le long de la rivière
Chippawa. En octobre 1814, les troupes américaines commandées par le
major général George Izard marchent vers le nord. Le 18 Octobre Izard
ordonné au brigadier général Bissell de se rendre avec une force
d'environ 900 hommes à Cook's Mills un avant-poste britannique, afin de
récupérer des provisions sous forme de blé destinées aux troupes
britanniques. Le 19 octobre éclate donc à Cook's Mills une violente
escarmouche impliquant les hommes du Glengarry Light Infantry et des
82e, 100e et 104e Régiments. Dirigées par le lieutenant-colonel
Christopher Myers les troupes britanniques et canadiennes réussissent à
atteindre leur objectif de reconnaissance des forces américaines afin
que Drummond puisse agir après quoi elles se retirent. Bissel accompli
également sa mission de détruire le blé entreposé aux moulins, après
quoi lui et ses hommes se retirent pour rejoindre la force américaine
principale. Peu après, les Américains détruisent Fort Erie et
retraversent la rivière Niagara pour atteindre les quartiers
d'hiver.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Dan Pagé, 2008 |
Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-la-Ferme-Crysler
Morrisburg, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Bataille de la Ferme Crysler
est situé dans le parc commémoratif de la Bataille de la Ferme Crysler,
près de l'Upper Canada Village, à l'est de Morrisburg, en Ontario. La
bataille, qui a eu lieu le 11 novembre 1813 sur des terres agricoles
appartenant à John Crysler, a officiellement mis fin à la campagne
américaine destinée à prendre Montréal. Puisque le champ de bataille
original est aujourd'hui sous l'eau, un monument commémoratif a été
érigé sur une colline gazonnée formée avec de la terre du lieu original.
Cet ensemble, qui constitue en soi le lieu historique, est composé d'un
obélisque flanqué de deux canons montés sur des affûts de la garnison
reposant sur un rectangle des dalles.
La valeur patrimoniale de la Bataille de la ferme Crysler tient à ses
associations historiques avec le conflit armé de 1813 lié à la campagne
américaine visant à conquérir Montréal. Le 10 novembre 1813, 8 000
soldats américains, sous la conduite du major général James Wilkinson,
arrivent dans la ville de Williamsburg, en Ontario. Au même moment, 800
soldats britanniques commandés par le lieutenant colonel Joseph Morrison
prennaient position sur les terres de la ferme de John Crysler derrière
deux larges ravins. Les Britanniques avaient suivi les Américains en
route le long du fleuve Saint Laurent et avaient reçu l'ordre de
ralentir l'avancée des Américains et d'empêcher une attaque surprise. Le
11 novembre, les Américains lancaient une attaque avec seulement la
moitié de leurs soldats. Le major général Wilkinson croyait les
Britanniques moins expérimentés et sous estimaient leur nombre puisque
la moitié des soldats britanniques portaient des manteaux d'hiver gris
par-dessus leur uniforme rouge traditionnel. Dépourvus de plan tactique,
les Américains subirent de lourdes pertes et furent repoussés vers
Cornwall. Ces lourdes pertes et le repli rapide des soldats lors de la
bataille de la ferme Crysler a mis fin à la campagne américaine destinée
à prendre Montréal.
En 1895, le ministère de la Milice et de la Défense a érigé un monument
sur le champ de bataille de la ferme Crysler. En 1921, après la Première
Guerre mondiale, la Commission des lieux et monuments historiques du
Canada (CLMHC) installe une plaque sur le monument existant. 'Lors de
l'aménagement de la voie maritime du Saint Laurent, le lieu d'origine de
la bataille est inondé et le monument est déplacé dans le parc
commémoratif de la Bataille de la Ferme Crysler en 1955.. Le monument
repose aujourd'hui sur un socle à gradins supporté par un rectangle de
dalles, au sommet d'une colline composée de terre provenant du champ de
bataille d'origine.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, André Guindon, 2009 |
Lieu historique national du Canada de la Bataille-du-Moulin-à-Vent
Prescott, Ontario
Tentative de soulèvement que les Britanniques ont fait échouer en
1838.
Le lieu historique national du Canada de la Bataille-du-Moulin-à-Vent
est un fragment d'un champ de bataille situé sur la rue Windmill Point à
Newport, Ontario. Le lieu désigné comprend une partie terrestre, à
partir du moulin à vent, qui forme un demi-cercle d'un rayon de 400
mètres, et une autre partie en bordure du moulin à vent, de même forme
et superficie; toutefois, seule une petite portion du champ de bataille
fait partie du lieu historique.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la
Bataille-du-Moulin-à-Vent réside dans la lisibilité des éléments
naturels et bâtis du paysage culturel associé à la bataille du
Moulin-à-Vent, et dans les vestiges encore intacts de la
bataille.
|

©Archives of Ontario / Archives publiques de l'Ontario, F 1075-13, H 1065, 1925 |
Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-la-Ruelle-de-Lundy
Niagara Falls, Ontario
Situé à Niagara Falls en Ontario, le lieu historique national du Canada
de la Bataille-de-Lundy's-Lane commémore les combats du 25 juillet 1814
qui se sont déroulés sur des terres agricoles entourées d'un verger et
d'une forêt sur Lundy's Lane. Une plaque installée au cimetière Drummond
Hill marque l'emplacement de cette bataille. En effet, Lundy's Lane fut
le site d'une grande bataille entre les forces britanniques et
américaines dans laquelle les Américains, qui gagnèrent du terrain après
la bataille de Chippewa, attaquèrent les positions défensives
britanniques qu'ils avaient installés. Suite à l'engagement férocement
disputé, les Américains furent vaincus et forcés au retrait de leurs
troupes. Cette bataille qui dura six heures, fut l'une des plus
sanglantes de la guerre de 1812, et marqua la fin de l'offensive
américaine dans le Haut-Canada.
Au cours de l'été de 1814, les forces américaines traversèrent la
rivière Niagara, à la hauteur du fort Érié, pour envahir le Haut Canada.
Au début, leur avancée vers le nord le long de la rivière Niagara se
déroula bien, et les forces américaines réussirent à défaire des troupes
britanniques dans la bataille de Chippawa. Les Britanniques, dirigés par
sir Gordon Drummond, se regroupèrent et, le soir du 25 juillet, les
troupes régulières britanniques ainsi que les soldats des Fencibles et
les miliciens canadiens assaillirent les forces américaines dans Lundy's
Lane, non loin de Niagara Falls. Les deux armées s'affrontèrent toute la
soirée, ne cessant d'attaquer et de contre attaquer, notamment pour
prendre possession des canons de campagne installés où se trouve
aujourd'hui le cimetière Drummond Hill. Les deux camps subirent de
lourdes pertes, mais à minuit, les Américains se retirèrent, laissant
les Britanniques et les Canadiens épuisés, maîtres de leur position. La
bataille de Lundy's Lane fut le combat le plus sanglant et le plus
violent de la guerre de 1812; elle a anéanti tous les espoirs des
Américains de conquérir le Haut Canada en 1814.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Stoney Creek
Hamilton, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Stoney Creek est
un parc commémoratif aménagé sur les lieux d'une bataille de la guerre
de 1812. Il est situé au bord de l'escarpement du Niagara, à l'est de la
ville de Stoney Creek, en Ontario. Le lieu comprend la maison Gage, le
monument de Stoney Creek, le monument du monticule Smith et du cimetière
de Stoney Creek, les paysages aménagés par la firme Dunnington et Grubb
et du cimetière de Stoney Creek, les ressources archéologies et une
collection situées, en partie, sur le site.
La valeur patrimoniale du lieu réside dans son rôle de témoin d'une
bataille cruciale dans l'histoire du Canada, comme l'illustrent le parc
commémoratif, les monuments rappelant la bataille et le cimetière
connexe. La bataille de Stoney Creek, qui s'est déroulée le 6 juin 1813,
a été un point tournant dans la guerre de 1812. Au cours de la bataille,
les troupes américaines, sous le commandement des généraux Windler et
John Chandler, ont été repoussées par les 8e et 49e régiments
britanniques dirigés par le lieutenant-colonel John Harvey et le major
Plenderleath. Ce champ de bataille constitue le point le plus avancé
ayant été atteint par les troupes américaines le long de la frontière du
Niagara.
L'importance du champ de bataille de Stoney Creek a d'abord été reconnue
lorsque le Women's Wentworth County Historical Society y créa un parc
commémoratif en 1899 et qu'il acquérait par la suite la propriété
adjacente, la maison Gage, également associée à la bataille. De 1909 à
1913, le County of Wentworth Veteran's Association érige un monument sur
le lieu et dans les années 1920, la firme Dunnington et Grubb effectue
l'aménagement paysager du parc. En 1963, la Commission des parcs du
Niagara prend la relève de la gestion du parc, qui est maintenant
exploité par la Ville de Hamilton.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
eu historique national du Canada de la Batterie-de-Vrooman
Niagara-on-the-Lake, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Batterie-de-Vrooman se situe
au nord du village de Queenston, en Ontario, sur la rive ouest de la
rivière Niagara. Situé sur la pointe Vrooman, maintenant propriété
privée, le lieu surplombe la rivière Niagara, ce qui lui confère une
position stratégique. La batterie de Vrooman a joué un rôle important
dans la bataille de Queenston Heights durant la guerre de 1812, bien
qu'elle soit aujourd'hui réduite à un monticule de terre au bord de la
rivière.
Le 13 octobre 1812, les forces américaines traversèrent la rivière
Niagara à Queenston et occupèrent les hauteurs du village. Pour déloger
les Américains, les forces britanniques tentèrent en vain une
contre-attaque, au cours de laquelle leur commandant, le Major-Général
Sir Isaac Brock trouva la mort. Peu après, les renforts britanniques
grimpèrent l'escarpement à l'ouest, délogèrent les américains et leurs
imposèrent la défaite. La batterie située sur la terre de Soloman
Vrooman, au bord de la rivière Niagara, comprenait une batterie de tir
de 24 livres montée dans un ouvrage de terre en forme de croissant.
Manœuvrée par le 5e Régiment Lincoln (milice) et par un détachement de
l'artillerie de milice Lincoln, sous les commandements respectifs du
capitaine Samuel Hatt et du lieutenant John Ball, la batterie
maintiendra tout au long de la bataille, un feu sans relâche sur les
forces américaines qui traversaient la rivière à ce même moment.
|
|
Lieu historique national du Canada de Beechcroft et Lakehurst Jardins
Roches Point, Ontario
Beechcroft et Lakehurst sont deux propriétés à Roches Point, situé sur
la rive sud du lac Simcoe. Grandes propriétés foncières privées, qui
servir de tampon pour ces propriétés, leur aurait permis de survivre dans
leurs styles du 19ème siècle. Un, Beechcroft, est aménagé en anglais
style paysager. Selon forte tradition locale ses motifs étaient
conçue par le premier architecte paysagiste de l'Amérique, Frederick Law Olmsted.
Le jardin On pense en outre avoir été ainsi créé vers 1870 au cours
l'occupation de A.G.P. Dodge de New York City. La propriété voisine,
connu sous le nom Lakehurst, montre l'influence de motifs mais est Olmstedian
beaucoup plus dans la tradition horticole et gardenesque. (from
Journal of Garden History, Vol 1, No. 2)
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2009 |
Lieu historique national du Canada Belle Vue
Amherstburg, Ontario
Le lieu historique national du Canada Belle Vue est une demeure en
brique de deux étages construite entre 1816 et 1819 dans le style
palladien. Peinte en blanc, elle se compose d'un corps central
rectangulaire flanqué de deux ailes, et est agrémentée d'une entrée
principale surmontée d'un petit portique.
Construite entre 1816 et 1819 pour Robert Reynolds, commissaire général
adjoint de la garnison du fort Malden, Belle Vue est un exemple
remarquable d'une résidence unifamiliale de style palladien. Elle
comporte un corps central rectangulaire de deux étages doté de cinq
baies et d'une entrée principale surmontée d'un petit portique reposant
sur des pilastres. Le corps principal est flanqué de deux ailes
accentuant l'horizontalité et la symétrie du bâtiment, en harmonie avec
les concepts du style palladien. Un long couloir intérieur relie le
corps central aux deux ailes.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2004 |
Lieu historique national du Canada du Blockhaus-de-Merrickville
Merrickville, Ontario
Un des bâtiments du réseau d'écluses du canal Rideau; construit en
1832-1833.
Le blockhaus de Merrickville est une structure de défense de deux
étages, en maçonnerie et en bois, situé sur les rives du canal Rideau
dans la ville de Merrickville, en Ontario.
Le blockhaus de Merrickville a été désigné un lieu historique national
parce qu'il a été considéré comme un excellent exemple du meilleur type
de blockhaus érigés pour la défense du canal Rideau aux environs de
1832.
Sa valeur patrimoniale réside dans son illustration d'un blockhaus
relativement grand, conçu par les Britanniques au cours du 19e siècle.
Construit en 1832-1833, il est associé à la construction de la voie
navigable du canal Rideau et à la défense du Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Bosquet-et-Maison-Gillies
Arnprior, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Bosquet-et-Maison-Gillies est
un domaine du XXe siècle, situé dans une zone boisée au bord de la
rivière des Outaouais, en banlieue d'Arnprior, en Ontario. Les
principaux éléments qui le composent sont un vieux peuplement de pins
blancs entourant une zone dégagée où se trouve une belle maison de style
néo-colonial, construite en pin blanc provenant de la forêt avoisinante.
La valeur patrimoniale de ce site a trait à l'intégrité du domaine qui
comprend le bosquet forestier, la maison dans une clairière, les
dépendances et les aménagements paysagers. Le bosquet Gillies, un des
rares terrains boisés encore accessibles à renfermer d'importants
peuplements mûrs de pins blancs de la vallée de l'Outaouais, a
longuement contribué à l'expansion de l'industrie du bois de sciage dans
la région. De plus, pendant plus de 125 ans, il a été préservé par ses
propriétaires, les familles McLachlin et Gillies, très reconnues dans
l'industrie forestière de la vallée. En 1937, dans une clairière du
bosquet, on a construit une belle maison de style néo-colonial qui
servira de lieu d'exposition permanent des produits en pin provenant des
terres à bois et des scieries des frères Gillies. Le bosquet et la
maison constituent tous deux un exemple bien préservé des maisons de
campagne construites pendant l'entre-deux-guerres.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |
Lieu historique national du Canada Burlington-Heights
Hamilton, Ontario
Le lieu historique national du Canada de Burlington-Heights se situe sur
un isthme de 2,5 kilomètres, qui s'élève 30 mètres au-dessus du lac et
qui se trouve entre Cootes Paradise et le port d'Hamilton, en Ontario.
Traversé par des voies ferrées, des artères routières importantes et un
canal, le lieu est notamment composé de parcs, d'un cimetière et de
jardins botaniques.
Expulsés du fort George après que les forces américaines furent
parvenues à l'embouchure de la rivière Niagara, les Anglais, dirigés par
le général John Vincent, ont battu en retraite vers Burlington Heights.
S'élevant 30 mètres au-dessus du lac et traversées par des routes
provenant de Niagara et d'Amherstburg et menant à York, les hauteurs
offraient une place forte naturelle pour le regroupement des Anglais.
C'est de là que le général Vincent a organisé l'attaque nocturne
victorieuse dirigée par le lieutenant-colonel John Harvey et lancée les
5 et 6 juin 1813 contre les forces américaines installées à Stoney
Creek. À la suite de la retraite des Américains vers le fort George, le
général Vincent a décidé de fortifier les hauteurs en aménageant deux
rangées de remblais autour de la péninsule, en plus de batteries de tir,
de blockhaus, de casernes et d'entrepôts. Centre de résistance établi
sur la route menant vers l'est, Burlington Heights est devenu un dépôt
d'approvisionnement d'importance pour les forces se trouvant dans la
péninsule de Niagara et a servi d'aire de mouillage sûre pour les
flottes naviguant sur le lac Ontario. En décembre 1813, les hauteurs ont
une fois de plus été employées comme point de rassemblement pour la
tenue d'une autre campagne contre les Américains, au cours de laquelle
les Anglais ont repris possession du fort George et ont pris le contrôle
du fort Niagara. Après la guerre de 1812, bien que les forces armées
n'avaient pas perdu confiance en l'emplacement comme position
stratégique, les bâtiments ont été laissés à l'abandon. Aujourd'hui, on
y trouve diverses attractions, comme le lieu historique national du
Canada du Château-Dundurn et une partie du lieu historique national du
Canada des Jardins-Botaniques-Royaux.
|
|
Lieu historique national du Canada du Cairn-de-Glengarry
Cairn Island, Ontario
Monument en pierre de forme conique doté d'un escalier, dédié aux
régiments Glengarry et Argyle (1840).
Le lieu historique national du Canada du Cairn-de-Glengarry est situé
sur The Cairn, une île du Lake St. Francis, près du village de South
Lancaster, dans le comté de Glengarry, en Ontario. Le lieu consiste en
un imposant ouvrage de maçonnerie en moellons de forme conique, d'une
hauteur de 16 mètres et d'un diamètre de 16 mètres à la base. Des
marches ont été aménagées en spirale autour de la structure construite
entre 1840 et 1842, pour commémorer les services de sir John Colborne.
Le cairn demeure un monument important et remarquable qui surplombe les
eaux pittoresques du fleuve Saint-Laurent.
Le cairn de Glengarry a été désigné lieu historique national du Canada
en 1921 parce que : c'est un monument érigé par la milice de Glengarry
en reconnaissance des services rendus par sir John Colborne, commandant
des forces britanniques pendant la Rébellion de 1837.
Le cairn de Glengarry fut érigé entre 1840 et 1842 sous la direction du
lieutenant-colonel Lewis Carmichael, qui commanda la milice de Glengarry
aux cours de la Rébellion de 1837 et des conflits frontaliers de 1838.
Le cairn fût originalement érigé pour commémorer les services de sir
John Colborne, plus tard aussi connu sous le nom de Lord Seaton, qui
commanda les forces impériales au cours de la rébellion. Le monument eut
également pour but de rendre hommage aux régiments de la milice de
Glengarry qui combattirent de 1837 à 1838. Véritable point de repère
pour les voyageurs du fleuve Saint-Laurent, le cairn fut rénové en 1905
par les citoyens de Glengarry et une plaque y fut apposée afin de mettre
en évidence son histoire.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, David Henderson, 2008 |
Lieu historique national du Canada de la Cale-Sèche-de-Kingston
Kingston, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Cale-Sèche-de-Kingston est
situé sur la partie de la pointe Mississauga du rivage de Kingston, sur
le fleuve Saint-Laurent. Il fait maintenant partie du complexe du Musée
de la marine. La Cale sèche de Kingston était une importante
installation de réparation des navires et offrait une cale sèche
permettant de travailler sur la partie submergée de la coque des
navires. La cale sèche, en forme de rectangle allongé, avait des parois
escarpées qui s'élevaient à 9,1 mètres du fond. La cale sèche originale
avait une cavité interne d'une largeur de 16,8 mètres et un plancher
long de 85,3 mètres. Les deux murs et le fond de la cale sèche étaient
construits en calcaire. La cale sèche a par la suite été rallongée à
115,2 mètres avec du béton. La porte de la cale sèche ou caisson de
flottaison, est située dans une assise rectangulaire disposée à angle
droit avec l'entrée de la cale sèche. Le caisson est construit en acier,
en forme de boîte rectangulaire aux côtés parallèles et aux extrémités
inclinées. À chacune des extrémités du caisson, on retrouve de lourds
rouleaux de fonte disposés à intervalles réguliers sur lesquels repose
et se déplace le caisson. Des escaliers de chaque côté de l'entrée
permettent d'accéder au plancher de la cale sèche.
La pointe Mississauga a été pendant plus de 150 ans le site de grands
chantiers navals, alors que Kingston était un des principaux centres
portuaires et chantiers navals des Grands Lacs. L'importance de cette
industrie a incité le gouvernement fédéral à construire cette cale sèche
en 1890. Opérée au départ par le ministère des Travaux publics en tant
qu'installation de réparation des embarcations lacustres, elle fut
agrandie et louée en 1910 à la Kingston Shipbuilding Company, premier
d'une série d'intérêts privés ayant opéré les chantiers navals jusqu'en
1968. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, des vaisseaux de la
marine, notamment des corvettes, ont été construits dans ces chantiers
navals.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, D. Dodd, 2008 |
Lieu historique national du Canada Canadian Car & Foundry
Thunder Bay, Ontario
Le lieu historique national du Canada Canadian Car & Foundry se trouve
au sud ouest de la ville de Thunder Bay, en Ontario. Situé dans les
limites des installations de Bombardier Transport, le lieu est bordé par
la rue Montréal au sud, l'avenue Mountdale à l'est, l'avenue Neebing à
l'ouest, et les voies ferrées du CN au nord. Il se compose des éléments
qui datent de la période de la Seconde Guerre mondiale, y compris une
structure de deux étages à charpente d'acier avec un revêtement
métallique divisé de la manière suivante : bâtiment 1, qui comprend les
baies de production A, B et C; bâtiments 2, 6 et 8; bâtiment 7 au sud,
et bâtiment 3 au nord.
La Canadian Car & Foundry a été créée en 1909 à la suite de la fusion du
Rhodes Curry Company d'Amherst, de la Canadian Car Company de Turcot et
de la Dominion Car and Foundry de Montréal. Dotée d'une équipe de
production qualifié et enthousiaste, la fonderie s'est taillée
rapidement une bonne réputation. En 1938, la société fournit des Hawker
Hurricanes à la British Royal Air Force et l'Aviation royale Canadienne,
qui a joué un rôle clé dans la victoire au bataille d'Angleterre. La
société est devenue le plus gros fabricant d'aéronefs durant la Seconde
Guerre mondiale, produisant plus de 2 300 chasseurs. En 1942, elle a été
contractée pour fabriquer les SB2C Curtiss Helldiver, que la United
States Navy a utilisée pendant la guerre du Pacifique.
Comme beaucoup hommes se sont enrôlés pendant la guerre, la Canadian Car
& Foundry embauche un grand nombre de femmes. Représentant celles qui
ont délaissé les occupations dites féminines pour travailler dans le
domaine public pendant la guerre, les travailleuses ont appris la
soudure, le perçage de précision, le rivetage, l'assemblage partiel
d'instruments et des inspections. Cette évolution des techniques ainsi
que des tendances du travail a pris place sous le leadership d'Elizabeth
Muriel Gregory ‘Elsie' MacGill, une ingénieure en aéronautique désignée
personne d'importance historique nationale. Cette dernière a supervisée
le premier plan du Hawker Hurricane. Cette période voit les femmes
acquérir de nouvelles habiletés et l'indépendance sur le plan financier
et a montré que les femmes pouvaient occuper des emplois non
traditionnels.
Après la guerre, la demande en aéronefs a chuté. La Canadian Car &
Foundry a trouvé son créneau et a fabriqué du gros équipement de
transport comme le matériel d'exploitation forestière, des autocars et
des remorques routières. En 1955, l'usine a commencé à produire des
wagons de métro pour des clients partout dans le monde, ce qu'elle fait
toujours sous la direction de Bombardier Transport de Montréal.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Canal-Rideau
Ottawa / Kingston, Ontario
Canal long de 202 km ouvert à la navigation; comporte 47 écluses.
Bâti au milieu du XIXe siècle, le lieu historique national du Canada du
Canal-Rideau est une voie navigable artificielle de 200 km aménagée de
la rivière des Outaouais au lac Ontario.
La valeur patrimoniale du canal Rideau tient à l'intégrité et à
l'intégralité de son paysage culturel qui rappelle les formes, matériaux
et techniques du début du XIXe siècle associés aux voies navigables et
qui témoigne des liens écologiques et humains durables entre le canal et
son corridor. De 1826 à 1837, le lieutenant-colonel John By a bâti le
canal en tant qu'ouvrage défensif, à la demande du gouvernement
britannique. En 1855, le Canada est devenu le gestionnaire de cette voie
navigable utilisée à des fins commerciales pendant une grande partie des
XIXe et XXe siècles. Parcs Canada s'est porté acquéreur du canal en 1972
afin de l'exploiter comme voie de navigation de plaisance.
|


©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Canal-de-Sault Ste. Marie
Sault Ste. Marie, Ontario
Première écluse mue à l'électricité (1888-1894).
Le lieu historique national du Canada du Canal-de-Sault Ste. Marie est
une voie navigable artificielle comprise entre la ville de Sault
Sainte-Marie et l'île Whitefish dans le chenal maritime reliant le lac
Huron au lac Supérieur, à Sault Sainte-Marie, en Ontario. Sa centrale
électrique construite sur le versant de la colline en aval de l'écluse,
et son barrage tournant de secours situé à l'ouest de l'écluse d'origine
près de la résidence du directeur revêtent une importance particulière.
Aujourd'hui, le canal sert d'aménagement récréatif.
La valeur patrimoniale du canal de Sault Ste. Marie a trait à sa
lisibilité et à son intégralité en tant que voie navigable artificielle,
y compris ses ouvrages d'ingénierie, ses bâtiments et ses aménagements
paysagers connexes. Achevé en 1895, il fait partie du réseau national de
canaux du Canada et comprend une centrale électrique construite en 1894,
pendant la phase initiale de construction, ainsi qu'un barrage tournant
de secours construit en 1895 par la Dominion Bridge Co. La gestion du
canal de Sault Ste. Marie a été transférée à l'Administration de la voie
maritime du Saint-Laurent (1959-1979), puis à Parcs Canada qui
l'exploite encore comme aménagement récréatif.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1992 |
Lieu historique national du Canada de la Caserne-de-Pompiers Balmoral
Toronto, Ontario
Située au centre ville de Toronto, en Ontario, la caserne de pompiers
Balmoral est un édifice aux dimensions modestes, en pierre rouge de
style néo-Queen Anne.
La caserne de pompiers de l'avenue Balmoral a été désignée lieu
historique national du Canada car elle constitue l'un des plus beaux
exemples du style néo-Queen Anne en architecture institutionnelle au
Canada.
La caserne de pompiers Balmoral est l'exemple par excellence d'un
édifice institutionnel de style néo-Queen Anne qui illustre la bonne
utilisation d'éléments historiques éclectiques dans un bâtiment doté
d'une fonction moderne. Construit en 1911 selon les plans de
l'architecte Robert McCallum, l'édifice évoque avec audace l'esthétique
urbaine du début de la Renaissance flamande, caractérisée par des
matériaux polychromes et le travail sculptural des surfaces qui
confèrent charme et économie à un édifice de dimensions modestes.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, B. Morin, 1993

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, B. Morin, 1993

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, B. Morin, 1993 |
Lieu historique national du Canada des Casernes-de-Butler
Niagara-on-the-Lake, Ontario
Ensemble de bâtiments témoignent de 150 ans d'histoire
militaire.
Les casernes de Butler sont un complexe militaire historique de cinq
bâtiments en bois, localisé en bordure du terrain communal situé
derrière le lieu historique national du Canada du
Champ-de-Bataille-du-Fort-George, à Niagara-on-the-Lake.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à la forme, au gros œuvre et
aux liens physiques entre les bâtiments, ouvrages et vestiges liés au
casernement et à l'entraînement militaire aux XIXe et XXe siècles.
Construites par les Britanniques après la guerre de 1812, ces casernes
ont servi de camp militaire jusqu'aux années 1960.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada des Casernes-de-Wolseley
London, Ontario
Le lieu historique national du Canada des Casernes-de-Wolseley fait
partie de la base des Forces canadiennes située dans la ville de London,
en Ontario. Également appelé Wolseley Hall ou bloc « A », cette
importante structure en forme de U est positionnée autour d'une cour
intérieur. L'édifice de brique de coleur chamois est de style
italianisant simplifié et comporte une tour centrale ainsi qu'une entrée
voûtée et des fenêtres en saillie. La désignation officielle s'applique
au bâtiment sur son tracé au sol.
Première école de formation de l'infanterie expressément érigée par le
gouvernement fédéral, les casernes de Wolseley ont été construites de
1886 à 1888 pour héberger la compagnie « D » de l'Infantry School Corps
du Royal Canadian Regiment. La création d'une force militaire canadienne
permanente débute en 1871 à la suite du retrait du Canada des troupes
régulières britanniques cette même année. Les troupes canadiennes en
service à l'époque sont composées de deux petites batteries d'artillerie
et de miliciens volontaires, une force peu entraînée à l'équipement
inadéquat. En 1882, le gouvernement crée des écoles militaires
permanentes afin de former et d'éduquer les officiers de façon
appropriée. Les installations de l'Infantry School Corps sont situées à
Fredericton, Saint-Jean et Toronto, où les trois compagnies (« A », « B
» et « C ») sont hébergées dans les anciennes casernes britanniques. En
1885, lorsqu'une quatrième école est créée à London, il faut de
nouvelles casernes pour héberger les 100 hommes qui composent la
compagnie « D ». Cette école ainsi que les autres écoles d'infanterie,
les écoles d'artillerie de Québec, de Kingston et de Victoria, l'école
de cavalerie de Québec et l'école d'infanterie portée de Winnipeg
constituent le fondement des forces permanentes du Canada.
Compte tenu qu'elles ont pour vocation la formation et l'hébergement des
officiers, les casernes de Wolseley comportent un certain nombre
d'espaces domestiques, une salle de cours et une salle de lecture ainsi
qu'un terrain de parade pour les exercices et les manœuvres militaires.
La conception éclectique du bâtiment intègre des éléments des tendances
contemporaines en architecture ainsi que des éléments militaires
traditionnels.
|

©Wilmot Township, 1985 |
Lieu historique national du Canada Castle Kilbride
Baden, Ontario
Le lieu historique national du Canada Castle Kilbride est une villa de
style à l'italienne de deux étages, bâtie sur une colline située à la
limite de la ville de Baden, dans le sud-ouest de l'Ontario. Cette
maison, construite en 1877-1878 se distingue par ses magnifiques
peintures murales de style néorenaissance qui datent de la fin du XIXe
siècle. Elle est située dans une parcelle de 1,2 hectares dotée d'un
jardin de style victorien, d'une voie d'accès circulaire, et une rangée
d'arbres matures entourent les lieux. Un rajout, qui abrite des bureaux
municipaux, a été bâti à l'arrière au milieu des années 1990.
Castle Kilbride est un magnifique exemple d'une maison victorienne à
l'italienne de la fin du XIXe siècle, construite dans un paysage
pittoresque. Cette villa, construite en 1877 et 1878 par James
Livingston, un prospère négociant en huile de lin, présente dans ses
pièces principales de remarquables peintures murales exécutées avec un
enduit à base d'huile de lin. Ces fresques constituent des exemples
exceptionnels de décoration murale domestique de la fin du XIXe siècle,
par l'excellence de leur exécution, leur admirable qualité décorative,
leur harmonie avec l'architecture de l'édifice, et parce qu'elles sont
dans l'ensemble en bon état. Leur style classique atteste les efforts
déployés au milieu du XIXe siècle pour remettre au goût du jour les
traditions oubliées de l'art mural de la Renaissance. Sous tous leurs
aspects, la conception et la réalisation de cette maison sont
d'excellente facture.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |
Lieu historique national du Canada de la centrale-électrique-de-la-Toronto Power
Toronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la
centrale-électrique-de-la-Toronto Power est situé sur les rives de la
rivière Niagara, juste au-dessus des chutes Niagara. La Centrale est un
édifice rectangulaire de 132 mètres sur 30 mètres avec une façade
classique imposante. Son plan symétrique comprend un bloc central avec
de lourds portiques ioniques flanqués de deux longues colonnades
ioniques. La Centrale contient des générateurs et se dresse au-dessus
des principaux composants d'ingénierie de l'installation qui comprennent
un barrage submergé, des conduites forcées et une fosse à roue qui
abrite les turbines, et le tunnel du bief aval.
La centrale électrique de la Toronto Power, associée à la mise au point
de l'énergie hydroélectrique au Canada, était une importante réalisation
technique à grande échelle pour l'époque, et elle a joué un grand rôle
dans le développement des affaires, de l'industrie et de la technologie
en Ontario et au Canada. La Centrale a été construite pour la Electrical
Development Company de l'Ontario afin d'approvisionner Toronto en
énergie hydroélectrique. L'installation a commencé en 1903 avec la
Centrale conçue dans un style Beaux-Arts classique par l'architecte E.J.
Lennox afin de compléter l'emplacement majestueux. La Centrale
électrique de la Toronto Power y a ouvert ses portes en 1906, et elle a
été achetée par Ontario Hydro en 1922. Elle a été exploitée jusqu'en
1974.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, W. Duford |
Lieu historique national du Canada du Centre-National-des-Arts
Ottawa, Ontario
Le Centre national des arts est une structure complexe au plan
irrégulier, dont la conception architecturale s'inspire du triangle et
de l'hexagone, tant pour l'ensemble de la composition, que pour les
détails ornementaux. L'édifice abrite plusieurs salles de spectacle, des
salles de répétition, des salles d'habillage et de maquillage, un
atelier-salle d'accessoires, des bureaux, des restaurants, des espaces
de réception et un garage souterrain. Conçu dans le style brutaliste
(béton brut), le Centre national des arts est bâti de béton armé coulé
recouvert de panneaux de béton et d'agrégats de granite laurentien de
textures variées. La composante architecturale dominante de ses formes
irrégulières est axée sur ses trois espaces scéniques s'élevant à partir
d'un ensemble de terrasses.
Le Centre national des arts était à la fois une précieuse réussite
architecturale et une réussite culturelle majeure pour le pays. La
structure, construite en 1965-69 selon les plans de la firme
d'architectes Affleck, Desbarats, Dimakopoulos, Lebensold et Sise,
reflète la contribution accrue de l'État à la vie artistique durant la
seconde moitié du 20e siècle. Elle a été édifiée dans le cadre du
centenaire de la Confédération, et visait à servir de porte-étendard de
la réussite culturelle du pays dans le domaine des arts de la scène. Le
Centre national des arts est également une des composantes du lieu
historique national du Canada de la Place-de-la-Confédération.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |
Lieu historique national du Canada du Champ-de-Bataille-du-Fort-George
Niagara-on-the-Lake, Ontario
Guerre de 1812, capture du Fort George par les Américains en
1813.
Le lieu historique national du Canada du
Champ-de-Bataille-du-Fort-George est situé près du lieu historique
national du Canada du Fort-George, dans la ville de Niagara-on-the-Lake,
en Ontario. Le paysage vallonné et dégagé, situé près de la rive du lac
Ontario, au niveau de Two Mile Creek, est le site d'une des plus
importantes et plus féroces batailles de la Guerre de 1812. Il n'existe
aucun vestige visible de la bataille de 1813 entre les forces d'invasion
américaines et les forces britanniques et la milice canadienne, mais un
cairn et une plaque érigés par la Commission des lieux et monuments
historiques du Canada (CLMHC) marque l'angle nord-est du site de la
bataille.
La valeur patrimoniale du champ de Bataille du Fort George a trait au
fait que ce paysage a été le témoin d'une importante bataille livrée sur
le sol canadien. La bataille, qui a eu lieu du 25 au 27 mai 1813 a été
une des plus féroces de la Guerre de 1812, alors que les forces
britanniques et canadiennes ont tenté le débarquement des américains à
Two Mile Creek. La victoire des Américains leur a permis de pénétré dans
la péninsule du Niagara et a forcé les troupes britanniques et
canadiennes à l'abandonner temporairement. Malgré leur victoire, les
Américains ont été arrêtés à la bataille de Stoney Creek, puis battus à
Niagara (maintenant Niagara-on-the-Lake), qu'ils ont abandonné et
incendié en décembre 1813.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Champ-de-Bataille-de-Ridgeway
Ridgeway, Ontario
Lieu où s'est livrée la bataille contre des envahisseurs Fenians en
1866.
Le lieu historique national du Champ-de-Bataille-de-Ridgeway est situé
sur une parcelle de forêt-parc de quatre hectares dans la petite
communauté de Ridgeway, au sud-ouest de l'Ontario et à environ cinq
kilomètres à l'ouest de la ville de Fort Erie. Le lieu comprend le champ
de bataille de 1866, qui est maintenant occupé par des propriétés
agricoles privées. Il n'existe sur place aucun vestige connu de la
bataille.
Le 2 juin 1866, la bataille de Ridgeway a opposé les volontaires de la
milice canadienne à une troupe d'environ 500 à 800 Féniens, légèrement
au nord de l'ancienne ville de Ridgeway. Les premiers affrontements
entre la milice et les Féniens ont éclaté près de l'intersection des
chemins Ridge et Garrison, mais la majeure partie des combats se sont
déroulés sur, ou à proximité, de la crête Lime, un terrain élevé qui
s'étendait presque parallèlement au chemin Ridge. Les volontaires de la
milice canadienne, commandés par le lieutenant-colonel Alfred Booker,
ont résisté solidement aux envahisseurs féniens, dirigés par le colonel
John O'Neil. Bien que supérieur en nombre, les miliciens n'ont pas pu
repousser les envahisseurs en raison de leur inexpérience, de leur
manque de formation et de problèmes d'approvisionnement. Après une
résistance courageuse, la milice est forcée de battre en retraite
jusqu'au village voisin de Stevensville. Les attaquants féniens sont
retournés aux États-Unis le lendemain, craignant que des renforts ne
soient envoyés aux miliciens depuis Chippawa, près de Niagara
Falls.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Chantier-Naval-d'Amherstburg
Amherstburg, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Chantier-Naval-d'Amherstburg
est constitué d'une longue parcelle rectangulaire surplombant la rivière
Détroit depuis la ville d'Amherstburg en Ontario. Cet ancien chantier
naval britannique, évacué par la Marine Royale en 1813, ne présente
aucun vestige visible. Marqué par un monument à quatre côtés arborant
quatre plaques commémoratives en laiton de la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada, le lieu a été transformé en parc
municipal de 4,25 hectares (10,5 acres) où s'y trouve un cénotaphe
municipal ainsi que plusieurs bâtiments construits après l'époque du
chantier naval ou y ayant été transportés.. Le parc est couvert d'herbe
et compte des arbres, des jardins classiques, des allées piétonnes ainsi
qu'une balustrade de métal qui le sépare de la rivière.
Le chantier naval d'Amherstburg est construit en 1796 après que les
forces britanniques quittent Détroit pour s'établir plus en aval sur la
rive est de la rivière Détroit. Le chantier, qui sert à la construction
et à la réparation de navires, constitue une plaque tournante pour les
forces navales britanniques présentes dans le secteur supérieur des
Grands Lacs. Les installations du chantier comprennent un grand
entrepôt, deux blockhaus, une cour à bois, une fosse de sciage ainsi
qu'un quai. Au nord du chantier, les Britanniques construisent le fort
Amherstburg à l'emplacement de l'actuel lieu historique national du
Canada du Fort-Malden, tandis qu'au sud, un établissement qui sera connu
sous le nom d'Amherstburg est fondé pour approvisionner le fort et le
chantier naval. Pendant près de vingt ans, le chantier produit des
embarcations allant du petit bateau sans pont au grand navire de combat
à trois mâts entièrement gréé. Le chantier naval d'Amherstburg joue un
rôle défensif considérable pendant la guerre de 1812, car les navires
qui y sont construits permettent aux Britanniques de garder le contrôle
de la région.
À la suite de la défaite des Britanniques à la bataille du lac Érié en
1813, Amherstburg est évacué, et le fort et le chantier naval sont
brûlés avant que les Américains ne s'en emparent. Ces derniers
construisent plus tard des installations qu'ils appellent fort Malden
sur les ruines du fort Amherstburg. Bien que le fort Malden soit rendu
aux Britanniques en juillet 1815, le fort et le chantier naval de la
région ne retrouveront jamais l'importance qu'ils avaient avant la
guerre. Le fort est utilisé brièvement pendant les rébellions de
1837-1838 avant d'être définitivement abandonné en 1858.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2008 |
Lieu historique national du Canada du Chantier-Naval-de-Kingston
Kingston, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Chantier-Naval-de-Kingston est
situé à la pointe Frederick, à Kingston, en Ontario. Cette pointe de
terre de 37 hectares se trouve au confluent de la rivière Cataraqui et
du fleuve Saint-Laurent. Le chantier naval, composé d'un ancien chantier
naval et d'un poste de la marine, occupait la plus grande part de la
péninsule où se trouvent maintenant les bâtiments du complexe du Collège
militaire royal du Canada (CMR). La reconnaissance officielle fait
référence aux structures toujours existantes associées au chantier
naval, dont les anciens quartiers du chirurgien de la marine et le
dispensaire maintenant appelé Maison du commandant (1813-1814), le mur
de pierre qui forme l'entrée ouest de la cour intérieure ou du centre du
campus du CMR et qui date de la période suivant immédiatement la guerre
(1816-1819), ainsi que la Frégate de pierre de trois étages (1819).
L'ancien poste de garde et la plus importante Maison du portier
(guérite) ont été construits vers 1838. Un grand espace ouvert,
autrefois utilisé comme chantier de construction, sert maintenant de
terrain de manœuvres et de cour de défilé. Dans la baie Navy se trouvent
toujours sous l'eau des vestiges des quais du chantier et des rampes de
mise à l'eau, ainsi que des épaves et des concentrations d'artefacts qui
lui sont associés.
Site militaire actif des années 1790 à 1853, le chantier naval a été
créé en 1789 en tant que point de transfert des marchandises sur les
Grands Lacs ainsi que base navale de la Marine provinciale du lac
Ontario. Le chantier naval de Kingston a servi de base navale principale
du Haut-Canada au cours de la Guerre de 1812. Le traité Rush-Bagot de
1817, qui limitait le nombre de navires de guerre britanniques et
américains sur les lacs, a entraîné un déclin de ses activités et vers
le milieu du siècle, le chantier naval fut fermé. En 1876, le site était
utilisé comme Collège militaire royal du Canada. Les premiers édifices
du CMR comprenaient certains de ceux qui sont érigés dans l'ancien
chantier naval, dont la Maison du commandant actuelle, autrefois appelée
quartiers du chirurgien de la marine, l'imposante Frégate de pierre,
construite afin d'entreposer l'équipement naval des vaisseaux de guerre
remisés après la Guerre de 1812 et encore utilisée comme dortoir depuis
l'ouverture du CMR en 1876, et le petit poste de garde et l'imposante
Maison du portier, qui abrite maintenant des bureaux. Le chantier naval
de Kingston était à l'origine protégé par le fort Frederick, une autre
composante du lieu historique national du Canada des
Fortifications-de-Kingston, et plus tard par Fort Henry au sommet de la
pointe Henry sur la rive opposée de la baie Navy.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Chapelle-de-Sa-Majesté / St.-Paul-des-Agniers
Brantford, Ontario
Lieu historique national du Canada de la Chapelle-de-Sa-Majesté /
St.-Paul-des-Agniers est une pittoresque structure blanche à charpente
de bois située dans une cour boisée sur les rives de la rivière Grand.
Reconnue comme la plus vieille église encore debout en Ontario, elle est
utilisée par la communauté Mohawk, qui s'est installée à cet endroit
après avoir soutenu loyalement les Britanniques au cours de la
Révolution américaine.
La valeur patrimoniale de la Chapelle-de-Sa-Majesté/St.-Paul-des-Agniers
réside dans le fait qu'elle témoigne de la profondeur et de la solidité
de l'alliance entre les Britanniques et les Mohawks ainsi que des débuts
de l'histoire du Canada. Sa principale valeur tient à sa présence, à sa
forme et à sa composition structurale. Enfin, on attribue également une
valeur à sa conception, à son décor, aux matériaux utilisés, à la
fonction de la chapelle, à son emplacement et à son cadre.
La chapelle a été construite par la Couronne britannique en 1785 pour
récompenser la Première nation mohawk qui, sous le commandement de
Joseph Brant, avait soutenue les Britanniques au cours de la Révolution
américaine. La chapelle de Sa Majesté / St. Paul des Agniers a été
construit par les loyalistes John Thomas et John Smith, également
originaires de l'État de New York. Elle est utilisée depuis sa
construction et a, par conséquent, subi de nombreuses améliorations et
modifications. Parmi les plus importantes, mentionnons la réorientation
de l'axe intérieur, que l'on a fait pivoter de 90 degrés en 1829 pour
l'aligner sur le pignon, et les modifications apportées en 1869 pour que
la chapelle, initialement de style géorgien, reflète davantage les
valeurs architecturales victoriennes. La chapelle de Sa Majesté / St.
Paul des Agniers a été désignée chapelle royale en 1904.
|
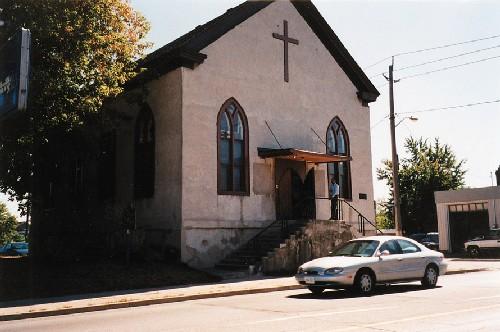
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1998 |
Lieu historique national du Canada de la Chapelle-Salem-de-la-British Methodist Episcopal Church
St. Catharines, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Chapelle-Salem-de-la-British
Methodist Episcopal Church est une église à pignon frontal, bâtie sur
des fondations élevée. Ce bâtiment paré de stuc, situé au 92 de la rue
Gevena à St. Catherines en Ontario, se distingue par ses fenêtres en arc
tiers-point régulièrement disposées, sa taille modeste et sa simplicité
générale.
Au XIXe siècle, la chapelle Salem de la British Methodist Episcopal
Church était un important centre d'activités abolitionnistes et des
droits civils au Canada. Cette église a été construite vers 1855 pour
remplacer une plus petite église en billes de bois car la communauté de
réfugiés grandissante et arrivant à St. Catherines par le chemin de fer
clandestin. Parmi elle se trouvait Harriet Tubman, célèbre organisatrice
du chemin de fer clandestin, qui a vécu près de Salem de 1852 à 1857 et
qui a personnellement dirigé l'évasion de nombreux réfugiés du sud des
États-Unis jusqu'à ce qu'ils soient en sécurité au Canada. La valeur
patrimoniale de l'église a trait à ses liens exceptionnels avec le
mouvement anti-esclavagiste et avec les premières communautés noires du
chemin de fer clandestin, attestés par l'église et sa forme en
auditorium qui sont typiques des premières églises
afro-canadiennes.
|

©Chapel of St. James-the-Less, Alan Brown, July 2006 |
Lieu historique national du Canada de la Chapelle-de-St. James-the-Less
Toronto, Ontario
La chappelle de St. James-the-Less est une chapelle funéraire qui a été
construite en pierre dans le style néogothique de la grande époque
victorienne, au milieu du XIXe siècle. Elle est située dans un cadre
pittoresque, au sommet d'un petit coteau paysager, juste à l'intérieur
des grilles principales du Cimetière St. James, au centre-ville de
Toronto.
La chappelle de St. James-the-Less a été désignée lieu historique
national en 1990 parce que cette petite chapelle funéraire est un
magnifique exemple du style gothique de la grande époque victorienne.
L'Église anglicane St. James-the-Less, qui a été dessinée par des
architectes torontois renommés, Cumberland et Storm, est un bon exemple
des petites chapelles construites dans le style néogothique de la grande
époque victorienne. Elle garde un intérieur fidèle à la liturgie, un
toit incliné et une tour proéminente de style néogothique ancien, mais
elle présente ses éléments d'une manière à la fois impressionnante et
harmonieuse. La chapelle est rehaussée par des élévations latérales et
le cadre pittoresque du Cimetière St. James aménagé par John G. Howard,
en 1842.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Butterill, 1995 |
Lieu historique national du Canada du Château-Dundurn
Hamilton, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Château-Dundurn est un domaine
datant du début du XIXe siècle situé à Hamilton en Ontario. Érigés à
Burlington Heights, entre le port de Hamilton et la dépression appelée
Cootes Paradise, le château Dundurn ainsi que ses bâtiments et
structures connexes font partie d'un domaine pittoresque de type parc
qui s'étend sur 13 hectares et surplombe la baie de Burlington. La
résidence principale, un édifice imposant de style italianisant, est
entourée de bâtiments secondaires construits au cours du XIXe siècle,
notamment un colombier, un pavillon de deux étages où se déroulaient des
combats de coqs (« Cockpit »), la maison du jardinier, la maison du
portier (« Battery Lodge ») ainsi qu'une écurie (« MacInnes Stable »).
Le lieu comprend également une grille d'entrée datant du XIXe siècle («
Rolph Gates ») ainsi qu'un pavillon construit au XXe siècle (« Park
Pavilion »).
En fonction de sa conception extérieure, de sa disposition et de son
paysage, Dundurn constitue l'exemple le plus complet des valeurs
pittoresques de l'architecture canadienne. Sa valeur patrimoniale réside
dans les qualités pittoresques du paysage et des bâtiments et dans leur
lien avec sir Alan Napier MacNab, politicien et homme d'affaires éminent
pour lequel Dundurn a été construit de 1834 à 1835. Continuellement
embelli tout au long du XIXe siècle, le château Dundurn demeure un
exemple détaillé d'un domaine de style pittoresque construit à cette
époque au Canada. Le domaine comprend une résidence principale
d'inspiration italienne, une série de dépendances de style classique et
néo-gothique, des éléments paysagers naturels, les vestiges d'un remblai
construit par l'armée en 1812 ainsi que des bâtiments agricoles datant
du XVIIIe siècle. Tous ces éléments forment un ensemble qui incarne les
principes du style pittoresque.
Appartenant à l'origine à Richard Beasley, qui y fait construire une
maison en brique de deux étages en 1800, le domaine Dundurn est acheté
par John Solomon Cartwright de Kingston en 1832. L'année suivante,
Cartwright vend la propriété à MacNab, qui commence la construction de
son « château » en 1834. Une fois les travaux achevés, en 1835,
l'édifice surpasse tout ce qu'a connu la jeune colonie en matière
d'ampleur, d'extravagance et d'élégance. Conçue par Robert Wetherell, un
architecte de Hamilton, la résidence principale constitue un mélange
éclectique de motifs classiques et italianisants. Elle est entourée d'un
paysage majestueux et offre une vue panoramique sur la baie voisine.
MacNab et le maître jardinier du domaine, William Reid, continuent
d'embellir la propriété tout au long de leur vie, faisant souvent appel
à des architectes et à des paysagistes professionnels. Le portique
classique est ajouté en 1855 selon les plans de l'architecte local
Frederick Rastrick. D'autres propriétaires ajoutent par la suite des
éléments, comme l'écurie en pierre. Le domaine a conservé ses jardins
classiques, ses aires familières de type parc ainsi que ses pentes et
ses ravins naturels, qui ont chacun pour dessein de produire divers
effets caractéristiques du style pittoresque : variété, suspense,
surprise, irrégularité des lignes et contraste.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Château-Laurier
Ottawa, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Château-Laurier est un hôtel du
début du XXe siècle situé dans le centre-ville d'Ottawa, en face de
l'ancienne gare Union. Le Château Laurier, érigé sur une hauteur,
surplombe la rivière des Outaouais, à proximité du canal et de la
rivière Rideau. Non loin de cet hôtel pittoresque de style Château se
trouve également le lieu historique national du Canada de la
Place-de-la-Confédération, qui comprend quelques-uns des bâtiments
historiques les plus importants au cœur de la capitale.
Le Château Laurier, bâti entre 1908 et 1912, est le premier d'une série
d'hôtels de style Château construits par la Grand Trunk Pacific Railway
Company (GTPR) afin d'inciter les touristes à emprunter ses routes
transcontinentales. La société érige des établissements de ce type de
Québec à Victoria, près de gares urbaines et souvent dans un
environnement spectaculaire. Le style Château, privilégié pour les
hôtels de cette compagnie de chemin de fer, est devenu une facture
typiquement canadienne, puis un symbole de qualité en hôtellerie.
Lorsque cette architecture a commencé à s'imposer comme un style propre
au pays, le Château Laurier est devenu un modèle en raison de sa
proximité du siège du gouvernement fédéral. La reprise de ce style à
l'échelle du Canada évoque très bien visuellement le lien qui unit en un
seul et même pays des villes et des régions aux cultures et aux
géographies fort différentes.
Pour achever les plans du Château Laurier, le cabinet montréalais Ross
and MacFarlane s'inspire des réalisations de l'architecte New Yorkais
Bradford Lee Gilbert. Les murs pâles de l'édifice, en calcaire de
l'Indiana, s'harmonisent bien avec le style de la gare de la GTPR,
située à proximité, tandis que son toit fortement incliné, ses tourelles
et ses éléments gothiques conviennent parfaitement à l'image du Canada
et à son climat. À partir de 1916 jusqu'aux années 1950, le gouvernement
fédéral insiste pour que le style établi par le Château Laurier soit
reprise d'une façon ou d'une autre dans tous les bâtiments fédéraux
d'Ottawa. D'ailleurs, l'édifice de la Confédération et le toit de la
Cour suprême témoignent bien de cette préférence.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2003 |
Lieu historique national du Canada Chiefswood
Six Nations of the Grand River First Nation, Ontario
Chiefswood est un petit joyau de villa à l'italienne situé dans un
pittoresque paysage boisé sur les rives de la rivière Grand, au coeur de
la réserve Six Nations Grand River, en Ontario. Son emplacement est la
clé de sa signification historique comme domicile de la famille Johnson,
plus particulièrement de la poétesse E. Pauline Johnson.
Le lieu historique national du Canada Chiefswood a été désigné parce
qu'il témoigne du rôle d'intermédiaire joué par la famille Johnson entre
les cultures autochtones et non autochtones.
Construite entre 1853 et 1856 pour le chef des Six nations George H.M.
Johnson (1816 - 1884), Chiefswood est la maison natale de la poétesse
Emily Pauline Johnson et le domicile de la famille Johnson jusqu'au
décès de George Johnson en 1884. Johnson est considéré comme un
personnage important au regard de la société et de la politique, en
qualité d'interprète officiel du gouvernement, rapprochant ainsi le
monde colonial britannique et le monde des Premières nations. Il a
construit sa maison sur une terre agricole qu'il a achetée aux abords de
la rivière Grand, à proximité de l'église missionnaire anglicane, près
de Tuscarora (Middleport). Bien qu'il ne s'agisse pas de la seule maison
construite par une famille des Premières nations au cours du XIXe
siècle, Chiefswood, est la seule d'une telle dimension et d'une telle
sophistication architecturale ayant survécu jusqu'à nos jours.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1995 |
Lieu historique national du Canada de la Christ Church, la chapelle-royale-de-Sa-Majesté-chez-les-Mohawks
Deseronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Christ Church, la
chapelle-royale-de-Sa-Majesté-chez-les-Mohawks est situé au centre du
haut d'une colline surplombant la baie de Quinte, à Tyendinaga, en
Ontario. Entourée par un cimetière et des arbres, ce beau petit bâtiment
de style néogothique est caractérisé par des vitraux et une flèche
modérée. Les murs extérieurs construits en calcaire local sont coiffés
d'un toit à deux pignons bas, et un clocher carré.
La valeur patrimoniale de ce site réside dans ses associations
historiques, telles qu'illustrées par les propriétés physiques de
l'église et par les artéfacts historiques particuliers qu'elle abrite.
La Révolution américaine, au cours de laquelle certains groupes de
Mohawks avaient combattu aux côtés des Britanniques, a laissé le peuple
Mohawk dépossédé de ses terres, dans ce qui est aujourd'hui l'état de
New York. Les Mohawks fidèles à la Couronne britannique sont venus à
Tyendinaga dans la baie de Quinte pour s'établir sur la terre qui leur
avait été promise par les Britanniques pour leur fidélité et leur
allégeance.
L'église, conçue par John Howard et financée par les Mohawk, a remplacé
une structure en bois plus âgée. L'emplacement éminent de l'église sur
un site élevé surplombant la baie de Quinte symbolise sa puissance pour
les peuples mohawk. L'église actuelle a été désignée chapelle royale en
1906. Cela signifie qu'elle est réservée à l'usage du monarque régnant.
Même si la flèche et une grande partie de son intérieur ont été
détruites par un incendie en 1906, les murs de pierre ont été préservés
et le reste de l'église a été scrupuleusement reconstruit par les
Mohawks. L'église contient encore des objets qui attestent à la fois
l'histoire mohawk et l'alliance entre la Couronne britannique et les
peuples mohawk.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, R. Godspeed, 2000 |
Lieu historique national du Canada du Cimetière-Beechwood
Ottawa, Ontario
Le cimetière Beechwood est un grand cimetière du 19e siècle, situé à
Ottawa. Créé en 1873, le cimetière Beechwood est un cimetière paysager
comportant des routes, des sentiers, des bâtiments et des monuments. Il
est situé sur un terrain vallonné, bordé d'un boisé.
Le cimetière Beechwood a été désigné comme lieu historique national en
2000 parce qu'il est un exemple exceptionnel de la conception des
cimetières ruraux du 19e siècle, qui se caractérisent par un paysage
naturaliste, pastoral et pittoresque à plusieurs perspectives. Il a
également été désigné parce qu'il contient deux très bons exemples de
paysages exprimant des traditions culturelles distinctes - le cimetière
chinois conçu conformément aux principes religieux chinois ; et un
cimetière militaire très visible - et parce qu'il comprend une
concentration de mausolées, de monuments et de balises qui sont
intéressants sur les plans architecturaux et historiques et qui
illustrent de nombreux aspects de l'histoire du Canada, de la province
de l'Ontario et de la ville d'Ottawa.
Le cimetière Beechwood est un exemple du type de cimetière rural ou
paysager qui est apparu aux États-Unis et au Canada au milieu du 19e
siècle. Il est typique des cimetières ruraux par son utilisation d'un
décor naturaliste pour attirer et réconforter l'être vivant; la création
d'un lieu sûr pour le défunt; l'utilisation de monuments funéraires pour
perpétuer la mémoire des individus qui ont une importance historique; et
son aménagement comme espace public de style parc. Il conserve une
grande partie de son caractère original qui s'exprime dans l'aménagement
des routes entrelacées et sinueuses; les îlots de formes irrégulières et
de grandeurs variées; et les monuments funéraires de styles différents
et de matériaux variés, le tout dans un paysage vallonné d'arbres,
d'arbustes et de plantes comportant plusieurs points de vue
pittoresques.
Le plan du cimetière a été conçu et supervisé par l'ingénieur municipal
Robert Surtees, et aménagé par Alpine Grant, jardinier paysagiste du
gouvernement. Le cimetière comprend des bâtiments et des structures du
19e siècle conçus par l'architecte d'Ottawa James Mather, en
consultation avec Robert Surtees; une résidence en pierre construite
dans les années 1880 à l'aide de pierres à chaux extraites du cimetière;
une résidence double pour les jardiniers et les contremaîtres; une
ancienne écurie, et une porte d'entrée en pierre. Surtees et Mather ont
tous deux occupé des postes de cadre pour le cimetière et y sont
enterrés.
Le cimetière chinois comprend des tombes datant des années 1920 et un
jardin commémoratif conçu et créé en 1996 par la communauté chinoise
selon les traditions architecturales et religieuses chinoises.
Comprenant une pagode avec un autel en granite et une cassolette de
bronze, le jardin est utilisé par la communauté pour rendre hommage aux
ancêtres.
Le cimetière Beechwood est l'emplacement du cimetière militaire national
des Forces canadiennes, acheté par le ministère de la Défense nationale
en 1944 pour y enterrer les anciens combattants des Forces canadiennes.
Le cimetière militaire est situé bien en vue au centre de Beechwood et
se distingue par ses stèles funéraires uniformes et un monument
militaire central.
Le cimetière Beechwood contient une gamme de pierres tombales évoquant
différentes périodes de son développement pour ce qui est des styles,
des matériaux et du symbolisme. Le cimetière est l'endroit où reposent
de nombreuses personnalités qui se sont distinguées par leurs
contributions à l'échelle nationale, provinciale ou locale; et on y
trouve aussi la tombe de personnes enterrées antérieurement dans les
premiers cimetières de la région d'Ottawa. Le cimetière contient aussi
plusieurs mausolées en pierre, y compris un mausolée néo-gothique qui a
été conçu par W. Ralston et qui est remarquable par ses dimensions, sa
conception, son ouvrage en pierre et ses détails.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Rhona Goodspeed, 2009 |
Lieu historique national du Canada du Cimetière-de-Cataraqui
Kingston, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Cimetière-Cataraqui est situé
dans la grande région de Kingston, en Ontario. Conçu selon les plans de
Frederick Cornell et créé en tant que cimetière non confessionnel en
1850, le cimetière Cataraqui, dont l'aménagement ressemble à celui d'un
parc, couvre une superficie d'environ 40 hectares et est un
cimetière-jardin rural de taille moyenne qui respecte les principes de
la conception pittoresque. Le paysage naturel, boisé et ondulé sert de
décor aux sentiers sinueux et aux nombreux monuments funéraires de types
et de styles variés.
La valeur patrimoniale du cimetière Cataraqui réside dans ses éléments
de conception et ses caractéristiques physiques. Le cimetière Cataraqui
s'inscrit dans la tradition des cimetières ruraux, qui s'est développée
au cours du XIXe siècle, de la fin des années 1840 jusque dans les
années 1870 dont on trouve des exemples dans de nombreuses régions du
Canada. Cataraqui est un exemple remarquable d'un des premiers
cimetières ruraux, de par l'utilisation de son paysage naturel pour
attirer et réconforter les vivants, la création d'un espace adapté pour
les sépultures, l'utilisation de monuments funéraires afin de perpétuer
la mémoire des défunts, ainsi que son aménagement ressemblant à celui
d'un parc ouvert au public, et comprenant diverses espèces d'arbres et
d'arbustes. Le cimetière Cataraqui a conservé presque toutes ses
caractéristiques d'origine, y compris ses nombreux points de vue
pittoresques. Le cimetière est également bien connu pour ses exemples
attrayants de statues décoratives de la fin du XIXe siècle éparpillées
sur l'ensemble du terrain. Il se trouvait à l'origine à trois milles à
l'extérieur de Kingston, mais il est maintenant situé à l'intérieur des
limites de la ville.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Cimetière-Mount Pleasant
Toronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Cimetière-Mount Pleasant occupe
83 hectares en plein centre-ville de Toronto (Ontario). Le cimetière,
créé à la fin du XIXe siècle dans une zone qui, à l'époque, se trouvait
tout au nord de la zone urbaine, a été dessiné de manière à présenter un
environnement naturel familier où des pelouses, des arbustes et des
arbres matures se mêleraient aux monuments commémoratifs et aux stèles
funéraires de divers styles et tailles. De nombreux sentiers sinueux
suivent les contours du paysage boisé pittoresque. L'aménagement
semblable à celui d'un parc offre des vues panoramiques qui, avec les
plantations sélectives, accentuent la beauté naturelle de
l'environnement.
Le terrain qu'occupe à présent le cimetière Mount Pleasant, a été acheté
en 1873 comme terres agricoles composées d'un ravin et d'un plateau
situés sur ce qui était alors le village de Deer Park. Le cimetière
Mount Pleasant, qui a été conçu en 1874 par le jardinier paysagiste H.
A. Englehardt, est étroitement associé au concept des cimetières ruraux
du XIXe siècle. Après les trois ans qu'a duré son aménagement, le
cimetière a ouvert en 1876. En plus d'être des lieux d'inhumation, ces
cimetières ruraux devaient aussi être des lieux de contemplation et de
loisirs. Le cimetière se distingue à présent par ses sentiers
pittoresques, ses arbres aux essences rares qui viennent du monde
entier, la coexistence de spécimens indigènes, et la richesse des
monuments funéraires historiques qui s'intègrent au dessin
original.
|

©Susan Schappert, 2007 |
Lieu historique national du Canada Cinéma Capitol de Port Hope
Port Hope, Ontario
Le cinéma Capitol de Port Hope a ouvert ses portes en 1930. Étant l'un
des premiers cinémas au Canada à être conçus spécialement pour la
projection de films parlants, il est représentatif des changements
architecturaux importants qui sont survenus dans la construction des
salles de cinéma à la fin des années 1920. Conçu par l'architecte
canadien Murray Brown, le cinéma est un exemple remarquable de salle
d'ambiance, un style très courant à l'époque, destiné à donner aux
spectateurs l'impression de se trouver dans un amphithéâtre romantique
en plein air. Aujourd'hui, ce cinéma de petite ville est en excellent
état et a conservé une bonne partie de son intégrité architecturale, ce
qui en fait un des rares exemples de cinémas de ce style toujours en
activité au Canada.
Le théâtre se trouve à Port Hope, petite ville de l'Ontario en bordure
du lac du même nom, à une centaine de kilomètres à l'est de Toronto. Il
est situé sur la rue Queen, une des artères les plus fréquentées de la
ville, où se côtoient bâtiments commerciaux et résidences. En 1930,
après la fermeture du seul cinéma de la ville, Famous Players a fait
construire un nouveau cinéma, conçu spécialement pour les films
parlants. Le Capitol a ouvert ses portes en août 1930, avec la
projection de Queen High, avec Charles Ruggles et Ginger Rogers,
suscitant l'enthousiasme de la population de la ville.
Le cinéma Capitol est un exemple remarquable de salle d'ambiance, un
style éphémère mais qui fut très populaire en Amérique du Nord vers la
fin des années 1920. Simple édifice à deux étages et demi à l'extérieur,
son intérieur a été décoré de façon à ressembler à un jardin médiéval
anglais. On y retrouve les éléments essentiels d'une salle d'ambiance, à
savoir un plafond étoilé, l'ambiance nocturne et les murs ornés de
motifs en trompe‑l'œil donnant l'impression aux spectateurs de se
trouver dans un amphithéâtre romantique en plein air. Le bas des murs de
l'auditorium est peint en gris pour imiter la pierre de Caen, et des
arbres y sont peints dans la partie supérieure. Les étoiles, à l'origine
peintes au plafond, ont été remplacées par de petites lumières lors de
la restauration. Sur l'extérieur du bâtiment se trouve une marquise
suspendue par des chaînes à l'image d'un pont‑levis. Cet élément,
conjugué aux vitres en losanges des fenêtres, est en accord avec le
décor intérieur imitant un château médiéval, et quelque peu en
contradiction avec le motif égyptien distinctif de l'enseigne. Le
bâtiment était des plus innovants pour l'époque de sa construction :
conçu pour être totalement à l'épreuve du feu, ce fut aussi le premier
bâtiment de la ville dont la structure était faite de poutres en acier.
Qui plus est, il offrait aux spectateurs le plus grand confort et les
services les plus modernes qui soient.
Comme bon nombre d'autres cinémas, le Capitol a fermé ses portes en
raison du déclin de la clientèle, toutefois, il doit sa survie à la
détermination de la population de la ville. En effet, c'est en 1993,
soit six ans après sa fermeture, que fut fondée, avec l'appui
enthousiaste de la population, la Capitol Theatre Heritage Foundation,
qui avait pour but de sauver le bâtiment. La première des trois tranches
de travaux de restauration a été entamée en 1995, puis le cinéma a
rouvert ses portes. Il a été possible de préserver certains des éléments
d'origine et, grâce aux nombreux documents historiques qui existaient,
de reconstruire à l'identique divers éléments qui s'étaient détériorés
avec le temps.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1978 |
Lieu historique national du Canada Claverleigh
Creemore, Ontario
De style néogothique, la villa Claverleigh située sur un vaste terrain
ressemblant à un parc dans un milieu rural isolé, à 3.2 kilomètres (2
milles) à l'ouest du village de Creemore, en Ontario.
La villa Claverleigh a été désignée lieu historique national en 1990
parce qu'elle est un très bel exemple d'une villa de style néogothique.
La valeur patrimoniale de ce lieu réside dans son expression matérielle
d'une villa de style néogothique au Canada.
La maison a été construite en 1871 par William Forster conformément aux
plans de son frère, l'architecte anglais Richard Forster, pour servir de
presbytère. Le style néogothique était considéré comme convenant tout à
fait au caractère ecclésiastique d'un petit presbytère.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Colline-de-la-Bataille
Wardsville, Ontario
Emplacement de la bataille des Longwoods, 1814; guerre de 1812.
Le lieu historique national du Canada de la Colline-de-la-Bataille se
trouve dans une région onduleuse, au cœur de la vallée de la colline de
la Bataille, près de la route 2 (aussi connu sous le nom de chemin
Longwoods), à l'ouest de Wardsville, en Ontario. Le lieu est associé à
la bataille de Longwoods, qui s'est déroulée le 4 mars 1814 dans une
plaine, près du ruisseau aujourd'hui appelé Battle Hill. Après une brève
escarmouche entre les membres de la force régulière britannique et les
forces américaines, les Britanniques doivent se replier au Delaware,
tandis que les Américains abandonnent leur avance et se retirent à
Detroit. Il ne subsiste aucun vestige connu de la bataille, mais le lieu
est marqué d'une plaque et d'un cairn, installés au sommet d'une petite
colline et entourés d'une clôture en fer.
Le 5 octobre 1813, après la défaite des Britanniques à Moraviantown, les
forces américaines peuvent pénétrer dans l'ouest du Haut Canada et y
entamer une série d'incursions. Même si les batailles organisées sont
rares, les autorités militaires britanniques tentent de contrecarrer les
avancées des Américains sur leur territoire en établissant des postes
d'observation. Puis, en compagnie de la milice locale et des alliés
autochtones, les Britanniques commencent à se déplacer dans les
campagnes. Vers la fin de février 1814, le commandant américain à
Detroit ordonne à un détachement de prendre d'assaut le poste
d'observation de Delaware. Les forces américaines, sous le commandement
du capitaine Andrew Holmes, rencontrent sur leur route une patrouille de
Rangers canadiens et décident de s'établir près du ruisseau Twenty Mile,
sur ce qui deviendra plus tard la colline de la Bataille, pour attendre
l'arrivée des Britanniques. Dès leur arrivée à la colline, les membres
de la force régulière britannique, sous les ordres du capitaine James
Badsen, attaquent les Américains, mais les pertes élevées les obligent à
retourner à Delaware. Les Américains se replient alors à Detroit, ratant
ainsi leur opportunité de prendre Delaware.
|
|
Lieu historique national du Canada de la Colline-Bead
Toronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Colline-Bead est situé à
l'intérieur du parc de la vallée de la Rouge, dans la portion basse de
la Rouge River Valley à Scarborough, en Ontario. Il occupe un terrain
surélevé sur la rive ouest de la rivière Rouge, à son confluent avec le
petit ruisseau Rouge, au nord et adjacent à l'autoroute 2. L'un des
rares sites Sénécas du XVIIe siècle au Canada, il comprend un village
historique Sénéca et un lieu de sépulture associé qui datent de la fin
du XVIIe siècle, un tertre couvert d'arbres sur un de ses versants, un
campement archaïque datant d'environ 3000 ans avant notre ère, ainsi que
d'autres sépultures situées sur la pointe du plateau, à l'est du
village.
La valeur patrimoniale de la colline Bead réside dans son intégrité en
tant que site archéologique intact et dans le fait qu'elle est liée aux
Sénécas. La datation du village et du lieu de sépulture qui lui est
rattaché a été établie à 1665-1687 de notre ère, époque à laquelle ils
étaient utilisés par les Sénécas, membres de la Confédération iroquoise.
La colline Bead est un exemple de village sédentaire et semi-permanent
typique des Sénécas. Ce type de village était généralement entouré d'une
palissade et situé non loin d'une voie navigable importante, dans un
endroit surélevé et défendable.
La colline Bead a été découverte à la fin du XIXe siècle, quand on a
signalé la présence d'un village entouré d'une palissade près de
l'embouchure de la rivière Rouge. Des travaux de prospection
archéologique plus approfondis ont permis la découverte de nombreux
petits artefacts tels que des contrebagues de verre, des pipes en
céramique, et des pierres à fusil d'origine européenne. Ces objets,
ainsi que l'emplacement du village sur un versant défendable et la
présence d'un lieu de sépulture sont des caractéristiques typiques des
villages Sénécas du XVIIe siècle. Puisqu'il est le seul village connu
des « Iroquois du nord », ce lieu présente un potentiel énorme pour
l'acquisition de nouvelles connaissances sur la culture iroquoise de
cette époque. Puisque la colline Bead n'a jamais été l'objet de fouilles
archéologiques de grande envergure, le site est bien préservé et
relativement intact.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Catherine Beaulieu, 2010 |
Lieu historique national du Canada de la Colline-du-Parlement
Ottawa, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Colline-du-Parlement est
situé bien en vue sur la rue Wellington, au sommet d'une colline qui
surplombe la rivière des Outaouais, au centre-ville d'Ottawa, en
Ontario. Le lieu comprend quatre édifices de style néogothique regroupés
sur un terrain paysagé, à savoir l'édifice de l'Ouest, l'édifice du
Centre, l'édifice de l'Est et la Bibliothèque. Construits entre 1859 et
1865 pour servir les besoins du gouvernement des provinces unies du Haut
et du Bas-Canada, les édifices du Parlement ont été occupés par la
Chambre des communes, le Sénat et des bureaux ministériels du nouveau
Dominion du Canada après la Confédération de 1867. Les édifices du
Parlement ont toujours été occupés, et ils continuent de représenter le
centre réel et symbolique du gouvernement du Canada.
Les édifices du Parlement sont d'abord construits pour servir les
besoins du gouvernement des provinces unies du Haut et du Bas-Canada,
mais ils sont occupés par la Chambre des communes, le Sénat et les
bureaux ministériels du nouveau Dominion du Canada après la
Confédération de 1867. D'abord connu sous le nom de Colline des
Casernes, l'emplacement des édifices est choisi en raison de sa
situation dominante, du point de vue splendide et dégagé qu'il offre sur
la région ainsi que de ses trois décennies d'occupation par une garnison
militaire et les Royal Engineers; l'endroit est donc au coeur de la vie
sociale de la ville.
En 1859, on lance la construction du complexe d'édifices bien en vue au
sommet d'une colline. Tous les édifices d'origine représentent des
exemples pittoresques de l'architecture néogothique de la grande époque
victorienne, même s'ils ne sont pas tous conçus par les mêmes
architectes. Thomas Fuller et Chilion Jones conçoivent l'édifice du
Centre et la Bibliothèque d'origine, tandis que Thomas Stent et Augustus
Laver dessinent les plans des édifices de l'Est et de l'Ouest. Les
édifices sont destinés à accueillir toutes les activités du gouvernement
: les édifices de l'Est et de l'Ouest sont réservés à l'ensemble de la
fonction publique, tandis que l'édifice du Centre, ouvert en 1865 mais
terminé officiellement le 6 juin 1866, est occupé par les différents
ministères. Les travaux de construction de la Bibliothèque commencent en
1859, sont revus en 1870 et sont achevés en 1877. Un incendie détruit
l'édifice du Centre, à l'exception de la Bibliothèque, en 1916. On
profite des travaux de reconstruction qui suivront pour agrandir le
bâtiment et y ériger la Tour de la Paix, qui sera terminée en 1928. On
conserve le style gothique, mais on y ajoute un plan axial inspiré des
Beaux-Arts agrémenté de détails gothiques.
Les édifices du Parlement jouent un important rôle symbolique, car ils
représentent l'expression physique du gouvernement du Canada. Au plan
visuel, ce symbolisme se manifeste principalement par l'image extérieure
de l'édifice du Centre et de la Tour de la Paix; cependant, le complexe
entier se détache clairement dans la capitale nationale,
particulièrement parce qu'il illustre une conception architecturale
qu'on ne trouve nulle part ailleurs au pays.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Mikaela Gallinger, 2022 |
Lieu historique national du Canada du Complexe de l’Observatoire fédéral
Ottawa, Ontario
Construit de 1902 à 1954, le complexe de l’Observatoire fédéral se
trouve dans le paysage culturel de la Ferme expérimentale centrale à
Ottawa, également un lieu historique national, sur le territoire
traditionnel algonquin anishinaabe non cédé. Le complexe est composé de
bâtiments distinctifs dont l’architecture témoigne de la vision tournée
vers l’avenir du gouvernement fédéral qui, au début du siècle, souhaite
établir des institutions scientifiques nationales dans la capitale. Cet
ensemble exceptionnel de bâtiments scientifiques, qui datent du début du
XXe siècle, et d’éléments paysagers permet de soutenir la recherche
partout au pays. Les fonctions de ces structures, leur interdépendance
et leur emplacement dans le paysage jouent un rôle essentiel dans le
succès de décennies de recherche menée sur place. De 1905 à 1970, le
complexe de l’Observatoire fédéral est un important centre pour la
recherche scientifique dans le domaine de l’astronomie appliquée à
l’arpentage, au service de l’heure et à la géophysique. Le méridien
d’origine du Canada, situé dans le complexe et déterminé par la
recherche astronomique, contribue à l’établissement de l’heure
officielle nationale et au programme d’arpentage. Les travaux de
recherche en géophysique soutiennent des études sismologiques et
gravitationnelles. De plus, le complexe de l’Observatoire fédéral est un
lieu de collaboration de chercheurs scientifiques du monde
entier.
L’expansion du Canada vers l’ouest à la fin du XIXe siècle met en
évidence la nécessité de produire des relevés cartographiques exacts qui
reposent sur des mesures astronomiques précises, un exercice
généralement entrepris sans l’autorisation ou la participation des
Peuples Autochtones qui occupent ces terres depuis des temps
immémoriaux. Le gouvernement fédéral construit un premier observatoire
national en 1890 dans un petit bâtiment, érigé là où se trouve
actuellement la Cour suprême. En 1901, un nouvel emplacement pour
l’observatoire est choisi dans la partie nord-est de la Ferme
expérimentale centrale. Suffisamment éloigné de la ville pour éviter la
pollution lumineuse, situé à une hauteur propice à l’observation
astronomique et assez près d’une ligne de faille pour mener des
recherches sismologiques, le site se prête bien à un agrandissement
éventuel. L’horloge maîtresse originale installée à la base de ce nouvel
observatoire est par ailleurs suffisamment proche pour donner l’heure
nationale exacte aux bâtiments gouvernementaux. La plupart des premiers
bâtiments du complexe sont conçus par le bureau de l’architecte en chef
du ministère des Travaux publics, dont l’Observatoire fédéral (1905), la
Maison de l’Observatoire (1909), l’Édifice azimut sud (1912) et
l’Édifice de la photo équatoriale (1914). D’autres bâtiments qui
subsistent, comme le Centre de données géophysiques (1908), le Bâtiment
du relevé sismologique (1913), l’Atelier d’usinage et l’Atelier de
menuiserie (1917), la Centrale électrique (avant 1928) et le Laboratoire
de géophysique (1954), sont ajoutés au complexe au fil du temps afin de
l’adapter à l’évolution de la recherche scientifique. À cela s’ajoutent
des éléments invisibles en surface, soit une série de tunnels reliant
les bâtiments et des voûtes souterraines construites aux fins de la
recherche sismologique. Malgré la perte de quelques structures, dont
l’Édifice azimut nord, le complexe est resté remarquablement
inchangé.
Outre son rôle de centre de recherche, le complexe sert de lieu de
sensibilisation et d’éducation où les chercheurs transmettent au public
leur passion pour l’astronomie lors des rencontres de la Société royale
d’astronomie, de conférences publiques, de visites guidées et
d’activités d’observation des étoiles le samedi soir. Tout au long de
son histoire, le complexe de l’Observatoire fédéral est le théâtre de
recherches et d’expériences qui ont grandement contribué à l’excellence
scientifique canadienne.
|



©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Complexe-de-la Rue-Ridout
London, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Complexe-de-la-Rue-Ridout est
situé au centre-ville de London, en Ontario, à la confluence des bras
sud et nord de la rivière Thames. Le complexe est constitué d'un
alignement de trois élégants bâtiments construits au XIXe siècle, dont
la résidence Anderson, et les bâtiments de la Banque du Haut-Canada et
de la Gore Bank of Canada. La similitude des formes, des matériaux
utilisés et des détails de leurs ornements confère à l'ensemble une
certaine unité, même si la facture unique de chacun des bâtiments et
leur structure distinctive offrent un paysage de rue varié.
La valeur patrimoniale de ce lieu réside dans le regroupement de ces
exemples représentatifs de l'architecture urbaine du sud-ouest de
l'Ontario au XIXe siècle. La partie nord de la rue Ridout a accueilli le
premier centre financier de London, où les avocats, médecins et
banquiers les plus réputés ont établi leurs bureaux et fait construire
leur maison. La rue était connue sous le nom de « rue des Banquiers »
après l'établissement des sièges sociaux de cinq banques, avant qu'elles
ne soient transformées en résidences et en commerces. Leur structure
conservatrice, de type classique en brique de couleur chamois fabriquée
dans la région, est typique des édifices de cette région à la fin du
XIXe siècle.
|

©Peterborough Architectural Conservation Advisory Committee, 1989 |
Lieu historique national du Canada Cox Terrace
Peterborough, Ontario
Le Cox Terrace est un édifice en brique de la fin du XIXe siècle, de
style Second Empire. Situé au coeur de Peterborough, il comporte sept
logements à deux et à trois étages. L'édifice est présentement un bien
commercial.
Cox Terrace a été désigné lieu historique national parce qu'il constitue
un bel exemple de maison en rangée érigée dans le style Second Empire.
Cox Terrace est une adaptation unique du style Second Empire à une
maison en rangée. Sa conception complexe, rare dans le cas de maisons en
enfilade, reprend le thème des pavillons regroupés propre aux édifices
publics imposants.
Cox Terrace a été construit par George A. Cox, homme d'affaires prospère
et influent et sénateur canadien. Cox a été désigné personne
d'importance historique nationale par la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada (CLMHC).
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Darlingside
Leeds and the Thousand Islands, Ontario
Darlingside est un dépôt de bois du milieu du XIXe siècle situé sur les
rives du Saint Laurent, juste à l'est du pont Ivy Lea, à mi chemin entre
Kingston et Brockville. Darlingside comprend deux terrains riverains de
2,8 hectares sur lesquels se trouvent un petit magasin d'un étage et
demi, une maison à ossature en bois, une étable et une remise à bateaux.
Les bâtiments sont situés sur un rebord étroit le long de la rive, sur
un terrain boisé et très incliné.
Darlingside a été désigné lieu historique national en 1992 parce qu'il
est l'un des rares exemples restants et relativement intacts d'un dépôt
de bois du cours supérieur du fleuve Saint Laurent.
La valeur patrimoniale du lieu réside dans la série de bâtiments
vernaculaires modestes construits dans un but précis et situés
stratégiquement sur un terrain riverain du fleuve Saint Laurent.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2000 |
Lieu historique national du Canada Diefenbunker / siège central du gouvernement d'urgence
Ottawa, Ontario
Le Lieu historique national du Canada Diefenbunker / siège central du
gouvernement d'urgence est un grand bunker souterrain situé à Carp, en
Ontario, juste au sud de la Capitale nationale. Il est niché en toute
sécurité juste au-dessous du sommet d'une crête naturelle, on ne peut
voir de l'extérieur que son tunnel d'entrée en métal et sa baraque en
acier, ainsi que le parc d'antennes annexe et la clôture périphérique.
Le bunker de Diefenbaker à proprement dit est une structure fortifiée
souterraine en béton de quatre étages, dont les entrées d'air, les
sorties de ventilation, les trappes de secours, les puits profonds et
les étangs d'eaux usées sont dissimulés dans les contours artificiels du
paysage environnant. Il est maintenant ouvert au public à titre de Musée
canadien de la guerre froide.
La valeur patrimoniale du Lieu historique national du Canada
Diefenbunker / siège central du gouvernement d'urgence, a trait au fait
qu'il illustre concrètement la détermination du Canada à survivre et à
fonctionner en tant que nation pendant une attaque nucléaire, comme
l'attestent son emplacement, son site dissimulé, sa conception défensive
et sa construction très fortifiée. Le Diefenbunker a servi de siège
central du gouvernement d'urgence du Canada pendant la Guerre froide. Il
a été conçu de 1957 à 1959, puis bâti de 1959 à 1961 par le gouvernement
du Canada dans le but d'abriter des politiciens et militaires clés en
cas d'attaque nucléaire. De 1961 à 1994, il a servi de noeud du réseau
de communications et du système de défense civile. À l'origine, le
complexe se composait de deux parties : un bâtiment de transmission
situé à Richardson, à 45 km au sud de Carp, et le bâtiment principal de
réception situé à Carp même. Le lieu historique national ne se compose
que du bâtiment de Carp, que la municipalité de West Carleton possède et
exploite à titre de site touristique.
|

©Jayne Elliott, 2002 |
Lieu historique national du Canada du Dispensaire-de-la-Croix-Rouge-de-Wilberforce
Wilberforce, Ontario
Situé près de la limite nord-est du village de Wilberforce, en Ontario,
le lieu historique national du Canada du
Dispensaire-de-la-Croix-Rouge-de-Wilberforce est une maison
rectangulaire simple, à ossature de bois, avec un toit à quatre versants
au sommet tronqué, et un porche ouvert qui protège l'entrée principale.
Ce dispensaire de la Croix-Rouge est peint en blanc et il occupe un
terrain d'une superficie d'un quart d'acre en retrait de la route,
comportant deux résidences privées. L'arrière de la propriété donne sur
le lac Dark.
La valeur patrimoniale de ce lieu, représenté par le bâtiment sur son
site, tient au fait qu'il fut le premier dispensaire de la division de
la Croix-rouge canadienne de l'Ontario à servir de centre de santé et
d'hôpital d'urgence pour le village et les régions voisines entre 1922
et 1957. Disposant d'un financement limité, la Croix-Rouge a loué une
maison existante qui pouvait loger une infirmière et abriter une salle
pour les soins d'urgence et les cours d'éducation sur la santé. Au fil
des années, le bâtiment et son terrain ont subi quelques modifications.
Il sert maintenant de musée d'interprétation des soins infirmiers en
régions éloignées.
Ici et ailleurs, des femmes dévouées ont concilié les activités
d'enseignement et de prévention et dispensé les soins infirmiers qui
faisaient cruellement défaut. Elles disposaient d'un soutien médical
minimal, d'infrastructures et d'équipement limités, voyageaient et
travaillaient souvent dans des conditions difficiles. Le programme des
dispensaires de la Croix-Rouge a servi de modèle aux programmes de santé
à l'extérieur du Canada, et il a facilité l'élaboration d'un système
national de soins de santé subventionné par le gouvernement.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Distillerie-Gooderham and Worts
Toronto, Ontario
Le complexe Gooderham and Worts comprend trente bâtiments industriels en
brique et en pierre, certains mitoyens entre eux, érigés sur treize
acres de terre à l'intersection des rues Trinity et Mill, à la limite
est du centre-ville de Toronto. Les bâtiments ont été construits entre
1859 et 1927 pour la production, l'emballage, l'entreposage, la mise en
marché et le développement des spiritueux de la firme Gooderham and
Worts.
Le comptexe Gooderham and Worts a été désigné lieu d'importance
historique et architecturale nationale parce qu'il forme un imposant
centre d'intérêt composé de bâtiments qui témoignent collectivement de
l'évolution de l'industrie de la distillerie au Canada.
La valeur patrimoniale du complexe Gooderham and Worts réside dans
l'exceptionnel sens de l'histoire et du lieu qui s'en dégage et qui
découle du caractère intégral du complexe, illustrant tout le processus
de distillerie, du traitement des matières premières à l'entreposage du
produit fini pour l'exportation; dans le témoignage matériel qu'il
fournit de l'histoire du commerce au Canada, de l'industrie de la
distillerie et des procédés de fabrication du XIXe siècle; dans la
cohésion architecturale du site, caractérisée par un degré remarquable
de conformité dans la conception, la construction et l'exécution des
bâtiments qui forment le complexe; et dans les liens physiques entre les
bâtiments et entre le lieu et la voie ferrée au sud.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |
Lieu historique national du Canada Earnscliffe
Ottawa, Ontario
Le lieu historique national du Canada Earnscliffe est l'ancienne
résidence du premier Premier ministre du Canada, Sir John A. Macdonald.
Cette villa du XIXe siècle construite en pierre locale est située au
milieu d'un parc paysager surplombant la rivière des Outaouais et
faisant face à la promenade Sussex qui fait partie du parcours
d'honneur. De style néo-gothique, elle est maintenant la résidence du
haut-commissaire britannique au Canada.
La valeur patrimoniale de ce lieu réside dans ses liens historiques avec
Sir John A. Macdonald, tels que l'attestent les éléments physiques
préservés de la propriété remontant à la période où il l'habitait. John
MacKinnon a construit cette maison de 1855 à 1857. Sir John A. Macdonald
l'a louée en 1870 et 1871, ainsi qu'en 1882, puis l'a achetée en 1883.
Il y a habité principalement lorsqu'il était Premier ministre du
Dominion du Canada, jusqu'à sa mort, en 1891. Par la suite, Earnscliffe
a été habitée par plusieurs propriétaires privés, jusqu'à ce que le
gouvernement du Royaume-Uni l'achète en 1930. Depuis, elle sert de
résidence au haut-commissaire de la Grande-Bretagne au Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Écluse-Ascenseur-de-Peterborough
Peterborough, Ontario
Le plus haut ascenseur hydraulique à bateaux au monde
(1896-1904).
Le lieu historique national du Canada de
l'Écluse-Ascenseur-de-Peterborough est situé sur la section de la
rivière Otonabee du canal Trent dans la ville de Peterborough, en
Ontario. Il est constitué d'un grand ouvrage en béton construit sur la
voie navigable Trent-Severn qui permet aux embarcations de franchir une
élévation de 19,8 mètres. L'écluse fonctionne selon le principe d'une
balance : lorsque le bac supérieur s'emplit d'un excédant d'eau, il
devient lourd et commence à descendre dès qu'on ouvre la vanne de
communication, déclenchant ainsi le cycle d'ascension du bac inférieur.
L'écluse-ascenseur fait encore partie du réseau du lieu historique
national du Canada de la Voie Navigable Trent—Severn, et elle est gérée
par Parcs Canada.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à ses caractéristiques
physiques préservées et au fait qu'elle est encore une merveille
technique reconnue tant à l'échelle nationale qu'internationale. À son
achèvement en 1904, elle était, avec sa dénivellation d'environ 20
mètres (65 pieds), la plus haute écluse-ascenseur hydraulique ainsi que
le plus grand ouvrage en béton non-armé au monde. Parmi les éléments de
sa construction mécanique, notons : les tranchées supérieures et
inférieures, et les digues, qui forment partie intégrante de sa
conception et de son exploitation.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, HRS, 2000 |
Lieu historique national du Canada de l'Édifice Ann Baillie
Kingston, Ontario
L'Édifice Ann Baillie est un bâtiment institutionnel de deux étages en
pierres calcaires au contour au sol cruciforme, orné d'un portique
monumental de style classique. Construit en 1903 pour servir de
résidence aux infirmières, il fait partie du complexe de l'Hôpital
général de Kingston situé à proximité de la rive du lac Ontario, dans la
ville de Kingston.
L'Édifice Ann Baillie a été désigné lieu historique national en 1997
parce qu'il atteste la contribution des infirmières et des sciences
infirmières à la médecine en tant que science. Il atteste également que
les infirmières sont un groupe de professionnelles de la santé, car il
rappelle la formation des infirmières et leur professionnalisme, leur
vie sociale, le développement de leur culture distincte et l'émergence
de chefs de file dans le domaine des soins infirmiers.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à ses liens avec la
professionnalisation des soins infirmiers en tant que carrière visée par
les femmes au début du XXe siècle, ainsi qu'aux caractéristiques
physiques de l'édifice qui attestent son utilisation par les étudiantes
en sciences infirmières. Construit en 1903 pour servir de résidence aux
étudiantes infirmières de la «Training School for Nurses» de l' Hôpital
général de Kingston, l'Édifice Ann Baillie a été une des premières
résidences d'infirmières construites au Canada.
Les écoles en milieu hospitalier offraient un programme de formation en
apprentissage aux étudiantes infirmières qui faisaient également partie
du personnel de l'hôpital. Il fallait donc des résidences pour loger ces
étudiantes dans un environnement sécuritaire et supervisé.
L'architecture d'inspiration classique de l'Édifice Ann Baillie est
typique des premières résidences d'infirmières, dont l'architecture
impressionnante et les quartiers sécuritaires visaient à attirer vers
cette profession des jeunes filles respectables issues de la classe
moyenne. Bien que l'édifice ne serve plus de résidence, de nombreux
vestiges attestent sa vocation d'origine. Il abrite maintenant le
«Museum of Health Care» et fait également partie du lieu historique
national du Canada de l'Hôpital général de Kingston.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, B Morin, 1993. |
Lieu historique national du Canada de l'Édifice-Birkbeck
Toronto, Ontario
L'édifice Birkbeck est un immeuble à bureaux de quatre étages situé au
centre ville de Toronto, en Ontario. Il se démarque à cause de son
architecture d'inspiration classique, sa conception grandiose, la
richesse de ses matériaux de construction et l'éclectisme de sa
décoration sculpturale. En érigeant cet édifice, on a voulu créer un air
de permanence ordonnée et de prospérité. Sa structure en acier et ses
matériaux de finition ignifugés le plaçaient à l'époque à l'avant-garde
de la technologie.
L'édifice Birkbeck a été désigné lieu historique national du Canada car
il constitue un bel exemple représentatif d'immeuble de transition
combinant un style historique avec une technologie moderne.
L'édifice Birkbeck, avec ses riches ornements de style baroque d'Édouard
VII, sa composition classique, son ossature d'acier et ses surfaces
ignifugées, illustre une période de transition dans la conception
commerciale urbaine qui combinait le style historique avec la
technologie moderne. Cet immeuble à bureaux de quatre étages, bâti en
1908 pour The Canadian Birkbeck Investment and Savings Company, est
typique des nombreuses petites institutions financières qui abondaient
dans les quartiers d'affaires centraux des villes canadiennes avant la
Première guerre mondiale. Cet édifice, construit par George W. Gouinlock
a été restauré en 1987 par la Fondation du patrimoine ontarien qui
l'utilise pour ses bureaux.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, M. Trepanier, 2002 |
Lieu historique national du Canada de l'Édifice-Central
Ottawa, Ontario
Le lieu historique national du Canada de l'Édifice Central est un
splendide immeuble de six étages, conçu pour abriter des établissements
commerciaux au rez-de-chaussée, et une combinaison de locaux commerciaux
et de bureaux aux étages supérieurs. Les deux premiers étages forment
une base arquée sur laquelle reposent trois étages de fenêtres en baie,
surmontés d'un étage de fenêtres palladiennes encastrées dans des
frontons décoratifs. Le parement de la façade est en briques rouges et
en tuiles décoratives, et les cadres des nombreuses baies sont en métal.
Le lieu historique national du Canada de l'Édifice Central a été désigné
lieu historique national parce qu'il constitue un excellent exemple de
l'architecture commerciale de style néo-Queen Anne.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de
l'Édifice Central a trait à sa conception architecturale exceptionnelle
ainsi qu'à ses particularités physiques qui reflètent les principes du
style néo-Queen Anne dont s'inspiraient les édifices commerciaux.
L'immeuble a été construit de 1890 à 1893 selon les plans de J.J.
Browne, un architecte d'Ottawa. Son emplacement, bien en vue, en fait un
des éléments importants du LHNC de la Place de la Confédération.
|
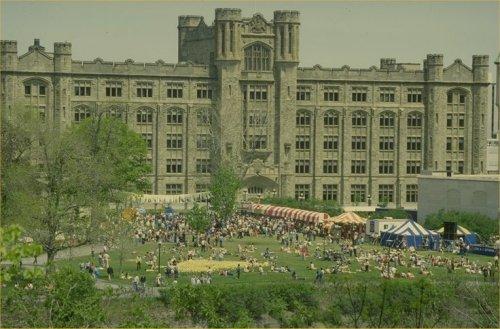
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |
Lieu historique national du Canada de l'Édifice Connaught
Ottawa, Ontario
L'Édifice Connaught est un grand bâtiment administratif à plusieurs
étages, de style gothique Tudor. Il est situé au centre-ville d'Ottawa,
en face du parc Major's Hill, de la colline du Parlement et de l'hôtel
Château Laurier.
L'Édifice Connaught a été désigné lieu historique national en 1990 parce
qu'il concrétise l'engagement de Sir Wilfrid Laurier de rehausser
l'architecture de la capitale nationale.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à son style architectural, à
sa conception, à ses matériaux et à son emplacement. À titre de Premier
ministre, Sir Wilfrid Laurier souhaitait transformer Ottawa en une
capitale nationale plus avenante, grâce à un programme fédéral de
construction dirigé par David Ewart, architecte en chef du ministère des
Travaux publics (1897-1914). Le style gothique Tudor a été modifié par
Ewart pour donner une identité fédérale à la capitale du Canada. Ce
style cadrait avec celui des édifices de la colline du Parlement, et on
considérait qu'il convenait à une capitale associée à l'Empire
britannique. L'Édifice Connaught figure parmi les chefs-d'œuvre d'Ewart
où le style gothique Tudor se combine avec les principes du style
Beaux-Arts. En outre, il s'agit du dernier édifice d'un groupe de
bâtiments fédéraux importants conçus par Ewart dans la capitale avant la
Première Guerre mondiale. Initialement, il a servi de nouvel entrepôt de
vérification des douanes à Ottawa, et il abritait les bureaux du
ministère des Douanes et du Revenu intérieur. On l'a baptisé d'après Son
Altesse Royale le duc de Connaught qui a été Gouverneur général du
Canada de 1911 à 1916.
|

©Library and Archives Canada / Bibliothèque et Archives Canada, PA-57417, 1927 |
Lieu historique national du Canada de l'Édifice-de-la-Douane de Kingston
Kingston, Ontario
Le lieu historique national du Canada de l'Édifice-de-la-Douane de
Kingston est un bel édifice néoclassique de deux étages, en pierre
calcaire, construit entre 1856 et 1859 par la Province du Canada. Situé
au centre de Kingston, il partage un pâté de maisons avec l'ancien
bureau de poste de Kingston et une écurie en pierre calcaire, associée à
deux édifices publics. Il fait partie, tout près, d'un ensemble
d'édifices commerciaux et publics du XIXe siècle, comprenant l'Hôtel de
ville.
L'Édifice de la douane de Kingston a été désigné lieu historique
national du Canada en 1971 parce qu'il est un bel exemple de
l'architecture d'édifices administratifs du milieu du XIXe siècle conçus
selon la tradition classique de la Grande-Bretagne.
L'Édifice de la douane de Kingston a été conçu en 1856 selon le style
britannique néoclassique, pour la Province du Canada, par le bureau
d'architectes montréalais Hopkins, Lawford et Nelson, en complément au
bureau de poste adjacent, construit en même temps. L'Édifice de la
douane présente avec harmonie un mélange d'éléments architecturaux
néoclassiques et Renaissance dans un rendu en pierre calcaire de
Kingston pour faire ressortir l'importance de la fonction de Kingston et
refléter la place vitale que tient cette ville dans le Canada
pré-confédératif.
Par l'utilisation habile et frappante d'éléments néoclassiques et son
emplacement judicieux dans une enceinte administrative, l'Édifice de la
douane de Kingston est aussi une belle illustration des principaux
édifices administratifs de l'époque, dont la conception avait pour but
de créer un sentiment de fierté et de respect à l'égard du gouvernement
dans la Province du Canada en pleine croissance.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Édifice-Langevin
Ottawa, Ontario
Le lieu historique national du Canada de l'Édifice-Langevin, se trouve
dans le lieu historique national du Canada de la
Place-de-la-Confédération, situé sur la rue Wellington au centre-ville
d'Ottawa, en Ontario. Placé bien en vue en face du lieu historique
national du Canada de la Colline-du-Parlement, il est l'un des plus
beaux exemples d'immeuble à bureaux de style Second Empire construit par
l'administration fédérale. D'apparence robuste, cet édifice de quatre
étages présente une volumétrie de pavillon, des façades en calcaire, des
fenêtres ceintrées et un toit a la Mansart en cuivre, complété par un
riche vocabulaire décoratif. L'édifice doit sa notoriété au fait qu'il
abrite les bureaux du Cabinet du Premier ministre et du Bureau du
Conseil privé.
L'Édifice Langevin, construit de 1883 à 1889, est un des plus beaux
exemples préservés des œuvres de Thomas Fuller, architecte en chef du
ministère des Travaux publics de 1881 à 1896. Pendant cette période,
Fuller a supervisé la construction de plus de 140 immeubles partout au
Canada, et il a conçu dans plusieurs petits centres urbains des édifices
qui symbolisent la présence du gouvernement fédéral. L'Édifice Langevin,
par sa conception et sa construction, atteste l'attention particulière
que Fuller prêtait aux détails architecturaux et sa volonté de
construire un ensemble d'immeubles fédéraux qui se démarquent par
l'excellence de leurs matériaux et de leur qualité d'exécution.
L'Édifice Langevin a été le premier édifice fédéral à vocation
ministérielle à ne pas être érigé sur la colline du Parlement. Les
premiers locaux de l'Édifice du Centre et deux édifices ministériels de
la colline du Parlement ont été conçus pour abriter les locaux de la
Province unifiée du Canada (aujourd'hui l'Ontario et le Québec) destinés
à des fins législatives et publiques. Après la Confédération en 1867, le
nombre de députés, de sénateurs et de membres du personnel de bureau
avait beaucoup augmenté. En outre, suite au transfert des Territoires du
Nord-Ouest au Dominion récemment formé, en 1870, le département de
l'Intérieur et le ministère des Affaires indiennes ont vu leurs tailles
et responsabilités s'accroître. Dès 1880, le manque de locaux à bureaux
sur la colline du Parlement était devenu un problème important pour les
parlementaires et les fonctionnaires. Il fut ainsi décidé en 1883 de
construire un nouvel édifice (l'Édifice Langevin) sur un terrain acheté,
plutôt que d'agrandir l'Édifice de l'Ouest de la colline du Parlement.
Une fois l'immeuble terminé en 1889, il fut baptisé Sir Hector Langevin,
un des Pères de la Confédération et ministre des Travaux publics au
moment de sa construction. Initialement, on y logeait les bureaux des
ministères de l'Agriculture, de l'Intérieur, des Affaires indiennes, et
la Poste. L'Édifice Langevin abritera les bureaux du ministère des
Affaires indiennes jusqu'en 1965. De 1975 à 1977, il est rénové pour
accueillir les bureaux du Cabinet du Premier ministre et du Bureau du
Conseil privé.
L'Édifice Langevin est un exemple tardif de l'emploi du style Second
Empire dans les immeubles gouvernementaux. Il est coiffé d'un toit en
mansarde orné de lucarnes, et possède de nombreux éléments de style
néo-roman qui lui confèrent l'allure d'un bâtiment de style
nord-américain plutôt que français. Il est également un des rares
exemples préservés d'immeubles construits dans ce style par le ministère
des Travaux publics.
|
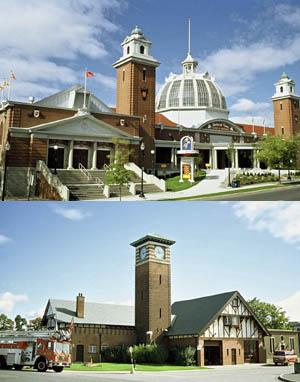
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, B. Morin, 1996 |
Lieu historique national du Canada de l'Édifices Gouinlock
Toronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada de l'Édifices Gouinlock est un
ensemble de cinq pavillons d'exposition permanents, construits à Toronto
au début du XXe siècle. Ils comprennent le Pavillon de la Presse (érigé
en 1904, sous le nom de Administrative Building), le Pavillon de la
Musique (érigé en 1907, et appelé successivement Railways Building,
Hydro Building et Career Building), le Pavillon de l'Horticulture
(1907), le Pavillon du Gouvernement (1912, connu aussi sous le nom de
Arts Crafts & Hobbies Building) et le Caserne des Pompiers et de la
Police (1912). Les quatre premiers édifices furent construits dans le
style Beaux-Arts baroque tandis que le Caserne des Pompiers et de la
Police se distingue par son style plus éclectique. Les édifices sont
regroupés en demi-cercle à l'extrémité ouest du parc de l'Exposition
nationale canadienne, à proximité du secteur riverain de Toronto. Ils
sont entourés de pavillons d'exposition plus récents, de tailles et de
styles variés.
Les édifices Gouinlock ont été désignés lieu historique national du
Canada en 1988 car ils forment le groupe le plus important de pavillons
d'exposition construits au Canada au début du XXe siècle.
Les édifices Gouinlock sont les seuls exemples qui témoignent encore
d'un ensemble de pavillons d'exposition conçus par l'architecte
torontois George W. Gouinlock, dans le cadre d'un plan complet pour la
Foire industrielle de Toronto. Érigés entre 1902 et 1912 dans le style
Beaux-Arts baroque, ils reflètent l'influence de l'exposition
internationale de Chicago de 1893, de par leur intégration ordonnée au
plan d'ensemble qui accordait une grande importance à l'entrée de chaque
édifice et aux interrelations physiques entre les bâtiments. Le Pavillon
de l'Horticulture (1907), entouré d'espaces paysagers aménagés de façon
attrayante à l'avant et à l'arrière de l'édifice, constituait le pôle
d'attraction du plan de Gouinlock. Le Pavillon du Gouvernement a été
construit pour accueillir les expositions du gouvernement fédéral. Le
Pavillon de la Presse, initialement appelé Administrative Building, a
été érigé pour imiter les édifices publics officiels de l'époque. Le
Pavillon de la Musique (1907), qui portait originellement le nom de
Railways Building, était le pavillon d'exposition des compagnies de
chemin de fer du Canadien Pacifique et du Grand Tronc.
Incité par le projet du gouvernement fédéral d'être le promoteur d'une
exposition importante sur le site en 1903, et inspiré par l'exposition
de Chicago, le Conseil municipal de Toronto a décidé de reconstruire le
site de l'exposition. La campagne de construction a transformé le site
connu sous le nom de Foire industrielle de Toronto qui regroupait des
bâtiments temporaires disposés de façon improvisée, en un ensemble
sophistiqué de pavillons d'exposition permanents de conception élaborée,
érigés dans un environnement paysager attrayant. Le projet de
construction reflétait l'évolution de la Foire de Toronto qui a cessé
d'être une foire municipale au XIXe siècle pour devenir une exposition
nationale représentant l'essor industriel, manufacturier et agricole du
pays. À la fin de la campagne de construction, la foire a pris
officiellement le nom d'Exposition nationale canadienne (Canadien
National Exhibition).
|

©Library and Archives Canada / Bibliothèque et Archives Canada, James L. Cotter, C-001719 |
Lieu historique national du Canada des Édifices-de-Moose Factory
Moose Factory, Ontario
Au moment de la désignation des édifices de Moose Factory en 1957, la
propriété se composait de plusieurs bâtiments parmi lesquels seule la
Maison du personnel se trouve toujours à son emplacement d'origine.
Construit en 1847-50, il s'agit du dernier établissement d'officiers de
poste de traite conservé au Canada et de la plus ancienne construction
de la baie James. La Poudrière, construite en 1865-66, est située à son
emplacement d'origine à quelque distance, dans ce qui est maintenant le
parc Centennial.
Créé en 1673, c'est le deuxième poste de la Compagnie de la Baie
d'Hudson érigé dans ce qui est maintenant le Canada. Il fut pris par les
Français sous Pierre de Troyes en 1686 et renommé fort St-Louis. Après
plusieurs changements de régime, il fut cédé à l'Angleterre en 1713 par
le traité d'Utrecht puis laissé à l'abandon jusqu'en 1730. Vers les
années 1770, il approvisionnait les postes intérieurs qui avaient été
construits pour faire concurrence à la Compagnie du Nord-Ouest. Après la
fusion des deux compagnies en 1821, Moose Factory devint le point de
ravitaillement pour des postes disséminés à l'intérieur du pays, même
aussi éloignés que le lac Témiscamingue sur les rives de la rivière des
Outaouais.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada

©Department of National Defence / Ministère de la Défense nationale, 1993 |
Lieu historique national du Canada des Édifices-de-Point-Frederick
Kingston, Ontario
Situés sur une péninsule à l'embouchure de la rivière Cataraqui à
Kingston, en Ontario, le lieu historique national du Canada des
Édifices-de-Point-Frederick consistent en un groupe de cinq structures
de maçonnerie, incluant Fort Frederick de même que les vestiges du mur
de pierres du chantier maritime. Quatre des bâtiments et le fort furent
érigés pour appuyer les activités de la Marine provinciale et de la
Marine royale; l'un d'entre eux, l'édifice Mackenzie, fut construit pour
répondre aux besoins du Collège royal militaire. Toutes ces structures
sont toujours utilisées par le Collège. Bien que modifiés jusqu'à un
certain point, au fil des ans, ces immeubles sont représentatifs de la
conception architecturale élégante mais sobre, de construction robuste
et du savoir-faire des artisans, caractéristiques de la meilleure
architecture militaire britannique.
Cette péninsule, chef-lieu de la Marine provinciale (1790-1813) et de la
Marine royale (1813-1853), constituait la plus importante base navale
britannique sur le lac Ontario durant la guerre de 1812. Les bâtiments
ayant survécu à cette période comprennent l'Hôpital naval, les immeubles
du poste de garde, et la Frégate de pierre. Le Fort Frederick, érigé en
1812-13, mais complètement reconstruit en 1846, se dresse à la pointe
sud de la péninsule. En 1875, la pointe a été choisie pour y établir le
Collège royal militaire du Canada qui accueillit sa première classe en
juin 1876.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Christine Boucher, 2022 |
Lieu historique national du Canada de l'arrondissement historique du Parc Rockcliffe
Ottawa, Ontario
L’arrondissement historique du Parc Rockcliffe est situé en territoire
traditionnel algonquin anishinaabe non cédé. Situé au nord-est du
centre-ville d’Ottawa, sur la rive sud de la rivière des Outaouais, cet
arrondissement possède une superficie estimée à 1,77 km2. Il est conçu
et aménagé dès 1864 par Thomas Coltrin Keefer à partir du vaste domaine
de Thomas MacKay acquis dans les années 1830. Il se distingue par ses
routes étroites et curvilignes sans bordure ni trottoir, ses vastes
terrains et jardins, et ses maisons implantées au centre d’un paysage
verdoyant, ce qui en fait un excellent exemple des traditions
pittoresques anglaises et américaines d’aménagement des banlieues de la
fin du XIXe siècle. Son architecture diversifiée et de grande qualité
est l’œuvre de plusieurs architectes de renom, tels qu’Allan Keefer,
Werner Noffke, A. J. Hazelgrove, Hart Massey et A. J. Ames. Ils prônent
l’utilisation de styles variés comme le Tudor, le Géorgien et le Queen
Anne, de matériaux naturels durables et de qualité, ainsi qu’une
intégration au site qui respecte l’ambiance rurale d’origine du village
du Parc Rockcliffe.
Le Parc Rockcliffe représente un site important pour l’histoire
autochtone. Les artefacts trouvés le long de la rivière des Outaouais
indiquent que des gens issus de nombreuses nations autochtones sont
passés par ce carrefour, lequel faisait partie d’un vaste réseau et
voies de communication menant à plusieurs régions d’Amérique du Nord.
Plus spécifiquement, les environs de Rockcliffe étaient connus pour être
le territoire de chasse du chef Constant Pinesi (décédé en 1834), grand
chef du peuple Algonquin Anishinaabe. Le Parc Rockcliffe se trouve sur
une ancienne route de portage qui offrait un raccourci autour des chutes
Rideau entre la rivière Rideau et la rivière des Outaouais.
Depuis 1864, le Parc Rockcliffe a été et demeure une communauté
résidentielle composée majoritairement de maisons unifamiliales.
Planifié comme un quartier purement résidentiel dans le but de loger les
futurs fonctionnaires venant s’établir à Ottawa, devenue capitale du
nouveau Dominion du Canada en 1867, l’arrondissement du Parc Rockcliffe
continue d’offrir un environnement propice à la plupart des corps
diplomatiques d’Ottawa. D’autres utilisations du sol, comme
l’aménagement de logements à forte densité de même que l’implantation de
commerces et d’industries ont toujours été exclus de cette collectivité.
Les seuls bâtiments institutionnels du Village sont trois écoles ainsi
qu’un centre communautaire et une bibliothèque combinés. Notons la
présence de la maison Hart Massey, construite en 1959 sur Lansdowne Road
North, exemple emblématique de l’architecture moderne résidentielle de
la moitié du milieu de XXe siècle au Canada. Les résidences privées
d’importance nationale telles que Stornoway, la résidence du chef de
l’opposition, ainsi que plusieurs ambassades parsèment le quartier.
Mentionnons la présence du lac McKay, anciennement connu sous le nom du
lac Hemlock ainsi que d’un petit étang adjacent formé à partir d’une
carrière, lesquels se trouvent dans la section est du village. Les parcs
et les espaces verts occupent une place très importante dans le village,
notamment les Jardins du jubilé et le Village Green ainsi que l’aire de
conservation Caldwell-Carver bordant le lac. Fusionné avec la nouvelle
ville d’Ottawa en 2001, le Parc Rockcliffe possède un haut degré
d’intégrité et présente toujours de nombreux éléments clés associés à sa
conception d’origine.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1999 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-African Methodist Episcopal Nazre
Amherstburg, Ontario
Le lieu historique national du Canada de l'Église African Methodist
Episcopal Nazrey est une simple chapelle en pierre de champ qui fait à
présent partie du complexe du North American Black Historical Museum à
Amherstburg, en Ontario. Symbole de l'expression remarquable de la
détermination des réfugiés, arrivés par le chemin de fer clandestin, qui
se sont installés dans cette région, l'église a été restaurée afin d'y
célébrer des cérémonies religieuses spéciales et, pour ce qui est de son
mandat de musée, pour y présenter l'histoire de la communauté noire.
En 1848, des réfugiés qui avaient fui l'esclavage américain ont
construit de leurs mains cette église pour la jeune communauté noire
d'Amherstburg. La forme simple du pavillon de l'auditorium est typique
de nombreuses églises construites par les communautés issues du chemin
de fer clandestin au Canada.
L'église doit son nom à l'évêque Nazery, qui dirigeait de nombreuses
congrégations, y compris celle-ci, de la conférence de la African
Methodist Episcopal Church basée aux États-Unis à la nouvelle British
Methodist Episcopal Church basée au Canada. Elle a gardé sa dénomination
jusqu'à la fin du XXe siècle, époque où de nombreuses congrégations en
déclin se sont regroupées et ont rejoint la African Methodist Episcopal
Church. Elle est à présent gérée dans le cadre du North American Black
Historical Museum.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Owen Thomas, 1999 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-African Methodist Episcopal-d'Oro
Edgar, Ontario
Le lieu historique national du Canada de l'Église-African Methodist
Episcopal-d'Oro est une église humble en billots de bois, accompagnée
d'un cimetière sans monuments, située au coin sud-est de l'intersection
de la ligne 3 de Oro-Medonte et la route secondaire 10/11, communément
appelé Old Barrie Road, à Edgar, dans le comté de Simcoe, en Ontario. Il
est préservé car il a été le lieu d'un ancien établissement
afro-canadien, associé aux miliciens noirs de la Guerre de 1812.
L'église épiscopale méthodiste africaine d'Oro à été construite par des
Afro-Canadiens. L' établissement Oro Noir était une approche unique de
l'intégration des Afro-Canadiens dans une communauté agricole. C'est Sir
Guy Carleton, commandant en chef des forces britanniques en Amérique du
Nord, qui en 1783 a eu l'idée d'une communauté afro-canadienne. Pendant
la révolution américaine, Carleton avait promis que les esclaves des
non-loyalistes qui s'enrôleraient dans l'armée britannique
retrouveraient leur liberté et ne redeviendraient jamais plus esclaves.
Non seulement des soldats noirs ont-ils combattu avec les forces
britanniques pendant la révolution américaine, mais ils ont aussi
constitué le «Coloured Corps», une unité particulièrement fiable de la
milice du Haut-Canada pendant la Guerre de 1812. De 1819 à 1826, les
Britanniques ont accordé 25 lotissements du comté d'Oro aux colons
noirs. Onze d'entre eux étaient d'anciens soldats qui recevaient ces
lots en reconnaissance de services qu'ils avaient rendus à l'armée. Même
si la région revêtait une importance stratégique, la terre était
éloignée et pauvre sur le plan agricole. Seulement neuf des
récipiendaires initiaux de ces lotissements l'ont accepté. Ils se sont
installés dans une zone située le long de la route Penatanguishine,
connue sous le nom de rue Wilberforce. De 1829 à 1831, trente nouvelles
familles sont venues se joindre à cet établissement. Ces colons ont
construit l'église d'Oro en 1847 et elle est restée en activité jusqu'au
tournant du siècle, époque à laquelle cette communauté s'est dissoute
d'elle-même. En 1916, l'Église épiscopale méthodiste britannique a
déclaré l'édifice abandonné. En 1947, puis en 1956, et encore en 1981
après des actes de vandalisme, des résidants locaux se sont regroupés
pour préserver le bâtiment.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de
l'Église-African Methodist Episcopal-d'Oro a trait à ses liens
historiques, attestés par la forme et la composition de l'édifice, et
par l'état de conservation du cimetière qui subsiste, ainsi que leur
emplacement et leur cadre.
|

©Ontario Ministry of Culture / Ministère de la Culture de l'Ontario |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. Anne
Toronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. Anne est
situé dans un quartier résidentiel du centre de Toronto (Ontario).
L'église anglicane St. Anne, construite en 1907-1908 dans le style
néo-byzantin, contient une remarquable collection de tableaux de dix
artistes canadiens de renom. Les décorations murales intérieures
élaborées, réalisées par J.E.H. MacDonald, couvrent les murs et le
plafond de l'abside, les voûtes principales, les pendentifs et le dôme
central. La collection comprend des scènes narratives, des textes
écrits, ainsi que des plâtres décoratifs et des détails qui accentuent
les lignes architecturales de l'édifice.
En 1923, après avoir accepté de peindre et de décorer l'église anglicane
St. Anne, J.E.H. MacDonald a fait venir neuf autres artistes, dont deux
autres membres du Groupe des Sept, Fred Varley et Frank Carmichael,
ainsi qu'un architecte, William Rae, qui a coordonné la décoration
intérieure. Pour rester en harmonie avec le plan de l'édifice, MacDonald
s'est inspiré des motifs, des couleurs et des traditions artistiques de
l'art byzantin, et a adapté ces traditions pour refléter le cadre
canadien contemporain.
Lawrence Skey, recteur de 1902 à 1933, véritable moteur de ce projet,
fut directement impliqué quant à la décision originale de construire
dans le style byzantin. Ceci illustre son soutien à un mouvement
œcuménique qui prônait l'unification avec les autres confessions
protestantes. L'architecte W. Ford Howland cherchait à évoquer la
première période byzantine, avant que l'Église chrétienne ne se scinde
en ses nombreuses confessions. W. Ford Howland était un associé de Burke
et Horwood, cabinet d'architectes de Toronto connu pour ses réalisations
de temples protestants. L'art et l'architecture de l'église anglicane
St. Anne illustrent une période particulière de l'histoire de l'Église
anglicane.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. Jude
Brantford, Ontario
Le lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. Jude,
petite église construite en 1871 dans une interprétation modeste du
style néogothique de la grande époque victorienne, est situé dans la
ville de Brantford (Ontario), dans le parc Alexandra, à l'est du
centre-ville. L'église se distingue par son intérieur remarquable, peint
en 1936, qui comporte une série de peintures murales et de motifs
décoratifs influencés par le mouvement Arts and Crafts et inspirés par
les œuvres de William Morris, fondateur du mouvement.
L'intérieur peint de l'église est un exemple des principes du mouvement
Arts and Crafts, y compris l'intégration de l'art dans l'architecture
pour créer un ensemble harmonieux et humaniste, l'artisanat élevé à un
rang plus élevé que le travail accompli par des machines et l'intérêt
pour la nature.
La décoration de l'église comprend des feuillages naturalistes en
à-plat, entrelacés avec des détails gothiques qui imitent plus le
travail de William Morris que n'importe quel autre exemple
ecclésiastique canadien connu. Le style des peintures murales, inspiré
des œuvres préraphaélites de la fin du XIXe siècle associées à William
Morris, reprend l'imagerie biblique imprimée en vogue au début du XXe
siècle. Conformément à l'approche du mouvement Arts and Crafts, les
peintures murales représentent des éléments paysagers, des effets
pittoresques paisibles et un éclairage doux et romantique. Les peintures
murales et les décorations peintes mettent en valeur les
caractéristiques architecturales d'inspiration médiévale de l'intérieur
de l'église qui les rehaussent à leur tour.
Trois générations de la famille Browne ont décoré plus de 450 intérieurs
d'église en Ontario, y compris l'église anglicane St. Jude. Peter
Charles Browne, peintre décoratif qui a étudié en Écosse, à l'apogée du
mouvement Arts and Crafts britannique, a créé la société familiale en
1905, après avoir immigré en Ontario. Le volume du travail exécuté par
la famille Browne dépasse celui de toute autre société ou artiste connu
dans le même domaine au Canada. Le programme de décoration de l'église
anglicane St. Jude a probablement été exécuté par Thomas Browne, fils de
Peter, selon les directives de son père.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Église-British Methodist Episcopal R. Nathaniel Dett
Niagara Falls, Ontario
Le lieu historique national du Canada de l'Église-British Methodist
Episcopal R. Nathaniel Dett est une petite église à charpente en bois
située dans un quartier résidentiel, proche du quartier commercial de la
ville de Niagara Falls en Ontario. Ce bâtiment à un seul étage se
distingue par son toit à pignon, sa façade à trois baies et ses
ouvertures régulièrement disposées. Son mur pignon se distingue par une
fenêtre à quarte-feuilles au-dessus d'un portique d'entrée simple,
flanqué de fenêtres en ogive. La salle de réunion, d'un étage avec une
forme ouverte et en forme rectangulaire, témoigne de la grande
implication de sa congrégation afro-canadienne.
La valeur patrimoniale du lieu tient à son emplacement, à sa forme et
aux matériaux de l'édifice ainsi qu'à son utilisation continue par la
communauté afro-canadienne. Emblème important de la communauté, cette
chapelle a été construite en 1836 sur la rue Murray, dans le quartier de
Fallsview, puis elle a été déplacée sur des rondins en bas de la
colline, dans le quartier actuel de Drummonville, moins humide et moins
venteux, avant d'être dressée sur une parcelle offerte par Oliver
Parnall, ancien esclave réfugié. La congrégation existait depuis
l'arrivée des Loyalistes après la révolution américaine et elle a
continué de se développer avec l'arrivée des réfugiés noirs fuyant
l'esclavage aux États-Unis. L'église a été rebaptisée en 1983 en hommage
à Nathaniel Dett (1882 — 1943), paroissien devenu musicien de renommée
internationale et compositeur de musique sacrée nord-américaine.
L'importance de la musique pour la communauté noire allait bien au-delà
des frontières de cette communauté, parce que la musique était souvent
un des seuls moyens d'interaction entre Blancs et Noirs. La musique
présentait un attrait particulier capable de mettre fin temporairement
aux divisions raciales, comme en témoignent les carrières respectives de
R. Nathaniel Dett et de Portia White. L'église abrite maintenant la
Norval Johnson Heritage Library, qui rassemble des documents sur
l'histoire de la communauté locale.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Cousineau |
lieu historique national du Canada de l'Église-de-la-First Baptist Church-d'Amherstburg
Amherstburg, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la
Première-Église-Baptiste-d'Amherstburg est situé dans une rue
résidentielle de la ville d'Amherstburg, dans le sud-ouest de l'Ontario.
Construite sur un petit terrain plat, cette église en bois de taille
modeste est coiffée d'un toit à deux versants, compte des fenêtres en
ogive, un vestibule muni d'un toit à deux versants et une rallonge à
l'arrière. Érigée en 1848-1849, elle est représentative des églises de
type auditorium construites par les colons noirs au cours de cette
période de colonisation. Sa taille modeste est en harmonie avec le parc
de logement du quartier.
La première église baptiste est construite en 1848-1849. Dès sa
création, l'institution est associée à l'évasion des esclaves et, plus
tard, au chemin de fer clandestin. Elle joue également le rôle d'Église
mère de l'Amherstburg Regular Missionary Baptist Association, l'une des
organisations noires les plus importantes du Canada-Ouest (qui deviendra
plus tard l'Ontario). La première église baptiste contribue grandement à
la création et au développement d'une tradition baptiste au sein de la
population noire de l'Ontario. Manifestation concrète des pratiques et
des croyances des premiers baptistes noirs qui se sont installés dans la
région, elle est la partie visible de ce que certains historiens
appellent l'« institution invisible », c'est-à-dire l'Église noire en
Amérique du Nord au temps de l'esclavage.
La première église baptiste est construite principalement par les
membres de la congrégation baptiste, après une collecte de fonds de
quatre ans. Anthony Binga, pasteur et aîné charismatique, constate la
nécessité de construire un bâtiment voué au culte pour accueillir sa
congrégation sans cesse croissante. Le quartier, établi dans les années
1830 et 1840, à l'époque de la construction de l'église, est un quartier
mixte qui compte une importante population de personnes noires récemment
établies. Nombre d'entre elles sont des réfugiés de l'esclavage aux
États-Unis, dont les plus récents empruntent souvent le chemin de fer
clandestin. Fondé dans les derniers rangs d'Amherstburg, le quartier est
le plus éloigné de la rivière Detroit. Son emplacement a peut-être été
influencé par la peur des chasseurs d'esclaves des États-Unis. Le
bâtiment de taille modeste à masse simple est typique des églises
construites par les colons noirs et d'autres groupes de protestants.
L'église a été conçue afin que tous les membres de la congrégation
puissent voir et entendre le pasteur. L'intérieur simple et dépouillé en
forme d'auditorium est typique des églises construites par les
communautés liées au chemin de fer clandestin au Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Église-de-la-First Baptist Church-de-Sandwich
Windsor, Ontario
Le lieu historique national du Canada de l'Église-de-la-First Baptist
Church-de-Sandwich est une église pittoresque en brique, située dans
l'ancienne ville frontalière de Sandwich, maintenant intégrée à Windsor
en Ontario. Elle est une petite église en brique avec un toit à pignon
située près de la rue, montrant les qualités vernaculaires de
simplicité, d'échelle faible et d'embellissement décoratif limité
caractéristiques aux églises du style « grand hall acoustique »
construites par les communautés des réfugiés du « chemin de fer »
clandestin au Haut-Canada au milieu du XIXe siècle.
Initialement associé avec l'établissement, pendant le XIXe siècle, d'une
communauté afro-canadienne des réfugiés qui arriveront du « chemin de
fer » clandestin, l'église de la First Baptist Church de Sandwich est
une des plus anciennes églises baptistes de cette époque en Ontario.
Étant donné que cette communauté noire était établie près de la
frontière américaine, elle était le centre de nombreuses activités
anti-esclavagistes, souvent organisées par l'entremise de l'Amherstburg
Regular Missionary Baptist Association.
Cette église a été bâtie sur un terrain donné par la Couronne en 1851.
La congrégation exigeait de tous ses membres qu'ils contribuent à sa
construction, soit en faisant des dons, soit en fabriquant des briques
avec les matériaux locaux. Au fil des ans, l'édifice a été embelli, et
on lui a notamment ajouté une tour d'entrée crénelée. La valeur
patrimoniale du l'Église de la First Baptist Church de Sandwich a trait
à ses liens historiques, illustrés par la localisation, la composition
et les matériaux du bâtiment.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Butterill, 1994 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Presbytérienne-St. Paul / Ancienne-Église-St. Andrew
Hamilton, Ontario
Lieu historique national du Canada de l'Église-Presbytérienne-St. Paul /
Ancienne-Église-St. Andrew est une élégante église en pierre agrémentée
d'une flèche en pierre élancée. Construite au milieu du XIXe siècle
selon le style néo-gothique, elle est située en plein centre-ville de
Hamilton.
L'église presbytérienne St. Paul / ancienne église St. Andrew, qui a été
construite entre 1854 et 1857 pour la congrégation anglicane de St.
Andrew, est un bel exemple du style néo-gothique appliqué à une petite
église paroissiale urbaine. Conçue par l'architecte William Thomas, elle
reflète l'influence du mouvement néo-gothique religieux, qui
privilégiait l'exactitude des plans historiques s'inspirant des églises
paroissiales anglaises de l'époque médiévale. L'église St. Paul's
illustre de nombreux principes du mouvement néo-gothique religieux dans
ses proportions, sa composition et ses détails décoratifs simples,
historiquement précis. Le chœur a été agrandi par l'architecte Hugh
Vallance vers la fin du XIXe siècle.
|
|
Lieu historique national du Canada des épaves de la guerre de 1812
Kingston, Ontario
Les HMS Prince Regent, HMS Princess Charlotte et HMS
St. Lawrence furent les plus puissants navires de guerre
britanniques construits au Haut-Canada pendant la Guerre de 1812. Le HMS
St. Lawrence, tout particulièrement, fut le plus imposant navire
de guerre et le plus lourdement armé à n'avoir jamais navigué en eau
douce. La seule apparition de ces navires sur les eaux du lac Ontario
permit aux Britanniques de prendre le contrôle du lac sans qu'un seul
coup de feu soit tiré.
La construction navale commence dès que les forces de la Marine royale
britannique prennent le contrôle de la base navale de Kingston à l'hiver
1812-1813, et c'est le commodore James Lucas Yeo qui dirige les
opérations à partir de mai 1813. La Marine se procure les matériaux
disponibles et met à contribution les compétences et la main-d'œuvre
nécessaires tant en Amérique du Nord britannique qu'en Grande-Bretagne
afin de construire rapidement des navires adaptés aux conditions du lac.
Entre 1813 et 1817, les chantiers navals de Kingston produisent au moins
une dizaine de navires, dont les HMS Prince Regent, HMS
Princess Charlotte et HMS St. Lawrence, tous mis à l'eau
en 1814.
La stratégie du commodore Yeo repose sur le maintien de la supériorité
navale, tant par le nombre de navires que la puissance de feu. On
recrute des constructeurs de navires chevronnés à Québec, et des
centaines de menuisiers et d'ouvriers travaillent d'arrache-pied à
Kingston pour contrer la production de leurs homologues de Sackets
Harbor, de l'autre côté du lac. Les poutres d'orme et de chêne sont
achetées dans la région, alors que les canons et autres pièces
d'équipement doivent traverser l'océan Atlantique avant d'être
transportés par paquebot et par portage le long du fleuve Saint-Laurent.
Les trois navires britanniques sont montés sur une coque en V prononcée
pour les rendre plus rapides sur l'eau et munis de canons en nombre
suffisant pour leur assurer une puissance de feu maximale. Les HMS
Princess Charlotte et HMS Prince Regent, armés
respectivement de 40 et 58 canons, sont mis en service en avril 1814. Le
HMS St. Lawrence est également livré en septembre de la même
année. Il est alors, avec ses 102 canons, le plus imposant navire de
guerre à naviguer sur le lac, ce qui permet aux Britanniques de
reprendre l'avantage.
Une fois la guerre terminée, la plupart des navires de l'escadron du lac
Ontario n'ont plus leur raison d'être compte tenu des conditions de
désarmement prévues dans l'Accord Rush-Bagot de 1817, et ces trois
navires finissent par couler. Les épaves du HMS Prince Regent, du
HMS Princess Charlotte et du HMS St. Lawrence, ainsi que
la collection d'objets provenant de ces navires, témoignent de la
présence de la flotte britannique à Kingston et nous permettent de mieux
comprendre cette course aux armements entre Américains et Britanniques,
ainsi que son rôle dans l'issue de la guerre.
|

©Heritage Conservation Program / Programme de Conservation du Patrimoniaux, J. Latremouille, 2002 |
Lieu historique national du Canada de l'Établissement-Buxton
Chatham-Kent, Ontario
Le lieu historique national du Canada de l'Établissement-Buxton est un
paysage culturel de quelque 4 680 hectares. Il s'agit d'un paysage
principalement agricole, formé de champs plats labourés, définis par des
fossés de drainage profonds et un quadrillage de routes. Les propriétés
familiales rurales sont réparties d'un bout à l'autre de
l'établissement, y compris les deux hameaux, Buxton Nord et Buxton Sud,
qui comprennent aussi des institutions religieuses, éducatives et
culturelles importantes liées à la fondation de l'établissement par les
réfugiés du Chemin de fer clandestin.
Ce lieu a une valeur patrimoniale parce qu'il est une illustration de
l'établissement par îlots des réfugiés du Chemin de fer clandestin,
grâce à la survivance des modèles d'utilisation de la terre et du
patrimoine bâti.
D'abord fondé sous le nom d'Établissement Elgin, en Ontario,
l'Établissement Buxton est aujourd'hui un paysage culturel distinct, qui
continue à fonctionner comme communauté tout en préservant les éléments
toujours présents de son histoire. L'Établissement Buxton a été fondé en
1849 par un ministre presbytérien irlandais, le révérend William King,
et 15 anciens esclaves qui ont acheté, avec d'autres abolitionnistes et
réfugiés du Chemin de fer clandestin, et en tant que société par
actions, une étendue de terres de 4 680 hectares. Les colons ont
défriché la terre et établi des fermes sur des parcelles de 50 acres
(202 342 mètre carrés) qu'ils ont achetées au fil du temps. En 1859,
l'Établissement avait atteint un sommet démographique avec une
population de plus de 1 000 personnes recevant les services de trois
écoles intégrées, de deux hôtels prônant la sobriété, d'un magasin
général, d'un bureau de poste, d'une scierie, d'une briqueterie, d'un
moulin à blé et d'une usine de potasse. Ses objectifs atteints, la
société a été dissoute en 1873 mais la communauté a survécu.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |
Lieu historique national du Canada Fairfield-sur-la-Thames
Chatham-Kent, Ontario
Le lieu historique national du Canada Fairfield-sur-la-Thames est situé
sur la rive nord de la rivière Thames dans le canton de Zone, entre
Thamesville et Bothwell, en Ontario. À l'origine, le village de
Fairfield, dont il ne reste plus rien, était situé sur la rive nord de
la rivière. Il est fondé en 1792, par une communauté de réfugiés
autochtones et de missionnaires moraves de l'Ohio. Le lieu comprend un
grand terrain sur lequel se trouvent un cimetière, le musée de Fairfield
ainsi qu'une plaque et un cairn érigés en 1948 par la Commission des
lieux et monuments historiques du Canada.
Le village de Fairfield est fondé en 1792 par des réfugiés autochtones
et des missionnaires moraves qui se déplaçaient de l'Ohio vers le
Canada. Ils fuyaient la persécution, dont ils étaient victimes aux
États-Unis parce qu'ils refusaient de prendre parti, durant la
révolution américaine. Les missionnaires moraves faisaient partie d'une
secte germanophone, connue sous le nom de la « Church of the Brethren »,
laquelle avait été fondée au début des années 1700, en Europe orientale.
Leur établissement dans le Haut Canada, nommé Fairfield, se trouvait sur
la rive nord de la rivière Thames et a été décrit comme la première
mission protestante de l'Ontario. Le peuple Delaware était le groupe
autochtone le mieux représenté de la communauté, bien que des membres
d'autres nations aient aussi été présents. Le cimetière Hat Hill,
associé à la mission Fairfield, est établi la même semaine que le
village.
Le village de Fairfield sur la Thames a existé pendant 21 ans, soit
jusqu'à la guerre de 1812. Le 5 octobre 1813, pendant la bataille de la
Thames, aussi appelée la bataille du village morave puisqu'elle s'est
déroulée tout près, les forces britanniques et leurs alliés autochtones
sont battus par les Américains. Après cette bataille, ces derniers ont
accusé les habitants pacifistes de Fairfield de cacher des officiers
anglais. Bien que les Américains n'aient trouvé aucune preuve confirmant
cette allégation, ils pillent et incendient après avoir permis aux
résidents de fuire les lieux. Par la suite, le village est reconstruit
sur l'autre rive de la rivière Thames.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1995

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1995

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Ferme-Expérimentale-Centrale
Ottawa, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la
Ferme-Expérimentale-Centrale, situé dans une banlieue d'Ottawa, en
Ontario, comprend diverses structures et différents bâtiments dans un
vaste paysage rural. Flanqué de grandes terres agricoles, son noyau
central est constitué de services administratifs regroupés dans divers
bâtiments éclectiques et pittoresques, d'un arboretum, de plantations,
et de jardins paysagers.
En 1886, dans sa volonté de créer de nouvelles méthodes et de nouveaux
produits agricoles rentables, le gouvernement fédéral crée la Ferme
expérimentale centrale. Le ministère de l'Agriculture choisit une
parcelle rectangulaire de plus de 400 hectares, située à environ 3
kilomètres de la Colline du Parlement. Située dans un endroit idéal en
raison de ses différents sols et de sa proximité aux transports
terrestre, maritime et ferroviaire, la ferme dessert l'Ontario et le
Québec. Ottawa s'est graduellement étalé de sorte que la ferme se trouve
maintenant dans un milieu urbain, à l'intérieur des limites de la ville.
La ferme comporte trois zones clairement définies : le noyau central des
bâtiments et espaces à vocation administrative et scientifique et des
dépendances; les champs et parcelles expérimentaux avec leurs
brise-vent; l'arboretum, les jardins paysagers et les haies
expérimentales. Le paysage pittoresque de la ferme est le résultat d'un
mouvement popularisé par des théoriciens et des praticiens anglais du
XVIIIe siècle qui voulaient idéaliser la nature dans leurs aménagements
paysagers. Une des conventions de ce mouvement préconise l'adoption de
certaines caractéristiques des domaines ruraux anglais, y compris les
vastes pelouses et les champs, les plans d'eau, les bosquets d'arbres et
d'arbustes, et les sentiers sinueux. Ces éléments visent à mettre en
valeur les qualités visuelles inhérentes de la nature, comme les
irrégularités, la diversité, la complexité des formes, des couleurs et
des textures et privilégient l'intégration harmonieuse des dépendances
ainsi que des bâtiments à vocation scientifique et administrative. Les
qualités pittoresques de la ferme représentent un aspect important de la
philosophie de l'agriculture au XIXe siècle.
Cette philosophie recommandait aussi le recours à la chimie et à la
génétique pour rendre la vie agricole plus productive et attrayante. Ses
partisans voulaient élaborer de meilleures méthodes agricoles en
appliquant des principes scientifiques à l'agriculture. Depuis sa
création, la ferme expérimentale centrale a joué un rôle clé dans le
développement de l'agriculture au Canada grâce à ses travaux de
recherche scientifique, d'expérimentation et de vérification pratique.
La Ferme a abordé des questions comme la santé humaine et animale,
l'importation de plantes et de bétail, l'identification des insectes
ravageurs importés et la lutte contre ces derniers, de même que la
fertilité du sol. La ferme a également contribué à l'expansion de
l'agriculture dans l'Ouest canadien en mettant au point des souches
rustiques de blé, et dans l'Est canadien, en faisant des recherches sur
les plantes fourragères et les graminées. La ferme est rapidement
devenue le noyau d'un réseau national de fermes expérimentales, en
raison de son emplacement central et de son administration mis au
service d'un vaste éventail d'enjeux agricoles nationaux.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national du Canada de la Ferme-Thistle Ha'
Claremont, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Ferme-Thistle Ha' est une
entreprise agricole comprenant 80 hectares de terre et des bâtiments de
ferme comme une grande maison de pierre, une imposante étable de bois et
divers bâtiments de service. Elle se trouve dans la municipalité de
Pickering, au nord du lac Ontario et légèrement au nord-est de Toronto.
La ferme Thistle Ha' fut désignée lieu historique national du Canada en
raison de ses associations historiques avec John Miller; un pionnier, un
importateur, et un éleveur du bétail de race au Canada. L'exemple de
John Miller a joué un rôle clé dans l'amélioration des races de bétail
en Amérique du Nord et du Sud au cours du 19e siècle.
La valeur patrimoniale du site réside dans sa représentativité d'une
ferme du 19e siècle, tel qu'illustré par ses champs agricoles et ses
principaux bâtiments, dont la maison de pierre et l'imposante étable de
bois. La ferme Thistle Ha' fut fondée lorsque l'immigrant écossais John
Miller en fit l'acquisition en 1848. En 1852, il commença à importer du
bétail de qualité, notamment des bovins Durham, des moutons Shropshire
et des chevaux Clydesdale, du Royaume-Uni. Depuis, sa famille poursuit
les activités d'élevage de la ferme familiale.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, CIHB - (HRS 898) |
Lieu historique national du Canada de la Filature-Forbes
Cambridge, Ontario
A été pendant quelque temps, au cours des premières décennies du xxe
siècle, la plus grande usine de filature cardée et peignée au Canada;
construit en 1863.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national du Canada de la Filature-de-Laine-Rosamond
Almonte, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Filature-de-Laine-Rosamond
est situé sur Coleman Island, juste à côté des chutes inférieures de la
rivière Mississippi, dans la ville d'Almonte, en Ontario. La structure
principale de la filature est un vaste édifice en pierre de six étages,
surmonté d'un toit plat, qui se caractérise par une tour-escalier et des
fenêtres régulièrement espacées. Il s'élève à côté d'une annexe de deux
étages qui abritait l'entrepôt et les bureaux et qui témoigne encore
d'un groupe de structures auxiliaires aujourd'hui disparues. En 1987, on
a entrepris de transformer la filature en condominiums à usage
d'habitation et, en 1991, le Mississippi Valley Textile Museum a ouvert
ses portes dans le bâtiment de deux étages qui abritait autrefois
l'entrepôt et les bureaux de la filature.
Construite en 1866, la filature de laine Rosamond produisait des étoffes
de laine cardée de qualité. Les filatures formaient un secteur
manufacturier important au Canada entre 1840 et 1870. Elles étaient
construites le long de la vallée du Mississippi où la force hydraulique,
la main d'œuvre et l'approvisionnement en laine étaient abondants. James
Rosamond a construit des filatures à Carleton Place et Almonte dans les
années 1840 et 1850. Ses fils, Bennett et James, ont construit la grande
filature d'Almonte en 1866, en partenariat avec George Stephen de
Montréal. L'expansion de la filature s'est poursuivie jusqu'au début du
XXe siècle. La filature a été un complexe industriel en exploitation
jusqu'en 1986.
|
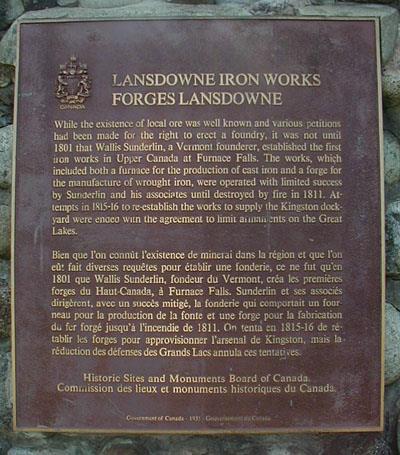
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2004 |
Lieu historique national du Canada des Forges-de-Lansdowne
Leeds and the Thousand Islands, Ontario
Le lieu historique national du Canada des Forges-de-Landsowne est une
fonderie située sur la rive est de la rivière Gananoque, dans le village
de Lyndhurst (Ontario), tout juste en aval des chutes. Parmi les
quelques vestiges apparents des forges, on compte des sections
partielles de ses fondations et des fragments de scories dispersés. Il
s'agit d'un site archéologique sur lequel se trouvent les vestiges d'une
fonderie, d'une scierie et d'installations connexes construites par
Wallis Sunderlin en 1801. Les forges de Lansdowne sont les premières à
être bâties dans le Haut-Canada. La Commission des lieux et monuments
historiques du Canada a installé une plaque et érigé un cairn pour
marquer l'endroit.
La valeur patrimoniale des forges de Lansdowne réside dans ses liens
historiques avec l'industrie du fer dans le Haut-Canada. À l'époque, la
présence de minerai de fer dans la région est connue et diverses
requêtes sont présentées au gouvernement en vue de l'établissement d'une
fonderie, mais ce n'est qu'en 1801 que Wallis Sunderlin, un fondeur du
Vermont, construit les premières forges du Haut-Canada à la chute au
Fourneau. Le site présente des avantages aux yeux de Sunderlin, compte
tenu de la chute naturelle de 7,3 mètres (la chute au Fourneau) sur la
rivière Ganonoque et de l'abondance de minerai dans la région. L'usine
comprend une scierie, un fourneau muni d'une cuve haute de 7,62 mètres,
et une structure entourant la cuve et une forge. Le fourneau sert à la
production de fonte et la forge à la fabrication d'articles en fer
destinés aux colons de la région. L'usine exploitée par Sunderlin et ses
associés connaît un succès mitigé avant d'être détruite par le feu en
1811. Sunderlin meurt durant la guerre de 1812. En 1815-1816, on tente
de rétablir les forges pour approvisionner l'arsenal de Kingston, mais
l'entente visant à limiter l'armement dans les Grands Lacs fait échouer
ces tentatives. Les ruines de briques visibles sur le site de nos jours
sont celles du moulin à farine Harvey, qui a été construit après l'usine
(en 1881).
|
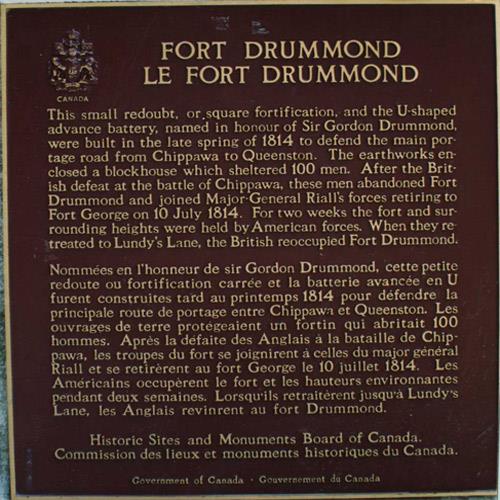
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989. |
Lieu historique national du Canada Fort-Drummond
Kingston, Ontario
Le lieu historique national du Canada Fort-Drummond est situé dans un
parc non loin du monument Brock à Queenston, en Ontario. Le fort,
construit durant la guerre de 1812 pour protéger la route de portage qui
contournait les chutes Niagara, comprenait à l'origine deux redoutes
carrées tombées en ruine après les hostilités. En 1926, les ruines ont
été annexées au parc, aujourd'hui appelé lieu historique national du
Canada des Hauteurs-de-Queenston.
Érigé au printemps de 1814, sur les hauteurs de Queenston, le fort
Drummond devait protéger la route de portage qui contourne les chutes
Niagara et permet de se rendre de Chippawa à Queenston. Il est composé
d'une redoute carrée comprenant un blockhaus pouvant accueillir 100
hommes, et d'une batterie avancée en forme de « U ». Après la guerre, le
poste est abandonné et tombe en ruines. Grâce à la création de la
Commission des parcs du Niagara, les deux redoutes sont intégrées au
parc des hauteurs de Queenston. En 1926, une pataugeoire est aménagée
dans la redoute ouest, à l'endroit où se trouvaient autrefois les
casernes, et demeure en usage.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national du Canada Fort-Erie
Fort Erie, Ontario
Le lieu historique national du Canada Fort-Erie est une fortification en
pierre pentagonale situé à un endroit stratégique, c'est-à-dire au bord
du lac Érié, à l'embouchure de la rivière Niagara à Fort Erie, en
Ontario. Aménagée sur un terrain plat à proximité de la rivière, la
structure actuelle est le quatrième fort construit sous le nom de fort
Érié sur le même emplacement. Le fort comprend divers bâtiments, dont un
corps de garde, des casernes et une poudrière, auxquels s'ajoutent des
ressources archéologiques et des éléments reconstruits.
La valeur patrimoniale du fort Érié tient à ses associations historiques
et aux vestiges archéologiques de ses anciennes fortifications. Quatre
forts différents, ayant porté le nom de fort Érié, ont été construits
sur ce site. Le premier (1764 —1799) et le deuxième (vers 1783 1803)
fort furent abandonnés après leur destruction par la crue des eaux du
printemps 1779. Le troisième fort Érié, érigé par les Britanniques entre
1805 et 1808, est reconstruit en janvier 1814, mais est pris par des
troupes américaines en juillet de la même année. Les Américains
utilisèrent le fort comme base opérationnelle et s'y sont réfugies après
avoir perdu la bataille de Lundy's Lane. Ils ont ensuite résisté à un
siège tenu par le général britannique Gordon Drummond, avant de détruire
et d'abandonner le fort le 5 novembre 1814. Le fort demeura alors en
ruines, bien que les terres avoisinantes soient loties et que des
pensionnaires militaires et d'autres colons s'y soient installés. En
1901, la propriété a été cédée à la Commission des parcs du Niagara qui,
entre 1937 et 1939, a restauré le fort pour lui redonner l'aspect qu'il
avait en 1814. Aujourd'hui, la Commission des parcs du Niagara continue
d'exploiter le fort Érié.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Butterill, 1995 |
Lieu historique national du Canada Fort-Frontenac
Kingston, Ontario
Le lieu historique national du Canada Fort-Frontenac est un site
archéologique situé sous l'intersection des rues Ontario et Place
d'Armes à Kingston, en Ontario. Le site s'étend sous quatre bâtiments de
pierre, construits dans les années 1820 pour former une partie des
anciens casernements de la Tête du Pont, sur la portion sud du terrain
autrefois occupé par le fort français. Ces quatre bâtiments font partie
d'un ensemble appelé fort Frontenac, dont les seuls éléments visibles de
nos jours sont des tronçons des courtines ouest et nord en calcaire sur
un carrefour, à l'intersection des rues Ontario et Place d'Armes.
Situé au confluent de la rivière Cataraqui et du lac Ontario, le fort
Frontenac est érigé en 1673 par le gouverneur de la Nouvelle France, le
comte de Frontenac, qui veut contrôler l'accès aux territoires riches en
fourrures du bassin des Grands Lacs et du Bouclier canadien. Alors que
le commerce des fourrures s'étend vers l'ouest le long des Grands Lacs
et au cœur des vallées du Mississippi et de l'Ohio, l'explorateur René
Robert Cavelier de La Salle reconstruit le fort, auparavant en bois, et
en fait un bâtiment en maçonnerie plus solide avec des murs de calcaire
et des bastions carrés. Le fort devient ainsi un solide poste avancé des
Français dans les conflits les opposant aux Anglais et aux Iroquois
puisqu'il est entouré de plusieurs bâtiments plus petits ainsi que d'une
petite colonie française. En 1682, pendant l'une des longues
explorations de La Salle vers l'intérieur des terres, le fort tombe aux
mains de créanciers qui négligent son entretien et, en 1689, les
Français en ordonnent la destruction après une attaque des Iroquois.
Toutefois, en 1695, le comte de Frontenac donne l'ordre de reconstruire
le fort, qui sera occupé jusqu'en 1745 par une petite garnison. En 1758,
le colonel John Bradstreet prend possession du fort, qui restera aux
mains des Britanniques jusqu'à la fin de la guerre de 1812. Devenu
vétuste, le fort est graduellement démoli. En 1982, les recherches
archéologiques ont mises à jour plusieurs tronçons des vieux murs de
calcaire érigés par La Salle, notamment des courtines nord et ouest,
encore visibles de nos jours.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, B. Morin, 1995

©CPS, ORO, 1989 |
Lieu historique national du Canada du Fort-George
Niagara-on-the-Lake, Ontario
Fort britannique de la guerre de 1812; ouvrage reconstruit; guerre de
1812.
Le lieu historique national du Canada du Fort-George est un fort
militaire du XVIIIe siècle en grande partie reconstitué qui se trouve
sur la rive ouest de la rivière Niagara, près de l'embouchure. Il est
situé sur les vestiges du premier fort George détruit en grande partie
pendant la guerre de 1812.
La valeur patrimoniale du fort George réside dans les vestiges d'une
ancienne fortification britannique du XVIIIe siècle intégrés à son
paysage culturel et dans les traces de l'histoire dont ces vestiges
témoignent, notamment ceux qui sont associés à la guerre de 1812, à la
bataille du fort George, à l'occupation du fort par les Britanniques et
les Américains et à sa destruction en mai 1813. Dans les années 1930, le
fort George a été reconstruit selon les plans originaux, ce qui a donné
lieu au réaménagement de la plupart de ses remblais et à la construction
de plusieurs bâtiments sur la superficie au sol occupée par le premier
fort.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Butterill, 1995 |
Lieu historique national du Canada du Fort-Henry
Kingston, Ontario
Fort britannique destiné à défendre le canal Rideau; achevé en
1836.
Le lieu historique national du Canada du Fort-Henry, forteresse
militaire britannique datant du XIXe siècle, est situé sur Point Henry,
entre l'entrée du port de Kingston et un deuxième port naturel à
l'embouchure de la rivière Cataraqui. Il se dresse sur une falaise
naturelle à la confluence de l'extrémité orientale du lac Ontario et du
début du fleuve Saint-Laurent.
La construction de Fort Henry par l'Armée britannique a commencé en
1832, et, en 1840, l'ajout des tours dans les fossés et des casemates de
l'intendance lui a conféré la configuration actuelle. Le fort a abrité
des unités de l'Armée britannique jusqu'en 1870, et ensuite les Forces
canadiennes. Fort Henry n'a jamais été le théâtre d'opérations
militaires, mais des combattants capturés au cours des rébellions de
1837-1838 et des deux Premières Guerres mondiales y ont été emprisonnés.
Il a été restauré au XXe siècle et il est ouvert au public pour des
visites interprétatives. D'abord classé lieu historique national du
Canada en 1923, il a aussi été classé en 1989 comme faisant partie du
lieu historique national du Canada des Fortifications-de-Kingston.
La valeur patrimoniale du lieu tient surtout aux vestiges de la masse, à
la forme et à la structure du fort, y compris sa batterie avancée, sa
redoute et son glacis, ainsi que ses proportions et sa
destination.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Fort-Malden
Amherstburg, Ontario
Ouvrage de défense frontalier du XIXe siècle; guerre de 1812.
Le lieu historique national du Canada du Fort-Malden s'étend sur un
vaste terrain aménagé caractérisé par des remblais, une caserne en
brique et une structure d'inspiration classique à vocation domestique;
ils sont situés sur la berge de la rivière Détroit, en face de l'île
Bois Blanc, à Amherstburg (Ontario).
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du
Fort-Malden réside dans l'association des ressources culturelles qui
subsistent au rôle militaire du fort aux XVIIIe et XIXe siècles. Le fort
est entouré d'un fossé profond bordé de pieux et d'un parapet en terre
surélevé doté de bastions et de pièces d'artillerie montées qui aident à
définir le terrain de parade de l'enceinte. La caserne en brique
construite en 1820 est le seul bâtiment du fort qui subsiste. Établi en
1796, le fort Malden a été construit sous le nom de fort Amherstburg par
le 2e bataillon des Royal Canadian Volunteers entre 1797 et 1799. Il a
été renforcé en 1812, puis évacué et incendié par les Britanniques en
septembre 1813. Les Américains l'ont partiellement reconstruit en 1815.
Après la guerre de 1812, le fort Malden a été remis aux Britanniques et
a été réaménagé en 1837-1838 pour servir de poste frontalier.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Fort-Mississauga
Niagara-on-the-Lake, Ontario
Tour fortifiée en brique sur des ouvrages en terre en forme d'étoile,
XIXe siècle; guerre de 1812.
Le fort Mississauga est une grosse tour défensive carrée en brique,
située au milieu des vestiges d'ouvrages de terre défensifs, au bord de
la rivière Niagara. Du côté des terres, le fort est entouré des « verts
» du terrain de golf aménagé dans l'agglomération de
Niagara-on-the-Lake.
La valeur patrimoniale du fort Mississauga réside dans son illustration
d'un type de structure militaire rare, occupant une position
stratégique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |
Lieu historique national du Canada du Fort-Norfolk
Norfolk County, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Fort-Norfolk est situé à
l'entrée du terrain de golf dans parc provincial de Turkey Point, et est
borné par le côté est d'Old Hill Road, près du lac Érié. Le site
présente des éléments paysagers et des feuillages variés, et est entouré
par les vastes étendues gazonnées du terrain de golf adjacent. À ce
jour, aucun vestige du Fort-Norfolk n'a été découvert; le lieu a
toutefois fait l'objet de plusieurs projets de recherches archivistiques
depuis sa désignation.
En 1795, le lieutenant-gouverneur John Graves Simcoe a choisi Turkey
Point pour y construire un fort et d'une station navale. Pendant la
guerre de 1812, l'endroit a revêtu une importance stratégique au profit
des Britanniques qui, sous les ordres du général Henry Procter, ont
construit un blockhaus et une palissade partielle sur la pente qui
domine la Turkey Point. De 1814 à 1815, le fort-Norfolk a servi de poste
militaire et naval pour les Britanniques, mais le projet a été abandonné
à la fin des hostilités. En 1826, le fort était dans un état de
détérioration tel, que les installations navales et militaires ont été
déplacées au nord-est de Grand River.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |
Lieu historique national du Canada Fort-Sainte-Marie-II
Christian Island, Ontario
Le lieu historique national du Canada Fort-Sainte-Marie-II est situé à
l'intérieur des limites de la réserve de la bande Beausoleil sur la rive
sud de Christian Island, dans la baie Georgienne, en Ontario. Le site
comprend une clairière bordée d'arbres, quelques maisons contemporaines,
un grand fossé, ainsi que le rivage de la baie Georgienne. Des murets de
pierre peu élevés, probablement un amoncellement de pierres érigé au 20e
siècle, délimitent le sol du fort carré et ses bastions d'angle.
L'endroit compte également une large fosse d'enfouissement construite
par les Hurons, mais qui n'a jamais été utilisée. Au fil des ans, les
éléments, tels que l'érosion causée par la rivière, ont légèrement
modifiés le cadre d'origine.
Fort Sainte-Marie II a été construit en 1649 à la suite de la
destruction d'une première mission, le lieu historique national du
Canada du Poste-de-Sainte-Marie-au-Pays-des-Hurons, situé sur la rivière
Wye. Le nouveau fort a été habité de juin 1649 à juin 1650 par des
missionnaires jésuites, des soldats français et des Hurons-Wendats qui
avaient fuit la mission de la rivière Wye à la suite des attaques des
bandes des Cinq-Nations qui cherchaient, avec les Hollandais, à couper
l'accès aux ressources de fourrures du nord des Hurons-Wendats.
Sur le nouveau site, les Français ont construit une petite place forte,
constituée d'un mur de pierre extérieur de style militaire d'une hauteur
de quatre mètres et entourée d'un fossé. Ces fortifications renfermaient
une église, des logements pour les missionnaires et un puits. Les
Hurons-Wendats vivaient dans un village tout près de la structure du
fort. Le site a été en partie abandonné en juin 1650 après un hiver
marqué par la famine, la maladie et les nouvelles menaces d'attaques de
la part des Iroquois. Les Jésuites, dirigés par le père Paul Ragueneau
et environ 300 Hurons-Wendats, se sont alors enfuis de Christian Island
en passant par le lac Nipissing et la vallée de la rivière des Outaouais
jusqu'à Québec. Le groupe s'est installé au nord de la ville de Québec,
à Lorette (Québec), sur ce qui est aujourd'hui le lieu historique
national du Canada de l'Arrondissement-Historique-du-Vieux-Wendake. Les
Hurons-Wendats demeurés sur place se sont installés dans le fort et, au
printemps suivant, ont affronté les Iroquois pour la dernière fois en
Huronie. Les survivants de ce groupe se sont ensuite enfuis et ont
rejoint les Jésuites et les autres Hurons-Wendats de la ville de
Québec.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J.P. Jérôme, 1994 |
Lieu historique national du Canada du Fort-St. Joseph
St. Joseph Island, Ontario
Avant-poste militaire britannique à la frontière occidentale; guerre de
1812.
Le lieu historique national du Canada du Fort-St. Joseph se compose des
vestiges de trois sites archéologiques, à savoir la pointe du vieux fort
St. Joseph, la pointe Rains et la pointe LaPointe, situés sur des
promontoires adjacents de l'île St. Joseph, pénétrant dans le lac Huron
au niveau de l'étroit passage qui le relie avec le lac Supérieur.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du Fort-St.
Joseph réside dans son emplacement et sa situation éloignée, ainsi qu'en
sa large collection de vestiges archéologiques datant de la période de
1796 à 1812. La pointe du vieux fort St. Joseph était un poste militaire
et un poste du British Indian Department. Il a été bâti de 1796 à 1799
par les britanniques, et évacué en 1812. La pointe Rains était
l'emplacement de Milford Haven, un établissement de colons britanniques
du XIXe siècle, tandis qu'un camp de chasse privé occupait la pointe
LaPointe, au XXe siècle. La tentative de construction d'une route vers
ce camp dans les années 1940 a endommagé la moitié est de la pointe du
vieux fort St. Joseph, ainsi que plusieurs structures de la pointe
Rains.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2008 |
Lieu historique national du Canada Fort St.-Pierre
Fort Frances, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Fort-Saint-Pierre est situé
dans la municipalité de Fort Frances, à 348 km à l'ouest de Thunder Bay,
en Ontario. Le lieu comprend une aire ouverte et gazonnée au parc
municipal Pither's Point, qui se trouve sur une pointe de terre à
l'extrémité sud-ouest du lac à la Pluie, à l'embouchure de la rivière à
la Pluie. Il n'existe plus de vestiges visibles du fort, qui a été érigé
en 1731, occupait un plan carré dont chaque côté mesurait un peu plus de
15 mètres, et comportait deux portes entourées d'une rangée double de
pieux d'une hauteur de 4 mètres. Un chemin d'une largeur d'environ 2
mètres entourait les deux principaux bâtiments du fort, qui comptaient
chacun deux pièces et des cheminées doubles. Deux bastions étaient
disposés de part et d'autre du fort, et l'un d'eux comprenait un
entrepôt et une poudrière.
En 1731, l'explorateur français La Vérendrye quitte Montréal avec 50
hommes, dont son fils aîné et son neveu, le sieur de Lajemmerais, et
prend la route vers l'ouest. Pendant que La Vérendrye passe l'hiver à
Kaministiquia, le sieur de Lajemmerais érige le fort Saint-Pierre à
l'extrémité sud-ouest du lac à la Pluie. Il s'agit du deuxième fort
français érigé au bord du lac à la Pluie, le premier étant le fort
Tekamanigan, construit en 1717 par Zacharie Robutel de La Noue et
abandonné en 1721. Le fort Saint-Pierre est destiné à servir à la traite
des fourrures au nord du lac Supérieur ainsi qu'à aider La Vérendrye à
poursuivre ses explorations vers l'ouest à la recherche de la « mer de
l'Ouest », une étendue d'eau hypothétique qui, croyait-on, permettrait
d'atteindre l'Extrême-Orient. Les Français abandonnent le fort
Saint-Pierre en 1758, durant la guerre de Sept Ans.
|
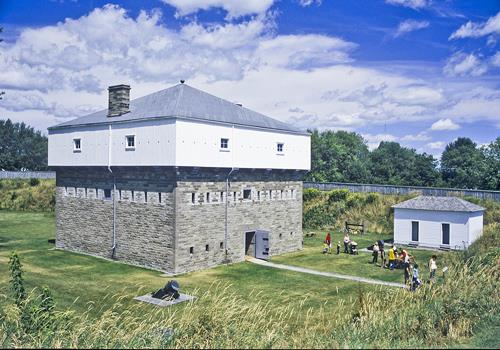
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Brian Morin, 2006 |
Lieu historique national du Canada du Fort-Wellington
Prescott, Ontario
Vestiges militaires de fortifications érigées entre 1813-1838; guerre de
1812.
Le lieu historique national du Canada du Fort-Wellington est une des
fortifications du XIXe siècle les mieux préservées du Canada. La
structure actuelle, qui date de 1838, a été bâtie sur l'emplacement d'un
fort plus ancien, sur la rive du fleuve Saint-Laurent, à Prescott, en
Ontario. Un blockhaus et le logement des officiers, construits sur une
élévation de terrain, dominent le fleuve.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du Fort
Wellington a trait à la lisibilité de son paysage culturel établi à
titre de forteresse du début du XIXe siècle, ainsi qu'à l'intégrité des
vestiges subsistants de ce paysage, datant de la période de 1813 à 1838,
qui illustrent son rôle historique.
Le fort Wellington a été construit en 1813 et 1814 par les lieutenants
colonels Thomas Pearson et George R.J. Macdonnell. Ce fort a joué un
rôle important pendant la Guerre de 1812, puis on lui a apporté des
améliorations qui lui ont permis de jouer un rôle, quoique plus limité,
lors de raids américains subséquents, et surtout ceux ayant suivi la
rébellion de 1837. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, il a servi de base à
la milice. Il est devenu un lieu historique national en 1925 et on l'a
restauré par la suite pour en faciliter la visite. De grandes sections
des terrains militaires associés au fort ont été séparées du site et
développées. Dans les années 1980, Parcs Canada a acheté des terrains
situés entre le fort et la rive, qui avaient été largement réaménagés
pour un usage ferroviaire (1855 à 1980).
|
|
Lieu historique national du Canada Fort-William
Thunder Bay, Ontario
Le Grand Portage étant passé en territoire américain en 1783, la
Companie du Nord-Ouest dut établir un autre entrepôt en territoire
britannique. En 1801 et 1802, elle construisit ici son nouveau poste,
qui prit le nom de William McGillivray, l'agent principal de la Companie
à Montéal. Chaque été de 1803 à 1821, les agents et les hivernants se
réunirent au fort William pour discuter d'affaires pendant que l'on
transbordait les fourrures du pays d'en haut et les marchandises
destinées aux postes du Nord-Ouest. Après 1821, sous la Companie de la
Baie d'Hudson, le fort William perdit peu à peu de son
importance.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national du Canada Fort-York
Toronto, Ontario
Le Fort York est situé au centre-ville de Toronto, en Ontario, près du
lac Ontario. Il s'agit d'un espace vert dégagé, niché au cœur d'un
quartier composé de tours d'habitation, ainsi que sept édifices
d'origine datant de la Guerre de 1812. Le terrain du fort et ses
environs contiennent le lieu de naissance de la ville, des vestiges du
paysage de la fin du XVIIIe siècle, une portion d'un champ de bataille
de 1813, des cimetières militaires, et de nombreuses ressources
archéologiques. Aujourd'hui, le fort est un musée qui présente la plus
importante collection d'édifices construits durant la Guerre de 1812 au
Canada.
La valeur patrimoniale de ce site a trait aux ressources qui lui sont
directement reliées, y compris les sept édifices construits durant la
Guerre de 1812 situés à l'intérieur du terrassement fortifié restauré,
le terrain de rassemblement dégagé à l'ouest, le cimetière militaire sur
l'avenue Strachan, et d'autres terrains séparés de la zone principale
par des routes surélevées.
Fort York, lieu de naissance de la ville moderne de Toronto, a été fondé
à la fin du XVIIIe siècle par John Graves Simcoe, lieutenant-gouverneur
du Haut-Canada. Il souhaitait que cet emplacement sûr, qui abritait une
garnison de soldats britanniques, attire des colons venant s'y établir
en permanence. Les envahisseurs américains ont brûlé le fort pendant la
Guerre de 1812, mais les Britanniques l'ont reconstruit pour y replacer
une garnison. En 1870, les forces canadiennes ont pris le relais des
Britanniques, et elles ont utilisé le fort jusqu'aux années 1930. De
1932 à 1934, la Ville de Toronto a restauré le fort pour en faire un
site historique. D'autres rénovations y ont été effectuées en 1949.
Le cimetière militaire, qui fait partie du Victoria Memorial Square et
qui est maintenant séparé du fort par des routes et un couloir
ferroviaire, a été fondé en 1794 pour y enterrer les soldats et les
membres de leur famille. Il a été utilisé jusqu'en 1863, date à laquelle
il a atteint sa pleine capacité de 500 sépultures. Peu de temps après,
le public s'est mobilisé pour le préserver à titre de cimetière et de
parc public. En 1905, on l'a rebaptisé « Victoria Memorial Square
».
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2007 |
Lieu historique national du Canada des Fortifications-de-Kingston
Kingston, Ontario
Protégeaient le chantier naval royal pendant la guerre de 1812; entrée
du canal Rideau.
Le lieu historique national du Canada des Fortifications-de-Kingston est
situé à l'intérieur et aux alentours de la zone portuaire de Kingston,
en Ontario. Érigées à l'embouchure de la rivière Cataraqui et
surplombant le confluent du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, les
fortifications consistent en un ensemble de cinq installations
militaires du XIXe siècle, notamment le lieu historique national du
Canada (LHNC) du Fort Henry, le Fort Frederick (qui fait partie du LHNC
des Édifices de la Pointe Frederick), le LHNC de la Tour Murney, le LHNC
de la Tour Shoal et la Tour Martello Cathcart. La concentration et
l'orientation vers l'eau de ces installations de calcaire, qui forment
un système de défense interdépendant, témoignent de leur fonction
essentielle de plateforme de défense pour canons. Les fortifications de
Kingston ont été construites entre 1832 et 1840, soit durant l'âge d'or
des canons à âme lisse.
La zone portuaire de Kingston, dont l'emplacement a toujours été
considéré comme stratégique, se trouve à l'embouchure de la rivière
Cataraqui, où se rencontrent les eaux du fleuve Saint Laurent et du lac
Ontario. Véritable porte d'entrée des Grands Lacs, le port représente
une plaque tournante du transport des marchandises, particulièrement
avant l'arrivée du chemin de fer. L'importance stratégique de l'endroit
est d'abord reconnue par les Français, qui y érigent une installation
militaire et un poste de traite en 1673. Capturée par les forces
britanniques en 1758, la zone portuaire de Kingston demeure occupée par
les militaires à partir de 1783, lorsqu'une garnison s'y installe. C'est
lorsque qu'éclate la guerre de 1812 que l'on entreprend la construction
des fortifications, qui ne comprennent alors qu'une série d'ouvrages de
défense rudimentaires construits à la hâte autour du port, comme les
blockhaus des pointes Henry, Frederick et Murney.
Après la guerre, Kingston devient un important centre commercial,
politique, naval et militaire de la colonie du Haut Canada. En 1832,
l'ouverture du canal Rideau, qui relie Kingston à Montréal, fait de la
ville un lieu d'échange de marchandises encore plus important. Afin de
protéger l'extrémité sud du canal, le gouvernement britannique décide de
fortifier le port en construisant le Fort Henry au sommet de la pointe
Henry. Conçu par les British Royal Engineers, le nouveau fort devient
l'élément central d'un système de défense composé de batteries et de
redoutes secondaires liées entre elles. La remise en état du Fort
Frederick et la construction des tours Martello Shoal, Murney et
Cathcart s'effectuent au milieu des années 1840. Ces fortifications, qui
s'ajoutent à l'ancienne batterie du marché, visent à renforcer le
système de défense de la ville, du canal et de l'arsenal. Alors conçues
selon les plus récents progrès en matière de canons à âme lisse, de
tactiques militaires et d'aménagement, les fortifications de Kingston
s'intègrent à leur environnement de par l'uniformité de leurs matériaux
de calcaire, et se démarquent de par leur construction adroite et leur
orientation et implantation comme plate forme de défense.
Lorsque la garnison britannique quitte Kingston en 1870, les
fortifications ne servent plus que d'installations de formation et
d'entreposage pour l'armée canadienne. Même si les fortifications ne
sont jamais attaquées, l'imposant système de défense qu'elles
représentent témoigne de l'importance historique et stratégique du
lieu.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |
Lieu historique national du Canada Frenchman's-Creek
Fort Erie, Ontario
Le lieu historique national du Canada Frenchman's-Creek est situé sur un
point au centre d'un pont enjambant le ruisseau Frenchman's, un affluent
de la rivière Niagara, situé près de Bridgeburg, en Ontario. Il est
marqué d'une plaque de la Commission des lieux et monuments historiques
du Canada. Il n'existe aucune ressource conservée connue liée à la
bataille qui s'est déroulée à cet endroit durant la guerre de 1812.
La bataille de Frenchman's Creek, un affrontement mineur, a eu lieu au
matin du 28 novembre 1812. Les Américains, qui avaient planifié une
attaque sur deux fronts (au ruisseau Frenchman's et au Fort Erie, se
préparaient à une invasion générale de la frontière du Niagara. Le
lieutenant colonel américain Charles Boerstler fût chargé d'attaquer les
soldats qui montaient la garde au ruisseau Frenchman's et de détruire le
pont qui enjambait le ruisseau, près de la rivière Niagara. Ces
manœuvres visaient à empêcher les renforcements britanniques de Chippawa
de perturber l'invasion principale, prévue au Fort Erie. Le
lieutenant-colonel Boerstler fût finalement repoussé par les forces du
lieutenant colonel Bisshopp et ne pu détruire le pont. Ces échecs ont
contribué, en partie, à l'annulation de l'invasion générale prévue à la
frontière du Niagara par les Américains à la fin de 1812.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Fulford Place
Brockville, Ontario
Situé le long de la rue King Est à Brockville, en Ontario, en surplomb
du fleuve Saint-Laurent, le lieu historique national du Canada Fulford
Place était la résidence de l'homme d'affaires et entrepreneur Albert W.
Fulford. La maison est une imposante structure de pierre, haute de deux
étages et demi, avec un toit en pente douce, une élévation asymétrique
et pittoresque et une riche finition intérieure. Avec son aménagement
d'origine, ce domaine constitue un exemple intact du type de résidence
construit par les bien nantis vers la fin du 19e siècle et le début du
20e siècle. L'aménagement spatial général du site conserve les éléments
structuraux paysagers tel que réalisés à l'origine par les frères
Olmsted, une entreprise américaine d'aménagement paysager.
La valeur patrimoniale de Fulford Place réside dans le fait que
l'endroit constitue un exemple particulièrement intéressant du type de
manoir que faisaient construire les bien nantis à la fin du 19e siècle
et au début du 20e siècle. Les résidences de ce type étaient assez
imposantes et conçues selon l'éclectisme stylistique de l'époque. La
conception est principalement de style Beaux-Arts dans sa symétrie
générale et ses détails classiques, avec des éléments du Renouveau
romanesque dans le traitement rustique de la maçonnerie. Les espaces
intérieurs offrent une suite de pièces publiques et privées ainsi que
d'importantes aires de service, typiques des manoirs de l'époque où on
recevait beaucoup et où le personnel était nombreux. La maison est
remarquable par le fait que la plupart de ses aménagements d'origine,
dont les meubles, la porcelaine, les tableaux, certains souvenirs de
famille, etc., s'y trouvent encore. De tels domaines présentent
également des aménagements paysagers importants dont une grande partie
des vestiges de l'aménagement d'origine par la firme des frères Olmsted
subsiste toujours.
|
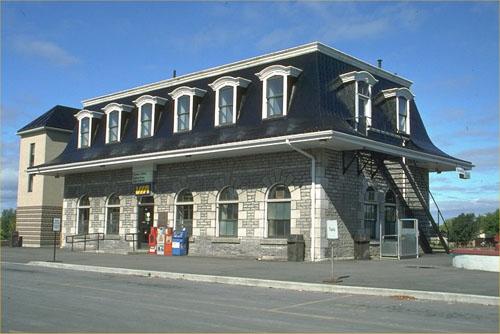
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1990 |
Lieu historique national du Canada de la Gare du Grand Tronc à Belleville
Belleville, Ontario
La gare ferroviaire de Belleville est un édifice en pierre d'un étage et
demi construit au milieu du 19e siècle. Elle est située dans la ville de
Belleville.
La gare ferroviaire de Belleville a été désignée lieu historique
national parce qu'elle est représentative des grandes gares construites
pour la Grand Trunk Railway Company (le Grand Tronc) et qu'elle est un
témoin durable des débuts du chemin de fer au Canada.
La gare ferroviaire de Belleville est un bel exemple des grandes gares
érigées au milieu du 19e siècle sur l'importante ligne Toronto-Montréal
pour le Grand Tronc, une compagnie alors nouvellement formée. Construite
en 1855-1856 par la réputée firme d'ingénierie anglaise Peto, Brassey,
Jackson and Betts, cette gare reprend en bonne part le plan standard des
gares de deuxième classe établi par l'architecte en chef Francis
Thompson pour le Grand Tronc. La structure d'origine à un seul étage, de
style à l'italienne, a été modifiée à la fin du 19e siècle par l'ajout
d'un toit en mansarde de style Second Empire.
Principal centre sectoriel de la ligne Montréal-Toronto du Grand Tronc,
la gare de Belleville était un élément important de ce réseau qui allait
transformer radicalement le transport terrestre et influer grandement
sur l'économie de la province. Le chemin de fer a permis l'essor de
Belleville au XIXe siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1990 |
Lieu historique national du Canada de la Gare-du-Grand-Tronc-à-Prescott
Prescott, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la
Gare-du-Grand-Tronc-à-Prescott est un petit bâtiment en pierre, situé à
côté des voies du CN, à la base d'un coteau à l'extrémité de la rue St.
Lawrence, à Prescott.
La valeur patrimoniale du lieu réside dans sa représentation matérielle
d'une gare standard de première classe du GTR ( « First Class A Type »),
sur la ligne Montréal-Brockville, au milieu du XIXe siècle.
La gare du Grand Tronc à Prescott a été construite en 1855, pendant la
première période de construction de la ligne du GTR entre Montréal et
Brockville (1852-1855). Conçue par l'architecte anglais Francis
Thompson, elle est représentative des petites gares construites pour la
nouvelle ligne.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1988 |
Lieu historique national du Canada de la Gare-du-Canadian Northern-à-Smiths Falls
Smiths Falls, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Gare-du-Canadian
Northern-à-Smiths Falls est situé à la périphérie ouest de Smiths Falls,
près de la rue William ouest. Cette gare de brique à la conception
personnalisée faisant penser au style château présente une tourelle
unique et une salle d'attente polygonale. Elle a servi de gare
ferroviaire de 1914 à 1979, puis, en 1983, elle est devenue le musée
ferroviaire de Smiths Falls.
La gare du Canadian Northern à Smiths Falls a été construite en
1912-1914 sur la nouvelle ligne Toronto-Ottawa de cette compagnie. Sa
conception personnalisée, sans doute œuvre de l'architecte de la
compagnie R.B. Pratt, concrétise la détermination de la compagnie de
rivaliser avec ses concurrentes dans le marché du Canada central pour
développer un réseau transcontinental.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la
Gare-du-Canadian Northern-à-Smiths Falls a trait à sa présence, qui
symbolise la détermination et les méthodes de cette compagnie, dans le
contexte ferroviaire très concurrentiel en Ontario au début du XXe
siècle. Cette valeur est illustrée par la conception personnalisée et la
forme imposante de la gare, sa composition, son emplacement et surtout
sa tourelle décorative unique, qui en font une curiosité locale.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |
Lieu historique national du Canada de la Gare-du-Grand-Tronc-à-St. Marys Junction
St. Marys Junction, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Gare-du-Grand-Tronc-à-St.
Marys Junction est un édifice de plain-pied, en pierre calcaire, qui
date du milieu du XIXe siècle. Il est bâti dans le style à l'italienne
typique des premières gares du Grand Tronc en Ontario. Le bâtiment est
situé dans un champ près d'une petite enclave urbaine au nord de la
ville de St. Marys, à côté de l'embranchement, où les lignes principales
du Canadien National venant de Toronto divergent pour traverser la
frontière canado-américaine à Windsor ou à Sarnia.
Le lieu historique national du Canada de la Gare-du-Grand-Tronc-à-St.
Marys Junction illustre le style à l'italienne d'une station de chemin
de fer de première classe conçue par l'architecte britannique Francis
Hopkins pour les gares des premières lignes du Grand Tronc. Cette
compagnie, qui allait de Sarnia (Ontario) jusqu'à Portland (Maine),
était la première ligne ferroviaire de longue distance construite au
Canada. Sa construction s'est faite par tronçons. Cette gare était
située sur le tronçon ouest de la ligne principale reliant Toronto à
Sarnia, commencé par Gzowski and Co. en 1856, et terminé en 1860. La
gare a été bâtie en pierre calcaire de la région de St. Marys en 1858.
En plus de servir de gare de marchandises et de passagers, la gare
contenait l'aiguillage manuel qui orientait les premiers trains
empruntant cette jonction.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la
Gare-du-Grand-Tronc-à-St. Marys Junction a trait à sa rareté, aussi bien
à titre de petite gare d'origine du Grand Tronc que de gare en pierre
sur le tronçon ouest de sa ligne principale. Le fait que sa conception,
ses dimensions, sa composition, ses matériaux, sa disposition et sa
localisation nous font clairement comprendre comment opérait le Grand
Tronc à ses débuts ajoute à cette valeur.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |
Lieu historique national du Canada de la Gare Union (Canadien Pacifique et Grand Tronc)
Toronto, Ontario
La gare Union est une gare de chemin de fer en pierre de style
Beaux-Arts, qui date du début du XXe siècle. Elle est située bien en vue
sur le côté sud de la rue Front, au centre ville de Toronto, et occupe
tout l'îlot entre les rues Bay et York.
La gare Union a été désignée comme lieu historique national en 1975
parce qu'elle est le plus bel exemple au Canada des gares construites
dans le style Beaux-Arts classique pendant une période caractérisée par
l'expansion des réseaux de chemin de fer nationaux et une forte
croissance urbaine.
L'utilisation efficace de la conception monumentale, les éléments
classiques et le décor formel font de la gare Union de Toronto l'un des
exemples d'architecture de chemin de fer du style Beaux-Arts les plus
remarquables au Canada. Entreprise conjointe du Grand Trunk Railway et
du Canadien Pacifique, la gare a été dessinée par une équipe
d'architectes bien en vue, soit les architectes montréalais Ross et
Macdonald, l'architecte du Canadien Pacifique, Hugh Jones, ainsi que
l'architecte torontois bien connu John Lyle. Les principes du style
Beaux-Arts ressortent clairement dans la monumentalité de sa masse, la
lisibilité et l'axialité de son plan, qui s'expriment clairement et
rationnellement sur l'extérieur de l'immeuble; l'expérience
processionnelle créée par le passage vers les grands espaces intérieurs;
les formes classiques des éléments structuraux et décoratifs de
l'extérieur et de l'intérieur du bâtiment; l'utilisation de matériaux
durables de haute qualité; et le cadre formel, axial.
La gare rappelle l'époque de forte croissance urbaine planifiée du début
du XXe siècle, au cours de laquelle les chemins de fer ont pris de
l'expansion et la ville de Toronto est devenue une métropole moderne. La
gare Union est la gare de chemin de fer urbaine la plus grande parmi
celles qui ont été construites au début du XXe siècle au Canada, et elle
appartient à un district d'édifices monumentaux qui illustrent la façon
dont s'est exprimé le mouvement City Beautiful à Toronto. La gare a
conservé un grand nombre des caractéristiques fonctionnelles originales
des gares de chemin de fer du début du XXe siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2002 |
Lieu historique national du Canada Glanmore / Maison-Phillips-Faulkner
Belleville, Ontario
Le lieu historique national du Canada Glanmore /
Maison-Phillips-Faulkner est une imposante maison en brique jaune de
trois étages du XIXe siècle, de style Second Empire. Elle est située sur
une grande parcelle d'angle dans un quartier résidentiel de la ville de
Belleville.
Conçue par l'architecte Thomas Hanley pour J.P.C Phillips, un riche
banquier et financier de Belleville et son épouse, Glanmore / maison
Phillips-Faulkner est un exemple classique du style Second Empire
répendu au sein de la classe moyenne supérieure canadienne de la fin du
XIXe siècle. Les éléments du style second Empire les plus remarquables
de la maison sont le toit en mansarde à pente unique et les riches
ornements sculptés le long de la façade. La maison est relativement bien
préservée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle sert maintenant de
maison-musée.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Glengarry-Landing
Springwater, Ontario
Le lieu historique national du Canada Glengarry-Landing est situé sur la
rive est de la rivière Nottawasaga, au sud d'Edenvale dans le comté de
Simcoe, en Ontario. Il s'agit d'un paysage semi-rural occupé, pendant la
guerre de 1812, par le Glengarry Light Infantry Fencibles qui y a
construit une flottille de navires en vue de secourir la garnison
britannique du fort Michilimackinac. Au moment de la désignation, le
lieu englobait des champs et des prés dégagés, où rien ne témoignait des
activités de l'expédition militaire de 1814. Aujourd'hui, le lieu est
divisé en plusieurs lots, et diverses structures et routes d'accès y ont
été construites.
En février 1814, pendant la guerre de 1812, le Glengarry Light Infantry
Fencibles, dirigé par le lieutenant colonel Robert McDouall, est envoyé
de Kingston, dans le but de prêter main forte, à la garnison du fort
Michilimackinac. En route, les troupes se sont arrêtées à la jonction de
la rivière Nottawasaga et de la crique Marl, où elles ont passé deux
mois à construire une flottille de navires en vue du transport des
fournitures et des soldats par le lac Huron, jusqu'au fort. Le 19 avril
1814, la flottille a quitté le lieu de débarquement pour se rendre au
fort Michilimackinac. Par la suite, McDouall divisa ses troupes et
envoya, au Wisconsin, un groupe dirigé par le major breveté William
McKay afin de recapturer Prairie du Chien sur la rivière Mississippi. Le
groupe a accompli cette mission avec succès en juillet 1814.
|

©National Geographic, 82-1874, 1982 |
Lieu historique national du Canada Hamilton et Scourge
Lake Ontario, Ontario
Le lieu historique national du Canada Hamilton et Scourge est situé au
fond du lac Ontario à 11 kilomètres au nord de Port Dalhousie, près de
St. Catharines. Le lieu comprend les épaves des deux cannonières
américaines, le Hamilton et le Scourge, qui ont coulé pendant la guerre
de 1812. Les navires sont dans un état de conservation remarquable,
malgré les dommages causés par le naufrage et les années passées au fond
du lac. Un important champ de débris entoure chacune des deux épaves et
on croit que le site contient de nombreux artéfacts.
Le Hamilton et le Scourge ont été construits à l'origine comme goélettes
marchandes, mais ils ont été réquisitionnés par les Américains et
modifiés à des fins militaires au moment où éclatait la Guerre de 1812.
Dans la nuit du 7 au 8 août 1813, une bourrasque soudaine s'élève sur la
flotte américaine stationnée au large de Port Dalhousie et les deux
navires chavirent et sombrent. Moins d'un quart des plus de 70 membres
d'équipage à bord des deux navires ont survécu. Les pertes humaines qui
en ont découlé représentent la plus importante perte de vie sur les
Grands Lacs de toute la guerre. Les navires épaves ont été découverts à
leur emplacement actuel en 1979 et ils ont été achetés du gouvernement
américain par la ville de Hamilton. Les épaves ont été l'objet de
plusieurs fouilles et recherches archéologiques sous-marines.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1988 |
Lieu historique national du Canada des Hangars-du-Corps-Royal-d'Aviation
Essa, Ontario
Les hangars du Corps royal d'aviation, situés sur la base des forces
canadiennes de Borden, près de Barrie (Ontario), font face à la piste en
une ligne torsadée. Sur les quinze hangars d'origine, construits sur le
premier aérodrome militaire canadien pendant la Première Guerre
mondiale, seuls huit subsistent. Certains de ces bâtiments de plain-pied
à charpente en bois ont été remis en état pour d'autres usages, y
compris un musée.
Les hangars du Corps royal d'aviation ont été construits en 1917 pour
servir de quartiers temporaires au premier aérodrome militaire canadien.
Témoins de la transition du Corps royal d'aviation (1916-1917) à
l'Aviation canadienne (1920), puis à l'Aviation royale du Canada (1924),
les hangars ont, depuis, abrité des écoles d'instruction aérienne et ont
servi à d'autres usages, y compris de musée. La valeur patrimoniale des
hangars du Corps royal d'aviation tient au fait qu'ils sont liés à
l'histoire, comme le montrent leur conception, leur forme et leur
composition fonctionnelles, ainsi que le choix de leur
emplacement.
|


©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada des Hauteurs-de-Queenston
Queenston, Ontario
Champ de bataille de la guerre de 1812 sur les hauteurs de Queenston;
monument Brock.
Les hauteurs de Queenston sont une vaste étendue de terrain située sur
un versant de l'escarpement du Niagara, au milieu d'un parc paysager et
boisé où l'on trouve un magnifique monument de 57,9 mètres (190 pieds)
de hauteur. Cette colonne de forme classique renferme la sépulture de
sir Isaac Brock. Le parc est l'endroit où s'est déroulée la bataille des
hauteurs de Queenston pendant la guerre de 1812.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada des
Hauteurs-de-Queenston réside dans l'intégrité des formes qui subsistent
encore et les liens spatiaux avec des vestiges du paysage culturel du
vaste champ de bataille. Cela comprend le lieu de débarquement à
Queenston, l'emplacement des batteries de défense britanniques, la route
de portage, la batterie du redan, les falaises, la pente sur laquelle
les Britanniques ont chargé l'ennemi et où le major-général Brock et le
lieutenant-colonel Macdonnell ont été tués, la route empruntée par
Sheaffe lors de sa marche et les hauteurs où les Britanniques ont
remporté la victoire. Le fort Drummond, qui fait partie des hauteurs de
Queenston, est un autre lieu historique national du Canada qui a fait
l'objet d'une reconnaissance distincte.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2007 |
Lieu historique national du Canada Heliconian Hall
Toronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada Heliconian Hall, situé au
centre-ville de Toronto, a été construit dans un quartier dominé par des
bâtiments en brique de l'époque victorienne et édouardienne entre
lesquels des bâtiments plus récents ont été bâtis. Construit en 1876
pour servir d'église, l'Heliconian Hall se distingue par son style
architectural et son ornementation néogothiques qui contrastent avec
l'extérieur simple fait de planches avec couvre-joints. L'édifice est
constitué d'une tour carrée à toit plat à la droite de l'entrée et d'un
corps central au toit à deux pignons à forte pente, flanquée de deux
porches d'entrée.
Au début du XXe siècle, la communauté artistique féminine de Toronto
comptait un nombre suffisant de femmes pour former un organisme
artistique multidisciplinaire seulement pour des femmes. Fondé en 1909,
un an après la formation du Arts and Letters Club, entièrement masculin,
l'Heliconian Club s'est inscrit dans un mouvement de clubs féminins qui
a balayé l'Amérique du Nord pendant cette période. Après presque 15 ans
sans maison de club, l'Heliconian Club a fait l'acquisition de l'Olivet
Congregational Church en 1923, l'a rénovée et décorée en fonction de ses
besoins. Stimulées par l'acquisition d'un centre permanent, les membres
du club se sont réunies plus souvent et ont organisé davantage
d'activités de toutes sortes. Premier établissement permanent du club,
l'Heliconian Hall a permis aux femmes du milieu artistique de se réunir,
d'échanger, de réseauter, et de disposer d'un lieu de création, et tenir
régulièrement des spectacles ou expositions, pour faire valoir les
talents des membres du club ou présenter des artistes invitées.
Les membres de l'Heliconian Club ont elles-mêmes acheté ce bâtiment
assez modeste qu'elles ont ensuite adapté et équipé en fonction des
activités et des objectifs de leur club. Doté d'une excellente
acoustique, d'une scène et d'une aire d'exposition dans le hall
principal, ainsi que d'équipement comme l'éclairage de scène et
d'exposition, l'Heliconian Hall est un lieu précieux de spectacle
suffisamment grand et doté des installations nécessaires à l'exercice du
rôle du club, c'est-à-dire réunir les femmes du milieu des arts.
|

©Maya Gavric & Century 21 Professional Group Inc., 2004 |
Lieu historique national du Canada du Homestead d'Adelaide Hunter Hoodless
Brant County, Ontario
Le Homestead-d'Adelaide-Hunter-Hoodless est une maison de ferme à
charpente de bois d'un étage et demi qui date du début du XIXe siècle.
Elle est située dans un cadre champêtre, dans la communauté rurale de
St. George, en Ontario.
Le Homestead-d'Adelaide-Hunter-Hoodless a été désigné lieu historique
national en 1995 à cause de ses liens directs avec les contributions
d'Adelaide Hunter Hoodless, figure de proue du féminisme maternel, qui a
joué un rôle clé dans la création de l'Institut féminin, de la Young
Women's Christian Association, du Conseil national des femmes du Canada,
de l'Ordre des infirmières de Victoria, et de trois facultés d'économie
domestique. La maison d'enfance de Hoodless, vu sa situation rurale et
son peu de commodités, illustre avec éloquence le dur travail et
l'isolement qu'avaient à subir de nombreuses paysannes au milieu du XIXe
siècle, une condition que Hoodless a cherché toute sa vie à améliorer.
La valeur patrimoniale du Lieu historique national du Canada du
Homestead-d'Adelaide-Hunter-Hoodless a trait à ses liens directs avec
Adelaide Hunter Hoodless, et surtout au rôle qu'il a joué pour façonner
les motifs pour lesquels elle est devenue un personnage d'importance
nationale. Sa situation relativement isolée et le fait qu'il s'agisse
d'une maison de ferme ontarienne typique de la deuxième moitié du XIXe
siècle contribuent également à sa valeur patrimoniale. Adelaide Hunter
est née dans cette maison et elle y a vécu jusqu'en 1881, date à
laquelle elle a épousé John Hoodless, un fabricant de meubles prospère
de Hamilton. Benjamine d'une famille nombreuse élevée par une mère
veuve, elle y a connu la misère et l'isolement qui l'ont poussée à son
activisme social. Cette expérience, ainsi que la perte de son plus jeune
enfant en 1889, ont façonné sa détermination, et défini la nature des
causes qu'elle a défendues.
Adelaide Hunter Hoodless (1857-1910) a également été reconnue en 1959
personnage d'importance nationale par la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Homewood
Augusta, Ontario
Le lieu historique national du Canada Homewood est une résidence en
pierre de deux étages datant du tout début du XIXe siècle et située
légèrement en retrait du fleuve Saint-Laurent, à quelques kilomètres à
l'est de Maitland, un hameau de l'est de l'Ontario.
Homewood a été construit en 1800-1801 pour le Dr Solomon Jones
(1756-1822), loyaliste éminent du sud-est de l'Ontario. Bâti en pierre
par le maçon montréalais Louis Brillière, il garde aujourd'hui une bonne
partie de ses caractéristiques d'origine. L'édifice a été agrandi par la
construction d'un ajout à l'arrière, aux environs de 1830, et de l'aile
ouest, en 1945. La demeure est restée dans la famille Jones jusqu'aux
années 1960, époque où elle a été achetée par la société Dupont. En
1974, la Fondation du patrimoine ontarien en est devenue propriétaire et
la conserve en tant que musée.
|
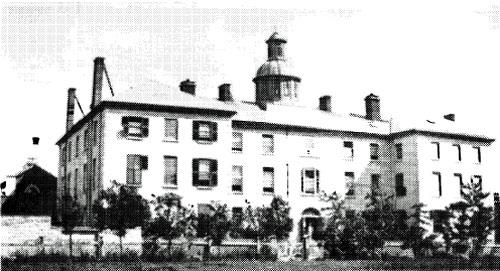
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Hôpital général de Kingston
Kingston, Ontario
Le Lieu historique national du Canada de l'Hôpital général de Kingston
est un complexe hospitalier composé de plusieurs édifices en pierre
calcaire d'inspiration classique, construits entre 1833 et 1924. Les
sept bâtiments reliés les uns aux autres qui composent le lieu
historique national font partie d'un campus hospitalier plus important
contenant des édifices construits après 1924, appelé l'Hôpital général
de Kingston. Cet hôpital est situé dans la ville de Kingston, à la
limite sud du campus de l'Université Queen's, sur la rive du lac
Ontario. L'édifice originel de l'hôpital (l'Édifice principal, 1833-35)
et ses deux ailes latérales (l'aile Watkins, 1862, et l'aile Nickle,
1890-91) font face au nord et donnent sur la rue Stuart. Un édifice
semi-circulaire abritant un amphithéâtre d'opération (la salle
d'opération Fenwick, 1895) jouxte l'arrière de l'Édifice principal.
Derrière ces bâtiments, on trouve aussi une maternité datant de la fin
du XIXe siècle (l'édifice Doran, 1893-94), une résidence d'infirmières
du début du XXe siècle (le Lieu historique national du Canada de
l'Édifice-Ann-Baillie, 1903-1904), et une aile du début du XXe siècle
contenant des chambres privées et semi-privées (l'aile Empire, 1914 et
1923-24). La plupart de ces bâtiments sont contigus l'un à l'autre ou
reliés par des passages. Certains sont également contigus ou reliés à
des édifices plus récents de l'hôpital. La disposition des bâtiments
forme une cour improvisée à l'arrière de l'Édifice principal.
Les sept édifices composant le Lieu historique national du Canada de
l'Hôpital général de Kingston illustrent l'évolution des hôpitaux au
Canada, qui sont passés d'établissements de bienfaisance du XIXe siècle
à des centres médicaux scientifiques au XXe siècle. L'Édifice principal
de l'Hôpital général de Kingston était le troisième hôpital général,
construit au Canada avec cette vocation, et il est le plus vieux à être
encore en opération dans le cadre d'un hôpital moderne.
Au XIXe siècle, on traitait en général les malades chez eux. Les
établissements de bienfaisance s'occupaient donc des malades déshérités.
L'Édifice principal de l'Hôpital général de Kingston a été construit de
1833 à 1835 avec la vocation d'hôpital de bienfaisance permanent. Ses
dimensions et sa conception modestes illustrent le goût pour les
édifices ordinaires qui prévalait au début du XIXe siècle. Le bâtiment a
également abrité pendant plusieurs années le Parlement des Canadas
unifiés, avant d'ouvrir ses portes à titre d'hôpital en 1845. L'aile
Watkins, ajoutée en 1862, offrait de l'espace supplémentaire pour les
patients. Elle illustrait les progrès réalisés dans les soins de santé
et le traitement des malades, ainsi que les mœurs de l'époque, avec ses
quartiers d'isolement pour les malades atteints de la variole, des
salles pour les patients payants, et une salle de chirurgie et de classe
pour les étudiants en médecine.
L'aile Nickle, ajoutée en 1890-1891, contenait des quartiers d'isolement
pour les malades contagieux, ainsi que des chambres pour les infirmières
et les étudiantes de l'école de soins infirmiers établie à l'hôpital en
1886. L'édifice Doran, bâti en 1894, offrait des installations
distinctes pour la maternité, la gynécologie et les enfants malades. Sa
conception de style pavillon et ses finitions intérieures
correspondaient concrètement aux méthodes d'isolement, d'asepsie et
d'antisepsie employées pour prévenir les infections. Son volet de
chirurgie traduisait le nouvel accent sur les interventions
chirurgicales dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie.
La salle d'opération Fenwick, construite en 1895, présentait un
amphithéâtre d'opération, avec des chaises pour les observateurs,
reflétant l'importance grandissante des chirurgiens et de la formation
médicale, ainsi que le besoin d'un environnement stérile et bien
éclairé. C'est le seul amphithéâtre d'opération datant d'avant 1920
subsistant au Canada. La construction en 1904 de la résidence
d'infirmières (édifice Ann Baillie), d'après des plans de William
Newlands, illustrait l'importance essentielle des infirmières pour
l'hôpital, ainsi que la réussite de l'école de soins infirmiers. Et
finalement, la construction de 1912 à 1914 de l'aile Empire avec ses
chambres privées et semi privées, et son agrandissement subséquent,
traduisait l'augmentation du nombre de patients payants, et
l'acceptation des hôpitaux par les gens aisés.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1990 |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Guelph
Guelph, Ontario
L'hôtel de ville de Guelph est un édifice de deux étages en pierre
calcaire, construit entre 1856 et 1857 dans le style néo-renaissance, et
agrandi en 1875. Il occupe un emplacement bien en vue au centre-ville de
Guelph, en face de la gare ferroviaire.
L'hôtel de ville de Guelph a été désigné lieu historique national en
1984, car il constitue un exemple d'hôtel de ville remplissant plusieurs
fonctions; il symbolisait la confiance de la ville en l'avenir, et la
maçonnerie de pierre lisse et la délicatesse des sculptures extérieures
représentent avec élégance et raffinement l'architecture civile de style
classique.
L'hôtel de ville de Guelph a été érigé en même temps que d'autres
bâtiments importants de la ville au milieu du XIXe siècle, une période
de fierté et de prospérité qui a suivi l'arrivée du service du chemin de
fer du Grand Tronc (Grand Trunk Railway) dans la communauté. Il
constitue un excellent exemple de bâtiment public multifonctionnel de la
moitié du XIXe siècle, en abritant sous un même toit un marché, les
services d'incendie et de police, la prison, une bibliothèque, la salle
de lecture du Mechanics Institute, une vaste salle publique et les
bureaux de la ville, et la salle du conseil. Conçu par William Thomas,
architecte torontois renommé, et construit par les entrepreneurs
Morrison et Emslie, avec un ajout en 1875 réalisé par George Netting,
l'hôtel de ville de Guelph est l'une des plus belles illustrations en
Ontario du style néo-renaissance du milieu du XIXe siècle, un style
classique inspiré des édifices italiens du XVIe siècle. Les éléments
sculptés de la façade ont été réalisés sous la supervision de Matthew
Bell, un artisan renommé.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Kingston
Kingston, Ontario
L'hôtel de ville de Kingston en est un, monumental construit en pierre
au milieu de XIXe siècle, dans le style néoclassique. Il est situé bien
en vue, en plein centre-ville historique de Kingston, au bord de l'eau,
et il occupe tout un pâté de maisons. À l'arrière, un grand espace
ouvert accueille en plein air et en saison les étals d'un marché
fermier.
L'hôtel de ville de Kingston a été désigné lieu historique national en
1961, car il constitue un exemple remarquable du style néoclassique au
Canada et est représentatif des hôtels de ville qui remplissent
plusieurs fonctions.
L'hôtel de ville de Kingston, qui a été conçu par l'architecte George
Browne, pour qui c'était le premier grand contrat, suit ce qui se
faisait à l'époque en matière d'édifice public dans sa composition et
dans l'importance accordée au portique et au dôme. Le portique toscan,
supprimé en 1958, a été reconstruit à l'identique en 1966. La conception
s'inspire du goût néoclassique pour ce qui est de la taille imposante,
de la projection hardie des extrémités des pavillons et du portique, et
de l'importance des éléments individuels du design.
Comme bien des hôtels de ville du milieu du XIXe siècle, celui de
Kingston a été conçu pour regrouper dans un même édifice les fonctions
d'hôtel de ville et de marché. Sa taille et sa conception
impressionnantes correspondaient à la prospérité et à l'envergure que
prendrait la ville comme capitale de la province. L'hôtel de ville
offrait deux grandes salles de réunion, des espaces de bureau et de
réunion pour les édiles, des quartiers pour le poste de douane, le
bureau de poste, le poste de police et la prison. Une section à
l'arrière comprenait l'espace réservé au marché. L'aile arrière a été
reconstruite en 1865, puis de nouveau en 1973. Le dôme a été reconstruit
en 1910 et le portique toscan, en 1966.
Quand le choix de Kingston comme capitale provinciale a été annulé et
que la ville a connu des revers de fortune, l'espace excédentaire dans
l'hôtel de ville a été loué à divers intérêts privés, y compris des
bars, des magasins, des églises, des associations, une banque et un
petit théâtre. L'attribution et l'utilisation de l'espace ont changé en
plus de 150 ans d'utilisation municipale, mais la propriété remplit
toujours à l'heure actuelle ses deux principales fonctions, soit celle
d'hôtel de ville et de marché.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1995 |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-ville-de-Napanee
Greater Napanee, Ontario
Le lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-ville-de-Napanee est
un magnifique hôtel de ville du milieu du XIXe siècle, de style
néo-grec. Il est situé bien en vue dans la petite localité de Napanee,
Ontario. L'imposant portique à colonnes a été ajouté en 1928.
Construit en 1856, l'hôtel de ville de Napanee est un des premiers
exemples de combinaison d'hôtel de ville et de marché, une combinaison
fréquente en Ontario avant 1870. Conçu par l'architecte de Kingston
Edward Horsey, avec son portique ajouté au XXe siècle, ce bâtiment à la
fois noble et simple est un des rares exemples subsistants d'hôtel de
ville de style néo-grec.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1980 |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Perth
Perth, Ontario
Le lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Perth est
un élégant édifice en pierre de deux étages surmonté d'une coupole ornée
en couches contenant une horloge municipale. Il se dresse, bien en vue,
au 80 de la rue Gore Est à Perth (Ontario).
L'Hôtel de ville de Perth a été conçu par l'architecte John Power et
construit par Alexander Kippen, en 1863-1864, pour la ville de Perth,
qui était en pleine expansion. Il offrait non seulement des bureaux et
des salles de conseil à l'administration municipale, mais aussi, ce qui
était commun à l'époque, des espaces pour un marché, une salle de
concert, une caserne de pompiers, un poste de police et un bureau de
poste. L'intérieur a été sensiblement modifié au fil des années, mais
l'extérieur est remarquablement intact. Les locaux du marché situés à
l'arrière de l'édifice ont été transformés en caserne de pompiers.
Depuis sa construction, l'édifice a toujours abrité l'hôtel de ville de
Perth.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-St. Thomas
St. Thomas, Ontario
L'hôtel de ville de St. Thomas est un édifice raffiné en pierre, de deux
étages et demi, orné d'une tour d'horloge proéminente. Ce bâtiment de
style romanesque à la Richardson a été bâti à la fin du XIXe siècle. Il
est situé bien en évidence sur la rue principale de St. Thomas, au
centre-ville, avec une généreuse marge de recul.
L'hôtel de ville de St.Thomas illustre bien les grands hôtels de ville,
exclusivement voués à l'administration municipale qui ont fait leur
apparition au Canada dans les années 1880 et 1890. La construction d'un
tel édifice reflétait l'énorme croissance qu'avait connue la ville dans
le dernier quart du XIXe siècle, principalement à cause de
l'amélioration de sa desserte ferroviaire. Le bâtiment a été
principalement conçu pour accueillir les services administratifs
municipaux. Ses dimensions monumentales et son emplacement bien en vue
symbolisaient à la fois l'augmentation de la taille du gouvernement
municipal, ainsi que la fierté et l'ambition de la communauté. La foi de
la ville en ses progrès futurs était typique des communautés dont la
prospérité provenait des installations ferroviaires.
L'aspect extérieur et les aménagements intérieurs de l'hôtel de ville de
St. Thomas sont typiques des grands hôtels de ville administratifs bâtis
dans les villes moyennes à la fin du XIXe siècle. À la fin du siècle,
les hôtels de ville urbains étaient passés d'édifices à vocations
multiples à des bâtiments de grandes dimensions consacrés uniquement aux
services administratifs et législatifs du gouvernement municipal. La
construction d'édifices à vocation unique et de grandes dimensions
traduisait à la fois la croissance des zones urbaines et l'expansion des
services locaux fournis par le gouvernement municipal.
Plusieurs édifices publics construits au Canada, dans les années 1880 et
1890, ont été bâtis dans le style romanesque à la Richardson. L'hôtel de
ville de St. Thomas, conçu par l'architecte local Neil Darrach, est un
exemple sobre de ce style, comme l'attestent ses grandes dimensions et
son aspect massif, sa pierre rustiquée, sa tour d'horloge proéminente,
ses toits polygonaux très pentus, et ses ouvertures en plein cintre. Par
ailleurs, l'intérieur ouvragé avec la chambre du conseil en voûte, haute
de deux étages, cadre avec le style de l'extérieur.
|

©Stratford City Hall, Perry Quan, 2011 |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Stratford
Stratford, Ontario
Le lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Stratford
est situé bien en vue dans une place municipale triangulaire située au
centre du quartier des affaires de Stratford, en Ontario. Construit à la
fin du XIXe siècle, il est un édifice monumental en brique rouge orné
d'une tour de l'horloge proéminente. Sa conception pittoresque présente
un mélange éclectique de caractéristiques de la fin de l'époque
victorienne.
L'hôtel de ville de Stratford illustre le développement des hôtels de
ville à la fin du XIXe siècle, alors que l'étendue des fonctions
administratives des gouvernements municipaux augmentait, et que les
villes souhaitaient exprimer leur fierté municipale et leur ambition en
construisant des édifices impressionnants de grandes dimensions. Sa
conception pittoresque intégrant des détails provenant de divers styles
traduit l'éclectisme de la fin des années 1890. L'architecte de Toronto
George W. King, assisté de l'architecte local J.W. Siddall, a exploité
le caractère irrégulier du site sur lequel est bâti ce bâtiment en lui
donnant des façades intéressantes sur tous ses angles. Ses dimensions
monumentales, sa tour proéminente et sa structure en brique rouge font
ressortir son caractère d'édifice municipal.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Île-Beausoleil
Muskoka District, Ontario
Le lieu historique national du Canada de l'Île-Beausoleil est formé de
la plus grande île du parc national du Canada des
Îles-de-la-Baie-Georgienne, situé dans le bras Severn, dans le sud de
l'Ontario. Les découvertes archéologiques témoignent de la présence
d'activités humaines et de colonies sur l'île, et ce, du Paléoindien
supérieur jusqu'à aujourd'hui. Les Anishinaabeg ont utilisé l'île comme
halte traditionnelle, campement saisonnier, puis comme réserve au milieu
du XIXe siècle; les caractéristiques du paysage culturel de l'île sont
au cœur des récits traditionnels anishinaabes et sont représentatifs de
la période de création des réserves et de la période postérieure à leur
création. L'île a été nommée en l'honneur de Louis Beausoleil, un colon
métis dont le homestead, construit en 1819, s'élevait à l'extrémité sud
de l'île. Le paysage se compose du Bouclier canadien et de marécages.
En tant que paysage culturel, l'île Beausoleil évoque certains aspects
de l'évolution de la relation que les Anishinaabeg de la région sud de
la baie Georgienne ont entretenue au cours des siècles avec leurs
territoires ancestraux. En tant que lieu où sont ancrées de nombreuses
traditions orales des Anishinaabeg, l'île sert de lien physique avec les
ressources, rites et cérémonies qui reflètent leur mode de vie
traditionnel et qui perpétuent leur mémoire et culture collectives.
D'une superficie de 1 089 hectares, l'île Beausoleil, que les
Anishinaabeg décrivent comme un « endroit rocheux flottant à
l'embouchure d'une rivière », est habitée par l'homme de façon
irrégulière depuis le Paléoindien supérieur (vers 10 400 à 9 500 avant
le présent). Représentative de la présence anishinaabe dans le sud de
l'Ontario, elle compte parmi les premiers endroits occupés par l'homme
dans la province. L'île est bien connue des peuples autochtones, qui s'y
réfugiaient en cas de mauvais temps et l'utilisaient comme halte. À
l'époque de la création des réserves (1838-1856), elle soutenait deux
villages. Le chef John Assance y a conduit son peuple après avoir cédé
leurs terres à Coldwater. La bande du chef Assance s'établit alors sur
le côté sous le vent de l'île, à Cedar Spring. En 1844, on y trouve 14
maisons, une étable, une centaine d'acres cultivées et un cimetière.
Assance fait construire une petite église catholique romaine, puis une
école en 1847. Le camp Kitchewa du YMCA, deuxième village datant de la
période de la création des réserves, situé au nord de l'île comprend au
moins 15 habitations et peut-être une église. Le sol peu fertile et la
population relativement grande rendent infructueuses les tentatives pour
coloniser l'île à long terme et y exercer l'agriculture à l'européenne.
Dès 1844, certaines personnes décident de s'installer sur l'île
Christian située à proximité. En 1852, la plupart des membres de la
bande du chef Assance les y ont suivis. Les Anishinaabeg qui demeurent
sur l'île Beausoleil y établissent des homesteads, principalement dans
le sud-est de l'île et pratiquent un mode de vie traditionnel fondé sur
la pêche, la chasse et la cueillette.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Île-Bridge / Île-Chimney
Front of Yonge, Ontario
Le lieu historique national du Canada de l'Île-Bridge / Île-Chimney se
situe sur l'île Chimney, dans le fleuve Saint-Laurent, à environ 20
kilomètres en amont de Brockville, en Ontario. Sur cette île, durant la
guerre de 1812, fut établie une garnison britannique fortifiée qui
protégea la route d'approvisionnement vers le Bas-Canada et qui servit
de lieu de rencontre pour les navires britanniques. En 1980, la
Commission des lieux et monuments historiques du Canada érigea sur l'île
une plaque afin de commémorer l'endroit.
Pendant la guerre de 1812, la seule voie de communication du Haut-Canada
était le Saint-Laurent, qui servait au transport de presque tout le
matériel civil et militaire de Montréal à Kingston. De peur que les
Américains ne tentent d'intercepter les approvisionnements, l'île Bridge
fut transformée en un abri fortifié pour les bateaux-ravitailleurs et en
une base pour les canonnières anglaises. Au début de 1814, on termina un
blockhaus et une batterie circulaire munie d'un canon de 18 livres. En
1814, des artilleurs et un détachement du 57e Régiment gardaient ces
ouvrages de défense qui tombèrent en ruines peu après la guerre.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Île-Navy
Niagara Falls, Ontario
Vestiges archéologiques associés à la construction de navires.
Le lieu historique national du Canada de l'Île-Navy est une étendue de
terre fortement boisée et inhabitée sur le côté canadien de la rivière
Niagara, en amont des chutes du même nom, en Ontario. Dans les années
1760, l'île Navy est devenue le premier chantier naval britannique du
secteur supérieur des Grands Lacs et durant les Rébellions de 1837, a
été le siège du gouvernement en exil de William Lyon Mackenzie. L'île
présente plusieurs ressources archéologiques.
En 1761, les Britanniques établissent un chantier naval sur l'île Navy
pour y construire les vaisseaux requis pour le transport de troupes et
de fournitures vers les lacs Supérieur et Huron. Pendant le soulèvement
de Pontiac en 1763-1764, trois goélettes (Boston, Gladwin et Victory) et
deux sloops (Charlotte et Huron) construits au chantier naval,
transporteront des troupes et des fournitures au siège de Fort Détroit.
Le chantier naval fut eventuellement transféré à Détroit, où le courant
était moins rapide et le risque d'attaque américaine diminué.
L'île Navy a également joué un rôle important dans les Rébellions de
1837 dans le Haut-Canada et le Bas-Canada. Après avoir échoué dans sa
tentative de prendre le contrôle du gouvernement en décembre 1837,
William Lyon Mackenzie, le chef de la rébellion du Haut-Canada, s'enfuit
à Buffalo. Il établit alors, sur l'île Navy, un « gouvernement en exil
». Les rebelles y sont rejoint par des sympathisants américains et l'île
a tôt fait d'être entourée de fortifications rudimentaires pour contrer
les invasions des troupes britanniques et de la milice du Canada. Les
réguliers britanniques et la milice bloquent aussitôt l'île. Le 14
janvier 1838, le chef des rebelles, jugeant la situation désespérée,
quittait les lieux. L'occupation de l'île aura durée un peu plus d'un
mois, mais l'impact de la rébellion de Mackenzie, et d'un soulèvement
similaire au Bas Canada, aura eu des répercussions dans les colonies.
Les Rébellions de 1837-1838 constituent des événements clefs dans
l'escalade des conflits politiques dans le Haut-Canada et ont joué un
rôle dans la réforme du système politique du Haut et du
Bas-Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, G. Vandervlugt, H.06.644.09.01(10), 2001 |
Lieu historique national du Canada de l'Île-Whitefish
Sault Ste. Marie, Ontario
Le lieu historique national du Canada de l'Île-Whitefish se trouve sur
le côté canadien de la rivière Ste Marie, en Ontario, plus précisément à
la hauteur de la ville de Sault Ste. Marie. Il y a plus de 2000 ans,
l'île Whitefish abritait un établissement autochtone, un poste de traite
et un camp de pêche. Du point de vue géomorphologique, l'île en forme de
larme est un chaos de blocs de faible élévation faisant un kilomètre de
long et jusqu'à 500 mètres de large. La couche de sol qui recouvre le
roc fait par endroits 50 centimètres, accumulation principalement causée
par l'activité humaine étalée sur plusieurs siècles. La haute teneur
organique de ce sol alimente un couvert de denses broussailles qui
occupent la plus grande partie du paysage. L'île est située à la limite
sud des terres du lieu historique national du Canada du Canal-de-Sault
Ste. Marie. Elle n'est pas exploitée et ses ressources archéologiques et
géographiques sont encore intactes.
L'île Whitefish a abrité des campements autochtones depuis sa formation,
causée par une suite de processus géologiques, il y a plus de 2000 ans.
À partir de l'époque où les Autochtones découvrent la poterie, environ
300 ans avant notre ère, huit cultures s'y succèdent, avant que ne
naisse la nation Ojibway dans la région de Sault Ste. Marie. La position
toute particulière de l'île, entre le lac Huron et le lac Supérieur,
ainsi que les eaux poissonneuses des tumultueux rapides Ste-Marie, en
font un lieu parfait pour la traite et l'établissement de campements
préhistoriques et historiques jusqu'au début du XXe siècle. L'île
témoigne non seulement de l'évolution de la culture Ojibway, dans
laquelle la pêche occupe une place importante, mais également de
l'influence exercée par la culture des autres peuples installés autour
des Grands Lacs et qui passent sur l'île, en visite ou pour la traite.
Bien que l'île Whitefish soit aujourd'hui entourée de quartiers
industriels et urbains, sa valeur est demeurée intacte.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Jamie Dunn, 2002 |
Lieu historique national du Canada des Jardins-Botaniques-Royaux
Hamilton, Ontario
Le lieu historique national du Canada des Jardins-Botaniques-Royaux est
un vaste jardin botanique qui a été aménagé au cours du XXe siècle.
Situé en bordure de Hamilton, à l'ouest de la ville, il occupe près de 1
100 hectares sur diverses parcelles de terrain regroupées autour de la
baie Burlington, à l'extrémité occidentale du lac Ontario. Le lieu
comprend une série de jardins thématiques, un arboretum, une aire de
conservation et un centre d'interprétation.
Les Jardins botaniques royaux ont fait partie d'un projet de la fin des
années 1920 destiné à embellir Hamilton en y créant des allées
paysagères et un campus pour l'Université McMaster. Le plan pour un
jardin botanique a été élaboré par la Commission de gestion des parcs de
Hamilton sous la présidence de Thomas Baker McQuesten. La décision de la
Commission, en 1932, de réunir des parcelles de terrain séparées pour
créer les jardins a été prise sur la recommandation d'un conseil
consultatif qui incluait les architectes paysagers Carl Borgstrom et
Howard Dunington-Grubb. Le plan unique des jardins, qui comprenait une
série de jardins distincts et de zones de conservation aménagées au sein
d'une promenade, marquait un changement radical par rapport à la
conception que l'on avait d'un jardin botanique au XIXe siècle.
Le plan paysager des Jardins a été influencé par Carl Borgstrom, qui
croyait à une approche naturelle du plan paysager et à la création d'un
jardin botanique qui plairait au grand public. Il a conçu un jardin de
rocailles, dans une gravière abandonnée, contiguë à la promenade, et il
a transformé la carrière en un paysage complexe composé de sentiers
sinueux, d'escaliers cachés, de corniches, de crevasses et de bassins
pittoresques. Il a présenté une liste de recommandations en 1942 qui
mentionnait des éléments importants qui ont été suivis au cours des 20
années suivantes. Cette liste incluait d'importantes composantes, tels
des jardins classiques, des roseraies et des jardins grimpants, un
arboretum, et un jardin de lilas.
Le conservateur en botanique K. Matthew Broman a conçu en 1947 le jardin
du lac qui sert de jardin d'essais pour les collections de plantes
herbacées rustiques et renferme une collection d'iris importante.
En 1962, l'architecte paysager J. Austin Floyd a conçu un jardin
classique dans Hendrie Park. Influencé par le style international, il a
créé un cadre géométrique pour les avenues et les massifs de fleurs
organisés le long d'un axe principal qui est une réminiscence de la
conception des jardins de la Renaissance.
Le jardin éducatif, d'abord aménagé en 1947-1948 comme projet éducatif
pour les enfants, comprend une maison, une serre et six hectares de
jardins où les plantes sont choisies pour leur attrait esthétique, leur
robustesse et leur valeur éducative.
L'arboretum, aménagé dans les années 1950 et 1960, a été conçu pour
faciliter la circulation automobile, avec des arbres plantés le long
d'avenues qui partent en étoile d'un stationnement circulaire central.
Le Jardin des lilas Katie Osborne, créé en 1960-1961, possède
aujourd'hui la plus grande collection de lilas du monde.
La zone de conservation couvre 800 hectares de marais, de lacs peu
profonds, de bois, de prés, de versants et de terres agricoles à l'état
sauvage. Il comprend le Cootes Paradise Sanctuary, marécage très
surveillé, contigu à la baie Burlington, et le Rock Chapel Sanctuary.
Un centre d'interprétation, conçu en 1958, offre des espaces pour une
bibliothèque, un herbier, une salle de conférence, un atelier
d'horticulture et un auditorium.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Kay-Nah-Chi-Wah-Nung
Morley, Ontario
Le lieu historique national du Canada Kay-Nah-Chi-Wah-Nung fait partie
d'un vaste réseau de monticules funéraires anciens qui longent la
rivière Rainy depuis Quetico, à l'est, jusqu'au lac des bois dans le
sud-est du Manitoba. Construit de 3000 avant J.-C. à 1650 après J.-C.,
le lieu historique national du Canada est formé d'une bande de
basses-terres large de 500 mètres s'étendant sur trois kilomètres le
long de la rive nord de la rivière Rainy, dans une région isolée se
trouvant à mi-chemin entre le lac à la Pluie et le lac des Bois.
Le lieu historique national du Canada Kay-Nah-Chi-Wah-Nung est l'un des
premiers grands centres d'habitation et d'inhumation rituelle au Canada.
Il renferme des éléments de preuve de l'occupation humaine datant de 5
000 ans, y compris des monticules funéraires des cultures Laurel (300
av. J.-C. — 1 100 apr. J.-C.) et Blackduck (800 — 1 650 apr. J.-C.).
Domicile des Ojibways au cours des siècles derniers, le site a été
colonisé par les Premières nations de la rivière Rainy, de l'époque du
Traité no 3, de 1873 à 1916, et contient donc des éléments de preuve de
cabanes et de bâtiments de ferme ainsi que des traces d'activités
connexes. Cet endroit a une importance culturelle et spirituelle
considérable pour les Ojibways et constitue un lien vivant entre le
passé, le présent et l'avenir. En raison de son emplacement au cœur d'un
immense réseau de voies navigables nord-américain, il est aussi d'une
grande importance pour les Premières nations ailleurs sur le continent.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada
Kay-Nah-Chi-Wah-Nung repose sur ses associations historiques avec des
cultures anciennes et actuelles symbolisées par l'atmosphère de
l'endroit, son emplacement et ses caractéristiques naturelles, la
présence d'anciens monticules funéraires et de sites d'habitation ainsi
que sa fonction, lien vivant entre ceux qui ont visité, occupé et
utilisé l'endroit dans le passé et les Ojibways qui y vivent
aujourd'hui.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Jennifer Cousineau, 2018 |
Lieu historique national du Canada L'Observatoire David Dunlap
Richmond Hill, Ontario
Lorsqu'il ouvre ses portes en 1935, dans un endroit alors isolé à 20 km au nord
de Toronto à Richmond Hill, en Ontario, l'Observatoire David Dunlap abrite le
deuxième plus grand télescope au monde. Il joue un rôle central dans
l'établissement de l'astronomie comme discipline universitaire au Canada. Projet
à long terme de C.A. Chant, « père de l'astronomie canadienne », l'Observatoire
accueille des générations d'astronomes à l'Université de Toronto, combinant des
mandats d'enseignement, de recherche et d'accessibilité publique. Grâce à ses
recherches à l'Observatoire, l'astronome Thomas Bolton réalise une percée
astronomique majeure lorsqu'il confirme l'existence des trous noirs en 1971.
Financé par Jessie Donalda Dunlap, qui le nomme à la mémoire de son défunt mari,
l'Observatoire David Dunlap comprend deux bâtiments principaux : le grand dôme
du télescope, un bel exemple bien conservé de la conception des observatoires du
début au milieu du XXe siècle au Canada qui conjugue avec succès des éléments
modernes et néoclassiques, et l'élégant bâtiment administratif de style
Beaux-arts, conçu par le cabinet Mathers & Haldenby. Ces constructions
s'agencent avec les autres bâtiments érigés pour l'Université de
Toronto.
En tant que centre éducatif, l'Observatoire David Dunlap renforce immédiatement
la discipline de l'astronomie au Canada. Bien que le gouvernement fédéral
finance alors deux observatoires — l'Observatoire fédéral à Ottawa et
l'Observatoire fédéral d'astrophysique à Victoria — le manque d'infrastructures
universitaires se traduit par un manque d'opportunité pour les étudiants
canadiens de recevoir une formation pratique en astronomie au cours de leur
formation. Par conséquent, l'Université de Toronto devient la première école
canadienne à offrir des diplômes d'études supérieures en astronomie avec
l'attribution d'un premier doctorat en 1953.
Les recherches menées à l'Observatoire David Dunlap mènent à des centaines de
publications, mais l'une d'entre elles se démarque particulièrement par son
importance. À l'été 1971, le chercheur postdoctoral Thomas Bolton confirme la
présence d'un trou noir dans la Voie lactée. Il s'agit d'une découverte
astrologique majeure puisque personne n'avait précédemment réussi à repérer un
trou noir. L'article original confirmant son existence est une contribution
importante dans le domaine de l'astronomie.
L'élément visuel le plus marquant de l'Observatoire David Dunlap est le grand
dôme du télescope, ou plus simplement « l'observatoire ». Il s'agit d'une
immense structure en dôme ayant pour fonction principale de protéger le
télescope réfléchissant de 1,87 m qu'elle abrite. La coupole est peinte en blanc
et comprend un ensemble de volets rétractables surélevés pour l'observation
astronomique, caractéristique de l'architecture en astronomie du XXe siècle.
Situé au nord-est de l'observatoire, le bâtiment d'administration est accessible
par un sentier de procession pavé. Cette structure imposante est une composition
sobre de style Beaux-arts. Faisant écho à l'architecture du dôme, le bâtiment
d'administration comporte trois coupoles symétriques qui abritaient autrefois
chacune un télescope fonctionnel (un seul l'est toujours). Ces petites coupoles
font du bâtiment d'administration un deuxième lieu de recherche en astronomie,
les étudiants pouvant y être formés sans avoir à rivaliser avec les chercheurs
en astronomie pour obtenir du temps d'observation dans le grand dôme.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1995 |
Lieu historique national du Canada du Lieu-de-Sépulture-de-sir John A. Macdonald
Kingston, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Lieu-de-Sépulture-de-sir John
A. Macdonald, situé dans le cimetière Cataraqui, à Kingston, est marqué
d'une modeste croix de pierre, gravée d'une inscription. Celle-ci est
installée sur un lot familial en pente douce et de forme rectangulaire,
ceinturée d'une clôture de fer forgé. Près de son centre et entouré
d'autres pierres tombales, un grand obélisque de granite porte les noms
de Macdonald et de Williamson, les deux familles liées à la concession.
La mémoire de sir John A. Macdonald est aussi immortalisée par une
petite pierre tombale rectangulaire gravée et une petite plaque de métal
portant son nom, près de la porte en fer forgé du lot.
Le lieu de sépulture de sir John A. Macdonald rappelle l'homme qui a
dominé la vie politique du Canada durant son premier quart de siècle.
John A. Macdonald était un homme d'État visionnaire, un fervent partisan
conservateur et un chef respecté. Ses politiques concernant l'expansion
du pays vers l'ouest et la construction d'un chemin de fer menant de
l'Atlantique au Pacifique ont jeté les bases d'une nation
transcontinentale développée. Macdonald est mort à Ottawa, le 6 juin
1891, alors qu'il était encore premier ministre. Puisqu'il avait passé
la plus majeure de sa vie à Kingston, sa dépouille y a été transportée
pour être enterrée au lot familial, au cimetière Cataraqui. Une modeste
croix de pierre marque sa tombe, comme il l'avait souhaité.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada 2005 |
Lieu historique national du Canada Lynnwood/Maison-Campbell-Reid
Simcoe, Ontario
Le lieu historique national du Canada Lynnwood/Maison Campbell Reid est
un charmant bâtiment en brique de dimension modeste et de style
néoclassique érigé dans la ville de Simcoe sur une petite colline qui
surplombe la rivière Lynn. Cette maison de brique rouge, de forme
rectangulaire, haute de deux étages et coiffée d'un toit en croupe
présente des ouvertures découpées à intervalles réguliers et une
corniche denticulée. Sa façade est animée par un porche central orné de
colonnes ioniques et surmonté de deux fenêtres centrées à larges meneaux
et par les cheminées qui percent le toit.
Vers 1850, Duncan Campbell, banquier, commissaire des terres et premier
maître de poste de Simcoe, fait construire le bâtiment qui deviendra la
résidence Lynnwood/Maison Campbell Reid. Au moment où M. Campbell quitte
ses fonctions publiques, la maison, qui vient d'être achevée, et son
terrain paysagé de 4 hectares (10 acres) ont déjà acquis une certaine
renommée en raison de leur élégance. La maison est un exemple
remarquable de résidence de dimension modeste de style néoclassique. En
1911, le magnifique terrain qui ceinture la maison est lotie.
L'extérieur sobre du bâtiment, aux éléments équilibrés et harmonieux et
aux fenêtres réparties symétriquement, s'ajoute au porche classique,
remarquable par ses détails et sa qualité d'exécution, et aux hautes
souches de cheminées ornées. L'intérieur soigné témoigne du statut du
premier propriétaire, membre fortuné de la société.
|

©Eaton's of Canada Ltd. / Eaton Canada ltée., c. 1930. |
Lieu historique national du Canada du Magasin-Eaton - Auditorium-du-Septième-Étage-et-Salle-Ronde
Toronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Magasin-Eaton -
Auditorium-du-Septième-Étage-et-Salle-Ronde comprend un ancien
restaurant (Salle ronde), un large foyer (salle d'attente) et un
auditorium reconnu comme étant un tour de force du dessin Art Deco. Ces
espaces sont situés dans l'ancien magasin Eaton de la College Street, au
centre-ville de Toronto. Ces pièces, qui viennent d'être restaurées,
sont à présent des lieux d'événement privés dans l'édifice réhabilité de
la College Street. Tout l'édifice, conçu par les architectes canadiens
Ross et Macdonald et leurs associés, Sproatt et Rolph, a été
officiellement reconnu par la municipalité de Toronto en vertu de la Loi
sur le patrimoine de l'Ontario.
La série des salles de style Art Deco, dessinées par l'architecte
français Jacques Carlu, la peintre de murales Natacha Carlu, et
l'architecte René Cera dans le grand magasin Eaton de la College Street,
a été construite en 1930, a ouvert ses portes en 1931 et les a fermées
en 1970 jusqu'à sa rénovation en 2000-2003. Ces pièces, dans lesquelles
d'importants événements culturels du moment ont été organisés et qui
étaient le lieu de rassemblement favori de la classe moyenne torontoise,
sont à présent louées à titre privé.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1980 |
Lieu historique national du Canada de la Mairie-du-Canton-d'Oxford-on-Rideau
Oxford Mills, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la
Mairie-du-Canton-d'Oxford-on-Rideau est un élégant édifice de deux
étages, surmonté d'une coupole. Cet ancien pavillon de canton, situé à
Oxford Mills en Ontario, abrite à présent la bibliothèque locale.
La mairie du canton d'Oxford-on-Rideau, qui a été conçue par un
architecte de Brockville, John Steacy, devait servir de centre
d'administration municipale et de centre communautaire. Elle a été
construite en 1875 par l'entrepreneur en bâtiment Ambrose Clothier, qui
a utilisé de la pierre locale. Entre 1967 et 1970, l'intérieur original
de l'édifice, qui est typiquement composé de deux salles ouvertes, l'une
au-dessus de l'autre, a été restauré et partagé en un bureau et une
chambre forte pour l'administration municipale. Il a servi de siège à
l'administration locale jusqu'en 1998, année où le canton de
Oxford-on-Rideau a été fusionné avec le canton de North Grenville, et où
les bureaux municipaux ont été regroupés à Kemptville.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la
Mairie-du-Canton-d'Oxford-on-Rideau tient à son identité d'édifice
public, représentatif de l'importance de l'administration locale dans
les petites localités de l'Ontario au XIXe siècle et à sa taille, à ses
éléments architecturaux, à ses proportions, à la superbe exécution du
travail, aux matériaux employés et à l'installation.
|
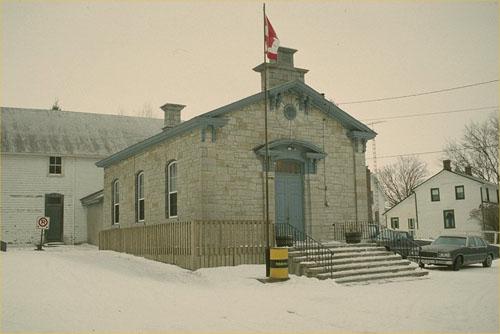
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national du Canada de la Mairie-du-Canton-de-Wolfe Island
Wolfe Island, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Mairie-du-Canton-de-Wolfe
Island est un petit édifice élégant en pierre situé sur Wolfe Island,
près de Kingston (Ontario). Il s'agit d'une structure simple, construite
au milieu du XIXe siècle pour servir de lieu de réunion à la communauté
et au conseil municipal.
Le lieu historique national du Canada de la Mairie-du-Canton-de-Wolfe
Island est une salle publique élaborée, dessinée par Edward Horsey,
architecte de Kingston. Elle a été construite en 1859 pour servir de
lieu de réunion au conseil local après que la Loi sur les municipalités
de 1849 ait accordé l'autonomie administrative à l'Ontario rural. Sa
grande salle unique sert de salle de conférence et de salle de réunion.
Depuis, l'intérieur a été divisé et comprend un bureau municipal et une
salle de conseil.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |
Lieu historique national du Canada de la Maison Annandale / musée Tillsonburg
Tillsonburg, Ontario
La façade, tirée d'un livre de modèles, de cette maison inspirée de
l'éclectisme victorien ne laisse pas présumer de son intérieur tout à
fait extraordinaire. Richement décorée de peintures murales et au
plafond, de vitraux et de fenêtres aux carreaux de verre peint, et de
boiseries et ornements métalliques décoratifs, elle constitue une
tentative ambitieuse de représenter les goûts introduits au Canada par
le Mouvement esthétique.
Cette maison a été construite en 1881 et 1882 dans le sud-ouest de
l'Ontario pour l'entrepreneur local E.D. Tillson, considéré comme le
père de Tillsonburg. Elle devait être le manoir de la ferme modèle de
Tillson (actuellement réaménagée en résidence de banlieue), et qui
attira des visiteurs de tous les coins du Canada et de l'étranger. Tout
comme la ferme, la maison a été réalisée selon un design et une
technologie dernier cri. En 1882, Tillson a financé la visite du renommé
auteur et esthète Oscar Wilde à l'Institut de mécanique de la ville
voisine de Woodstock. Cette visite a eu une influence décisive sur la
décoration intérieure de la maison. En effet, Wilde a popularisé le
Mouvement esthétique qui prônait la décoration «artistique» des maisons
de la classe moyenne par toute une gamme d'ornements intérieurs, de
préférence réalisés par des artisans locaux. Les Tillson ont donc engagé
James Walthew, un designer de Detroit, qui a travaillé de 1883 à 1887 à
la décoration de la maison. L'extérieur, déjà en construction à époque,
respecte de près les plans de la «villa de brique n°2» de l'ouvrage
«Villas and Cottages: or Homes for All», de William M. Wollett, d'Albany
dans l'état de New York. En 1985, on a ajouté à l'arrière de la maison
une aile moderne de deux étages servant de musée. L'édifice entier est
maintenant un musée.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1981 |
Lieu historique national du Canada de la Maison Banting
London, Ontario
La Maison Banting est un bâtiment en brique jaune de deux étages et
demi, anciennement habitée par le Dr Frederick Banting. La maison a été
construite en 1900, et on y a ajouté une aile moderne à l'arrière à la
fin du XXe siècle. Elle est située sur une grande artère du centre-ville
de London et abrite maintenant un musée qui présente la vie et les
réalisations de Banting.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait au fait qu'il témoigne de la
vie du Dr Banting.
Banting a acheté la maison du 442, rue Adelaide pour en faire son foyer
et son cabinet médical. Il y a emménagé en juillet 1920. Les pièces
situées à l'avant du rez-de-chaussée lui servaient de cabinet de
consultation, et il dormait dans la chambre d'en-avant à l'étage. Il
louait le reste de la maison à ses anciens propriétaires. C'est dans
cette maison, par une nuit d'octobre 1920, alors que sa situation
financière et ses responsabilités de conférencier à temps partiel à
l'université l'empêchaient de dormir, qu'il a découvert que le
prélèvement d'un extrait du pancréas d'un chien pourrait être utile dans
le traitement du diabète. Il a réussi, grâce à l'aide du professeur
J.J.R. Macleod, à dénicher un laboratoire et un assistant (Charles H.
Best) à l'Université de Toronto. Ils y ont effectué, avec l'aide de
James B. Collip, des travaux de recherches qui allaient mener à la
découverte de l'insuline en janvier 1922. Banting a vendu sa maison à la
fin de 1921.
La maison, à l'exception de l'ajout moderne construit sur le côté est, a
conservé son intégrité architecturale. Elle est mondialement reconnue
comme le « lieu de naissance de l'insuline », et revêt une importance
particulière pour tous les diabétiques et ceux qui effectuent des
recherches sur la maladie. C'est le seul édifice historique lié à
Banting et à la découverte de l'insuline au cours de la période
1920-1922.
|
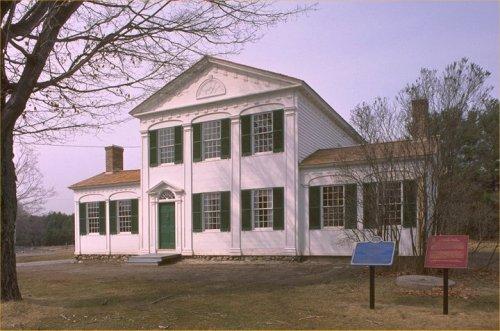
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1985 |
Lieu historique national du Canada de la Maison Barnum
Grafton, Ontario
Cet édifice, inspiré des grandes traditions architecturales européennes,
démontre que le classicisme peut s'adapter à un bâtiment de dimensions
modestes construit dans une zone frontalière. La composition symétrique
et les ornements classiques, tels que le fronton du pignon et l'élégante
arcature aveugle agrémentant la façade, confèrent à ce petit joyau de
style néo-classique son charme et sa dignité. Un ajout moderne a été
construit à l'arrière.
Cette maison de bois a été construite vers 1820 pour le colonel Eliakim
Barnum, un émigrant américain. Elle illustre l'influence du style
néo-classique, introduit au Canada par des colons de la
Nouvelle-Angleterre familiers avec le style fédéral développé dans le
Nord-Est des États-Unis, dans l'architecture domestique. La disposition
de l'ensemble, composé d'un corps principal flanqué de deux ailes est
d'inspiration palladienne, mais la façade du corps principal rappelant
celle d'un temple, le fronton imposant et les murs égaux percés
d'arcades aveugles sont de style néo-classique. La porte à fronton
soutenue par des pilastres, les corniches décoratives et le tympan orné
d'un motif en éventail sont autant de motifs néo-classiques qui
présentent une finesse et une linéarité particulières aux maisons de
bois.
|

©ERA Architects / Courtesy of Emma Greer |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Bethune-Thompson / Maison-White
Williamstown, Ontario
La Maison-Bethune-Thompson / Maison-White évoque éloquemment son époque
et sa région. Elle combine une construction de type poteaux-sur-sol et
une véranda, typiques de l'architecture québécoise, avec la symétrie et
les ornements classiques typiques des influences architecturales
britanniques de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècles. Son
intérieur, tout comme son extérieur, remarquablement bien conservés,
font partie de la désignation.
Cette ancienne maison ontarienne présente à la fois une conception
classique et des techniques de construction historiques. L'aile sud en
billes verticales date peut-être des années 1780, époque à laquelle le
loyaliste Peter Ferguson s'est établi sur le site. La partie centrale de
la maison a été construite aux environs de 1805 pour servir de
presbytère au révérend John Bethune, premier pasteur presbytérien du
Haut-Canada. Elle a servi par la suite de résidence à l'explorateur
David Thompson. Sous le stuc du bloc principal, trois des murs de la
charpente de bois sont remplis de moellons bruts et le quatrième d'un
mélange «de bouts de bois et de boue». La façade à cinq baies,
anciennement flanquée d'ailes similaires, est de tradition britannique
classique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canad, M. Schwartz, 2006a |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Billings
Ottawa, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Billings, une
résidence raffinée s'élevant sur deux étages et demi, construite en bois
et comportant cinq baies, est l'une des plus vieilles résidences
d'Ottawa. Le classicisme, dont sa conception s'inspire, confère à la
maison Billings, autrefois noyau du village de Billings Bridge, une
certaine grandeur. Ancienne demeure de la famille Billings, elle sert
dorénavant de musée.
La maison Billings, l'une des plus vieilles résidences d'Ottawa, a été
construite par Braddish Billings, né au Massachusetts en 1783, qui a été
le premier à s'établir dans le canton de Gloucester, en 1812. La
résidence Billings devint le noyau de la communauté de Billings Bridge à
Ottawa. Son architecture s'inspire du style caractéristique de la
Nouvelle-Angleterre de l'époque géorgienne et se distingue par ses
détails raffinés classiques. La maison d'origine a été construite entre
1828 et 1829, mais l'aile est, un élément architectural d'une ancienne
demeure de Billings, a été déménagée et lui a été annexée en 1831. Plus
tard, une véranda de deux étages a été démolie, et des lucarnes ainsi
que l'aile ouest ont été ajoutées; la demeure s'est dès lors composée
d'un pavillon central flanqué de deux ailes.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, B. Morin, 1995 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Commémorative-Bethune
Gravenhurst, Ontario
Lieu de naissance du Dr Norman Bethune, héros national des Chinois et
peut-être le plus grand humanitaire international canadien.
Le lieu historique national du Canada de la
Maison-Commémorative-Bethune, le presbytère original de l'église
presbytérienne Knox, est situé dans le vieux quartier résidentiel de
Gravenhurst, Ontario.
La valeur patrimoniale du lieu réside dans son association avec le Dr
Norman Bethune et dans le fait qu'il illustre le cadre dans lequel s'est
déroulée son enfance. La famille Bethune n'a vécu dans la maison que de
1890 à 1893; elle a ensuite déménagé dans une nouvelle paroisse, dans
une autre petite ville de l'Ontario. Les Chinois vénèrent le Dr Norman
Bethune à grâce à l'oeuvre qu'il a accomplie dans leur pays, servant sur
les champs de bataille, formant du personnel médical et mettant sur pied
des programmes médicaux et des hôpitaux. La société chinoise voit en lui
un modèle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |
Lieu historique national du Canada de la Maison d'enfance de Billy Bishop
Owen Sound, Ontario
Le lieu historique national de la Maison d'enfance de Billy Bishop est
une imposante maison de brique à deux étages et demi, situé dans un
quartier résidentiel d'Owen Sound, en Ontario. Elle est, avec sa solide
construction sans prétention de style, typique des maisons de la classe
moyenne canadienne bâties à la fin du XIXe siècle.
La valeur patrimoniale de la Maison d'enfance de Billy Bishop a trait au
fait qu'elle témoigne de la vie du fameux pilote, particulièrement en
1894-1911, période où il y vivait. De plus, sa conception, la qualité
d'exécution de ses matériaux, son plan et son site, tous modestes et
typiques des maisons des petites villes canadiennes construites à la fin
du XIXe siècle.
L'as canadien de la première grande guerre mondiale, Billy Bishop, a
vécu dans cette maison du temps de sa naissance en 1894 jusqu'en 1911.
La maison avait été construite en 1884 et a continué à être habité par
des proches de la famille Bishop jusqu'en 1987. Depuis lors, elle abrite
le Billy Bishop Heritage Museum qui est ouvert au public.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1995 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Ermatinger
Sault Ste. Marie, Ontario
Le lieu historique du Canada de la Maison-Ermatinger est situé à Sault
Ste. Marie (Ontario). Construite entre 1814 et 1823 par Charles
Ermatinger de la Compagnie du Nord-Ouest, cette maison serait une des
plus anciennes dans le nord-ouest de l'Ontario. Cette maison de deux
étages et cinq ouvertures, d'inspiration classique, surmontée d'un toit
à comble en croupe, est construite en maçonnerie solide et comprend une
grosse charpente en bois.
Construite quand Sault Ste. Marie n'était encore qu'un petit poste de
traite des fourrures sur les lacs Supérieur et Huron, cette belle maison
est rapidement devenue le centre des affaires et de la vie sociale de la
région et a été remarquée par des visiteurs tels que Lord Selkirk, Anna
Jameson, Sir John Richarson, Paul Kane et George Catlin. Elle a été
construite entre 1812 et 1823 par Charles Ermatinger, commerçant de
fourrures indépendant qui était lié à Montréal, tant sur le plan des
affaires que sur le plan familial. En 1812, Ermatinger a conduit un
groupe de volontaires sous les ordres du capitaine Roberts pour
s'emparer de Michilimackinac, ce qui a rendu la région du nord plus sûre
pour les Britanniques et a fortement contribué à la reddition, par Hull,
de Détroit en août 1812. La famille Ermatinger a quitté Sault Ste. Marie
en 1828.
Cette imposante maison, grande pour son époque (10 m sur 12 m) et avec
sa construction en maçonnerie et sa conception d'inspiration classique,
était alors un remarquable centre d'intérêt. Elle a servi de mission,
d'hôtel, de taverne, de tribunal, de bureau de poste, de salle de bal,
de salon de thé et de logement à ses occupants successifs. En 1965, la
ville de Sault Ste. Marie en a fait l'acquisition et l'a restaurée dans
son apparence d'origine. Elle abrite à présent un musée.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, James De Jonge, 1997 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Familiale-Rurale-de-Bell
Brantford, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la
Maison-Familiale-Rurale-de-Bell est une propriété de banlieue dont le
bâtiment principal est typique de l'Ontario rural au milieu du XIXe
siècle. Cette maison d'un étage et demi, où on décèle une influence de
l'esthétique pittoresque, est coiffée d'un toit à pignon à pente faible.
Elle est ornée d'une porte centrale, de cheminées d'extrémité de pignon,
et d'un attrayant porche frontal en bois ouvragé. De plus, elle est
jouxtée d'une serre-jardin d'hiver et entourée d'un aménagement paysager
pittoresque. Le lotissement contient également une remise en bois pour
les voitures et un ensemble de structures modestes liées à
l'exploitation du lieu à titre de musée.
La valeur patrimoniale de ce lieu réside dans ses liens historiques tels
qu'illustrés par l'emplacement, la conception et les matériaux d'origine
de la maison. Dans la maison de ses parents, Alexander Graham Bell a
conçu en juillet 1874 son idée fondamentale du téléphone, puis il a
effectué en août 1876 les premiers essais réussis de transmission à
longue distance. La maison familiale rurale de Bell évoque l'influence
formatrice du père de Bell, qui était une sommité en matière
d'acoustique de la parole, ainsi que celle de sa mère, qui était sourde.
Ils ont stimulé chez leur fils un intérêt pour l'enseignement de la
parole aux sourds, une passion qu'il a conservé toute sa vie et qui
s'est avérée cruciale pour la découverte du téléphone. La maison
familiale rurale de Bell est depuis le début du XXe siècle un symbole du
remarquable accomplissement de cet inventeur. En 1935, à cause de
l'érosion de la falaise située en arrière, on a déplacé la maison et la
remise vers l'avant du lotissement, les installant sur de nouvelles
fondations, plus près de la route principale. Malgré la perte d'une
partie de la propriété au fil des ans, et notamment de la plupart des
dépendances et d'un verger, le lieu demeure dans un contexte semi-rural
et un environnement paisible. La serre-jardin d'hiver d'origine de
l'époque de Bell a été reconstruite dans les années 1970, tout comme la
véranda et les cheminées de la maison.
|

©City of Windsor, Nancy Morand |
Lieu historique national du Canada de la Maison François-Bâby
Windsor, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Maison François-Bâby est une
maison de belles proportions en brique rouge de deux étages, de style
néo-géorgien, dont la construction remonte au début du XIXe siècle. Elle
est située dans un lotissement bien entouré, sur la rive sud de la
rivière Detroit au centre-ville de Windsor, en Ontario. La maison et son
lotissement sont entourés par une zone de développement urbain dense.
La valeur patrimoniale de la maison François-Bâby découle du rôle
important qu'elle a joué pendant la guerre de 1812. Son lien avec cet
épisode historique est attesté par le site, par les matériaux d'origine
qui subsistent de la maison largement remise en état, et par les
vestiges archéologiques connexes potentiels.
François Bâby, un politicien et administrateur local renommé, a commencé
à construire la maison au printemps 1812. En juillet 1812, les forces
américaines dirigées par le Brigadier-Général William Hull, ont traversé
la rivière Detroit, et se sont servies de la maison Bâby, en
construction mais située stratégiquement, comme quartier général pour
leur invasion. Quand Hull fut battu en retraite en août 1812, les forces
britanniques, dirigées par le Major-Général Isaac Brock, occupèrent la
maison Bâby. Les forces de Brock ont construit sur la propriété une
batterie d'artillerie de quatre canons, et ouvert le feu sur le Fort
Detroit. Le 16 août suivant, les Britanniques ont traversé la rivière,
Hull a capitulé et a rendu le Fort Detroit à Brock. En 1815, Bâby a
réintégré sa résidence et a développé la propriété. Il a aussi modifié
la maison au fil des ans. En 1948, la Windsor Historic Sites Association
a remis en état la structure de l'édifice, qui avait été abandonné
pendant des années et subi un incendie. La maison sert maintenant de
musée communautaire.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |
Lieu historique national du Canada de la Maison George-Brown
Toronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Maison George-Brown est une
résidence victorienne de trois étages, située à l'intersection des rues
Beverley et Baldwin, au cœur de Toronto. La propriété comprend un
édifice en brique rouge avec garniture en pierre de taille, coiffé d'un
toit mansardé, et l'élégante grille de fonte entourant le jardin qui ont
été construits pour George Brown, un des Père de la Confédération. La
maison, où George Brown a habité à la fin de sa vie, abrite aujourd'hui
un musée, une salle de réunion et des bureaux.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la
Maison George-Brown a trait à ses liens avec George Brown, et par
association avec l'avènement de la Confédération du Canada, ainsi
qu'avec le Mouvement abolitionniste et le Chemin de fer clandestin.
L'emplacement et les caractéristiques physiques de la maison évoquent
ces liens historiques.
Cette maison a été construite de 1875 à 1877 pour George Brown, et sa
famille l'a occupée de 1877 à 1886. Brown y a vécu, retiré du monde,
jusqu'à sa mort en 1881. Alors qu'il vivait là, Brown était rédacteur en
chef du journal The Globe, qu'il possédait, en plus d'être sénateur et
Père de la Confédération. Brown et sa famille ont également joué un rôle
crucial au sein du Mouvement abolitionniste, dont les activités
canadiennes étaient centrées à Toronto. Brown lui-même s'est impliqué
personnellement pour aider de nombreux réfugiés du Chemin de fer
clandestin. La Fondation du patrimoine ontarien a restauré la maison qui
est maintenant ouverte à la visite publique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Dennis Carter-Edwards, 1996. |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Glengarry
Cornwall, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Glengarry est situé
sur Stonehouse Point, juste à l'est de Cornwall, en Ontario. Maintenant
en ruine, il comprend les murs de pignon en pierres des champs de la
maison qui sont aujourd'hui couverts de broussailles. La maison a
vraisemblablement été construite en 1792 par le Lieutenant colonel John
Macdonell, premier président de l'assemblée législative du Haut Canada
et pionnier de la colonisation de l'Ontario. L'endroit désigné comprend
les ruines de la maison Glengarry sur son tracé au sol.
Au terme de la Révolution américaine, John Macdonell reçoit de la
Couronne une terre en récompense de son service militaire. Il y bâtit
probablement une première maison en bois rond, mais on signale qu'en
1792, il a presque terminé la construction d'une grande maison en
pierres des champs près de la rive du fleuve Saint-Laurent. Macdonell la
nommera la maison Glengarry.
Peu de détails subsistent quant à l'utilisation de la maison après la
mort de Macdonell. Pendant la guerre de 1812, elle est convertie en
caserne et habitée par les soldats de la milice locale, qui
l'endommagent considérablement. Les habitants de la région racontent que
la maison aurait brulé en 1813, mais cela semble peu probable puisqu'on
a présenté au gouvernement britannique, en 1815 et 1825, des demandes de
remboursement des coûts de rénovation de la maison. Dans les années
1890, la maison est en ruine, et seuls les murs de pignon demeurent
debout. En 1921, la Commission des lieux et monuments historiques du
Canada recommande qu'elle soit désignée lieu historique national du
Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, M. D'Abramo, 2006 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Griffin
Hamilton, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Griffin est une
modeste résidence d'un étage et demi située au sommet d'une colline
surplombant la vallée Dundas dans le canton d'Ancaster, aujourd'hui la
ville de Hamilton. Construite vers 1827, l'habitation simple de style
géorgien est typique des résidences de quatre pièces que l'on retrouvait
dans le Haut-Canada au XIXe siècle. Elle est surmontée d'un toit à
pignon incliné vers l'avant et revêtue de bardage à clins horizontal
sans finition.
Au XIXe siècle, avant la Confédération, de nombreux immigrants noirs ont
emprunté le chemin de fer clandestin pour quitter les États-Unis et
venir s'installer au Canada, fuyant l'esclavage et les lois restrictives
qui les régissaient. Enerals Griffin, l'un de ces pionniers noirs qui
ont choisi de s'établir au Canada, est arrivé dans la région de Niagara
avec sa femme en 1829. En 1834, M. Griffin a acheté, de George Hogeboom,
l'ancienne maison Lawrason et cinquante acres (202 342,8 mètres carrés)
de terrain. La maison Griffin est l'un des rares exemples qui subsistent
encore aujourd'hui d'habitation typique de quatre pièces que l'on
retrouvait dans le Haut Canada à cette époque. Elle a subi d'importantes
restaurations entre 1992 et 1994 afin qu'elle retrouve l'apparence des
années 1830-1850.
En plus de sa valeur architecturale, la maison Griffin est aussi
particulière sur le plan historique parce qu'elle témoigne de la
complexité de l'expérience des Noirs en Amérique du Nord britannique
durant les premières années du chemin de fer clandestin, en ce sens
qu'elle représente une habitation plus raffinée que celles
habituellement associées aux réfugiés noirs. L'emplacement de la maison
Griffin dans le canton d'Ancaster (devenu la ville de Hamilton)
contribue également à la valeur historique du lieu. En effet, au XIXe
siècle, les immigrants étaient plus attirés par le marché du travail et
le potentiel agricole de la communauté à prédominance euro-canadienne
que par les établissements planifiés de réfugiés du Sud-Ouest de
l'Ontario. La maison Griffin représente l'établissement permanent des
immigrants noirs dans ce qui est à présent le Canada, puisqu'elle est
passée d'une génération de Griffin à l'autre jusqu'en 1988, année où
elle a été vendue à la Hamilton Conservation Authority.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de La maison Hart Massey
Ottawa, Ontario
La valeur patrimoniale de la maison Hart Massey repose sur ses intérêts
architectural et environnemental. Elle a été érigée en 1959 selon les
plans de l'architecte Hart Massey, qui l'habitat jusque dans les années
1970. Cette résidence est un exemple emblématique de l'architecture
moderne résidentielle de la moitié du XXe siècle au pays et un spécimen
canadien de style international en raison de sa prise en compte du
paysage environnant. Conçue à partir d'un plan rectiligne, il s'agit
d'une structure minimaliste composée d'une série de boîtes modulaires,
certaines vitrées, d'autres à parois opaques, qui s'ouvrent sur la
nature et qui en font un ensemble architectural tout à fait unique.
Cette prestigieuse résidence reflète les goûts personnels et les idéaux
modernistes de l'architecte Hart Massey, qui l'a conçue pour lui et sa
famille et qui lui a valu la médaille d'argent des prix Massey pour
l'architecture, la plus haute distinction de l'époque. Suspendue sur de
fines poutres d'acier qui semblent flotter au-dessus d'un terrain
fortement incliné face au lac Mckay, la maison a été conçue dans le
souci de préserver l'intégrité de son environnement naturel; son
architecture se prolongeant dans le paysage et ses immenses parois
vitrées supprimant les barrières entre l'espace intérieur et extérieur.
La maison Massey est située dans le quartier résidentiel de Rockcliffe
Park, à Ottawa. C'est l'une des rares propriétés construites directement
sur les rives du lac McKay. Elle compte deux étages. Les aires communes
sont situées au niveau inférieur tandis que les chambres sont situées au
deuxième étage. Dans son désir de préserver la nature du site, Massey
éleva la maison hors terre sur de fines colonnes. Des arbres matures,
incluant un grand saule au nord, des arbustes, des buissons, des fleurs,
des plantes vivaces et des aires gazonnées agrémentent la propriété, le
tout intégré à un site en pente. Les façades sont lisses et dépourvues
d'ornementation et les grandes surfaces de verre exposent un système
structurel basé sur une ossature en acier ou en béton armé. Le côté de
la maison faisant face au lac, comporte des fenêtres du sol au plafond
qui donnent une vue entièrement dégagée du paysage environnant. À
l'intérieur, les murs de séparation du rez-de-chaussée ont une hauteur
aux trois quarts pour créer une aire ouverte. On trouve un agencement de
beige et de noir dans toute la maison.
Le bâtiment a subi des changements au fil des ans. Le plus important fut
certes l'agrandissement de la maison au nord en 1993 par l'ajout d'une
boîte modulaire sur chacun des niveaux. Toutefois, l'intégrité de sa
conception esthétique ainsi que du traitement des matériaux a été
maintenue. Les propriétaires suivants ont soigneusement restauré et
rénové la maison tout en respectant méticuleusement son concept
d'origine. Quelques changements ont aussi été apportés à l'aménagement
paysager en accord avec l'architecture de la maison. Des jardins ont été
intégrés avec succès et de nouvelles variétés de plantes et de fleurs
continuent d'être introduites.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Hillary
Aurora, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Hillary est une
résidence en brique d'un étage et demi de style néogothique, entourée de
grandes pelouses, d'arbres et de plantes. Elle est située dans la ville
d'Aurora en Ontario, juste au nord de Toronto. La maison et son parc
constituent un excellent exemple de villa du milieu du XIXe siècle,
s'adaptant au style pittoresque en vogue à cette époque. Elle est
maintenant exploitée sous le nom de The Koffler Museum of Medecine.
Construite en 1861-1862 pour la famille Geikie, puis modifiée par ses
propriétaires subséquents en 1869 et en 1888, la maison et son parc
constituent un des exemples les plus complets du style néogothique
pittoresque en Ontario. Les deux ajouts successifs attestent l'évolution
du style néogothique. L'ajout construit en 1888 a été conçu par
l'architecte David Dick.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Butterill, 1995. |
Lieu historique national du Canada de la Maison Homer-Watson / École-des-Beaux-Arts-Doon
Kitchener, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Homer-Watson /
École-des-Beaux-Arts-Doon est situé dans la localité de Doon, qui fait
aujourd'hui partie de la ville de Kitchener (Ontario). Il s'agit d'une
maison modeste d'un étage et demi datant du XIXe siècle, situé sur une
grande propriété, qui a servi de logement et d'atelier au paysagiste
canadien Homer Watson. La maison a été designée pour son ajout
remarquable qui abrite une galerie et un atelier, dans lequel on trouve
des œuvres d'art et des espaces de création associés à la carrière
d'Homer Watson.
Le paysagiste canadien Homer Watson (1856-1936), commémoré en 1939 par
la Commission des lieux et monuments historiques du Canada en tant que
personne historique nationale, est né à Doon. Il a acheté cette maison
en 1881, année où il s'est marié, et il y a vécu jusqu'à sa mort en
1936. La résidence, construite en 1834, était à l'origine une maison de
ferme typique du XIXe siècle en brique puis Watson l'a personnalisée
afin de poursuivre son art en y a soutant un atelier, à l'arrière (1893)
et une galerie (1906). Sa valeur tient particulièrement aux salles et
aux endroits associés à son art, à son atelier et aux espaces de
galerie, aux paysages et aux caractéristiques des environs associés à
ses peintures, et à l'emplacement de la résidence dans la communauté
historique de Doon. Certaines des œuvres les plus respectées de Watson
représentent des paysages des environs vus de différents emplacements
sur la propriété. La maison a abrité l'École des beaux-arts Doon et a
constitué un monument privé à la mémoire de Homer Watson. Depuis, c'est
la ville de Kitchener qui en a assumé la gestion.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1988 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Inverarden
Cornwall, Ontario
Important cottage de style Régency construit en 1816; lié au commerce
des fourrures.
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Inverarden est une
belle maison du début du XIXe siècle érigée sur un lot d'un hectare qui
faisait partie du domaine original de John McDonald of Garth, du côté
nord de la route de comté 2 (autrefois la route 2), en bordure du fleuve
Saint-Laurent, dans la banlieue de Cornwall.
La valeur patrimoniale du lieu réside dans son illustration de
l'architecture domestique de style Regency et dans son association avec
le commerçant de fourrures John McDonald of Garth, de la Compagnie du
Nord-Ouest.
La maison Inverarden témoigne parfaitement du goût et de la position
sociale des commerçants de fourrures de la Compagnie du Nord-Ouest venus
vivre leur retraite dans cette région de l'Ontario au XIXe siècle. John
McDonald of Garth a construit le corps central de la maison Inverarden
en 1816, puis il l'a flanqué d'ailes (1821-1823) pour en faire une
imposante demeure de style Régence.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1998 |
Lieu historique national de la Maison Joseph-Schneider
Kitchener, Ontario
Le lieu historique national de la Maison Joseph-Schneider, situé sur une
des principales artères de la ville de Kitchener, est un vestige de
propriété construite au début du XIXe siècle pour abriter une famille
mennonite. Actuellement, cette maison à charpente de bois de deux étages
sert de musée. Ses dépendances reconstruites comprennent une
boulangerie, un lavoir, un jardin d'époque, un verger, et une partie de
la forêt-parc située près d'un ancien bassin de réserve.
La Maison Joseph-Schneider a été désignée lieu historique national du
Canada parce qu'elle rappelle la principale vague d'immigrants
mennonites germanophones partis du comté Lancaster en Pennsylvanie pour
s'établir dans le comté de Waterloo au début du XIXe siècle, ainsi que
pour son plan vernaculaire conçu par les Mennonites de Pennsylvanie
avant la Révolution américaine.
Construite vers 1816 par Joseph Schneider, chef des immigrants
mennonites germanophones partis du Nord de la Pennsylvanie aux
États-Unis en 1807, cette propriété a été convertie en musée en
1979.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Laurier
Ottawa, Ontario
Maison de deux premiers ministres du Canada, sir Wilfrid Laurier et
William Lyon Mackenzie King, style Second Empire, 1878.
Le lieu historique national du Canada de la Maison Laurier est une
grande maison de style Second Empire située sur un lot résidentiel, au
coin nord-ouest des rues Laurier et Chapel, dans le quartier historique
de la Côte-de-Sable Est, à Ottawa.
La valeur patrimoniale du lieu réside dans son association avec les
premiers ministres sir Wilfrid Laurier et William Lyon Mackenzie King
ainsi que dans son illustration de leur carrière politique.
Conçue par l'architecte James Mather, cette maison de style Second
Empire a été construite en 1879 pour un bijoutier d'Ottawa. Elle a
ensuite été achetée et habitée par sir Wilfrid Laurier (1897-1919), puis
par Mackenzie King (1923-1950), tous deux chefs du parti libéral à leur
époque respective. Jusqu'en 1950, le Canada n'avait pas de résidence
officielle pour ses dirigeants politiques. Laurier et King ont tous deux
été premier ministre du Canada (1896-1911, 1921-1925, 1926-1930,
1935-1948) et chef de l'opposition officielle pendant qu'ils vivaient à
la maison Laurier. Ayant transformé le troisième étage de la maison en «
bureau », King y menait d'ailleurs une bonne partie des affaires de
l'État.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Shannon Ricketts, 1996 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Macdonell-Williamson
East Hawkesbury, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Macdonell-Williamson,
également appelée Villa des Peupliers, est situé sur le bord de la
rivière des Outaouais, dans la ville de Pointe Fortune, en Ontario. Il
s'agit d'une élégante résidence en pierre bâtie selon une adaptation
locale du style palladien. Cette maison de deux étages présente une
façade principale de cinq baies coiffée d'un toit en croupe bas et un
intérieur agréablement ornementé. La maison est construite sur un
lotissement herbagé, vestige d'un ancien domaine fonctionnel. Elle
illustre la renommée de son premier propriétaire, John Macdonell, un
éminent homme politique et d'affaires du début du XIXe siècle.
La valeur patrimoniale de la maison Macdonell a trait à son ancienneté
et à sa présence architecturale imposante, ainsi qu'à ses liens avec
John Macdonell et, de ce fait, avec un important phénomène commercial et
résidentiel. Sa valeur a trait à l'excellence de la conception, des
matériaux et de la facture de la résidence, tant sur le plan extérieur
qu'intérieur, ainsi qu'à son emplacement.
La maison Macdonell a été construite en 1817-1819 pour l'ancien associé
de la Compagnie du Nord-Ouest John Macdonell, et sa femme métisse
Magdeleine Poitras. Macdonell était l'un des anciens administrateurs de
la Compagnie du Nord-Ouest qui se sont fait construire une maison de
retraite sur les rives de la rivière des Outaouais, à l'ouest de
Montréal, au début du XIXe siècle. Macdonell est décédé en 1850. La
famille Williamson a acheté la maison en 1882 et l'a habitée jusqu'en
1961, date à laquelle elle a été expropriée pour la construction du
barrage de l'Hydro Québec à Carillon. La Fondation du patrimoine
ontarien en est devenue propriétaire en 1978.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Butterill, 1995 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Matheson
Perth, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Matheson, situé au
cœur du vieux Perth, en Ontario, a été construit en 1840 par Roderick
Matheson, un marchand d'origine écossaise. Cette élégante maison est
typique des résidences d'inspiration palladienne des gens fortunés de
l'époque précédant la Confédération canadienne. Exemple tardif de ce
type de maison, cette résidence en grès à deux étages et à cinq
ouvertures est d'une conception classique, avec une élévation principale
symétrique et une façade en saillie couronnée d'un fronton. La maison
est unique en son genre en raison du fait qu'elle faisait partie d'un
groupe d'édifices comprenant une boutique, deux entrepôts et une remise
ayant appartenu à une même famille et faisant toujours partie du paysage
des rues Gore et Foster.
Roderick Matheson émigra de l'Écosse au Canada en 1805, et poursuivit
une carrière militaire dans les Glengarry Light Infantry Fencibles, où
il devint commissaire payeur pendant la guerre de 1812. En 1816, à la
fin de la guerre, il fut mis en demi-solde et il reçut une parcelle de
terre de 230 acres dans le territoire militaire de Perth. Il devint un
marchand prospère, membre du Conseil législatif et sénateur. La maison
est restée dans la famille jusqu'en 1930. En 1966, la ville de Perth l'a
achetée et réhabilitée pour en faire le musée de Perth.
La maison est représentative de l'ancienne architecture canadienne
écossaise dans son inspiration classique, sa décoration simple et
l'utilisation de matériaux de construction en pierre. Le paysage de rue,
dont elle constitue un élément important, continue cette typologie avec
ses édifices d'inspiration classique en pierre locale bâtis en bordure
de la rue.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1990 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-McCrae
Guelph, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Maison-McCrae est un
bungalow en pierre, du milieu du XIXe siècle, situé au 108, rue Water,
avec vue sur un parc jouxtant la rivière Speed à l'extrémité sud de
Guelph, en Ontario. La maison a été renommée, car le poète canadien
auteur de ''In Flanders Fields'', le colonel John McCrae, y est né.
La maison McCrae a été désignée lieu historique national du Canada en
1966 en raison de son importance pour l'histoire de l'architecture, et
parce qu'elle est le lieu de naissance de John McCrae.
Le poète et colonel canadien John McCrae est né dans la maison McCrae le
20 novembre 1872. McCrae lui-même a été reconnu personnage historique
d'importance nationale en 1946 parce qu'il a écrit le poème ''In
Flanders Fields'' en 1915 sur le champ de bataille d'Ypres, en Belgique.
Ce poème, publié anonymement dans le magazine britannique Punch, est
devenu un des poèmes les plus célèbres de la Première Guerre mondiale. À
cause de lui, le coquelicot est devenu le symbole des soldats morts
durant cette guerre, qui constituent une importante cohorte dont McCrae
fait partie. Un an après la naissance de McCrae, sa famille a quitté
cette maison, même s'il a continué à vivre à Guelph jusqu'à ce qu'il
obtienne son diplôme en médecine à Toronto, puis qu'il serve dans le
corps médical de l'armée canadienne en Europe. La maison, construite
entre 1850 et 1860, a subi quelques modifications au fil des ans.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la
Maison-McCrae a principalement trait à ses liens avec le colonel John
McCrae, tels qu'illustrés par son caractère de résidence ontarienne
modeste de la classe moyenne au XIXe siècle, et notamment par les
caractéristiques qu'elle a conservées, reliées à la période pendant
laquelle la famille McCrae l'occupait en 1872-1873.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1981 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-McMartin
Perth, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Maison-McMartin est une
belle construction en brique rouge à deux étages, située au 125 de la
rue Gore, dans le centre de Perth (Ontario). Son architecture
d'inspiration classique, particulièrement ouvragée pour l'époque et
l'endroit, a été préservée pour en faire un musée.
Si la Maison McMartin a été désignée lieu historique national en 1972,
c'est parce que cette imposante maison symbolise les aspirations
sociales et financières d'un membre de l'élite loyaliste.
Le lieu historique national du Canada de la Maison-McMartin a été
construit en 1830 pour Daniel McMartin (1798-1869), un des premiers
avocats de Perth, alors capitale du district de Bathurst. Daniel
McMartin, qui est né à Williamsburg dans une famille loyaliste, a fait
ses études au lycée John Strachan de Cornwall et à Osgoode Hall, à
Toronto. Il appartenait à l'élite loyaliste du Haut-Canada. La maison
qu'il a fait construire était une construction chic et ouvragée, reflet
du style fédéral américain. En 1883, elle a connu d'importantes
rénovations et, en 1919, son intérieur a été modifié et elle est devenue
salle paroissiale de l'église catholique romaine St. John. En 1972, elle
a été achetée par la Fondation du patrimoine ontarien, qui a procédé à
des réparations au fil des ans.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la
Maison McMartin tient à son lien avec l'élite loyaliste au pouvoir,
comme le montre son style raffiné, ses proportions imposantes, sa
composition subtile et ses détails ouvragés.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Maison-McQuesten / Whitehern
Hamilton, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Maison-McQuesten /
Whitehern, demeure élégante en pierre du milieu du XIXe siècle, est
située dans un jardin fermé, au 41, rue Jackson Ouest à Hamilton. Cette
maison de deux étages de style néoclassique, résidence d'une famille
importante, les McQuestens, a conservé plusieurs des installations et
des pièces de mobilier des époques victorienne et édouardienne. Elle
abrite à présent un musée.
La maison McQuesten / Whitehern est un exemple supérieur d'architecture
résidentielle du milieu du XIXe siècle et elle est typique des grandes
maisons construites à cette époque en Ontario. La maison a été
construite en 1848 par Richard O. Duggan en tant que pièce maîtresse
d'un domaine résidentiel. En 1852, elle a été achetée par le docteur
Calvin McQuesten et elle est demeurée propriété de la famille McQuesten
jusqu'en 1959, année où celle-ci en a fait don à la ville de Hamilton. À
l'époque de l'honorable T.B. McQuesten, ministre ontarien renommé,
certaines modifications ont été apportées à la maison : le domaine a été
réduit, et les jardins ont été dessinés par la société paysagiste
Dunnington-Grub. Entre 1968 et 1971, la maison a été restaurée pour
devenir un musée.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Dianne Dodd, 2002 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Musée-Erland-Lee
Hamilton, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Musée-Erland-Lee est
situé dans un paysage rural de la ville de Stoney Creek (Ontario). C'est
dans cette maison de ferme ornementée de style néogothique qu'a été
rédigée la constitution du très réputé Institut féminin. La maison d'un
étage et demi, avec parement avec couvre-joints et la menuiserie
particulière en dentelle de bois, se dresse au milieu du parterre
gazonné et de jardins.
La Maison-Musée-Erland-Lee, construite en bois rond en 1808, a été
modifiée et agrandie en 1860 et en 1873 par Abram Lee, père d'Erland
Lee, et elle a gardé aujourd'hui son apparence des années 1890. Elle est
associée à la fondation du premier Institut féminin en tant que
résidence de Janet Chisholme Lee et de son mari Erland Lee qui,
ensemble, ont organisé la réunion de la fondation, rédigé la
constitution, officialisé le soutien du gouvernement provincial et
incarné un très bel exemple dans Stoney Creek.
La maison est devenue le symbole puissant et largement reconnu des
Instituts féminins tant au Canada qu'à l'étranger. Siège de l'«institut
mère», il constitue le lieu le plus intimement associé à la création
d'une importante organisation d'agricultrices centrée sur la famille,
l'amélioration de soi et de son environnement. La maison en soi est
typique des nombreux soi-disant cottages ontariens, qui présentent une
masse rectangulaire d'un étage et demi, une façade à trois ouvertures
avec une porte centrale, un pignon central qui amortit un toit incliné
en pente vers l'avant, et un plan intérieur avec un escalier central.
L'élaboration de son décor témoigne des objectifs d'«amélioration» du
mouvement.
|

©J. A. Cousineau, Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2017 |
Lieu historique national du Canada de La maison Park
Amherstburg, Ontario
La maison Park, une résidence du XVIIIe siècle située sur la principale
rue commerciale d'Amherstburg, en Ontario, est considérée comme l'une
des plus anciennes maisons de la région. La date exacte de sa
construction est inconnue, mais il est dit depuis longtemps que cette
habitation dotée d'un entrepôt a été transportée sur les eaux de la
rivière Détroit jusqu'au Haut-Canada par ses propriétaires loyalistes
lorsque l'Angleterre a cédé Détroit aux Américains, en 1796. La maison
Park possède une histoire associée aux fluctuations économiques qu'a
connue cette région transfrontalière du sud de l'Ontario. Son
utilisation initiale par les marchands relocalisés de Détroit puis sa
transformation par les frères Park dans le contexte de l'industrie
maritime locale sont des témoins historiques de la colonisation dans la
région de Windsor, là où les enjeux du pouvoir colonial se manifestaient
non seulement dans les frontières floues, mais aussi dans l'architecture
et les paysages de la région. Il s'agit d'un rare exemple de bâtiments
de type colonial qui étaient autrefois très courants dans les colonies
et les postes de traite partout en Amérique du Nord. Sa conception
asymétrique, l'aménagement d'un couloir central et la construction de
poteaux rainurés de type français tirent leur origine des
caractéristiques courantes des bâtiments canadiens-français.
Située sur un grand terrain bordant la rivière Détroit, la maison Park
appartient à des groupes ou à des particuliers œuvrant dans le commerce
fluvial entre les années 1790 et le milieu du XIXe siècle. Elle sert aux
marchands relocalisés de Détroit à la fin du commerce de la fourrure
avec la France et l'Angleterre, à l'époque où la frontière
internationale avec les États-Unis est tracée. En 1823, la maison est
achetée par les frères Park, qui la transforment pour l'utiliser pour
l'industrie maritime locale. De 1881 à 1936, la maison est habitée par
un médecin de la région, Theodore Park, qui y établit son cabinet et
fait construire une aile pour y installer ses bureaux.
La maison Park présente une variante du style de construction pièce sur
pièce connue sous le nom de construction poteaux-en-coulisse. La méthode
de construction pièce sur pièce, qui consiste à superposer des pièces
équarries à l'horizontale, est une caractéristique importante du paysage
de la Nouvelle-France. Des poteaux de coin et de mur verticaux sont
mortaisés, soutenant les extrémités tenonnées des rondins horizontaux,
qui glissent les uns sur les autres. Le style pièce sur pièce se répand
dans tout le pays durant le commerce de la fourrure grâce au travail
d'artisans accomplis.
Au cœur de la région où se trouve le plus ancien établissement français
permanent en Ontario, la maison Park témoigne de la mobilité de la
population de descendance française à l'heure où le Régime français tire
à sa fin et que le Haut-Canada fait son apparition. Par son
architecture, la maison Park relate l'histoire des commerçants et des
artisans qui ont peuplé la région de Windsor. En 1972, lorsque le
bâtiment est installé à l'endroit où il se trouve aujourd'hui, la
structure de ses murs intérieurs a été révélée. Elle l'est restée
depuis, témoignant de la manière dont les artisans français ont mis à
profit leur ingéniosité pour adapter d'anciennes techniques à la
topographie, aux matériaux et au climat d'une nouvelle terre.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-de-Sir-John-Johnson
Williamstown, Ontario
Maison du célèbre Loyaliste (1780).
Le lieu historique national du Canada de la Maison-de-Sir-John-Johnson
est une vaste maison en bois typique des constructions vernaculaires de
l'Ontario au XIXe siècle, érigée sur un grand terrain au bord de la
rivière Raisin, à Williamstown, Ontario. La maison a évolué autour d'un
noyau datant de la fin du XVIIIe siècle. Le lieu désigné se compose
essentiellement de la maison ainsi que d'une remise, une glacière, et
des vestiges de la première aile ouest et la couche calcinée datant du
défrichage initial des terres.
La valeur patrimoniale de la maison de sir John Johnson réside dans son
illustration des techniques de construction des pionniers à la fin du
XVIIIe siècle et dans son association avec sir John Johnson. La
structure originale de la maison a été bâtie de 1784 à 1792 et faisait
partie d'un ensemble de bâtiments associés à un moulin. Elle a été
agrandie vers 1813-1830 (ajout ouest) et au début des années 1860 (ajout
est).
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Manège-Militaire-de-John Weir Foote
Hamilton, Ontario
Le manège militaire John Weir Foote est situé dans la partie commerçante
du centre-ville de Hamilton (Ontario). Il s'agit d'un grand édifice qui
se compose de deux sections construites à différents moments. La section
nord, sur la rue James, a été construite en 1888 selon le style à
l'italienne. La section sud, plus grande, qui se trouve à quelque 24
mètres (80 pieds) au sud de l'édifice original, a été terminée en 1908.
Un ajout de deux étages sur la rue James réunit les deux édifices, ce
qui donne une façade en brique continue. L'ensemble forme, avec l'ajout
construit en 1936 à l'arrière de la salle d'exercices nord qui réunit
cette dernière à la salle d'exercices sud, un nouveau grand complexe
autour d'une cour ouverte. La pierre rouge et les pierres de garniture
blanches utilisées donnent une impression d'unité au tout.
Conçue par Henry James, ingénieur en chef du ministère de la Milice, la
salle d'exercice du côté nord, qui constitue la première section du
manège militaire, fut construite en 1888 selon le style à l'italienne.
Il s'agit d'un des cinq exemples qui subsistent encore des premières
salles d'exercices permanentes de la deuxième phase de construction des
salles d'exercices au Canada, entre 1872 et 1895. Les caractéristiques
de cette deuxième phase sont l'emploi varié des styles, tels Château ou
à l'italienne, et l'adoption commune d'un plan rationnel. Les salles
d'exercices, construites en pierre ou en brique, révèlent une approche
prudente du traitement de grands espaces, comme on le voit ici dans les
fermes à deux poinçons en bois d'œuvre renforcé de la section nord. Ces
édifices ont été construits de plus en plus pour servir à la fois de
centres d'entraînement entièrement équipé et de cercle de loisirs. Le
manège militaire, construit en 1888, souligne aussi l'importance
continue de Hamilton en tant que centre de milice, et comme première
ligne de défense du pays.
En 1905, il a été décidé que Hamilton avait besoin d'une deuxième salle
d'exercices. Exceptionnellement, le ministère des Travaux publics a
accordé le contrat à la société d'architecture Stewart et Whitton. La
deuxième section, salle d'exercices sud (1905-1908), est plus grande que
la section nord et fait partie de la phase de 1896-1918 de la
construction des salles d'exercices, du temps où Frederick Borden était
ministre de la Milice (1896-1911). Il s'agit des salles d'exercices de «
catégorie A » réservées aux postes de commandement de bataillon et aux
centres militaires importants. Cette conception suit celle des salles
d'exercices des années 1880 et 1890, toutes les salles auxiliaires étant
disposées de part et d'autre d'une salle de deux étages. Les salles de
ces édifices de « catégorie A » ont une largeur standard allant de 22,8
m à 24,4 m, et la longueur varie entre 45,7 m et 71,6 m. Ces salles
d'exercices, aménagées pour l'entraînement et la classe, comportant des
installations récréatives et des toilettes modernes, ont établi une
nouvelle norme dans la modernisation de la milice. Une approche prudente
du traitement de grands espaces se voit dans les fermes à deux poinçons
en bois d'œuvre renforcé. La conception de la grande époque victorienne
pittoresque exprime le rôle de l'édifice par son vocabulaire
architectural, qui comprend des références militaires telles que les
tours d'angle et les portes pour les troupes. Il satisfait aussi la
position sociale de la milice et convient très bien au quartier
commerçant de Hamilton.
Le manège militaire sert à présent de siège au 11e Batterie, Royal
Canadian Artillery; à la Royal Hamilton Light Infantry; aux Argyll and
Sutherland Highlanders of Canada (Princess Louise's); et au 705 Escadron
des communications. L'édifice, qui s'appelait à l'origine le James
Street Armoury, a été rebaptisé John W. Foote VC Armoury en souvenir de
l'honorable lieutenant-colonel John Weir Foote VC, CD.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1980 |
Lieu historique national du Canada du Manège-Militaire-de-Peterborough
Peterborough, Ontario
Le manège, situé en plein centre-ville de Peterborough, en face du parc
de la Confédération, a été construit dans un style néo-roman robuste. La
brique rouge extérieure contraste avec les fondations en pierre mal
équarrie et les pierres décoratives. Ses belles proportions, ses
éléments et ses motifs militaires évoquent une forteresse médiévale. Le
toit à deux versants et la haute fenêtre couverte d'un arc du grand
manège compense l'accent mis sur la largeur de la façade principale.
L'entrée principale est monumentale, et la porte pour les troupes y est
surmontée d'une arche ornée de boulets trophées.
Profitant de la poussée de fierté nationale et de l'engouement militaire
suscités par la guerre des Boers (1899-1902), le gouvernement canadien
s'est engagé dans une réforme importante du système de défense national.
Le nouveau programme comprenait l'expansion et la modernisation de la
milice ainsi que la construction de manèges militaires dans tout le
pays.
Thomas Fuller, architecte en chef du ministère des Travaux publics, a
conçu le manège de Peterborough, qui était un des plus grands manèges de
classe B. Mesurant plus de 24 m sur 51 m, il est un des plus imposants
et des mieux conçus de l'époque. Il respecte, de plus, la norme en
matière d'espaces applicable aux manèges militaires en 1909, y compris
des manèges, des magasins, des bureaux administratifs et des services
d'hygiène.
Le manège militaire abrite le Hastings and Prince Edward Regiment,
formé, au départ, de deux régiments distincts, créés en 1800 et en 1804
et qui a pris part à de nombreux conflits, y compris la Guerre de 1812,
la Rébellion de 1837 et les deux Guerres mondiales. Le régiment a reçu
de nombreux honneurs de bataille pendant la Deuxième Guerre mondiale qui
sont inscrits sur ses drapeaux.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1999

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1980 |
Lieu historique national du Canada du Maple Leaf Gardens
Toronto, Ontario
Situé à l'intersection des rues Carlton et Church au centre ville de
Toronto, le lieu historique national du Canada du Maple Leaf Gardens
était à l'origine un aréna d'avant garde en brique jaune, construit pour
accueillir l'équipe de hockey des Toronto Maple Leafs. Il s'agit d'une
structure rectangulaire en béton dotée d'une charpente à poteaux et à
poutres et d'un plancher dalle; son esthétisme simple s'inspire des
styles Art Déco et Art Moderne caractérisés par des formes épurées et
une décoration géométrique. La façade de brique et de pierre s'élève sur
une hauteur de 27 mètres, et les formes géométriques simples sculptées
dans la pierre accentuent la verticalité du bâtiment. Un dôme
rectangulaire flottant ajoute au bâtiment un surplus de 19 mètres de
hauteur au dessus du niveau de la rue. Les besoins fonctionnels,
davantage que le souci des détails architecturaux, ont fait de cet
endroit solidement construit un lieu où les spectateurs se sont
retrouvés pendant 68 ans.
Construit en 1931, le Maple Leaf Gardens a été conçu pour accueillir en
grand nombre les partisans du club de hockey de Toronto, les Maple
Leafs, et a gardé son statut d'icône en tant que « temple du hockey » au
Canada, malgré le départ des Maple Leafs vers un nouvel aréna. Le
Gardens a été érigé par des travailleurs qui ont été payés en actions de
la société, ce qui les a incités à travailler rapidement. Commencé en
avril, l'aréna était terminé à peine huit mois plus tard. Quelque 13 233
spectateurs ont rempli l'aréna à pleine capacité pour assister à la
partie inaugurale entre les Leafs et les Chicago Blackhawks. Lorsque les
Leafs ont emporté la Coupe Stanley l'année suivante, ils sont rapidement
devenus l'équipe la plus connue de la Ligue avant la prolongation. Les
Maple Leafs ont gagné six Coupes Stanley entre 1941 et 1951 et ils ont
dominé le jeu. Leur association avec l'aréna en ont fait un sanctuaire
vénéré du hockey, tant en raison de la concurrence nationale entre
l'équipe torontoise et sa rivale de toujours, les Canadiens de Montréal,
qu'en raison de la concurrence à l'échelle internationale, lors de la
victoire de l'Équipe-Canada contre l'Union soviétique en 1972.
L'aréna était plus qu'un sanctuaire du hockey. Il a également été
pendant de nombreuses décennies le plus grand site intérieur au Canada
pour des événements culturels, politiques et religieux, attirant des
foules immenses pour de très nombreux moments mémorables de l'histoire
culturelle du pays. En plus du hockey, tant professionnel qu'amateur, le
Gardens a accueilli plusieurs manifestations sportives, incluant le
combat fameux pendant lequel le canadien George Chuvalo a perdu contre
Muhammed Ali après 15 reprises brutales de boxe. Alors que les
événements sportifs ont rempli le Gardens tout au long des années 1930,
d'autres types d'événements ont bientôt commencé à s'y tenir : des
discours, dont celui de Sir Winston Churchill en 1932 sur la nécessité
de renforcer l'empire britannique, des orchestres, des concerts, dont
deux concerts des Beatles à guichets fermés au sommet de la beatlemanie
en 1964, des rassemblements religieux, des manifestations politiques,
dont le plus grand ralliement communiste du pays dirigé par Tim Buck,
qui venait d'être libéré du Pénitencier de Kingston. Ces premiers
événements au Gardens reflètent la vie sociale du Canada et sa diversité
culturelle. Plus qu'un aréna d'hockey, il était aussi un lieu de culture
populaire au Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2009 |
Lieu historique national du Canada de Maplelawn-et-Ses-Jardins
Ottawa, Ontario
Le lieu historique national du Canada de Maplelawn-et-Ses-Jardins est
situé dans un quartier à la fois résidentiel et commercial d'Ottawa, en
Ontario. Le site comprend une imposante maison en pierre de deux étages
et demi et un jardin clos, datant du XIXe siècle. Construit dans la
tradition classique britannique pour William Thomson, la maison présente
une façade symétrique de cinq baies ainsi qu'un toit en croupe flanqué
de deux cheminées d'extrémité.
Maplelawn et ses jardins constituent un exemple rare et bien conservé de
domaine rural canadien du XIXe siècle. Construite de 1831 à 1834 pour
William Thomson, la résidence principale illustre parfaitement la
tradition classique britannique avec son plan rectangulaire, ses façades
symétriques et la position centrale de son entrée principale. Les
fenêtres à battants ne sont cependant pas propres à ce style; elles
témoignent plutôt de l'influence exercée par les bâtiments
canadiens-français sur l'architecture domestique dans la vallée de
l'Outaouais. L'intérieur s'ouvre sur un vaste hall d'entrée, surmonté
d'une arche centrale semi-elliptique néoclassique. L'escalier tournant
élégant, les portes à panneaux et les moulures de plafond sont typiques
des maisons construites à cette époque.
Tout près de la résidence, s'étend un jardin clos typique d'une acre,
dont il faut souligner la rareté qui s'inscrit dans la tradition
britannique au Canada. Disposé symétriquement, ce jardin comporte une
plate-bande centrale de forme ovale située à l'intersection de deux
sentiers en gravier, ce qui divise le jardin en quatre parterres
gazonnés. Le mur en maçonnerie de pierres d'origine encercle le jardin
et la maison, située dans la partie ouest de l'enceinte. Initialement,
le jardin servait principalement de potager à la famille Thomson, mais
dans les années 1940, on en a fait un luxuriant jardin ornemental de
plantes vivaces.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Michel Pelletier, 2004 |
Lieu historique national du Canada du Marché-Kensington
Toronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Marché-Kensington est un petit
quartier situé à l'ouest de l'avenue Spadina au coeur du centre-ville de
Toronto, en Ontario. Semblable à bien d'autres communautés
ethnoculturelles urbaines du centre-ville de Toronto, le marché
Kensington fait partie de ce grand secteur d'immeubles résidentiels,
institutionnels et commerciaux. À l'intérieur de ses limites, on trouve
un quartier commercial et résidentiel composé de rues étroites bordées
de petits magasins aux auvents colorés exploités dans d'anciennes
résidences et qui offrent des aliments, des épices et des vêtements
provenant de partout dans le monde. Derrière et entre les devantures de
magasin se trouvent de petites ruelles qui sillonnent le quartier entre
de courtes rangées de petites maisons de la fin du XIe siècle occupant
d'étroits terrains. Les rues du district sont essentiellement bordée
d'immeubles à usage multiple. Bon nombre d'entre eux abritent un magasin
au rez-de-chaussée qui s'étend vers la rue ainsi que des appartements à
l'étage. La plupart de ces immeubles remontent aux années 1880 à 1960,
et leur façade a été grandement modifiée, soit au moyen d'un nouveau
revêtement apposé par le propriétaire ou d'un réaménagement en fonction
de divers goûts personnels et culturels originaux qui reflètent le
milieu éclectique de Kensington.
Le secteur appelé aujourd'hui marché Kensington est d'abord créé en 1815
par George Taylor Denison, qui construit le domaine Bellevue sur une
parcelle de terrain de 40 hectares (100 acres) à l'ouest de l'avenue
Spadina. Dans les années 1850 et 1860, les Denison subdivisent peu à peu
leur terrain et en vendent des parties à des immigrants britanniques et
irlandais. À mesure que la densité urbaine augmente, les ouvriers
construisent de petites maisons le long des nombreuses ruelles. Au début
du XXe siècle, Kensington accueille un grand nombre d'immigrants juifs,
la plupart en provenance de Russie ainsi que des régions est et
centre-sud de l'Europe. Au cours des trente années suivantes, ces
immigrants établissent l'esprit dynamique du marché. Dans les années
1920 et 1930, en raison de la concurrence croissante, les magasins
s'étendent de plus en plus près des rues, qui sont déjà étroites. Les
auvents et les kiosques extérieurs atteignent le bord de la rue, et des
rallonges sont construites devant de nombreux immeubles afin d'agrandir
la superficie des magasins. À partir des années 1950, le marché
Kensington accueille une mosaïque culturelle composée de groupes
ethniques, raciaux et religieux de plus en plus diversifiés, notamment
des immigrants de l'Europe de l'Est, du Portugal et de l'Italie, arrivés
après la guerre. Dans les années 1960, un grand nombre de gens
d'affaires afro-antillais et chinois et d'autres provenant des Indes
orientales s'installent dans le quartier et ouvrent de nouveaux
magasins. L'aspect diversifié de l'histoire du marché Kensington est à
l'origine du milieu culturel et architectural en constante évolution que
l'on peut observer dans le quartier aujourd'hui.
|

©Massey Hall, Paul Henman, August 2009 |
Lieu historique national du Canada Massey Hall
Toronto, Ontario
Massey Hall est une salle de concert de trois étages en brique rouge
située au centre-ville de Toronto. Cette salle, construite à la fin du
XIXe siècle selon le style palladien, a été la salle de concert
principale de Toronto pendant la plus grande partie du XXe siècle. Elle
est reconnue pour la chaleur de son acoustique.
Massey Hall a été désigné lieu historique national du Canada en 1981
parce qu'il est une des institutions culturelles les plus importantes du
Canada, et qu'il est renommé pour son acoustique exceptionnelle.
La valeur patrimoniale de Massey Hall a trait à son rôle historique à
titre d'institution culturelle, ainsi qu'à sa conception fonctionnelle
qui lui a conféré une excellente acoustique. Les caractéristiques
conceptuelles et physiques de l'édifice concrétisent ces valeurs. C'est
Hart Massey (1823-1896), un prospère industriel, qui a fait don de
Massey Hall à la Ville de Toronto. Il a confié les plans à S.R.
Badgeley, un architecte de Cleveland natif du Canada. Depuis son
ouverture en 1894, Massey Hall a doté Toronto d'installations qui ont
facilité le développement de la vie musicale à Toronto, et notamment du
Toronto Symphony Orchestra et du Toronto Mendelssohn Choir. Son
intérieur a été modifié en 1933, puis en 1948. Depuis plus d'un siècle,
la «chaleur» de son acoustique a attiré des auditeurs, orchestres,
solistes et orateurs de tous les coins du monde.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Molnar, 2004 |
Lieu historique national du Canada de la Mission-St.-Ignace-II
Tay, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Mission-St.-Ignace-II est
situé près de la baie Georgienne dans le canton de Tay, en Ontario. La
région était autrefois un territoire huron wendat, et la mission St.
Ignace II témoigne de l'évacuation de la Huronie qui a eu lieu lors de
la seconde moitié du XVIIe siècle. L'emplacement précis de St. Ignace II
n'est pas connu; le lieu désigné est constitué de terres agricoles
abandonnées recouvertes d'une forêt secondaire s'ouvrant sur un pré.
C'est dans ce pré que se situe, sous un abri, une grande croix en pierre
érigée par la Compagnie de Jésus pour commémorer le martyre des pères
Brébeuf et Lalemant.
St. Ignace II est l'un des nombreux sites de missions jésuites sur le
territoire de la nation huronne-wendat au milieu du XVIIe siècle. Le 16
mars 1649, le village huron-wendat et la mission jésuite de St. Ignace
II sont attaqués par les Cinq Nations iroquoises. Après avoir pris St.
Ignace II, les Iroquois poursuivent leur chemin vers l'ouest et, dans la
même matinée, attaquent le village et la mission Saint-Louis, où ils
font prisonniers les missionnaires Brébeuf et Lalemant. Ces derniers
sont ramenés à St. Ignace II et exécutés le lendemain. Ces attaques
feront comprendre à la nation huronne-wendat qu'elle n'est pas à l'abri
des attaques destructrices sur son propre territoire, ce qui entraîne
une série d'événements l'obligeant à abandonner la Huronie en
1650.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2003 |
Lieu historique national du Canada de la Mission-Saint-Louis
Victoria Harbour, Ontario
Emplacement d'un village Huron détruit par les Iroquois en 1649.
Située près de Victoria Harbour, en Ontario, le lieu historique national
du Canada de la Mission-Saint-Louis s'étend sur un haut plateau le long
de la rivière Hogg, à 3 kilomètres à l'intérieur des terres, près de la
baie Georgienne. Ce site archéologique, qui couvre une zone de 2
hectares, était en plein champ lorsqu'il a été l'objet de fouilles, au
cours de la première moitié du 20e siècle. Depuis lors, le champ a été
laissé en jachère, une partie des lieux a donné naissance à une forêt
mixte de bois franc et le reste a été planté de pins. Des tertres et
dépressions indiquent l'emplacement de fouilles archéologiques passées.
Saint-Louis est le nom donné par les jésuites en 1640 au village sur
estacade de la tribu des Ataronchronon, partie de la Confédération
huronne-wendate. Le matin du 16 mars 1649, le village huron-wendat et
mission de St. Ignace II a été attaqué par des Iroquois de la Ligue des
Cinq-Nations. La mission capturée, les Iroquois ont continué vers
l'ouest le jour même pour attaquer le village et la mission Saint-Louis,
où ils ont capturé les missionnaires Jean de Brébeuf et Gabriel
Lalement. Les raids ont mis en évidence la menace des attaques
destructives à l'intérieur de leur territoire traditionnel, et ont
déclenché une suite d'événements obligeant les nations huronnes à
abandonner l'Huronie en 1650.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |
Lieu historique national du Canada de la Monnaie-Royale-Canadienne
Ottawa, Ontario
La Monnaie royale canadienne est un édifice de deux étages en pierre
calcaire, de style néo-Tudor. La partie principale du bâtiment a été
construite de 1905 à 1908, et l'affinerie collée à l'arrière de 1909 à
1911. La Monnaie royale canadienne est située sur la promenade Sussex,
très près d'autres édifices gouvernementaux de l'époque.
La Monnaie royale canadienne a été désignée lieu historique national du
Canada en 1979 parce que l'édifice combinait les fonctions de Monnaie
(frappant des pièces de monnaie et des médailles), et d'affinerie pour
l'or des mines canadiennes.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à sa vocation historique
combinée, comme l'attestent son emplacement, sa conception
fonctionnelle, son style néo-Tudor, et les matériaux préservés de
l'époque de sa construction.
Avant la construction de la Monnaie, la plupart des pièces de monnaie
canadiennes étaient frappées à la Monnaie royale de Londres, avec de
l'or canadien envoyé en Angleterre par bateau. En janvier 1908,
l'ouverture officielle de la branche de la Monnaie royale britannique à
Ottawa a été marquée par la frappe d'une pièce de cinquante cents. À ses
débuts, la Monnaie avait deux fonctions : frapper des pièces de monnaie
et affiner l'or extrait des mines canadiennes. Elle a permis au Canada
d'avoir un meilleur contrôle sur sa devise. À ce titre, elle abritait
des bureaux et des opérations industrielles. En 1931, la Monnaie est
passée sous le contrôle du gouvernement du Canada, qui l'a rebaptisée
Monnaie royale canadienne.
Le choix du style et de l'architecte reflétaient l'importance accordée à
ce bâtiment. Par son style et son parement de pierre, la Monnaie royale
canadienne était représentative de l'approche du gouvernement fédéral
consistant à instaurer une identité distincte à la Capitale en utilisant
uniformément le style gothique Tudor. En outre, la référence aux
châteaux anglais convenait parfaitement à la fonction d'hôtel de la
monnaie, et à son association avec la Monnaie britannique. L'architecte,
David Ewart, était architecte en chef du ministère des Travaux publics.
Il a appliqué le style néo-Tudor à d'autres importants bâtiments
fédéraux de l'époque, et en particulier aux lieux historiques nationaux
du Canada du Musée-Commémoratif-Victoria et de l'Édifice-Connaught.
La Monnaie royale canadienne se compose d'un édifice à bureaux orienté
vers la promenade Sussex, et d'une affinerie et d'un atelier alignés à
l'arrière. Un poste de garde surveille les entrées des visiteurs, qui
doivent franchir une haute clôture de métal et de pierre. Même si elle a
été construite de 1905 à 1908 et ses annexes en 1909, 1916 et 1951, la
Monnaie royale canadienne a subi ses plus grandes modifications en 1985,
alors qu'on a démoli la plus grande partie du bâtiment d'origine, ne
laissant qu'une partie de la façade et la tour de l'entrée. L'année
suivante, on a reconstruit l'édifice d'apparence identique à
l'extérieur, mais en y apportant d'énormes changements à l'intérieur. En
1987 on a modifié le poste de garde sud pour le transformer en zone
d'accueil des visiteurs.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Ken Elder, 1998 |
Lieu historique national du Canada du Moulin-à-Farine-Backhouse
Norfolk County, Ontario
Le moulin à farine Backhouse est situé dans le village patrimonial de
Backus. Sa situation rurale et le torrent qui coule à côté illustrent la
vie industrielle et économique des premières communautés pionnières du
Haut-Canada. Sa volumétrie simple et considérable, sa charpente de bois
équarri à la main et sa machinerie préservée nous rappellent les
origines du secteur agricole canadien.
C'est John Backhouse (ou Backus) qui a construit dans les années 1790 ce
rare exemple technologique et architectural préservé des débuts de la
mouture dans le Haut-Canada qui a fonctionné jusqu'en 1957. Ces
imposants bâtiments à charpente de bois, qu'on trouvait en général dans
les communautés agricoles frontalières au début du XIXe siècle,
utilisaient l'énergie hydraulique pour moudre le grain. Les machines
plus modernes, ajoutées à la fin du XIXe et au début du XXe siècles,
étaient plus fréquentes dans les petits établissements commerciaux
ruraux. Ces moulins ont marqué les débuts d'une industrie qui allait
devenir une des plus importantes du Canada.
|
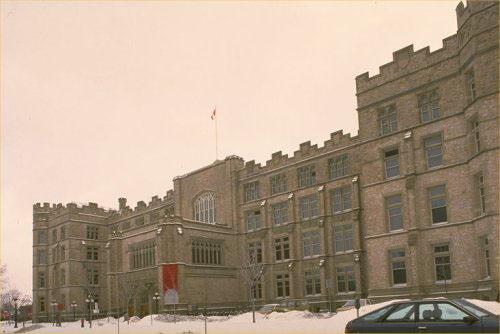
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1987 |
Lieu historique national du Canada du Musée-Commémoratif-Victoria
Ottawa, Ontario
Le musée commémoratif Victoria est un grand édifice de style gothique
Tudor, en pierre de Tyndall, situé près du centre ville d'Ottawa. Il est
isolé dans un îlot urbain entouré d'espaces verts et de zones de
stationnement. Le bâtiment et la propriété sur lequel il se trouve sont
situés à l'extrémité sud de la rue Metcalfe, orientée nord-sud, qui part
du Parlement du Canada et va jusqu'au musée.
Le musée commémoratif Victoria a été désigné lieu historique national du
Canada en 1990, parce qu'il a joué un rôle important et précurseur dans
le développement de la muséologie au Canada et pour son architecture.
La construction du musée commémoratif Victoria, de 1905 à 1911, a
coïncidé avec le boom précédant la Première Guerre mondiale, au cours
duquel de nombreux musées encyclopédiques ont été érigés dans la plupart
des grandes villes d'Europe et d'Amérique du Nord. À titre de premier
musée fédéral bâti avec cette vocation précise, sa construction
représentait le point culminant de décennies d'efforts de la part du
personnel de la Commission géologique et d'histoire naturelle du Canada
et de scientifiques canadiens, visant à accueillir les collections
d'histoire naturelle et humaine du Canada dans un bâtiment convenable.
Une fois achevé, en 1911, l'édifice abritait le Musée des beaux-arts du
Canada, ainsi que les collections de la Commission géologique et
d'histoire naturelle du Canada, et quelques-uns de ses bureaux. Dès ses
débuts, ce musée a innové sur le plan des méthodes d'exposition, et
plusieurs muséologues et anthropologues canadiens renommés y ont
travaillé, notamment Charles Sternberg, Diamond Jenness et Edward Sapir.
La réussite du musée, l'expansion de ses collections et le travail de
ses scientifiques ont conduit, en 1927, à la création du Musée national
du Canada, distinct de la Commission géologique du Canada. Le bâtiment a
abrité ce musée jusqu'en 1950. En 1959, le Musée canadien de l'homme et
de la nature en est devenu le seul occupant. Puis, en 1988, cette
institution a été scindée en Musée canadien des civilisations et Musée
canadien de la nature, ce dernier demeurant dans le musée commémoratif
Victoria.
Le musée commémoratif Victoria, dont le projet a été autorisé en 1901,
était le plus ambitieux de cinq bâtiments conçus pour la Capitale dans
le style gothique Tudor par David Ewart, architecte en chef du ministère
des Travaux publics. La qualité architecturale, les dimensions et
l'emplacement de ces cinq bâtiments ont beaucoup fait pour rehausser
l'image d'Ottawa à titre de capitale. Le constructeur local, George
Goodwin, a érigé le musée commémoratif Victoria d'après les plans
d'Ewart.
Le musée commémoratif Victoria a été construit pour la Commission
géologique du Canada sur une discrète parcelle paysagée, située à
l'extrémité sud de la rue Metcalfe. Son emplacement, le fait qu'on le
voit depuis la Colline du Parlement, ses grandes dimensions, sa fonction
publique et sa situation dans une zone ressemblant à un parc, cadraient
parfaitement avec la vision qu'avait Laurier pour la Capitale. La
conception de l'édifice et l'orientation du site respectent les
principes du style Beaux-Arts. Les ornements intérieurs et extérieurs du
bâtiment proviennent du vocabulaire de style gothique Tudor. Sa tour
d'entrée, au centre de la haute façade principale symétrique, constitue
l'élément central de sa conception. Cependant, le sol s'étant avéré
instable, on a dû réduire de manière significative sa hauteur, cinq ans
après l'ouverture du bâtiment. En 2004-2005, on a fait d'importantes
rénovations à l'édifice, en ajoutant une nouvelle tour de verre à sa
façade, et en y faisant d'importantes modifications intérieures.
L'édifice du musée commémoratif Victoria a également abrité le Parlement
du Canada de 1916 à 1920, après qu'un incendie ait détruit l'édifice du
Centre du Parlement.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2003 |
Lieu historique national du Canada du Musée-Stephen Leacock / Old Brewery Bay
Orillia, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Musée Stephen Leacock / Old
Brewery Bay est situé en bordure du lac Couchiching, dans la
municipalité d'Orillia, en Ontario. Construite sur un terrain de près de
quatre hectares, la propriété fait face au lac et se dresse sur une
pelouse agrémentée de fleurs qui donne accès au rivage des baies Brewery
et Barnfield ainsi qu'à un boisé naturel connu sous le nom Leacock
Point. La maison de deux étages, autrefois la résidence d'été de
l'humoriste Stephen Leacock, présente des murs chaulés et une terrasse
ornée de piliers donnant vue sur le lac. Le lieu comprend des tonnelles
rénovées, une remise à bateaux et un centre d'accueil.
La valeur patrimoniale de ce lieu réside dans ses associations faites à
Stephen Leacok, démontrés par les aménagements caractéristiques apportés
à la maison et à la propriété où il vivait au cours de la première
moitié du XXe siècle.. Leacock (1869 1944) est une personnalité
littéraire importante, un humoriste, un intellectuel, un conférencier,
une personnalité de la radio et un auteur à succès canadien. Entre 1915
et 1925, il devient même l'humoriste le plus connu du monde anglophone.
Ses oeuvres inspirent une génération entière d'auteurs canadiens et
américains. Au cours de sa carrière, Leacock écrit plus de 60 livres,
dont son chef d'oeuvre intitulé « Sunshine Sketches of a Little Town ».
Après avoir quitté la vie publique en 1936, Leacock passe la majeure
partie de son temps dans sa résidence d'Old Brewery Bay jusqu'à sa mort,
en 1944.
Baptisée « Old Brewery Bay » par Stephen Leacock en hommage à une
brasserie du XIXe siècle située à proximité, la propriété devient
pendant 28 ans la résidence d'été du Montréalais, où il invite sa
famille et ses amis. C'est dans cette propriété que Leacock s'adonne à
ses passe temps favoris, laisse libre cours à ses passions pour
l'architecture créative et accueille sa famille et ses amis. Au fil des
ans, Stephen Leacock conçoit beaucoup de structures et d'éléments
paysagers au sein de la propriété et en supervise la construction. Le
seul bâtiment qui subsiste, une grande maison, est érigé en 1928 selon
les plans des architectes Wright et Noxon de Toronto. Leacock influence
grandement l'aménagement de la maison de façon à pouvoir y accueillir
ses invités et à y écrire ses ouvrages. Il tient à ce que les matériaux
du chalet se trouvant au même endroit soient réutilisés dans la
construction de la nouvelle maison, qui exprime bien sa personnalité
encore aujourd'hui.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du N.C.S.M. Haida
Hamilton, Ontario
Dernier représentant des destroyers de classe «Tribal» de la Seconde
Guerre mondiale.
Le N.C.S.M. Haida est un destroyer restauré de classe Tribal, amarré au
quai numéro 9 du port de Hamilton. Il a été retiré du service actif, et
il est maintenant ouvert au public.
La valeur patrimoniale du N.C.S.M. Haida a trait à son caractère lisible
de destroyer intégral de classe Tribal dont la conception a été
«améliorée» pour pouvoir l'utiliser dans les eaux canadiennes, ainsi
qu'à ses états de service impressionnants. Il a été construit en 1942 à
Newcastle, en Angleterre, pour la Marine royale canadienne, selon une
conception élaborée par cette dernière. Son lancement a eu lieu à
Newcastle en 1942. Il a été affecté à la Marine royale canadienne (MRC)
en 1943 et a participé à de nombreuses opérations avec la marine
britannique pendant la Deuxième guerre mondiale, dans l'Arctique, dans
la Manche, au large des côtes normandes et dans le golfe de Gascogne. Le
Haida a été converti en destroyer d'escorte en 1951-1952, puis a connu
deux périodes d'affectation avec les Nations Unies en Corée. À partir de
1954, il a poursuivi ses missions avec la MRC et participé à de
nombreuses activités de l'OTAN et des Nations Unies pendant la guerre
froide, jusqu'à ce qu'il soit retiré du service en 1963. Sauvegardé par
des particuliers, il a été placé dans le port de Toronto, acheté par la
province de l'Ontario et il est devenu une des attractions de la Place
Ontario. Parcs Canada l'a acheté en 2002, puis réparé, remis à neuf et
placé dans le port de Hamilton où il a été ouvert au public. On l'a
qualifié de bateau de guerre le plus célèbre du Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Molnar, 2005 |
Lieu historique national du Canada Nanticoke
Nanticoke, Ontario
Le lieu historique national du Canada Nanticoke est situé sur les rives
du lac Érié dans le canton de Walpole en Ontario. En novembre 1813, ce
lieu a été le théâtre d'une escarmouche entre une milice volontaire,
formée de fermiers des environs, et une bande de maraudeurs américains
qui pillaient les fermes du district. Il ne reste aucun vestige
important de la bataille de Nanticoke sur les lieux qui sont
actuellement occupés par la centrale électrique de Nanticoke.
Pendant la guerre de 1812, la Grande-Bretagne a retiré ses troupes
régulières du Sud de l'Ontario qui se sont repliées au Fort de Kingston
après avoir subi plusieurs défaites aux mains des Américains à l'automne
de 1813. Ce repli, et la présence militaire réduite qui en a découlé, a
incité une bande de maraudeurs américains à piller les fermes des
environs. Des résidents établis ont alors décidé de former une milice
volontaire qui, le 13 novembre 1813, a attaqué les Américains sur la
ferme John Dunham, au sud du village actuel de Nanticoke.
Trois des maraudeurs ont été tués, plusieurs ont été blessés, dix-huit
ont été capturés et les autres ont fui. Cette attaque a mis un terme aux
pillages dans la région, et a permis de conserver plus de 3 000
kilogrammes (7 000 livres) de provisions nécessaires à la milice
britannique postée à la frontière de Niagara pour soutenir sa campagne
hivernale.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2002

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2002

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2002 |
Lieu historique national du Canada de Niagara-on-the-Lake
Niagara-on-the-Lake, Ontario
Le lieu historique national du Canada de Niagara-on-the-Lake est une
ville loyaliste du début du XIXe siècle situé sur la rive sud du lac
Ontario près de la frontière des États-Unis. Cet arrondissement comprend
plus de 25 pâtés de maisons consistant en plus de 90 édifices
résidentiels, commerciaux, religieux et institutionnels, construits
entre 1815 et 1859. La plupart de ces bâtiments ont été conçus dans la
tradition classique britannique, produisant des similitudes de
conception, de matériaux et d'échelle. Les larges rues bordées d'arbres
de l'arrondissement sont disposées selon un plan quadrillé de la fin du
XVIIIe siècle. L'arrondissement comprend aussi un parc municipal et deux
cimetières du début du XIXe siècle. Le paysage est légèrement vallonné
par endroits, avec une partie d'un ruisseau traversant une partie de
l'arrondissement.
Niagara-on-the-Lake a été bâtie à l'origine en 1779 pour servir de dépôt
d'approvisionnement des forces loyalistes de la Grande-Bretagne. À la
fin du XVIIIe siècle, elle était devenue un important centre militaire
et culturel, et elle a brièvement servi de capitale du Haut-Canada. Le
plan quadrillé de la ville, élaboré en 1794, suivait le modèle des plans
impériaux des nouvelles villes coloniales. Suite à la destruction de la
ville par un incendie en 1813, les colons loyalistes l'ont entièrement
rebâtie. Les rues ont conservé leur disposition, leurs proportions et
leurs contours d'origine. De 1831 à 1859, la ville a continué à
prospérer à titre de port d'expédition et de constructions navales. Les
habitants ont donc alors bâti ou agrandi leurs maisons et les édifices
commerciaux de la ville.
Les édifices à la conception classique construits entre 1815 et 1859
sont les plus répandus dans l'arrondissement. La plupart d'entre eux
sont toujours à leur emplacement d'origine près de la rue, et leurs
conceptions, leurs matériaux et leurs dimensions sont similaires. La
majorité de ces édifices a été restauré et a retrouvé son aspect
initial. La partie commerciale de la rue Queen, construite en grande
partie entre 1813 et 1840, présente les caractéristiques familières des
rues commerciales de cette époque. Elle se démarque des paysages urbains
ultérieurs du XIXe siècle par ses façades individualisées et la
différence marquée entre les édifices.
Les résidents de Niagara-on-the-Lake ont été parmi les premiers groupes
de citoyens au Canada à militer en faveur de la restauration de leur
patrimoine bâti. La Société historique de Niagara, créée par les
résidents en 1896, a collectionné des objets et des documents associés à
l'histoire locale, et a publié des histoires locales. À partir du milieu
des années 1950, certains citoyens ont commencé à restaurer des
propriétés privées pour leur rendre l'apparence qu'elles avaient au XIXe
siècle et pour promouvoir la conservation. En 1962, ils ont formé la
Fondation Niagara, un groupe local de pression et de collecte de fonds
voué à la préservation des points d'intérêt de la ville.
Niagara-on-the-Lake a été une des premières municipalités de l'Ontario à
nommer un comité consultatif pour la conservation architecturale local
chargé de prodiguer des conseils au sujet du patrimoine local. La ville
a été désignée Arrondissement de conservation du patrimoine en
1986.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Roger LeLièvre |
Lieu historique national Du Canada du NGCC Alexander Henry
Thunder Bay, Ontario
L’ancien navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Alexander Henry,
un brise-glace léger, baliseur et navire d’aide à la navigation utilisé
dans les Grands Lacs de 1959 à 1985 est aujourd’hui retiré du service.
Étant le principal brise-glace canadien à naviguer sur le lac Supérieur,
et le premier brise-glace appartenant au gouvernement à cet endroit,
l’Alexander Henry fournit des services exemplaires dans le domaine de la
navigation maritime, brisant la glace pour prolonger la saison de
navigation à la Tête-des-Grands-Lacs. Ses fonctions fondamentales
comprennent l’approvisionnement des phares et le transport des gardiens
de phare, l’entretien des bouées, la participation à des expéditions de
recherche et de sauvetage ainsi que d’autres missions importantes. Le
bâtiment représente l’engagement du gouvernement du Canada envers la
navigation maritime à une époque où le transport et le commerce
maritimes prennent de l’expansion.
Conçu par le cabinet d’architectes navals de Montréal German & Milne et
construit aux chantiers de la Port Arthur Shipbuilding Company, il est
mis à l’eau le 18 juillet 1958. Le bâtiment fait partie de la dizaine de
brise-glaces construits dans le cadre d’un programme gouvernemental de
construction navale motivé par l’expansion d’après-guerre du transport
et du commerce maritimes parallèlement aux préoccupations pour une
présence canadienne dans l’Arctique. Construit à l’origine pour la
flotte des Services maritimes du ministère des Transports, le navire est
l’un des 49 grands bâtiments intégrés à la Garde côtière canadienne
après la création de l’organisme en 1962 et repeints à ses couleurs
emblématiques, le rouge et le blanc. Plaque commémorative en bronze avec
texte doré Plaque commémorative de la Commission des lieux et monuments
historiques du Canada pour le Lieu historique national du NGCC Alexander
Henry
L’Alexander Henry fait partie d’une longue tradition de soutien
gouvernemental à l’égard de la navigation maritime et est un exemple
représentatif de cette activité sur les Grands Lacs. La Garde côtière
canadienne est mise sur pied pour résoudre les complexités croissantes
des tâches associées avec une navigation sécuritaire. Le bâtiment est
chargé de veiller au passage en toute sécurité d’énormes volumes de
navires, dont la circulation est rendue possible par la construction des
canaux et des écluses. Le développement de ces infrastructures culmine
avec la Voie maritime du Saint-Laurent en 1959, laquelle permet aux
vraquiers océaniques de grande taille d’emprunter le cours supérieur du
fleuve Saint-Laurent et de rejoindre les cinq Grands Lacs. L’un des
rôles du navire est de prolonger aussi longtemps que possible la saison
de navigation, notamment en ouvrant des passages pendant la prise des
glaces au début de l’hiver et au moment de la débâcle au printemps. Les
principales cargaisons en vrac transportées sur le lac Supérieur
comprennent les céréales, le charbon, le minerai de fer et la pulpe de
bois. La région est devenue une composante majeure de l’économie
canadienne. Le navire s’occupe par ailleurs de l’entretien des aides à
la navigation, transportant les gardiens de phare et des fournitures aux
diverses stations de phare, et de l’entretien des bouées pendant la
saison de navigation. Il sert aussi pendant des missions de recherche et
sauvetage lors de sinistres maritimes. Il effectue également des
missions de soutien en intervention environnementale, pour la recherche
scientifique et en hydrographie. Alors que la grande majorité du travail
de l’Alexander Henry se déroule sur le lac Supérieur, il fait route dans
les années 1980 jusque dans la région de Terre-Neuve où il participe à
l’entretien des aides à la navigation.
Le NGCC Alexander Henry est retiré du service en juillet 1985 et devient
ensuite un navire-musée. Il est d’abord exposé au Musée maritime des
Grands Lacs à Kingston, qui en assure l’entretien pendant plus de trente
ans. La Lakehead Transportation Museum Society achète le brise-glace en
2017 et accueille maintenant des visiteurs estivaux au Transportation
Museum de Thunder Bay. Le navire est l’un des meilleurs exemples encore
existants du programme gouvernemental de construction de brise-glaces de
la fin des années 1950, mis au point pour permettre au Canada de
s’acquitter de ses responsabilités au large des côtes et dans les eaux
intérieures.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J Butterill, 1993 |
Lieu historique national du Canada Osgoode Hall
Toronto, Ontario
Osgoode Hall est un majestueux édifice de style palladien, construit en
plusieurs étapes au milieu du XIXe siècle. Il est entouré de pelouses et
séparé de la rue par une clôture en pierre et en fer forgé au portail
ouvragé. L'édifice et son terrain occupent tout un pâté de maisons du
quartier des affaires au centre-ville de Toronto.
Osgoode Hall a été désigné lieu historique national en 1979 parce qu'il
est représentatif du système judiciaire en Ontario et du rôle qu'il a
joué pour protéger de l'extradition les réfugiés du « chemin de fer
clandestin. » Sa valeur patrimoniale a également trait au fait qu'il est
un des trésors architecturaux et historiques du Canada.
Depuis sa construction en 1832, Osgoode Hall sert de siège social au
Barreau du Haut-Canada, l'organisme directeur de la profession juridique
en Ontario. Il a été baptisé en l'honneur de William Osgoode, premier
juge en chef du Haut-Canada. À titre de siège social d'une société
juridique, il met à la disposition des juristes praticiens depuis 1832
une bibliothèque, une salle à manger et des salles d'études. Au XIXe
siècle, il a aussi fourni des chambres aux étudiants en droit. De 1889 à
1974, le Barreau a tenu à Osgoode Hall une école de droit, qui était
jusqu'en 1959 la seule de la province. Il gère encore à Osgoode Hall le
cours d'admission au barreau de l'Ontario. Depuis 1846, Osgoode Hall
sert aussi de palais de justice aux cours provinciales supérieures. À ce
titre, de nombreuses causes importantes y ont été entendues. En 1874, la
Province est devenue propriétaire d'une partie de l'édifice, le Barreau
demeurant propriétaire de l'aile est et de la Grande bibliothèque. On a
apporté de nombreuses additions et modifications au bâtiment au cours
des XIXe et XXe siècles, pour répondre à l'accroissement du Barreau et
du système judiciaire.
La célèbre cause John Anderson a été entendue au palais de justice
d'Osgoode Hall en 1861. Ce jugement a créé une jurisprudence interdisant
l'extradition vers les États-Unis des réfugiés qui en provenaient. Ceci
a protégé les réfugiés du « chemin de fer clandestin » d'être renvoyés
chez eux comme esclaves en fuite.
Sur le plan architectural, Osgoode Hall offre une combinaison de
caractéristiques des styles palladien et néo-classique du milieu du XIXe
siècle. Le bâtiment originel a été construit de 1829 à 1832 sur des
plans de John Ewart, aidé du Dr. W.W. Baldwin. Le caractère inhabituel
du plan et des façades de l'édifice provient des nombreuses additions
effectuées ultérieurement par divers architectes. De 1844 à 1846, on a
ajouté une aile centrale et une aile ouest, d'après des plans de Henry
Bower Lane, créant ainsi la configuration de base de l'édifice actuel.
Lors des rénovations réalisées par Cumberland & Storm en 1857, on a
remplacé l'aile centrale et ajouté d'autres importantes composantes
structurelles et décoratives. En 1865, on a ajouté une école de droit à
l'arrière de l'aile est, d'après des plans de William Storm. Puis, on a
continué pendant tout le XXe siècle à faire d'autres ajouts et
modifications au bâtiment.
Mis à part ses liens appréciés avec le droit et avec le système
judiciaire provincial, Osgoode Hall est reconnu pour sa présence
imposante dans la rue Queen, et pour ses espaces intérieurs ouvragés.
Ceux-ci comprennent la Grande bibliothèque, la Rotonde, et la salle à
manger avec lambris de bois pour les membres du Barreau. La firme
Hamilton & Son, de la fonderie St. Lawrence de Toronto, a construit la
clôture et les portails en fer forgé qui entourent la propriété.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national du Canada Our Lady of the Immaculate Conception
Guelph, Ontario
Prenant leur inspiration des cathédrales médiévales françaises, les
tours jumelles de cette grande église en pierre se dressent au-dessus du
centre-ville de Guelph (Ontario). L'église, pièce maîtresse d'un
ensemble d'édifices de culte et d'enseignement catholiques, est bien
située au sommet d'une colline. Ses caractéristiques s'inspirent du
style néo-gothique français, comprenant une façade avec des tours
jumelles, une grande rosace et une abside polygonale ainsi que des
chapelles en étoile.
Contrairement à la période précédente du néo-gothique religieux qui
imposait aux architectes de suivre des précédents jugés corrects, le
style néo-gothique de la grande époque victorienne les laissait libres
de s'inspirer de divers pays et de diverses périodes, tout en respectant
certains principes établis quant à la composition et à la structure.
Comme beaucoup d'églises conçues par des architectes anglophones à la
fin du XIXe siècle, la conception de Our Lady of Immaculate Conception
démontre la forte influence du style néo-gothique français. Conçue par
Joseph Connolly, principal architecte de l'Église catholique de
l'Ontario, Our Lady of Immaculate Conception incorpore des éléments
architecturaux néo-gothiques français tels que la façade avec des tours
jumelles, les rosaces et une abside polygonale avec des chapelles en
étoile. L'église, qui a été construite entre 1876 et 1888 et dont les
tours ont été terminées en 1925—1926, est considérée comme l'œuvre
majeure de Joseph Connolly.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2004 |
Lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-du-Comté-de-Frontenac
Kingston, Ontario
Le lieu historique national du Canada du
Palais-de-Justice-du-Comté-de-Frontenac est un édifice monumental en
pierre calcaire, de style néo-classique, construit au milieu du XIXe
siècle. Son imposant portique à colonnes et son dôme dominent un vaste
parc qui s'étend jusqu'au rivage du lac Ontario. Il est situé au centre
de la ville de Kingston, dans un quartier résidentiel datant du XIXe
siècle, qui jouxte l'Université Queen's.
Le palais de justice du comté de Frontenac est représentatif des palais
de justice monumentaux conçus et érigés en Ontario après 1850.
L'adoption de la Municipal Act qui conférait aux autorités de comté des
pouvoirs accrus a justifié la construction de vastes palais de justice
répondant aux besoins des nombreuses fonctions des comtés. Le palais de
justice du comté de Frontenac est l'un des derniers exemples de palais
de justice érigés pendant la grande période de construction des palais
de justice, entre 1852 et 1856. Conçu par l'architecte Edward Horsey,
l'édifice possède une façade élaborée, composée d'un portique central
flanqué d'ailes et coiffé d'une coupole avec dôme. Le mélange d'éléments
architecturaux d'inspiration italienne et classique est représentatif
des bâtiments judiciaires de l'Ontario du milieu du XIXe siècle. Détruit
par un incendie, le palais de justice a été reconstruit en 1874 par
l'entrepreneur George Newlands, selon les plans de l'architecte John
Power. Le seul changement extérieur important est le dôme central, plus
haut et plus imposant.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-des-Comtés-de-Leeds-et-de-Grenville
Brockville, Ontario
Le palais de justice des comtés de Leeds et de Grenville est un édifice
monumental situé en évidence en haut de la place historique de la ville
de Brockville (Ontario). La place, aménagée sur une colline et bordée
d'églises et d'édifices à l'architecture officielle de bâtiments
publics, donne sur le centre historique et le fleuve Saint-Laurent. Le
palais de justice, de style classique britannique, est un édifice en
pierre symétrique, avec une façade principale qui comprend un bloc
central avec un portique flanqué de deux ailes identiques.
Le palais de justice des comtés de Leeds et de Grenville a été désigné
lieu historique national du Canada en 1966 parce qu'il s'agit de l'un
des palais de justice de district les plus grandioses du Haut-Canada et
parce qu'il abrite sans problème les divers locaux d'une salle
d'audience, de bureaux et d'une prison, tout en présentant des
proportions extérieures classiques et monumentales.
Le palais de justice des comtés de Leeds et de Grenville actuel est un
édifice néoclassique imposant, conçu par le célèbre architecte torontois
John Howard et construit par Benjamin Chaffey, entrepreneur local, entre
1842 et 1844. L'édifice, conçu comme structure polyvalente, a été
agrandi et rénové, mais il garde l'aménagement original des locaux d'une
prison et d'un tribunal. En rassemblant les fonctions de palais de
justice, de bureau et de prison, le comté a réuni les fonds de deux
programmes distincts, soit des administrations civile et judiciaire.
Résultat, l'édifice est plus grand et plus complexe que si deux
bâtiments distincts avaient été construits. L'aile ouest a été ajoutée
en 1888, tandis que la maison du gardien, sur l'aile est, date de
1898.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-du-Comté-de-Middlesex
London, Ontario
Le lieu historique national du Canada du
Palais-de-Justice-du-Comté-de-Middlesex est une structure imposante
située sur un terrain de 1,6 hectare à London, en Ontario. Bâti en 1827,
il constitue l'un des premiers exemples du style néogothique, sa
construction précédant même celle du premier édifice important de ce
style en Angleterre, les Chambres du Parlement (1840-1865). Même si des
rénovations importantes ont été effectuées durant les années 1880,
l'édifice conserve son style néo-gothique romantique d'origine,
caractérisé par sa tour centrale, ses tours octogonales, son crénelage,
ses fenêtres en lancette et ses larmiers.
En 1793, John Graves Simcoe, premier lieutenant-gouverneur du
Haut-Canada, réserve un endroit aux fourches de la rivière Thames pour y
établir la capitale de la province. Même si la ville de York (Toronto)
est finalement choisie comme capitale, le gouvernement conserve
l'endroit à des fins publiques. En 1800, le District de London est créé
dans le sud-ouest du Haut-Canada. Un an plus tard, Thomas Talbot, qui
avait accompagné Simcoe en tant que son secrétaire particulier durant sa
tournée d'inspection de la province en 1793, reçoit une vaste concession
de terres dans le nouveau district après son immigration dans le
Haut-Canada. Talbot consacre les 40 années suivantes à promouvoir la
colonisation dans une vaste région du sud-ouest de l'Ontario, le long
des rives du lac Érié, connue sous le nom de l'établissement Talbot.
En 1826, le parlement du Haut-Canada choisit le site des fourches de la
rivière Thames pour y fonder le siège du district et commande le plan
cadastral de la ville de London. En 1827, une commission appelé le «
Court House Building Committee », sous la direction de Talbot,
entreprend la construction d'un palais de justice et d'une prison au
siège du district à London. Conçue par l'architecte John Ewart de York,
l'impressionnante structure de style néogothique est terminée au début
de 1829. En 1846, une section distincte est annexée sur le côté ouest
pour y établir la prison. En 1878, l'aile est du bâtiment est ajoutée,
de même que l'imposante tour centrale. En 1911, une bibliothèque de
droit est ajoutée dans la partie sud de l'édifice.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1990 |
Lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-du-District-de-Niagara
Niagara-on-the-Lake, Ontario
Situé sur la principale artère de Niagara-on-the-Lake, le lieu
historique national du Canada du
Palais-de-Justice-du-District-de-Niagara est un bel édifice de pierre de
style classique. Son classicisme se révèle dans sa facture symétrique et
ses détails tels que son fronton central, son porche à colonnes, son
assise de ceinture et ses tours de fenêtres. Les espaces intérieurs
conservés reflètent les diverses fonctions auxquelles l'édifice était
destiné.
Le Palais de justice du district de Niagara marque une étape de la
transition vers des édifices publics plus imposants et plus sophistiqués
construits après 1850. Sa plus vaste échelle découle de la volonté de
lui attribuer une gamme étendue de fonctions. Outre son rôle de palais
de justice, ses bureaux et ses geôles, le Palais de justice du district
de Niagara abritait également un hôtel de ville et un marché. Les
structures ont été conçues par William Thomas, un architecte de stature
nationale, maîtrisant bien divers styles classiques.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Catherine Beaulieu, 2010. |
Lieu historique national du Canada du Parc-des-Édifices-du-Parlement
Ottawa, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Parc-des-Édifices-du-Parlement
est situé bien en vue sur la rue Wellington, en surplomb de la rivière
des Outaouais, au centre-ville d'Ottawa, en Ontario. Le lieu comprend
les quatre édifices du Parlement (l'édifice du Centre, l'édifice de
l'Est, l'édifice de l'Ouest et la Bibliothèque) de même que les jardins
qui ceinturent ces édifices. Les terrains avoisinants sont aménagés avec
des plates-bandes, des arbres matures, une terrasse surélevée, des voies
d'accès, et comptent de nombreux monuments commémoratifs de même que des
statues de tailles et de styles variés. Le lieu comprend également
plusieurs bâtiments auxiliaires construits récemment derrière l'édifice
de l'Ouest.
Construits selon le style néo-gothique entre 1859 et 1865, les édifices
du Parlement furent conçus pour accueillir le gouvernement des provinces
unies du Haut et du Bas-Canada. Les édifices furent ainsi occupés pour
une toute première fois en 1865 par le nouveau gouvernement, et suite à
la confédération en 1867, ils devinrent l'adresse permanente de la
Chambre des communes, du Sénat et des bureaux des ministères du nouveau
Dominion du Canada. Dans la foulée de ces changements institutionnels,
il devint important de faire aménager les terrains avoisinants.
En 1873, le ministère des Travaux publics demanda à Calvert Vaux,
paysagiste de renom de New York, un plan d'aménagement des terrains de
la colline du Parlement. Remplaçant le projet du designer anglais
Marshall Wood, le plan de Vaux est exécuté au cours de la deuxième
moitié des années 1870. L'aménagement imaginé par Vaux met en valeur la
dénivellation entre l'édifice du Centre et ceux de l'Est et de l'Ouest
grâce à une terrasse surélevée comportant des baies en saillie et des
escaliers. Trois escaliers relient les deux paliers; de chaque côté, des
rampes tournantes mènent à l'entrée principale de l'édifice du Centre.
L'aménagement comporte également diverses voies d'accès afin de faire le
lien entre les édifices du Parlement et les édifices ministériels. Des
petites plates-bandes géométriques, des allées diagonales et une place
centrale agrémentée d'une fontaine ornent aussi les pelouses.
Parallèlement aux travaux d'aménagement visant à concrétiser le projet
de Calvert Vaux, d'autres travaux ont également été réalisés afin
d'aménager des jardins moins classiques ainsi que la Promenade des
amoureux au nord des édifices, selon la vision de Thomas Scott,
architecte principal du ministère des Travaux publics. Même si on
discerne toujours l'aménagement réalisé par Vaux, il a aujourd'hui été
en grande partie remplacé par de nouveaux aménagements. Par exemple, la
fontaine et les allées diagonales ont disparu, et des arbustes cachent
le contour ciselé du mur de soutènement de la terrasse. De plus,
quatorze statues supplémentaires ont été élevées dans les jardins depuis
l'époque de Vaux. La première statue construite derrière les édifices
rendait hommage à sir George-Étienne Cartier; elle a été dévoilée en
1885. S'y sont ajoutées les statues de sir John A. MacDonald, en 1895,
ainsi que celles d'Alexander Mackenzie et de la reine Victoria, en 1901.
Des allées, des plates-bandes et une maison d'été ornementale ont
également été aménagés à l'arrière des édifices au cours des années qui
ont suivi, mais les plates-bandes et la maison d'été ont été détruites
pour faire place à un parc de stationnement, à l'instar d'une bonne
partie de l'aménagement paysager d'origine. Le parc des édifices du
Parlement est souvent le théâtre de célébrations nationales et de
l'expression de la démocratie.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1992 |
Lieu historique national du Canada du Parc-Provincial-Algonquin
Nipissing, Ontario
Le parc provincial Algonquin a été créé en 1893. Il est situé dans le
Bouclier canadien, au nord-est de Toronto et au nord-ouest d'Ottawa. Le
terrain montagneux et très boisé, se trouve au milieu de cinq grandes
rivières et de nombreux petits lacs. La reconnaissance officielle
englobe une superficie de 7571 kilomètres carrés, dont 15 % sont des
plans d'eau, ainsi que les divers bâtiments, structures, chaussées et
sentiers qui s'y trouvent.
Le parc provincial Algonquin a été désigné lieu historique national en
1992 car il a tant apporté à la gestion de parc, il a été le premier
parc à bénéficier du programme d'interprétation de parc et il a
contribué de si belle façon à faire connaître le Canada aux Canadiens,
grâce aux oeuvres des artistes, comme ceux du Groupe des Sept, qu'il a
inspiré.
La valeur patrimoniale du parc se trouve dans son paysage culturel qui
englobe une vaste zone naturelle de forêts et d'eau où vivent une flore
et une faune indigènes, dans ses structures favorables aux loisirs des
vacanciers et dans son illustration de la gestion de parc.
Créé en 1893, le parc Algonquin a été le premier parc provincial du
Canada. Proposé à l'origine par Alexander Kirkwood du Ontario Department
of Crown Lands pour préserver les cours d'eau majeurs et protéger la
faune et les forêts. Le parc a largement dépassé ces objectifs.
Les techniques de gestion mises au point au parc Algonquin ont été
appliquées à des parcs provinciaux et nationaux partout au Canada. Le
parc a servi de banc d'essai pour l'étude de questions complexes comme
la protection de la nature par opposition à la promotion des loisirs et
la conservation des forêts par opposition à l'exploitation forestière.
Le parc reflète les trois motifs de sa création : réserve forestière;
réserve de chasse et pêche; et station thermale et terrain d'attractions
pour l'agrément des Ontariens. Les techniques de gestion des forêts ont
misé sur l'établissement des règlements visant l'exploitation
forestière; la prévention et le contrôle des incendies et le reboisement
assisté. Les politiques sur la gestion de la faune ont soit carrément
interdit la chasse et la pêche dans le parc, soit limité ou soumis ces
activités à un système de permis. Diverses autres politiques de
conservation et d'intervention en la matière ont également été mises en
oeuvre. Différentes installations ont été construites pour accueillir
visiteurs et vacanciers.
Le programme d'interprétation de parc a été inauguré au parc Algonquin
dans les années 1940 par le biologiste J.R. Dymond du Musée royal de
l'Ontario et par la suite a été utilisé dans d'autres parcs à travers le
Canada. Un musée du parc, crée en 1958, a présenté des expositions sur
la faune et la flore du parc et a accueilli des naturalistes qui y ont
donné des conférences.
Les rives rugueuses des lacs du parc et les pentes boisées attirent les
propriétaires des chalets, les touristes, les artistes et les amateurs
de la nature, en créant une ambiance chaleureuse pour le parc dans la
province et dans tout le pays. Le chemin de fer, construit en 1896 pour
assurer l'accès au parc, a donné le coup d'envoi à la construction des
installations récréatives et à la promotion du parc. Des compagnies
ferroviaires et d'autres entreprises privées ont érigé des hôtels et des
pavillons; des particuliers ont construit des chalets d'été sur des
terrains loués à bail; et la direction du parc a marqué, cartographié et
entretenu les voies d'eau internes, les portages et les emplacements de
camping pour canoteurs et adeptes du camping sauvage. Après la
construction des routes dans le parc, des installations pour les
roulottes de camping et la navigation de plaisance ont été ajoutées. La
beauté sauvage du parc Algonquin a inspiré bien des artistes, notamment
des membres du Groupe des Sept, qui par leurs oeuvres ont ajouté à la
réputation du parc.
|
|
Lieu historique national du Canada du Parkhill
Parkhill, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Parkhill est situé près du
Parkhill, en Ontario. Ce site archéologique était jadis un établissement
Paléo-Indien sur une ancienne rive de lac, représentant le niveau du lac
Huron bien avant l'époque moderne. Aujourd'hui situé sur une plaine
cultivée, le site s'étend sur près de 0,5 hectares (1,2 acres) juste au
nord du Parkhill Creek. Le sol densément argileux contient des vestiges
archéologiques remontant à une période de 8800- 7800 Av. J.C., époque à
laquelle le site s'établissait sur la rive de l'ancien lac glacial
Algonquin. Il s'agit du plus ancien site Paléo-Indien d'habitation
répertorié en Ontario.
Le lieu historique national du Canada du Parkhill est exceptionnel non
seulement à cause de l'importante quantité de pointes rainurées qu'on y
a découvertes et de sa taille substantielle, mais également parce qu'il
constitue le seul site d'occupation Paléo-Indienne de la région des
Grands Lacs. Mesurant environ 243 mètres de large par 495 mètres de
long, le site possède l'une des plus vastes collections d'artéfacts
Clovis de tous les sites connus. Aucun autre site ontarien connu n'a
produit autant de pointes rainurées que Parkhill. On croit que le site
jouissait d'une exposition bien abritée au sud près d'un cours d'eau
tributaire et d'une forêt de pins et d'épinettes. Ce lieu offrait
probablement un riche environnement entre la rive de l'ancien lac et la
plage fossile. La richesse du site est digne de mention de même que la
vaste gamme de types d'outils qu'on y a retrouvée, laquelle comprend des
pointes, des galets aménagés bifaciaux, des grattoirs, des couteaux, des
gravoirs, un taret à rainures et d'importantes quantités d'éclats et de
débitage.
|

©Harold Clark Photography |
Lieu historique national du Canada Parkwood
Oshawa, Ontario
Parkwood est un grand domaine résidentiel développé de 1915 à 1940 par
le colonel R.S. McLaughlin, un industriel canadien, et par sa femme
Adelaide Louise Mowbray McLaughlin. Le domaine se compose d'une grande
résidence de deux étages et demi en maçonnerie de style Beaux-Arts,
entourée d'un terrain paysagé très ouvragé de 4,8 hectares, et de
bâtiments secondaires. L'intérieur de la résidence est richement décoré
selon des styles convenant aux fonctions de chaque espace, et il
contient une collection très riche en ameublement d'époque, en
beaux-arts et en arts décoratifs. Les bâtiments secondaires du domaine
comprennent la maison du gardien, les garages, une maison de
thé/belvédère, et de grandes serres. Des haies bien fournies délimitent
les diverses zones de la propriété (cour d'entrée, terrains récréatifs,
zone de services, et secteurs de l'écurie et de la ferme), tout comme
les aires de jardins individuels. Les grands jardins officiels
comprennent un jardin en contrebas avec un pavillon japonais, un jardin
italien clôturé avec un bassin de plantes aquatiques, une grande pelouse
qui descend en pente majestueuse à l'avant avec une terrasse, et les
jardins du sentier menant à la maison d'été, un court de tennis, un
jardin blanc monochrome, une roseraie, un jardin de fleurs à couper, un
verger et un jardin d'eau de style Art déco. Le domaine, qui occupe tout
un pâté de maisons de la ville, est bordé d'un mur sur le devant de la
propriété et d'une clôture en bois le long les trois autres côtés. Il
est situé au centre de la ville d'Oshawa, en Ontario.
Le lieu historique national du Canada Parkwood, le domaine du colonel
Sam McLaughlin, revêt une importance nationale à cause de la maison,
avec sa collection d'ameublement et d'art décoratif d'époque, et de son
terrain, notamment ses jardins classiques. La succession d'architectes
renommés associés à ce domaine lui confère un attrait supplémentaire.
Le domaine Parkwood est un des plus beaux exemples qui subsistent,
pratiquement intact, de conception architecturale et paysagère
canadienne, et d'ameublement et d'art décoratif d'époque datant de
l'entre-deux-guerres. La résidence principale, conçue par les
architectes canadiens Frank Darling et John Pearson, est influencée par
le style Beaux-Arts américain. Ses jardins combinent adroitement les
traditions britannique et nord-américaine, comme l'attestent
l'utilisation des espaces, des plantations, de la végétation, du
mobilier de jardin, et les liens visuels entre les divers éléments.
Le domaine Parkwood témoigne du rôle prépondérant que R. Samuel
McLaughlin a joué au sein de l'élite sociale et d'affaires du Canada
dans la première moitié du XXe siècle. Les modifications apportées par
le colonel McLaughlin et sa femme, Adelaide Louise Mowbray McLaughlin,
pendant les 55 ans où ils l'ont habité, contribuent largement à
l'opulence de ce domaine, qui illustre la vie d'une famille canadienne
riche et privilégiée.
La planification, la conception et la construction de Parkwood sont
l'œuvre de plusieurs architectes, architectes paysagers, artistes et
ouvriers spécialisés renommés du pays, qui l'ont réalisé de 1915 à 1940.
Darling & Pearson, le cabinet d'architectes le plus en vue du Canada à
l'époque, a réalisé les plans de la résidence principale de 55 pièces,
et coordonné la conception intégrale du domaine, avec ses nombreux
bâtiments annexes. Les architectes paysagers William E. Harries et
Alfred V. Hall ont dirigé les premières modifications apportées au
terrain suite à son achat par McLaughlin. Howard Burlingham
Dunnington-Grubb et Lorrie Alfreda Dunnington-Grubb, les horticulteurs
et architectes paysagers les plus renommés du Canada, ont agrandi ces
jardins dans les années 1920. On y a notamment installé des statues
sculptées par Frances Loring et Florence Wyle, des artistes de Toronto.
John Lyle a dessiné le magnifique jardin d'eau de style Art déco,
aménagé en 1935-36, et George Tanaka a conçu en 1963 le jardin japonais
situé dans une des serres du domaine.
La résidence et les jardins contiennent encore un grand nombre d'oeuvres
et d'objets d'art ainsi que de pièces de mobilier ramassés par les
McLaughlin, qui complètent la conception et la décoration du domaine et
ajoutent à sa magnificence. On y trouve notamment un mobilier et des
accessoires de chambre à coucher de style Art déco conçus par John
Lyle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1995 |
Lieu historique national du Canada du Pavillon Aberdeen
Ottawa, Ontario
Le pavillon Aberdeen, qui combine harmonieusement le sens pratique et la
fantaisie, exprime l'esprit de la foire. Son espace intérieur
volumineux, bien éclairé par de nombreuses fenêtres, est idéal pour des
expositions de toutes sortes, tandis que son extérieur extravagant
composé d'un toit décrivant une courbe majestueuse, d'un dôme, de tours
cornières et d'ornements classiques, personnifie l'atmosphère de fête
créée par une foire. L'édifice est situé au milieu du parc Lansdowne,
sur le champ de foire du centre-ville d'Ottawa.
Le pavillon Aberdeen a été désigné lieu historique national du Canada
parce qu'il s'agit du seul bâtiment d'exposition de grandes dimensions
du XIXe siècle préservé au Canada.
Ce grand bâtiment d'exposition a été bâti en 1898 par la Dominion Bridge
Company, pour l'Association de l'exposition du Canada central. Ce
bâtiment, conçu par l'architecte d'Ottawa Moses C. Edey, a été baptisé
d'après le comte d'Aberdeen, Gouverneur général en titre, fervent
supporteur du mouvement des foires agricoles. Ce bâtiment, également
connu sous le nom de Palais bovin, est le plus ancien exemple d'édifice
de ce type au Canada. L'ornementation ouvragée en métal pressé et le
mélange fantaisiste de motifs classiques et agricoles du bâtiment
évoquent à la fois l'esprit de fête et le caractère sérieux des foires
du XIXe siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada 1988 |
Lieu historique national du Canada du Pavillon-d'Information-Touristique-de-Thunder Bay
Thunder Bay, Ontario
Le lieu historique national du Canada du
Pavillon-d'Information-Touristique-de-Thunder Bay, qui est un des
premiers bureaux d'information touristique ouverts, a été construit à
partir d'un dessin novateur inspiré d'un mélange des styles
architecturaux classique et asiatique. Il a une structure octogonale en
brique, entourée d'une véranda, un toit en forme de pagode surmonté
d'une coupole et une entrée à fronton surmontée d'un castor gravé. Il
est situé en bas de la route Red River et de la rue Water, près de
l'eau, le long du chemin de fer historique, dans le quartier Port Arthur
du centre-ville de Thunder Bay.
Le pavillon d'information touristique de Thunder Bay a été dessiné par
l'architecte local H. Russell Halton et construit par la Commission
industrielle de Port Arthur en 1909. C'est l'un des premiers bureaux
d'information touristique conçus pour attirer l'attention de tous ceux
qui traversaient Port Arthur, en train ou en bateau, afin de vanter les
avantages de la ville en tant que centre industriel et touristique à une
époque où sa voisine et rivale, Fort William, devenait un carrefour des
transports de plus en plus important. Le pavillon a continué de servir
de bureau d'information touristique jusqu'à ce que le déclin du trafic
ferroviaire rende son avenir incertain. En 1986, il a été fermé et son
avenir est resté incertain jusqu'à sa restauration en tant que local
patrimonial.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Erica Lenton, 2008 |
Lieu historique national du Canada des Peintures-Rupestres-Mazinaw
Bon Echo Provincial Park, Ontario
Situé à la confluence des lacs haut Mazinaw et bas Mazinaw, dans le Parc
provincial Bon Echo, le lieu historique national du Canada des
Peintures-Rupestres-Mazinaw constitue une vaste collection de symboles
pictographiques dessinés sur la surface d'une falaise s'élevant
abruptement à partir de la rive du lac.
Les recherches archéologiques sur le site ont commencé dès 1895 et se
sont poursuivies périodiquement jusqu'à présent. Ce lieu est sans rival
quant à la complexité et à la taille et il ne fait aucun doute que
l'aspect dramatique de la grande falaise qui se dresse ici, surgissant
audacieusement des eaux du lac, a déterminé son choix comme lieu
d'expression artistique pictographique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Butterill, 1994 |
Lieu historique national du Canada du Pénitencier-de-Kingston
Kingston, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Pénitencier-de-Kingston est
situé dans la banlieue ouest de la ville de Kingston, en Ontario, sur le
côté est du port de Portsmouth. De l'extérieur, le mur massif en pierre
et la porte nord constituent un point de repère intimidant et mémorable.
Un groupe de bâtiments en pierre classiques datant du début du XIXe
siècle, y compris un bloc cellulaire d'origine, subsiste encore dans
l'enceinte de l'établissement.
La valeur patrimoniale du Pénitencier de Kingston réside dans son
illustration de la conception et de la construction d'une prison par la
lisibilité de son paysage culturel pénitentiaire du XIXe siècle, sa
taille, son plan fidèle à la philosophie d'Auburn, son architecture
inspirée du style néo-classique, son emplacement et sa situation
géographique. La valeur réside aussi dans l'excellence architecturale
des premiers bâtiments pénitentiaires, leur conception esthétique et
fonctionnelle, les matériaux d'origine, le savoir-faire et la
composition.
Le pénitencier de Kingston, inauguré en 1835, est le plus ancien
établissement correctionnel du Canada. Son plan d'ensemble, avec
l'entrée principale imposante menant à un pavillon cellulaire en forme
de croix et à trois ateliers à l'arrière, a servi de modèle aux autres
prisons fédérales pendant plus d'un siècle. William Powers,
sous-directeur du pénitencier d'Auburn en Pennsylvanie, a fourni des
plans pour les bâtiments à l'intérieur de l'enceinte — un impressionnant
ensemble architectural de structures érigées dans le style classique du
XIXe siècle. Les bâtiments ont été construits en pierre de la région, en
grande partie par les prisonniers, selon les plans des architectes et
construteurs John Mills, William Coverdale et Edward Horsey. Les
éléments d'origine comprennent l'aile sud (1834-1835), l'aile nord
(1836-1840), l'aile est (1836-1857), l'aile ouest (1838-57), la cuisine
et le réfectoire (1839-1841), l'hôpital (1847-1849) et la rotonde
(1859-1861).
Le pénitencier de Kingston a occupé jusqu'à 80 hectares (200 acres), un
site qui comprenait les 4 hectares (10 acres) des bâtiments de la
prison, une série de carrières de pierre et une ferme qui permettaient
de subvenir aux besoins de l'établissement pénitentiaire. Au fil des
années, certains biens connexes ont été cédés et les structures dans
l'enceinte de la prison ont subi des modifications; toutefois, les
éléments essentiels du plan initial du pénitencier demeurent
visibles.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, B. Morin, 1993 |
Lieu historique national du Canada des Pétroglyphes-de-Peterborough
Otonabee-South Monaghan, Ontario
Situé dans le Parc provincial Petroglyphs, le lieu historique national
du Canada des Pétroglyphes-de-Peterborough, représente une vaste étendue
de marbre de surface située dans un environnement forestier à
Peterborough (Ontario.) On trouve, gravées dans le marbre, des centaines
de formes humaines et animales réalistes ainsi que de nombreuses
représentations abstraites et symboliques qui ont été inscrits entre
900-1400 ans.
Situé sur un affleurement de marbre blanc du Bouclier canadien, le site
des Pétroglyphes de Peterborough représente l'une des plus importantes
concentrations de gravures sur roche préhistorique au Canada. Des
centaines d'images d'une vaste gamme de formes animales et humaines
ainsi que des représentations abstraites et symboliques témoignent
éloquemment de la vie spirituelle et intellectuelle des indiens
Algonquins qui les ont gravées entre 900 - 1400 de notre ère. Le site
est un lieu sacré et un monument à leur sens artistique et à leur
sensibilité.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Phare-et-du-Blockhaus-de-l'Île-Bois-Blanc
Bois Blanc Island, Ontario
Blockhaus en bois partie des ouvrages de défense du fort Malden; 1839;
points d'attaque des rebelles canadiens et de leurs sympathisants
américains; janvier 1838.
Le lieu historique national du Canada du
Phare-et-du-Blockhaus-de-l'Île-Bois-Blanc se trouve sur l'île Bois
Blanc, dans la rivière Detroit, près d'Amherstburg, en Ontario. Le lieu
compte un blockhaus carré en bois de même qu'un phare en calcaire de
style impérial datant des années 1830. Les deux bâtiments se trouvent à
l'extrémité sud de l'île Bois Blanc.
L'île Bois Blanc fut proposé comme lieu de défense stratégique pour la
première fois par le lieutenant-colonel Gother Mann lorsque les Anglais
préparaient l'établissement de nouveaux postes pour remplacer ceux
perdus aux mains des Américains pendant la Révolution américaine. En
1837, le gouvernement du Haut-Canada a autorisé la construction d'un
phare sur la pointe sud de l'île, dans le but de faciliter la navigation
maritime sur la rivière Detroit. Après le déclenchement des Rébellions
de 1837, des volontaires de la milice ont occupé le territoire de l'île
Bois Blanc en vue de protéger l'endroit des rebelles canadiens et de
leurs sympathisants américains. Le 8 janvier 1838, ces derniers
s'emparent de la goélette Anne et ont navigué sur la rivière Detroit
jusqu'à l'île Bois Blanc. Les miliciens, craignant alors que ce
déplacement vers l'île Bois Blanc ne soit qu'une diversion des rebelles
pour attaquer Amherstburg, ont décidé de quitter l'île. Les forces
rebelles ont débarqué à la pointe sud de l'île et ont établis un camp
près du phare. Le 9 janvier, ils sont repartis à bord de la goélette
Anne, mais s'échouent au sud d'Amherstburg. Tous les rebelles à bord de
la goélette furent alors capturés par la milice. Les autres rebelles,
demeurés sur l'île, ont décidé aussitôt de se replier.
Après le raid, les Anglais ont reconstruit le fort Malden, maintenant un
lieu historique national du Canada, et le lieutenant-colonel Richard
Airey, craignant une nouvelle attaque des rebelles, a proposé à ses
hommes d'établir d'autres postes de défense sur l'île Bois Blanc. Trois
blockhaus ont été construits en 1839 et ont été occupés par les troupes
britanniques jusqu'en 1858, année au cours de laquelle les terres ont
été offertes en location à des particuliers.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, A. Powter, 1997 |
Lieu historique national du Canada du Phare-de-la-Point-Abino
Crystal Beach, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Phare-de-la-Point-Abino est un
phare de béton aux proportions élégantes et aux ornements classiques,
situé à l'extrémité est du lac Érié, près de Crystal Beach et de la
ville de Fort Erie. Conçu dans le style néo-classique tardif, le phare
présente une volumétrie carrée, légèrement effilée élevé par une base
rectangulaire d'un étage coiffé d'un toit plat. Le phare est construit
juste au-delà de la rive, à laquelle il est relié par une jetée en béton
légèrement surélevée menant à la maison du gardien située sur la terre
ferme.
La valeur patrimoniale du phare de Point Abino a trait aux qualités
architecturales et fonctionnelles de la tour et à son emplacement par
rapport à l'ancienne maison du gardien. William P. Anderson a conçu le
phare de Point Abino. Il a été construit entre 1917 et 1918 par le
ministère canadien de la Marine et des Pêcheries pour aider à la
navigation à l'extrémité est du lac Érié. Sa conception de style
néo-classique, en harmonie avec les maisons d'été d'Américains
avoisinantes, était plus élaborée que celle de la plupart des phares
canadiens. L'ancienne maison du gardien, située dans un endroit discret,
est un bungalow de style Arts-and-Crafts qui cadre avec le site. Le
phare fonctionne depuis sa mise en service, mais aujourd'hui il est
automatisé et on peut le visiter.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Phare-de-la-Pointe-Clark
Amberly, Point Clark, Ontario
Tour et maison du gardien de phare de l'époque de l'Empire britannique
(1859).
Le lieu historique national du Canada du Phare-de-la-Pointe-Clark est
une tour en pierre haute de 26,5 mètres (87 pieds) qui s'élève sur un
promontoire rond surplombant la rive est du lac Huron entre Sarnia et
Tobermory, en Ontario. La tour effilée est coiffée d'une lanterne en
fonte à 12 versants avec un toit en dôme, et l'extérieur est revêtu de
pierre calcaire rustiquée blanchie à la chaux. Le phare de la pointe
Clark est entouré d'un entrepôt en bois et de l'ancienne maison du
gardien de phare, laquelle est aujourd'hui un musée.
La valeur patrimoniale du phare de la pointe Clark réside dans la
qualité et l'intégralité de sa forme physique, sa lanterne distinctive,
son emplacement et son activité ininterrompue depuis 1859. Connu sous le
nom de tour impériale, le phare a été construit entre 1856 et 1859 par
l'entrepreneur John Brown pour le compte du ministère des Travaux
publics. Marquant l'emplacement d'un dangereux haut-fond dans le lac
Huron, il assurait la sécurité de la navigation lié à l'accroissement du
trafic commercial et voyageur sur le lac. La technologie utilisée pour
l'appareil d'éclairage a évoluée au fil des années, et le mécanisme de
rotation de la lanterne a été remplacé par un moteur électrique en 1953.
Le site a été occupé par un gardien jusqu'au milieu des années 1960,
lorsque la lumière a été automatisée. Le phare a été acquis par Parcs
Canada en 1967 mais continue d'être exploité par la Garde côtière
canadienne comme un aide de navigation.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |
Lieu historique national du Canada du Phare-de-la-Pointe-Mississauga
Niagara-on-the-Lake, Ontario
Emplacement du premier phare des Grands Lacs, 1804.
Situé sur la berge de la rivière Niagara à Niagara-on the-Lake, en
Ontario, le lieu historique national du Canada du
Phare-de-la-Pointe-Mississauga marque l'emplacement du premier phare des
Grands Lacs en 1804. On pense qu'il existe des vestiges archéologiques
du phare au-dessous de ce qui est maintenant le bastion de mortiers est
du lieu historique national du Canada du Fort-Mississauga, mais il ne
subsiste aucun élément hors sol qui en témoigne.
La valeur patrimoniale du phare de la pointe Mississauga réside dans ses
connotations historiques symbolisées par la plaque commémorative apposée
à l'entrée ouest du Fort Mississauga.
Le phare de la Pointe Mississauga a été construit en 1804 par les maçons
du 49e Régiment de Fantassins. Le phare comprenait une tour en pierre
hexagonale et un bâtiment adjacent qui était la résidence du gardien.
Endommagé pendant la bataille du fort George en 1813, le phare a été
démoli par les Britanniques en 1814, alors qu'ils construisaient le fort
Mississauga sur le même site. Selon la légende locale, les vestiges du
phare auraient été intégrés à la tour du fort.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1990 |
Lieu historique national du Canada de la Pharmacie-de-Niagara
Niagara-on-the-Lake, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Pharmacie-de-Niagara est un
magnifique exemple d'établissement commercial et de pharmacie de la fin
du XIXe siècle. C'est un édifice blanc de plain-pied paré de planches à
clins, de style géorgien. Il est situé sur la rue Queen, la principale
rue commerciale de Niagara-on-the-Lake. Le bâtiment est caractérisé par
une porte centrale avec une imposte en arche flanquée de deux grandes
vitrines arquées. On l'identifie facilement grâce à son enseigne
proéminente, ainsi que son pilon et son mortier en trois dimensions
fièrement disposés au-dessus de la porte.
La pharmacie de Niagara a été désignée lieu historique national du
Canada en 1968, car elle est un des rares exemples subsistants
d'ancienne pharmacie.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la
Pharmacie-de-Niagara a trait au fait qu'elle illustre richement
l'exploitation professionnelle et commerciale d'une pharmacie à l'époque
de la Confédération. Elle est remarquable par sa forme extérieure, ses
accessoires et aménagements intérieurs, ses matériaux d'origine de la
fin du XIXe siècle, sa conception fonctionnelle, sa situation et son
emplacement. La pharmacie de Niagara a été en opération au moins de 1866
à 1964. Ainsi, elle est une des plus anciennes pharmacies du Canada à
avoir été exploitée sans interruption. Le bâtiment a été construit aux
environs de 1820, puis il a été converti en pharmacie commerciale à la
fin du XIXe siècle, comme l'attestent son intérieur et son extérieur. En
1969, elle a été acquise par la Fondation du patrimoine ontarien; elle a
été restaurée, aménagée et a fait l'objet d'une interprétation pour la
visite du public par l'Ontario College of Pharmacy.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Meryl Oliver, 2005

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Ian Doull, 1987 |
Lieu historique national du Canada de la Place-de-la-Confédération
Ottawa, Ontario
Situé au cœur de la Capitale nationale, le lieu historique national du
Canada de la Place-de-la-Confédération est mieux connu des Canadiens et
des Canadiennes comme l'emplacement du Monument commémoratif de guerre,
avec le tombeau du soldat inconnu. La Place s'ouvre sur le terminus nord
de la rue Elgin, immédiatement au sud-est de la Colline parlementaire,
et constitue un espace ouvert urbain planifié où convergent les sphères
commerciale, cérémoniale, et institutionnelle de la ville. Créée au
début du XXe siècle sur le site d'un ancien district commercial, la
Place est construite autour d'un pont permanent qui enjambe le canal
Rideau et est encadrée par un groupe de bâtiments comprenant l'édifice
Central, l'édifice Scottish-Ontario, le bureau de poste Central,
l'édifice Langevin, l'édifice de l'Est des édifices du Parlement, le
château Laurier, la gare Union (Grand Tronc) et le Centre National des
Arts.
La valeur patrimoniale de cette place réside dans son rôle de lieu
cérémonial et dans sa manifestation physique d'espace public inspiré du
mouvement City-Beautiful, tel qu'illustré par son emplacement au cœur
d'Ottawa. Il réside aussi dans le groupe éclectique de bâtiments d'âge,
de fonction et de styles divers. Ce groupe de bâtiments comprend
plusieurs lieux historiques nationaux du Canada désignés, comme le
Centre National des Arts (1964-1969) le Château Laurier (1909-1912),
l'édifice Langevin (1883-1912), l'édifice Central (1890) et la portion
de l'édifice de l'Est des édifices du Parlement (1859-1865). De plus, la
Place est érigée sur une partie d'un autre lieu historique national, le
canal Rideau. Depuis le dévoilement en 1939 du présent Monument
commémoratif de guerre, la Place est devenue le lieu de rassemblement
des commémorations nationales du jour du Souvenir, afin de rendre
hommage aux soldats du pays décédés à la guerre.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Historical Services Branch, Bryan Horton August 2009 |
Lieu historique national du Canada Pointe-au-Baril
Maitland, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Pointe-au-Baril est situé
sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, près du village de Maitland,
en Ontario. C'est dans ce chantier naval du XVIIIe siècle, dont il ne
reste aucun vestige visible, que la marine française a construit et
lancé les navires Iroquoise et Outaouaise, les dernières corvettes
construites par la France dans les Grands Lacs. Le chantier naval a été
construit près d'un fort en forme d'étoile qui abritait des casernes,
des stocks de navires et des ateliers. Le chantier et le fort ont tous
deux été abandonnés et détruits en 1760.
La France entreprend la construction du chantier naval de la pointe au
Baril à l'automne 1758, pendant la guerre de Sept Ans. Plus tôt dans
l'année, les forces du lieutenant-colonel britannique John Broadstreet
avaient détruit le fort Frontenac et coulé toute la flotte française du
lac Ontario. Dans l'espoir de reprendre le contrôle du lac, la France
décide d'ériger un fort et un chantier naval sur la pointe au Baril, à
partir desquels elle pourra armer une nouvelle flotte. Une importante
force française sous les ordres du capitaine Pierre Pouchot arrive au
fort en 1759 et termine la construction des corvettes Iroquoise et
Outaouaise. Mais à l'été de cette même année, la capture imminente de la
pointe au Baril force les Français à détruire les installations et à
battre en retraite sur l'île Galop, située à proximité, où ils érigent
le fort Lévis.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1988 |
Lieu historique national du Canada du Pont-Basculant-de-Smiths Falls
Smiths Falls, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Pont-Basculant-de-Smiths Falls
est un des tout premiers ponts basculants en béton. Il a été construit
au début du XXe siècle sur le canal Rideau pour le trafic ferroviaire.
Érigé à proximité de la ville de Smiths Falls, il montre aujourd'hui sa
plate-forme levée en permanence, son contrepoids massif dressé presque
perpendiculairement au ciel et sa tour adjacente inoccupée.
Le pont basculant de Smiths Falls a été désigné lieu historique national
en 1983, car il constitue un exemple remarquable des tout premiers ponts
basculants de type Scherzer érigés selon un concept novateur dans le
domaine des ponts mobiles.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du
Pont-Basculant-de-Smiths Falls réside dans son excellence technologique
illustrée par le caractère particulier de la forme, des matériaux et de
la conception de l'ouvrage. Le pont basculant de Smiths Falls a été
construit sur la ligne Toronto-Ottawa du Chemin de fer Canadien du Nord
en 1912 et 1913. Il fallait très peu de puissance pour le mouvoir en
raison du mécanisme de roulement exceptionnel qui éliminait pratiquement
toute friction et du contrepoids aérien en béton qui équilibrait les 21
mètres de travée levante en poutres à âme pleine. Alimenté
électriquement à l'origine, le pont a été actionné manuellement de 1915
à 1978. Les ponts basculants munis de mécanismes de roulement de type
Scherzer sont apparus au Canada vers 1911, et le pont de Smiths Falls
est le plus ancien du genre à exister encore. Au milieu des années 1980,
le Chemin de Fer Canadien du Nord a transféré la propriété du pont à la
ville de Smiths Falls aux fins de conservation en tant que ressource
patrimoniale.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |
Lieu historique national du Canada du Pont-de-Béton-en-Arc-du-Lac-Canal
Bolsover, Ontario
Le lieu historique national du Canada du
Pont-de-Béton-en-Arc-du-Lac-Canal enjambe la voie navigable Trent-Severn
près de la localité de Bolsover, en Ontario. Très robuste, ce pont de
béton est composé d'une seule arche soutenue par des culées construites
sur les rives. La surface en béton de l'arche, qui forme un demi cercle
presque parfait au dessus de la voie navigable, est estampée pour imiter
les pierres des voûtes et les assises des culées de ponts à arc en
maçonnerie. Le pont figure parmi les exemples les plus remarquables
d'ouvrages d'art bâtis sur cette voie navigable.
La conception du pont, dont la construction marque les débuts de
l'utilisation du béton armé, comme en témoigne la structure d'origine,
confère à ce lieu sa valeur patrimoniale. Au départ, le pont est conçu
comme une structure simple en béton, mais tout juste avant son érection,
plusieurs modifications importantes sont apportées aux plans amenant les
ingénieurs à ajouter des armatures à la structure. Ces derniers ne
tirent toutefois pas pleinement parti des propriétés des arches de béton
armé, ce qui explique que l'arche et les culées soient beaucoup plus
imposantes que nécessaire. La configuration et la masse de ce pont, le
premier construit en béton armé au Canada, ressemblent à celles des
anciens ponts en arc en béton ordinaire, inspirées des ponts en arc
classiques en pierre. Après la construction du pont du lac Canal, le
béton armé devient le matériau de prédilection pour la construction des
autres ouvrages importants du lieu historique national du Canada de la
Voie Navigable Trent-Severn, notamment l'écluse de Rosedale (1908) et le
barrage de Bobcaygeon (1909). À partir de ce moment, le béton armé
remplace complètement le béton ordinaire.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |
Lieu historique national du Canada de Port Stanley
Port Stanley, Ontario
Le lieu historique national du Canada de Port Stanley est situé sur une
section de terrain triangulaire, à l'est de Kettle Creek, dans le
village de Port Stanley, en Ontario, ou plus précisément sur un petit
îlot directionnel, à l'intersection des rues Bridge, Main, Joseph et
Colborne, au cœur du village. Bien qu'il ne s'y trouve aucune ressource
connue liée aux débuts de l'histoire de Port Stanley, la Commission des
lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC) a tenu à souligner
l'association du village à l'expédition du général Brock, à Adrien
Jolliet et à d'autres premiers explorateurs importants en érigeant une
plaque et un cairn au coin nord est du lieu.
Les Européens commencent à explorer et à cartographier les Grands Lacs
au cours du XVIIe siècle. Le point de débarquement de Kettle Creek, qui
deviendra plus tard le village de Port Stanley, fait alors partie d'une
des premières routes importantes reliant le lac Érié à d'autres voies
navigables intérieures. De nombreux explorateurs et voyageurs font donc
halte à l'embouchure de Kettle Creek durant les XVIIe et XVIIIe siècles.
Mentionnons entre autres Adrien Jolliet, le frère de l'explorateur et
cartographe Louis Jolliet, qui a été le premier à débarquer à
l'embouchure de Kettle Creek en 1669. C'est de cet endroit précis,
emplacement actuel de Port Stanley, que les Européens entreprennent la
première descente des Grands Lacs.
En plus, François Dollier de Casson et René de Bréhant de Galinée
arrivent à l'embouchure de Kettle Creek en 1670 en utilisant
l'information recueillie par Jolliet. Ils entament ensuite un voyage
vers le nord pour se rendre à l'endroit où se trouve Sault Ste. Marie
aujourd'hui. En 1749, soit près d'un siècle plus tard, le capitaine
français Pierre Joseph Celoron de Blainville, officier des troupes
coloniales régulières, traverse la région de Port Stanley pour faire
valoir les revendications de la France dans la vallée de l'Ohio. En
1761, sir William Johnson, le surintendant britannique du département
des Affaires des Indiens du Nord passe par cette région pour se rendre à
Detroit, où il participera à un grand conseil réunissant des tribus de
l'Ouest. Après la création du Haut Canada en 1791, le colonel Thomas
Talbot devient un des premiers colons de descendance britannique à
s'établir dans la région de Port Stanley. Durant la guerre de 1812, le
général Isaac Brock y établit également son campement alors qu'il se
dirige vers le fort Detroit pour en prendre possession. Enfin, lord
Edward Stanley, premier ministre de la Grande Bretagne pendant trois
mandats, de 1852 à 1868, visite l'établissement voisin de Talbot lors de
sa visite au Canada et aux États-Unis. Le village a été appelé Port
Stanley en l'honneur de lord Stanley, à la suite de sa visite.
|
|
Lieu historique national du Canada de Port Talbot
Port Talbot, Ontario
Près de la falaise était la résidence journal hutte depuis près de 50
ans de l'honorable colonel Thomas Talbot, qui le 21 mai 1803, a commencé
il ya le règlement Talbot. De là, en 1809-1811, Mahlon Burwell arpenté
et aménagé Talbot Road à l'est et à l'ouest, pour l'année de la route la
plus longue et le meilleur dans la province. Dans la guerre de 1812,
Talbot était le colonel commandant de la région de Londres. Le 10 Août
1812, l'expédition de Brock campait sur la plage sur la voie de la
capture de l'armée de Detroit et de Hull. Les forces ennemies ont
attaqué à plusieurs reprises le règlement et vers le 20 Septembre 1814,
brûlé les usines de Talbot et les bâtiments de Burwell à Port
Talbot.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |
Lieu historique national du Canada du Portage-de-la-Baie-de-Quinte
Carrying Place, Ontario
Lieu où fut signé le traité de 1787 entre les Britanniques et les
Mississaugas.
Le lieu historique national du Canada du Portage-de-la-Baie-de-Quinte
est situé sur l'isthme à l'ouest de la baie de Quinte sur le lac
Ontario. C'est à cet endroit, à l'intersection des routes de Trenton et
de Carrying Place, que sir John Johnson et les chefs des Mississaugas
ont négocié un traité en 1787. Le lieu comprend un petit terrain
appartenant à l'agence Parcs Canada sur lequel se trouvent un cairn et
une plaque commémorative de la Commission des lieux et monuments
historiques du Canada.
Dans les années 1780, les établissements des loyalistes situés le long
du fleuve Saint-Laurent et ceux de la région du Niagara sont séparés par
les terres des Mississaugas. La Couronne britannique possède alors la
plupart des terres entre Toronto et le lac Simcoe, mais elle désire
relier les établissements du fleuve Saint-Laurent et ceux du Niagara.
Ainsi, le gouverneur général, lord Dorchester, envoie le surintendant
des Affaires indiennes, sir John Johnson, négocier un traité avec les
chefs des Mississaugas au portage de la baie de Quinte, un isthme
reliant la baie de Quinte et le lac Ontario. Le traité est signé en 1787
et l'acquisition des terres est achevée en 1788.
|

©Huronia Historical Park, Rosemary Vyvyan & William Brodeur, 2005 |
Lieu historique national du Canada du Poste-de-Sainte-Marie-au-Pays-des-Hurons
Midland, Ontario
Le lieu historique national du Canada du
Poste-de-Sainte-Marie-au-Pays-des-Hurons est l'ancien siège de la
mission des Jésuites auprès des Hurons-Wendats de 1639 à 1649. Il est
situé sous le site de la mission des Jésuites reconstruite au XVIIe
siècle sur les rives de la rivière Wye qui coule en direction de la baie
Georgienne, près de Midland en Ontario. Le site actuel comporte des
bâtiments reconstruits dans le style européen des missions religieuses
et comprend des casernes, des ateliers et des maisons longues
iroquoises, tous situés à l'intérieur d'une palissade de bois.
Le poste de Sainte-Marie-au-Pays-des-Hurons a été désigné lieu
historique national du Canada en 1920, parce qu' il s'agit du siège de
la mission des Jésuites auprès des Hurons de 1639 à 1649.
Fondée par les Jésuites en 1639, Sainte-Marie était le siège de la
mission des Jésuites auprès du peuple Huron-Wendat. La mission était
construite sur le territoire connu sous le nom de Huronie, lequel était
habité par un peuple d'agriculteurs sédentaires vivant dans des villages
densément peuplés. Des Hurons chrétiens visitaient la mission pour y
prier, puis pour y recevoir des soins médicaux après la construction
d'un hôpital. Cependant, la mission demeurait essentiellement une
enclave européenne, le siège d'où partaient les missionnaires vers
chaque village. La mission est devenue une colonie assez importante avec
chapelle, hôpital, entrepôts, résidences et ateliers.
Toutefois les contacts directs prolongés entre les populations
autochtones et les Européens ont profondément affecté les deux groupes.
La Huronie avait souffert de l'éclosion de la variole et d'autres
épidémies d'origine européenne. Il en résulta une intensification des
attaques des Iroquois, des divisions sociales et des conflits internes
occasionnés par les conversions au christianisme. À l'hiver 1648-1649,
la Huronie était tellement ravagée par la maladie et les conflits que
les Jésuites abandonnèrent et brûlèrent Sainte-Marie et, accompagnés de
quelques convertis Wendats, déménagèrent sur Christian Island (autrefois
Gahoendoe ou Île-Saint-Joseph), établissant ce qui est aujourd'hui
devenu le lieu historique national du Canada du Fort-Sainte-Marie-II. En
1650, les Jésuites et les Hurons se retirèrent vers le site appelé de
nos jours le lieu historique national du Canada de
l'Arrondissement-Historique-du-Vieux-Wendake, juste au nord de la ville
de Québec.
Les premières fouilles archéologiques sur le site ont débuté au cours
des années 1840 et 1850, puis furent reprises au cours des années 1940
et 1950. Ce sont ces travaux qui ont permis la reconstruction, en 1964,
des bâtiments érigés à l'époque sur le site.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, A. Roos, 200 |
Lieu historique national du Canada du Premier-Champ-Pétrolifère-Commercial
Oil Springs, Ontario
Situé près de Oil Springs en Ontario, le lieu historique national du
Canada du Premier Champ Pétrolifère Commercial est un paysage industriel
qui met en valeur l'extraction de pétrole et de gaz; le matériel de
transport et de raffinage; et des bâtiments. Comme les terres agricoles
voisines, le terrain du lieu historique est plat et à découvert.
Les habitants locaux connaissaient depuis longtemps l'emplacement des
gisements d'ozocérite, d'abord exploités commercialement pour
l'extraction du bitume nécessaire aux travaux d'asphaltage. L'analyse
plus poussée de ces gisements a révélé qu'ils pouvaient avoir de
nombreuses autres applications. De plus, les progrès réalisés en matière
de forage, de raffinage et de transport ont rendu possible
l'exploitation commerciale de ce champ pétrolifère. Toute cette activité
a eu une influence importante, tant sur le plan technologique que
financier, sur le développement de l'industrie de raffinage au Canada
comme à l'étranger.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2000 |
Lieu historique national du Canada du Presbytère-de-Leaskdale
Leaskdale, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Presbytère de Leaskdale est
l'ancien presbytère presbytérien où Lucy Maud Montgomery a habité de
1911 à 1926 avec son époux et sa famille. C'est une modeste maison de
brique de la fin du XIXe siècle, bâtie sur un lotissement résidentiel
situé juste au nord de l'église presbytérienne St. Paul, sur la route
régionale n°1 de Durham, dans le hameau de Leaskdale, en Ontario, au
nord de Toronto.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du
Presbytère-de-Leaskdale a trait à son association avec la vie de Lucy
Maud Montgomery et avec ses œuvres publiées ultérieurement. Cette valeur
est illustrée par la forme, les matériaux, le site et l'emplacement de
la maison, subsistants de la période pendant laquelle elle y habitait,
soit de 1911 à 1926. La maison a été construite en 1886 pour servir de
presbytère à l'église presbytérienne St. Paul, dont le révérend Ewan
Macdonald, mari de Lucy Maud, a été le pasteur de 1911 à 1926. C'est là
que Montgomery a vécu les quinze premières années de son mariage,
qu'elle a eu ses enfants et qu'elle a commencé à les élever. La ville
d'Uxbridge a acheté la maison en 1993 pour la restaurer à titre de lieu
historique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1982 |
Lieu historique national du Canada de la Prison-du-Comté-de-Huron
Goderich, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Prison-du-Comté-de-Huron est
un complexe carcéral fermé datant de la première moitié du XIXe siècle,
qui comprend un bâtiment de détention octogonal de trois étages avec des
ailes, un logement pour le gardien et cinq cours fermées. Situé au 181,
rue Victoria nord à Goderich (Ontario), il abrite à présent un musée sur
les prisons.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la
Prison-du-Comté-de-Huron tient aux aspects de ce complexe qui illustrent
la conception panoptique d'une prison. La prison du comté de Huron a été
construite entre 1839 et 1841, à l'époque où la ville de Goderich est
devenue le chef-lieu du district Huron. À l'origine, une salle
d'audience était aménagée au troisième étage. Conçus par Thomas Young,
les plans correspondent à ceux des prisons britanniques créées par
Jeremy Bentham, soit le plan panoptique. Ce plan comprend un bloc
octogonal central d'où partent des ailes rayonnantes entre lesquelles se
trouvent des cours cunéiformes. L'ensemble, qui est entouré de murs
épais en maçonnerie, a servi de prison au chef-lieu Huron jusqu'en
1972.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, B. Morin, 1993 |
Lieu historique national du Canada du Quatrième-Bureau-de-Poste-de-York
Toronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada du
Quatrième-Bureau-de-Poste-de-York forme maintenant la partie est d'un
ensemble d'immeubles situé à l'est du centre-ville de Toronto. Il
s'agissait à l'origine d'un immeuble isolé en brique de trois étages et
demi datant du début du XIXe siècle. Il a été relié à l'immeuble
adjacent du Lieu historique national du Canada de la
Banque-du-Haut-Canada pendant les années 1870 par la construction d'un
immeuble de jonction. Certaines des caractéristiques et des ouvertures
originales du bureau de poste, qui ont été modifiées à la fin du XIXe
siècle, ont été restaurées depuis.
Le quatrième bureau de poste de York est l'un des plus anciens exemples
qui subsistent au Canada d'immeubles spécifiquement construits pour
servir de bureau de poste. Ce petit bâtiment est typique des édifices du
début du XIXe siècle à caractère résidentiel, ornés d'éléments
néoclassiques et combinant des bureaux publics et une résidence privée.
Il a été construit pour le maître de poste, James Scott Howard, à une
époque où les bureaux de poste du Haut Canada étaient la propriété du
maître de poste désigné.
Le quatrième bureau de poste de York occupe la partie est d'un ensemble
d'immeubles comprenant le lieu historique national du Canada de la
Banque-du-Haut-Canada. Depuis les années 1870, les immeubles de ce
groupe ont été reliés les uns aux autres quand un ordre religieux a
construit un immeuble de jonction.
|
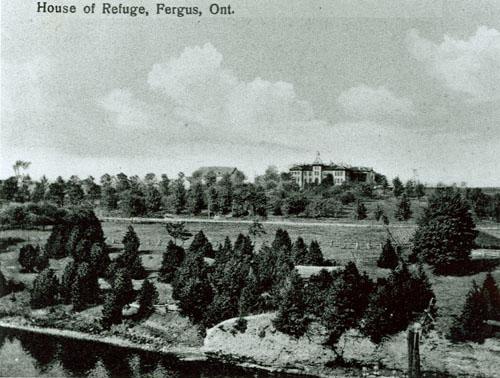
©Wellington County Archives/Archives de Wellington County, ca. 1910 |
Lieu historique national du Canada du Refuge-pour-les-Pauvres-du-Comté-de-Wellington
Fergus, Ontario
Le lieu historique national du Canada du
Refuge-pour-les-Pauvres-du-Comté-de-Wellington est une ancienne ferme
dominée par un édifice en pierre de deux étages, de style à l'italienne,
situé au haut d'une colline. Il se trouve à côté de la rivière Grand
dans l'ancien hameau d'Aboyne, entre Elora et Fergus, dans le sud-ouest
de l'Ontario. Pendant près d'un siècle, il a été le refuge des pauvres
du comté, dont il abrite à présent les archives et le musée.
La valeur patrimoniale du refuge pour les pauvres du comté de Wellington
tient à sa représentation d'un refuge pour les pauvres subventionné par
l'État, illustrée par le paysage culturel d'une ferme mise en
exploitation avec, en surplomb, un grand immeuble d'habitation.
Le refuge pour les pauvres du comté de Wellington a été construit en
1876-1877 pour accueillir en dernier recours les sans-abri et les
pauvres du comté de Wellington. Ses premiers occupants y étaient logés
de façon spartiate en échange de leur travail domestique ou agricole.
Plus tard, il a abrité une maison pour personnes âgées et handicapées.
Conçu selon les plans de l'architecte Victor Stewart, de Guelph,
l'édifice a été modifié au cours des ans, par la construction d'un
nouveau porche d'entrée en 1907, et des ajouts à l'arrière entre 1892 et
1893, puis entre 1954 et 1955.
Tout au long de son histoire, le refuge pour les pauvres du comté de
Wellington a opéré comme une ferme mise en exploitation. Il comprend une
grange construite en 1877 par John Taylor, architecte d'Elora, à
laquelle ont été ajoutés un silo en 1914, une remise à voitures et un
hangar en 1888, des portails d'entrée en 1927, une chaufferie en 1947,
des champs et des pâturages, et un cimetière (1888 — 1946).
L'institution a fermé en 1971 et l'édifice principal a été réhabilité
pour abriter le musée et les archives du comté de Wellington en
1987-1988. Une partie de la ferme continue sa production
agricole.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2004. |
Lieu historique national du Canada des Remblais-de-Southwold
Iona, Ontario
Spécimen rare et bien préservé de village fortifié autochtone
complètement entouré de fortifications construites par la nation
iroquoienne des Attiwandaron (Neutres) entre 1450 et 1550
environ.
Situé près d'Iona, dans le comté d'Elgin, le lieu historique national du
Canada des Remblais-de-Southwold est une propriété contenant des
vestiges archéologiques d'un village, habité à l'origine par les
Attiwandaron, également connus comme les Iroquois neutres. Le village
est entouré de remblais ostensibles et bien préservés, une rareté dans
le sud de l'Ontario. L'intérieur du village présente un modèle
typiquement iroquoien, de longues maisons peu distantes l'une de
l'autre, plusieurs étant imbriquées. L'imbrication des maisons indique
que plusieurs maisons ont été reconstruites au cours de la vie du
village, une autre caractéristique typique des iroquois.
Attiwandaron est un nom qui, en langue Huron-Wendat, fait référence à la
confédération des peuples iroquoiens vivant au nord du lac Érié,
demeurés neutres dans le conflit entre les Hurons-Wendats et la ligue
des Cinq-Nations iroquoises. Le village abrita un jour plusieurs
centaines de personnes qui vivaient dans de longues maisons : des
habitations multi-cellules qui logeaient des familles élargies complètes
liées par une ancêtre maternelle commune. Le village était, et demeure,
entouré de remblais ostensibles. Les Français du 17e siècle parlaient
des Attiwandaron comme «la nation neutre» ou les neutres. Il n'existe
pas de population descendant directement des Attiwandaron de nos jours,
car toute leur confédération a été dispersée ou incorporée au sein des
Cinq-Nations iroquoises entre les années 1647 et 1651. Il s'agit du seul
village iroquoien administré par Parcs Canada dont l'existence soit
commémorée comme celle d'un village en soi.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1982 |
Lieu historique national du Canada de la Résidence-John-R.-Booth
Ottawa, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Résidence-John-R.-Booth est
situé à Ottawa, en Ontario. Construite en 1909, cette vaste demeure est
un exemple remarquable du style néo-Queen Anne. Sa conception
architecturale raffinée présente de nombreux éléments en saillie, des
pignons profilés, des corniches de pierre ornées et une tour d'angle
carrée de style médiéval. À l'intérieur, la demeure a conservé la
plupart de ses nombreuses caractéristiques et finitions d'origine. La
combinaison de ces éléments architecturaux produit un effet de splendeur
opulente.
Cette luxueuse résidence fut construite en 1909 pour John R. Booth, le
magnat canadien du bois. Exemple remarquable du style néo-Queen Anne, la
demeure, située sur un terrain d'angle, possède deux façades principales
pouvant être appréciées séparément. La vue d'angle permet d'apprécier
l'équilibre et l'harmonie qui se dégagent des pignons identiques, reliés
par une cheminée élancée. À la mort de John R. Booth en 1925, la demeure
resta dans la famille Booth jusqu'en 1947, puis elle fut vendue au
Laurentian Club d'Ottawa. Le site a été acquis par l'Université Trinity
Western en 2001 pour établir une base pour les programmes éducatifs à
Ottawa. Par la suite, l'Université a ouvert le « Laurentian Leadership
Centre » en 2002.
|
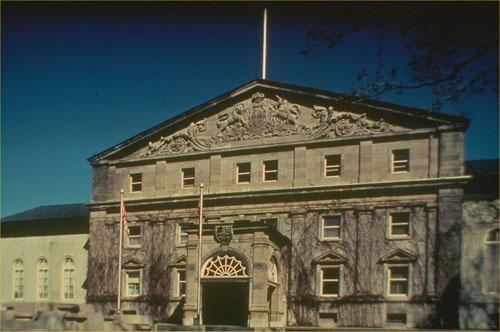
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Rideau-Hall-et-le-Parc
Ottawa, Ontario
Le lieu historique national du Canada Rideau-Hall-et-le-Parc est une
grande propriété boisée située près de la rivière des Outaouais, dans la
Capitale nationale. Depuis 1864, elle sert de résidence au Gouverneur
général du Canada.
La valeur patrimoniale de ce site a trait à ses liens avec le Gouverneur
général du Canada, et elle s'exprime par son élément paysager incluant
la maison vice-royale et les édifices de service qui composent à eux
tout ce pittoresque domaine. La propriété est issue de la maison
originale de 1838 de l'industriel local Thomas Mackay. Depuis qu'elle
sert de résidence au Gouverneur général du Canada, le gouvernement
fédéral l'a transformée dans le style d'un domaine rural anglais. Des
ajouts ont été effectués à la maison, et notamment : une aile à deux
étages en 1865, la salle de la tente en 1876-1878, l'aile Minto en
1898-1899, et une façade nord-ouest à fronton en 1914. Une vingtaine
d'édifices ont été construits, dont plusieurs sous la direction de
Frederick Preston Rubridge, architecte en chef du ministère des Travaux
publics, et notamment : le Pavillon d'entrée dans les années 1860,
l'Édifice de l'écurie en 1866-1867, le Pavillon de cricket dans les
années 1870, le Gazomètre en 1877-1878 et la Laiterie en 1895. De plus,
le parc a été aménagé, notamment par la construction de l'entrée
principale en 1867-1868 et d'une clôture élaborée dans les années
1920-1930, pour évoquer un domaine rural britannique pittoresque.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |
Lieu historique national du Canada Roselawn
Kingston, Ontario
Le lieu historique national du Canada Roselawn est une maison de deux
étages de style néo classique construite à Kingston, en Ontario.
Auparavant au centre d'un vaste domaine, la maison est aujourd'hui
située sur un grand terrain paysagé. Cette élégante résidence en
calcaire au toit à quatre versants possède une façade principale en
saillie et un large pignon central au dessus de la porte d'entrée. Parmi
les détails de style classique de cette construction symétrique, notons
un porche ouvert à colonnes, une corniche denticulée ainsi que des
fenêtres et des cheminées réparties également.
Érigée en 1841 par l'architecte William Coverdale pour David John Smith,
Roselawn rappelle l'époque où de fortunés habitants de Kingston se
faisaient construire de magnifiques maisons de campagne en périphérie de
la ville. Ses proportions, ses frontons et ses ouvertures en arche
reflètent le style néo-classique de l'époque. Entre 1851 et 1868, la
maison est habitée par Sir Henry Smith jr, solliciteur général du
Haut-Canada, puis président de la chambre du Canada Uni. De 1948 à 1969,
elle devient la résidence officielle du commandant du Collège de la
Défense nationale. Queen's University l'achète en 1970 et y fait
d'importants travaux de rénovation et d'agrandissement pour la
transformer en un centre d'éducation continue pour l'université. Elle
est une fois de plus rénovée en 1997 pour devenir le Donald Gordon
Conference Centre.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Smyth Photo, 1991 |
Lieu historique national du Canada de la Rotonde de l'Algoma Central
Sault Ste. Marie, Ontario
La Rotonde de l'Algoma Central consiste en une grande rotonde en brique
du début du XXe siècle avec une plaque tournante interne. Elle est
située dans le triage Steelton, à Sault Ste. Marie.
Si la Rotonde de l'Algoma Central a été désignée lieu historique
national en 1992, c'est parce qu'il s'agit d'un exemple remarquablement
bien préservé du genre.
La Rotonde de l'Algoma Central, qui a été construite par Algoma Central
Railway en 1912 pour l'entretien et la révision des locomotives à
vapeur, est la première de deux rotondes d'un même design construites au
Canada. Elle se distingue des autres rotondes par sa taille imposante et
du fait qu'une plaque tournante complète y a été incorporée, au lieu de
voies directes parallèles.
La rotonde, qui est presque entièrement intacte, comprend une plaque
tournante intérieure, de nombreux postes de travail avec des fosses, et
un atelier de mécanique attenant. Avec les deux édifices latéraux de
taille, de construction, d'âge et d'intégrité comparables, il domine la
gare de triage.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1994 |
Lieu historique national du Canada de la Rotonde-de-la-Rue-John (Canadien Pacifique)
Toronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada de la Rotonde-de-la-Rue-John
(Canadien-Pacifique) est une structure semi-circulaire basse en brique
construite pour placer les locomotives sur une grande plaque tournante.
Elle est située non loin du secteur riverain de Toronto, sur une
ancienne voie ferrée, près de la tour du CN. On y effectue des travaux
de remise en état afin qu'elle soit utilisée à d'autres fins et ouverte
au public.
La valeur patrimoniale de la rotonde de la rue John réside dans son
emplacement dans l'ancien grand dépôt ferroviaire de Toronto, et dans sa
conception et sa forme physique préservée qui illustrent le rôle qu'elle
jouait dans l'industrie ferroviaire. La Rotonde de la rue John a été
conçue par l'ingénieur en chef J.M.R. Fairbairn du département
d'ingénierie du Chemin de fer Canadien Pacifique, et construite de 1929
à 1931 par la compagnie Anglin-Norcross Ltd. de Montréal. La rotonde
comportait 32 compartiments pour faciliter l'inspection, l'entretien, le
nettoyage et la réparation des locomotives à vapeur. À l'apparition du
diesel, elle a été de moins en moins utilisée. Le Chemin de fer Canadien
Pacifique puis VIA Rail ont continué a s'en servir au besoin jusqu'en
1986. La ville de Toronto, qui en est maintenant propriétaire, a enlevé
la plaque tournante, déplacé le réservoir à charbon et à sable, et a
également, de 1994 à 1997, démonté puis reconstruit les compartiments 1
à 11 dans le but de remettre le site en état pour d'autres
vocations.
|

©Royal Conservatory of Music, Canuckistan, May 2011 |
Lieu historique national du Canada Royal Conservatory of Music
Toronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada Royal Conservatory of Music est
situé sur une rue passante du centre-ville de Toronto. Depuis 1963,
cette école de musique influente et reconnue occupe un grand bâtiment de
quatre étages richement décoré, conçu dans le style éclectique de la fin
de l'époque victorienne. Au plus ancien bâtiment, formant l'élément
central, se sont greffés de vastes ajouts plus récents pour créer un
petit complexe. La façade symétrique présente des détails appuyés :
maçonnerie de pierre à parement brut, briquetage décoratif, baies en
saillie, cordons et ligne de toit complexe contrastant avec les
matériaux et le traitement.
Parmi les nombreux conservatoires qui ont vu le jour au Canada au XIXe
siècle, le Royal Conservatory of Music, fondé en 1886, est l'un des
rares qui subsistent. Sa longévité est sans doute en partie attribuable
à l'excellence de son enseignement, au calibre de ses diplômés, à ses
normes élevées et à sa saine administration. Il a toujours été un
établissement majeur, accueillant un grand nombre d'étudiants et
bénéficiant d'un financement substantiel. Son succès rapide l'a obligé à
emménager dans un bâtiment voué à l'enseignement, auquel se sont
ajoutées d'autres installations, et des succursales en milieux
résidentiels. Le bâtiment actuel, McMaster Hall, autrefois le Toronto
Baptist College, a été vendu à l'Université de Toronto par le
gouvernement en 1936. Le Royal Conservatory of Music y donne des cours
et y tient des répétitions depuis 1963. Affilié à l'Université de
Toronto jusqu'en 1991, le Royal Conservatory of Music est maintenant un
établissement indépendant.
|

©D. Gordon E. Robertson, 2010 |
Lieu historique national du Canada des Ruines-de-l'Église-Catholique-St. Raphael
South Glengarry, Ontario
Le lieu historique national du Canada des
Ruines-de-l'Église-Catholique-St. Raphael est un ensemble évocateur de
ruines en pierres situées dans un paysage pastoral et religieux, dans le
Comté de Glengarry Sud, en Ontario. En 1970, le toit de l'église St.
Raphael, les tours construites en 1830 et toute la décoration intérieure
réalisée en 1900 sont détruits par le feu. Les murs extérieurs sont
épargnés et, par le fait même, son plan, sa taille impressionnante ainsi
que ses remarquables ouvrages en maçonnerie sont préservés. Les murs de
maçonnerie de l'ancienne église imposante sont situés à proximité d'un
vieux cimetière, d'une petite église moderne et d'autres établissement
religieux.
La valeur patrimoniale du lieu réside dans ses associations historiques,
comme l'illustrent les ruines bien préservées de l'ancienne église
catholique St. Raphael érigé dans un arrondissement à vocation
religieuse. Les ruines de l'église catholique St. Raphael revêt
également une importance en raison de son association avec Alexander
Macdonell, premier évêque catholique du Haut Canada, qui administre son
diocèse à partir de l'ancienne église au cours des années 1820. Jusque
dans les années 1840, la paroisse de St. Raphael est le plus grand et le
plus important arrondissement religieux des anglophones catholiques du
Haut Canada. Les ruines, qui y sont situées, font partie d'un riche
paysage historique qui comprend un cimetière ainsi que de nombreux
établissements réligieux historiques et modernes.
Témoignant de l'histoire des débuts du catholicisme dans le Haut Canada,
les ruines de l'église catholique St. Raphael constituent un élément
tangible de l'ancienne église monumentale, dont le plan est inspiré des
églises du Québec conçues par l'abbé Pierre Conefroy. L'église St.
Raphael, dont la construction commence en 1815, se dresse au cœur de
l'un des premiers établissements écossais, et pendant les cinq années
suivantes, la paroisse St. Raphael est le berceau du catholicisme en
Ontario. En 1970, un incendie détruit l'église St. Raphael. Depuis les
ruines actuelles subsistent et ont été stabilisées. Aujourd'hui, ces
ruines constituent un testament évocateur des efforts déployés par
l'évêque Alexander Macdonell afin d'instaurer l'église catholique dans
le Haut Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2003 |
Lieu historique national du Canada Ruthven Park
Cayuga, Ontario
Le lieu historique national du Canada Ruthven Park est un domaine rural
préservé et pittoresque du milieu du XIXe siècle, comprenant une villa
de style néo-grec, des dépendances associées et les vestiges
archéologiques d'un village du début du XIXe siècle. Le domaine et les
ruines du village sont situés sur la berge est de la rivière Grand,
juste au nord du village de Cayuga, en Ontario.
La villa, construite dans le style néogrec de 1845 à 1846, et agrandie
dans les années 1860, constitue le centre d'intérêt du domaine, avec sa
façade qui ressemble à celle d'un temple et ses pierres de taille
calcaires. À l'arrière, une série de bâtiments de ferme en pierre brute
calcaire et en brique, construits entre 1845 et 1867, entourent une cour
de ferme rectangulaire fermée qui tient lieu à présent de jardin clos.
La villa et ses dépendances se dressent sur une ligne d'étiage élevée
surplombant la rivière Grand à laquelle on accède par une longue allée
sinueuse. Les édifices sont situés dans une clairière et entourés d'une
pelouse et, plus loin, par des bois. Le domaine comprend aussi une
maison de gardien en brique et un cimetière familial. On trouve, au
nord, les vestiges de l'ancien village d'Indiana, y compris une maison à
pans de bois du milieu du XIXe siècle et les vestiges d'un barrage et
d'une écluse.
Dans les années 1830, la Grand River Navigation Company a transformé la
rivière Grand en une voie navigable pour des activités commerciales
entre Brantford et le lac Érié. Sous la direction, entre autres, de
David Thompson, la société a construit une série d'écluses, de barrages
et de canaux le long de la rivière. David Thompson a aussi conçu le
village d'Indiana, une des plus petites communautés de la vallée
inférieure de la rivière Grand, le long d'un canal, à avoir prospéré
grâce aux activités de la société. En 1845, David Thompson s'est inspiré
des domaines ruraux britanniques pour concevoir un domaine surplombant
la rivière qui reflète son statut social et économique.
Ruthven Park est un des rares exemples subsistants de la fusion
romantique de l'architecture classique et des paysages pittoresques qui
caractérisent les domaines ruraux de la fin du XVIIIe siècle et du début
du XIXe siècle. La villa néo-grecque, conçue selon les plans de
l'architecte américain John Latshaw, suit la forme et le plan de
l'architecture domestique néo-classique telle qu'elle s'est développée
au XIXe siècle. Une ornementation néo-grecque audacieuse et riche, dont
une façade telle celle d'un temple, à la manière néo-grecque américaine,
agrémente tant l'extérieur que l'intérieur de la villa.
Le domaine est directement associé au peuplement de la vallée inférieure
et moyenne de la rivière Grand. C'était une période de transition pour
le Haut-Canada, car des hommes d'affaires prospères tels que David
Thompson commençaient à modeler le paysage sur le modèle britannique. Le
domaine de David Thompson illustrait parfaitement les principes de
conception de style pittoresque. Les édifices, les espaces ouverts et la
végétation étaient disposés de façon à créer des panoramas agréables et
à tirer parti des éléments naturels. Les routes et les allées sont
disposées pour permettre de voir certains panoramas du domaine et de ses
composants. Les édifices et les structures d'inspiration néoclassique,
comprenant la villa, la maison de gardien et le cimetière familial,
ajoutent sophistication et charme au milieu naturel. La disposition des
bâtiments de ferme pour créer une cour abritée derrière la villa, montre
l'influence du mouvement de réforme agraire du XIXe siècle sur les
formes rurales.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Sandyford Place
Hamilton, Ontario
Le lieu historique national du Canada Sandyford Place est une rangée de
maisons en pierres construites au milieu du XIXe siècle. Elle est située
sur la rue Duke dans le quartier Durand, un quartier principalement
résidentiel situé à la périphérie sud du centre-ville de Hamilton.
Sandyford Place est l'un des rares exemples qui restent d'un petit
nombre de maisons en rangée construites pour les citoyens fortunés du
Canada au milieu du XIXe siècle. Construite pendant une période où
Hamilton était en croissance rapide, elle est caractéristique du style
de construction qu'on trouvait dans la ville à cette époque, quand de
nombreux pionniers écossais essayaient de recréer les terrasses en
pierres et le plan en échiquier des rues des villes écossaises. La
maçonnerie fine rappelle le travail des maçons écossais de l'Ontario à
l'époque.
|
|
Lieu historique national du Canada du Site-Archéologique-Cummins
Thunder Bay, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Site-Archéologique-Cummins se
trouve en périphérie de Thunder Bay, en Ontario, au nord du lac
Supérieur. Situé dans un paysage boisé, le site clôturé comprend l'étang
Cummins et la crête de plage du lac Minong, qui constituait autrefois le
rivage du lac glaciaire Minong. Il fait partie d'un circuit régional
complexe, formé de sites paléo-indiens, connu sous le nom de complexe
archéologique Lakehead et associé à des assemblages lithiques de la
période taconique, des affleurements rocheux de la formation de Gunflint
et d'anciennes lignes de rivage de lac proglaciaire. Du débitage de
taconite et des outils de pierre sont éparpillés tout le long de
l'ancienne ligne de rivage ainsi que dans les environs.
Le site archéologique Cummins, faisant partie du complexe archéologique
Lakehead, figure parmi les exemples les plus importants et
représentatifs des occupations par la culture Plano remontant à la phase
tardive de la période paléo-indienne (soit de 7000 à 3000 ans avant
notre ère). Le complexe archéologique Lakehead s'est développé en
fonction de la disponibilité des matières premières lithiques dans la
région, notamment dans la formation de Gunflint, riche en taconite, une
pierre précambrienne semblable au silex étant riche en fer et en silice,
dont se servaient les Planoïens pour fabriquer des outils. À l'instar de
la plupart des sites du complexe archéologique Lakehead, le site
archéologique Cummins a été développé parce qu'il se trouvait à
proximité de sources d'approvisionnement en eau, des voies migratoires
du caribou et qu'on y trouvait du poisson, du petit gibier et de la
sauvagine. Situé directement sur le gisement de taconite, le site
servait à la fois de carrière, d'atelier et d'aire d'habitation et
constitue la zone principale d'activités archéologiques du complexe
archéologique Lakehead. Bien que les portions entourant le site soient
continuellement affectées par l'extraction de gravier, l'étalement
urbain, la circulation de véhicules récréatifs et la construction de
routes, le terrain de 7,3 hectares appartenant à la Province d'Ontario
demeure toujours intact.
|

©J.V. Wright and J.E. Anderson, "The Donaldson Site," National Museum of Canada Bulletin 184, 1963 |
Lieu historique national du Canada du Site-Donaldson
Chippewa Hill, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Site-Donaldson est situé sur la
rive nord de la rivière Saugeen, près des premiers grands rapides, et en
amont du lac Huron, près de Chippewa Hill, en Ontario. D'une superficie
d'environ 1,2 hectare, le site archéologique est formé de trois
terrasses fluviales renfermant des vestiges d'un campement de
macrobande, occupé sporadiquement par les Saugeens pendant plus de 1 000
ans. Le lieu a fait l'objet de plusieurs fouilles archéologiques qui ont
permis de mettre au jour de nombreux artéfacts, notamment les vestiges
de deux bâtiments, de multiples fosses, dépôts et dépressions de même
que des biens culturels de toutes sortes.
Le lieu historique national du Canada du Site-Donaldson est le mieux
documenté et le plus grand site datant du Sylvicole moyen (environ 200
ans avant notre ère à 900 ans de notre ère) appartenant à la culture
saugeen. Occupé par une petite macrobande pendant le printemps et l'été,
le campement servait principalement de poste de récolte, où étaient
exploitées les abondantes ressources en poissons de la rivière Saugeen.
Diverses fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour de
nombreux objets de la culture matérielle de ce peuple autochtone,
notamment les vestiges de deux habitations, de deux cimetières distincts
et de plusieurs âtres, sur les haute et moyenne terrasses. De vastes
tertres, des fosses montrant des traces de la présence d'espèces
végétales et animales ainsi qu'une imposante collection d'artéfacts,
notamment des céramiques, des outils en pierre, en métal et en os,
témoignent des modes d'occupation du territoire et des pratiques
funéraires des Saugeens.
|
|
Lieu historique national du Canada du Site-Etharita
Clearview, Ontario
Village principal de la tribu des Loups (Petuns) (1647-1649).
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |
Lieu historique national du Canada du Site-de-la-Falaise
Port Dover, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Site-de-la-Falaise, situé sur
la colline Brant, à Port Dover, Ontario, surplombe la route 6, qui longe
la rive nord du lac Érié. Ce lieu est marqué d'une grande croix
commémorative. Une croix placée sur un piédestal, au sommet d'un
escalier octogonal, ce monument porte une plaque de la Commission des
lieux et monuments historiques du Canada, ainsi qu'une plaque
secondaire, qui rappelle la croix installée sur les lieux en 1670, mais
dont aucun vestige ne subsiste.
Le 6 juillet 1669, les missionnaires français François Dollier de Casson
et René Bréhent de Galinée quittent Montréal pour prendre part à une
expédition vers l'intérieur des terres, dirigée par Robert Cavalier de
La Salle. Les deux missionnaires, qui font partie d'un groupe composé de
vingt deux Européens et interprètes algonquins, quittent leurs
compagnons après ce qui est aujourd'hui Hamilton. Ils sont accompagnés
de sept hommes et disposent de trois canots. À la fin d'octobre 1669,
ils établissent un campement d'hiver dans le lieu devenu aujourd'hui
Port Dover. Ils le choisissent pour sa beauté et ses abondantes sources
de nourriture, et en prennent possession au nom de Louis XIV, roi de
France. Le 23 mars 1670, trois jours avant leur départ, ils érigent une
grande croix portant les armoiries de la France, marquant ainsi un
chapitre important de l'histoire de l'expansion du Canada.
|
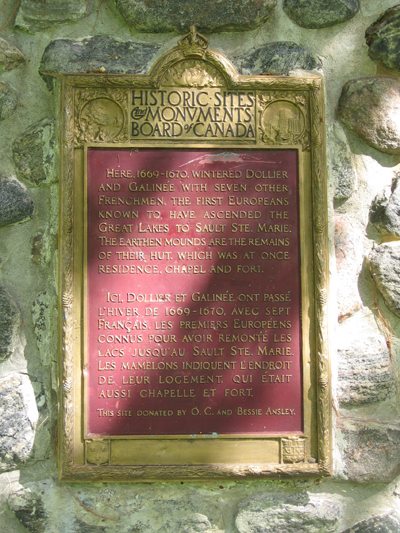
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Jim Molnar, 2005 |
Lieu historique national du Canada du Site-d'Hivernage
Port Dover, Ontario
Ici, Dollier et Galinée ont passé l'hiver de 1669-1670, avec sept
français, les premiers Européens connus pour avoir remonté les lacs
jusqu'au Sault Ste. Marie. Lew mamelons indiquent l'endroit de leur
logement qui était aussi chapelle et fort.
|
|
Lieu historique national du Canada du Site-Middleport
Six Nations of the Grand River First Nation, Ontario
Site archéologique, stade moyen de la tradition iroquoise de l'Ontario.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Site-de-la-Rivière-Pic
Pic River, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Site-de-la-Rivière-Pic est
situé sur de vastes terres basses et sablonneuses sur la rive nord du
lac Supérieur, à 14 kilomètres au sud de Marathon, en Ontario. Il est
borné par le lac à l'ouest, par des terres hautes et rocheuses au nord
ainsi que par la rivière Pic au sud et à l'est. On y trouve quatre sites
archéologiques, à savoir celui de Pic River, du fort Pic, de Heron Bay
et de Duncan, qui ont accueilli de nombreux établissements autochtones
et européens entre l'an 12 000 av. J.C. et la fin du XIXe siècle.
L'embouchure de la rivière du Pic a accueilli de nombreux établissements
autochtones, dont certains remontent à des millénaires. Dans les années
1780, les Européens ont établi à cet endroit un poste de traite des
fourrures qui par la suite a été occupé par la Compagnie du Nord Ouest
en 1799, puis par la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1821. Les
Ojibways, qui vivaient dans la région, ont fini par déménager en amont.
Signe des changements qui ont marqué la rive du lac Supérieur au fil du
temps, les vestiges découverts dans les sites montrent habituellement
que les plus anciens établissements se trouvaient en amont de la rivière
Pic. En effet, le site de Duncan (DdIn 7), celui qui est le plus en
amont, représente un petit camp datant de l'Archaïque inférieur ou du
Sylvicole supérieur (400 av. J C — 300 apr. J C). Le site de Heron Bay
(DdIn 1), situé au sud près de l'embouchure de la rivière, contient des
tertres témoignant de la présence du peuple autochtone Laurel entre le
Sylvicole inférieur et supérieur. Le site de Pic River (DdIn 2), qui se
trouve sur les terrasses de plage les plus rapprochées de l'embouchure
de la rivière, est un tertre qui s'étend le long d'une ancienne rive
datant du Sylvicole supérieur (1 300 — 1 600 apr. J C) jusqu'à l'époque
des contacts avec les Européens. Le site du fort Pic, quant à lui, se
trouve entre celui de Pic River et celui de Heron Bay, sur l'emplacement
de l'ancien poste de traite.
|
|
Lieu historique national du Canada du Site-Walker
Onondaga, Ontario
Vaste site iroquoien, tribu historique des Attiwandaronk (neutres).
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national Sites-Ossossane
Ossossane Beach, Ontario
Le lieu historique national du Canada des Sites-Ossossané se trouve sur
la rive de la baie Nottawasaga, dans la baie Georgienne, sur le lac
Huron, en Ontario. Il est composé de deux sites situés à 1,6 kilomètre
l'un de l'autre. L'ancien village couvre un surface d'environ 2,5
hectares sur une péninsule défendable; protégé sur trois côtés par des
terrains escarpés, il fut le principal lieu d'habitation d'un clan
huron, les Attignaouantans, ou clan de l'Ours, de 1632 à 1636 apr. J.-C.
L'ossuaire situé à proximité, qui couvre moins de 0,5 hectare, a été
créé lorsque le clan a abandonné le village, en 1636. D'une
circonférence de sept mètres et d'une profondeur de deux mètres, il se
trouve sur une ancienne terre agricole, dans un champ, parmi des pins
dispersés. Les deux sites sont séparés par des champs, un pâturage et un
marais.
La valeur patrimoniale des sites Ossossané découle de leur importance
historique et physique. Les deux endroits ont été datés avec précision,
appartiennent à une population connue et permettent d'approfondir notre
connaissance de la vie quotidienne et des rituels du peuple historique
huron. Le lieu désigné comprend deux aires d'intérêt archéologique
distinctes, soit le village d'Ossossané, à l'extrême sud du territoire,
qui fut le principal village du clan des Attignaouantans ou clan de
l'Ours dans la dernière partie de l'ère des Jésuites, et l'ossuaire
d'Ossossané.
Dans leurs récits, des missionnaires décrivent le village d'Ossossané et
son ossuaire. Principal village du clan huron de l'Ours de 1632 à 1636
apr. J.-C., il a probablement été habité avant 1632, et possiblement 12
ans avant l'épidémie de variole qui a décimé la Huronie en 1639 apr.
J.-C. Parmi les missionnaires français qui s'y sont rendus figurent les
pères Jean de Brébeuf et Lalemant. L'endroit a aussi accueilli la
mission de La Rochelle des frères Récollets et la mission de La
Conception des Jésuites. Ossosané était un grand village qui comptait
environ 40 longues maisons ainsi qu'une population de 1500 personnes
appartenant au clan des Attignaouantans (ou clan de l'Ours). Le village
repose sur un réseau de sentiers principal, point de liaison entre la
Huronie et les Pétuns. Des travaux d'excavation ont permis de mettre au
jour des poteries, des pipes, des perles, de la ferronnerie, des pointes
de flèche et des fragments de vases en cuivre. Les Hurons vivaient dans
un village pendant dix ou vingt ans avant de se déplacer après avoir
épuisé les ressources locales. Le village se situe dans un ancien champ
agricole aujourd'hui utilisé comme pâturage pour chevaux.
Avant de quitter le site du village d'Ossossané en 1636, les Hurons ont
créé un ossuaire à 1,6 km de là et procédé à un rituel dont a été témoin
le père Jean de Brébeuf, missionnaire français. Caractérisé uniquement
par une importante dépression en forme de demi-soucoupe dans le sol
avant l'excavation, l'ossuaire avait un diamètre de sept mètres et une
profondeur de deux mètres. Selon les récits de témoins oculaires,
l'ossuaire est le premier site du genre à avoir été excavé à l'aide de
moyens modernes en 1954. Les travaux d'excavation effectués ont permis
de mettre au jour des présents funéraires d'origine autochtone et
européenne, dont des perles de coquillage, des pointes de projectiles,
des textiles, des pipes, des pendentifs en os, de l'ocre rouge, des
peaux de castor, des noix d'hêtre, des billes de verre, des bouilloires
en cuivre, des couteaux, des ciseaux et des alènes en fer, des
bracelets, une clé, ainsi que des bagues, des perles et des bracelets en
cuivre. L'ossuaire d'Ossossané se situe sur une plaine sablonneuse.
Lorsqu'on y a effectué les premiers travaux d'excavation à la fin des
années 1940, il était en plein champ, mais depuis, l'endroit s'est
transformé en forêt secondaire. L'ossuaire du lieu historique appartient
aux Hurons-Wendats de la Première Nation de Wendake.
|
|
Lieu historique national du Canada Sheguiandah
Manitoulin District, Ontario
Le lieu historique national du Canada Sheguiandah est situé sur la rive
nord-ouest de l'île Manitoulin, près de la communauté actuelle de
Sheguiandah, en Ontario. Le site se distingue notamment par une colline
de quartzite contenant des artefacts témoignant de 9 000 années
d'occupation, allant de la période paléo-indienne au Sylvicole moyen. Il
s'étend au pied de la colline dans toutes ces directions et englobe le
village actuel de Sheguiandah.
Les vestiges trouvés à Sheguiandah témoignent d'une série d'occupations
successives par les premiers habitants de ce qui est aujourd'hui
l'Ontario, à partir de la période paléo-indienne, vers 11000 avant notre
ère, pendant le retrait du lac glaciaire Algonquin. Le lieu contient
aussi des artefacts de la période archaïque (1000-500 avant notre ère)
ainsi que des outils en pierre de la culture de Point Peninsula
caractéristiques du Sylvicole moyen (0 —500 de notre ère). Les
caractéristiques principales du site sont les affleurements de
quartzite, matériau avec lequel les premiers peuples autochtones
réalisent des outils et des armes. Ils utilisent de gros marteaux en
pierre pour détacher des morceaux de roche-mère dont les fragments les
plus fins servent à fabriquer des couteaux, des grattoirs et d'autres
outils pour la chasse, la pêche et la cueillette.
|

©Jennifer A. Cousineu, Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2018 |
Lieu historique national du Canada Spadina
Toronto, Ontario
Construit en 1866 pour l'entrepreneur torontois James Austin et son épouse Susan
Bright Austin, ce lieu d'intérêt de Toronto est un rare exemple de domaine et
villa de campagne transformés en une opulente résidence édouardienne. De 1897 à
1913, l'architecte torontois W.C. Vaux Chadwick, l'architecte Eustace G. Bird,
de la firme américaine Carrère and Hastings, et le peintre Gustav Hahn mettent
en œuvre de grands changements à la maison de campagne victorienne qui se
trouvait déjà sur le site et dont le concepteur est inconnu. C'est le fils de
James Austin, Albert, qui hérite de la Spadina. Avec l'aide de son épouse, Mary,
Albert fait faire des modifications visant à indiquer clairement aux voisins et
aux visiteurs la position sociale de premier plan qu'occupe la famille et la
richesse qu'elle possède. L'architecture, l'aménagement intérieur et
l'ameublement de ce manoir ainsi que les vastes terrains, jardins et dépendances
qui l'entourent illustrent la splendeur dans laquelle l'élite fortunée du Canada
vit pendant la rapide période d'expansion urbaine du début du XXe siècle. À
l'intérieur, cette aisance se traduit par l'aménagement novateur de pièces
publiques et privées pour la famille ainsi que de logements pour les
domestiques. À l'extérieur, elle s'exprime par la conception et la disposition
du jardin, de la serre et du garage, ce dernier comportant un logement pour le
chauffeur.
La Spadina actuelle est un grand manoir au style architectural éclectique
comptant 55 pièces. Auparavant, la propriété comptait deux petites maisons
construites en 1818 et 1836, également nommées Spadina, qui furent détruites par
les flammes. La Spadina ayant été considérablement modifiée dans son apparence
lors des dernières rénovations du début du XXe siècle, elle présente
essentiellement le style Second Empire, en plus de certaines caractéristiques
architecturales antérieures datant du milieu du XIXe siècle, visibles à
l'intérieur comme à l'extérieur. Dotée de briques couleur chamois, de moulures
vert foncé et d'un toit en mansarde gris, la Spadina se distingue par ses baies
vitrées à double hauteur, ses nombreuses lucarnes, sa terrasse à balustres du
côté sud et sa splendide porte-cochère en fer et en verre du côté ouest. La
maison est à peu près symétrique, divisée par un long couloir central nord-sud,
mais la disposition des fenêtres, des portes et des pièces est irrégulière. La
structure extérieure vivante de l'édifice révèle une conception d'élévation
différente sur chacun de ses quatre côtés.
L'intérieur de la Spadina combine des espaces luxueux réservés à un usage
familial privé et à des activités sociales ainsi que des espaces de service
autrefois habités par le personnel qui dirigeait la maisonnée. Le cœur du musée
est composé de nombreuses pièces présentant des collections intactes de meubles
et d'objets d'art d'origine ayant appartenu à la famille. Les autres pièces
remplissent diverses fonctions muséologiques, ce qui comprend des bureaux, une
bibliothèque et des espaces d'entreposage. Le sous-sol abrite aujourd'hui une
boutique de souvenirs, une salle de réunion, des espaces d'entreposage et un
espace exposant les fondations de la première maison (1818). Au rez-de-chaussée,
on trouve des pièces historiques telles que la cuisine, la salle à manger, le
hall d'entrée, la salle de réception, la salle de séjour et la véranda connue
sous le nom de la salle Palm. Le deuxième étage comprend des chambres
historiques, des bureaux à l'usage du personnel actuel et des salles de séjour.
Finalement, les espaces des serviteurs (chambres, salle de bain et salle de
séjour), des chambres pour la famille et des salles de séjour historiques
occupent le troisième étage.
Située sur la colline de Davenport, la Spadina repose sur 2,31 hectares de
terres dans le quartier Casa Loma, à Toronto. La partie nord de la propriété,
maintenant séparée de la partie sud, du côté ouest, par une pergola en pierre
datant de 1909, compte les bâtiments de services, soit l'étable (1850), le
garage/résidence du chauffeur (1909) et une serre (1913). Au nord de la maison,
on trouve également une pommeraie. À l'est se trouve une grande cuisine
soigneusement élaborée et un jardin de parterres fleuris. Au sud de la maison,
la terrasse donne sur une grande pelouse bien entretenue qui se termine par un
rideau d'arbres à la lisière de la colline de Davenport.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, D. Hamelin, 2005 |
Lieu historique national du Canada St. George's Hall (Arts and Letters Club)
Toronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada St. George's Hall (Arts and
Letters Club) est un édifice en pierre et en brique de trois étages
coiffé d'un toit en pente abrupte. Situé quelques mètres à l'ouest de la
rue Yonge, au centre ville de Toronto, le bâtiment, qui abrite le Arts
and Letters Club depuis 1920, emprunte des éléments architecturaux aux
styles roman, flamand et médiéval. Une vaste entrée de style néo-roman
domine la façade aux formes symétriques, alors qu'à l'arrière, un grand
hall occupe la plus grande partie de l'espace.
La valeur patrimoniale du St. George's Hall (Arts and Letters Club)
tient à son aménagement et à son décor, à sa vocation de lieu de
rencontre entre artistes et mécènes et à ses liens avec le Arts and
Letters Club. Construit en 1891 pour la St. George's Society, le
bâtiment est rénové en 1920, lorsqu'il devient la résidence du Arts and
Letters Club. Au sein du Club se rencontrent des artistes de diverses
disciplines — peintres, écrivains, musiciens, architectes et acteurs,
entre autres — ainsi que des mécènes amoureux de l'art. Depuis
quatre-vingt-cinq ans, St. George's Hall est un lieu de rassemblement
pour les artistes du milieu des arts et un centre important pour la mise
en valeur de l'activité artistique. Le bâtiment, notamment par son état
de conservation remarquable, témoigne de l'importance du Club dans
l'histoire culturelle du Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1996 |
Lieu historique national du Canada St. Lawrence Hall
Toronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada St. Lawrence Hall, élégant édifice
public de trois étages et demi, a été construit au milieu du XIXe siècle
dans le centre-ville de Toronto, à l'angle sud-ouest de l'intersection
des rues King et Jarvis. Ses proportions classiques, sa belle maçonnerie
en pierre, le faîte de son toit orné et sa coupole en dôme sont tout à
fait remarquables au cœur du paysage urbain du quartier.
Le St. Lawrence Hall a été construit par la ville de Toronto en 1850.
Conçu par l'architecte William Thomas dans le style à l'italienne, il
offrait à l'élite torontoise du XIXe siècle un élégant lieu de
rassemblement. Le rez-de-chaussée a été conçu à des fins d'espace
commercial, le deuxième étage, pour des bureaux. Quant au troisième
étage, il abrite une salle de réunion de 1000 places assises. L'édifice
était un lieu culturel important où étaient organisés des conférences,
des concerts, des bals et des réceptions auxquels participaient les
notables de la ville. Plusieurs réunions importantes en faveur de
l'abolition y ont également été organisées à l'époque où le Canada
accueillait des milliers de réfugiés du chemin de fer clandestin qui
fuyaient l'esclavage américain. Le St. Lawrence Hall, qui a été restauré
en 1967, est redevenu un centre culturel actif.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2006 |
Lieu historique national du Canada Taverne-de-Montgomery
Toronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada Taverne-de-Montgomery est situé à
Toronto, à l'angle de la rue Yonge et de l'avenue Montgomery. Le lieu,
actuellement occupé par un bureau de poste, est commémoré par une plaque
de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada fixée à la
base d'un mât porte-drapeau installé au nord du bâtiment. Il ne subsiste
aucune ressource connue de la taverne d'origine. Ses dimensions exactes
et son empreinte par rapport au bureau de poste demeurent inconnues.
En 1837, incapable d'obtenir une représentation juste par les voies
politiques, William Lyon Mackenzie, réformateur, rédacteur en chef d'un
journal et premier maire de Toronto (élu en 1834), réunit un groupe de
modérés et de radicaux dans une tentative de renversement du
gouvernement au pouvoir. Mackenzie établit son quartier général à la «
Montgomery's Tavern », située au nord des limites actuelles de Toronto,
et donne le coup d'envoi à la rébellion le 5 décembre, alors qu'en
compagnie de quelque 800 rebelles mal équipés et sans entraînement, il
entame sa marche vers le sud. La milice locale les repousse avant leur
arrivée à la ville, et le 7 décembre, le lieutenant-gouverneur sir
Francis Bond Head ordonne à 1 000 miliciens et volontaires sous les
ordres du colonel James FitzGibbon de riposter. Les forces de FitzGibbon
affrontent celles de Mackenzie près de la « Montgomery's Tavern » le
même jour et la rébellion est réprimée. La taverne est rasée par le feu
le même jour. Bien que la rébellion ait été écrasée, elle n'en a pas
moins contribué à l'établissement du gouvernement responsable au Canada,
de même qu'à l'union législative du Haut-Canada et du Bas-Canada en
1841.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national du Canada du Temple-de-Sharon
Sharon, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Temple-de-Sharon est situé au
nord de Toronto, dans le village de Sharon. C'est un élégant bâtiment de
bois formé de trois étages de taille décroissante. Les quatre côtés du
bâtiment sont percés de grandes fenêtres qui sont éclairées par des
bougies lors de cérémonies spéciales. Le temple a été érigé au centre
d'un vaste espace gazonné qui compte également d'autres bâtiments
associés à la communauté religieuse.
Sa valeur patrimoniale repose sur la qualité de sa conception
néoclassique et sur sa représentation du savoir-faire des pionniers et
des croyances des Enfants de la Paix. Ces derniers avaient fondé, au
nord de Toronto, une communauté coopérative d'abord appelée Hope et, par
la suite, Sharon. Le temple a été construit par les membres de la
communauté entre 1825 et 1831 selon les plans dessinés par le chef de la
communauté, David Willson et sous la direction du maître-charpentier
Ebenezer Doan. Le dernier service a été célébré dans le temple en 1889.
En 1917, le temple a été acquis par la York Pioneer and Historical
Society, qui a commencé la réhabilitation et l'a developpé pour en faire
un lieu historique et qui a déménagé d'autres bâtiments sur la propriété
au fil des ans.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Michelle Cinann, 2008 |
Lieu historique national du Canada du Temple-du-Travail-Finlandais
Thunder Bay, Ontario
Le lieu historique national du Temple du Travail Finlandais est un
bâtiment rectangulaire de deux étages en brique rouge situé au cœur du
quartier multiculturel de Bay-Algoma à Thunder Bay, en Ontario. La
conception éclectique du bâtiment se caractérise par deux sections de
toit en croupe reliées par une section centrale à deux versants. La
façade symétrique se distingue par une tour polygonale de trois étages,
au centre, avec des baies latérales carrées, des fenêtres disposées à
intervalles réguliers et des escaliers latéraux menant au porche de
l'entrée principale. La taille imposante du bâtiment témoigne de
l'importance de l'endroit comme centre de l'immigration finlandaise,
avec ses bureaux, ses salles de réunions, ses musées, son restaurant
d'origine et son vaste auditorium. Il abrite les salles de réunion de
deux organisations finlandaises qui représentent le rôle actif des
Canadiens d'origine finlandaise dans le mouvement ouvrier au Canada.
Le temple du travail finlandais évoque une époque importante de
l'immigration finlandaise au Canada au milieu des années 1870. Les
immigrants sont alors attirés par la promesse de trouver des emplois et
des terres à exploiter. La ville de Thunder Bay, en Ontario, gagne alors
en popularité auprès des Finno-Canadiens qui enracinent leur culture
dans la région et y établissent des organismes communautaires. Construit
en 1909-1910, le temple du travail finlandais abrite deux grandes
organisations finlandaises, le local socialiste et une organisation
antialcoolique (la New Temperance Society), tous deux associés au
socialisme au Canada. Le temple du travail finlandais a joué un rôle
dans le mouvement ouvrier au Canada et dans l'engagement de la
communauté en faveur des organisations politiques et communautaires.
C'est aussi le lieu privilégié pour l'expression et la conservation de
la culture et des traditions uniques de la communauté finlandaise, qui
reflète bien le multiculturalisme du secteur. De plus, le temple du
travail finlandais abrite le restaurant Hoito, établissement fondé en
1918 et reconnu mondialement qui sert toujours des mets traditionnels
finlandais. Le temple du travail finlandais est à la fois un symbole et
point d'intérêt important pour la communauté finlandaise, ainsi qu'un
établissement phare du secteur de la rue Bay-Algoma à Thunder
Bay.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada The Grange
Toronto, Ontario
Faisant maintenant partie du Musée des beaux-arts de l'Ontario au cœur
de Toronto, cette maison était jadis la pièce maîtresse d'un très beau
domaine dans la banlieue de la ville de York. Située à l'extrémité d'un
grand parc, cette maison en briques dotée d'une façade d'origine à cinq
baies et surmontée d'un fronton, reflète le classicisme britannique
conservateur, typique des autres domaines de l'est du Canada de son
époque.
The Grange a été construite aux environs de 1817 pour D'Arcy Boulton Jr.
dans un quartier de la ville de York qui comptait essentiellement des
domaines résidentiels appartenant à de riches citoyens. Sa façade à cinq
ouvertures symétriques et son fronton central en font un exemple de
l'influence conservatrice de la tradition classique britannique du
XVIIIe siècle. L'aile ouest résulte de deux ajouts, dont un dans les
années 1840, et d'autres modifications apportées par son nouveau
propriétaire, Dr Goldwin Smith, en 1885. Le Musée des beaux-arts de
l'Ontario en a fait l'acquisition en 1911 et, depuis, la maison sert de
musée.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Andrew Waldron, 2004 |
Lieu historique national du Canada The Studio Building
Toronto, Ontario
Le Studio Building, édifice en brique moderne de trois étages, d'allure
industrielle, a été construit en 1914, pour y aménager des ateliers
d'artiste au 25 de la rue Severn, dans le centre-ville de Toronto, au
bord du ravin Rosedale. Les ateliers ont été utilisés par de nombreux
artistes canadiens, parmi lesquels des membres du Groupe des Sept.
Le Studio Building a été dessiné par l'architecte Eden Smith, FIRAC, en
1913, et construit par R. Robertson and Sons en 1914, pour y aménager
des ateliers d'artiste pour le peintre Lawren Harris et le mécène
canadien, M. James MacCallum, qui les mettait à la disposition
d'artistes à la recherche d'un espace où travailler et vivre. Il
comprend six ateliers où des artistes canadiens travaillent dans
d'excellentes conditions depuis presque 100 ans. À un certain moment,
Tom Thomson, Arthur Lismer et Thoreau MacDonald vivaient et
travaillaient dans une cabane dans la cour qui a été détruite depuis.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada The Studio
Building tient à ses associations avec des artistes canadiens
importants, y compris le Groupe des Sept, et à ce qu'il est
l'illustration matérielle d'un des premiers ateliers d'artiste canadiens
de style moderne.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Mattie, 1992 |
Lieu historique national du Canada du Théâtre-Eglinton
Toronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada du Théâtre-Eglinton est un repère
connu de l'avenue Eglinton Ouest, situé dans la banlieue torontoise de
Forest Hill, en Ontario. De style Art déco raffiné et somptueux, le
théâtre Eglinton date du milieu des années 1930. La façade principale
est caractérisée par l'usage de multiples luminaires, en plus d'une
enseigne distinctive qui comprend des néons et un pylône à trois
sections coiffé d'un néon rond et clignotant.
Conçu par les architectes Kaplan & Sprachman de Toronto, le théâtre
s'écarte de la conception traditionnelle des cinémas dans la mesure où
son style et ses éléments décoratifs puisent dans le courant général de
la pensée et des pratiques de l'architecture plutôt que du monde du
théâtre. Cette place importante accordée à l'architecture est illustrée
par le style Art déco de l'édifice particulièrement par ses lignes
fluides et épurées, ses formes étagées et enchâssées, et par une
accentuation du détail décoratif.
Situé sur l'avenue Eglinton, dans la banlieue torontoise de Forest Hill
qui date des années 1920, le théâtre Eglinton illustre l'étalement
croissant de Toronto et la tendance nationale à construire les nouveaux
cinémas dans les banlieues plutôt qu'en plein centre des grandes
villes.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J Butterill, 1993 |
Lieu historique national du Canada du Théâtre-Royal-Alexandra
Toronto, Ontario
Le Théâtre Royal Alexandra est un théâtre de style Beaux-Arts datant du
début du XXe siècle. Il est situé au centre-ville de Toronto.
Le Théâtre Royal Alexandra a été désigné lieu historique national parce
que c'est un exemple d'importance nationale d'un théâtre construit
spécifiquement pour des représentations théâtrales en public.
Le Théâtre Royal Alexandra est une version intime mais somptueuse des
théâtres traditionnels du XIXe siècle construits exclusivement pour des
représentations théâtrales en public. Dessiné par le célèbre architecte
torontois, John M. Lyle (1872-1945), qui avait travaillé dans le secteur
de la conception de théâtre à New York, le Théâtre Royal Alexandra est
une importation directe du genre de petits théâtres somptueux et
d'atmosphère intimiste qui étaient construits à New York. Le théâtre est
conçu de telle façon qu'il peut contenir un nombre assez élevé de sièges
dans un espace donnant l'illusion d'être petit. Le Théâtre Royal
Alexandra est l'un des derniers théâtres de ce genre à avoir été
construit au Canada et il est probablement le meilleur exemple qui reste
des théâtres de ce genre. Depuis qu'Ed Mirvish l'a sauvé et rénové en
1963, le Théâtre Royal Alexandra a joué un rôle central dans la vie
sociale et culturelle de Toronto. Son style Beaux-Arts continue d'offrir
un décor élégant pour les représentations théâtrales et les
concerts.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada des Théâtres-Elgin-et-Winter Garden
Toronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada des Théâtres-Elgin-et-Winter
Garden regroupe deux théâtres superposés dans un même édifice
exceptionnel au centre-ville. L'édifice a été construit au début du XXe
siècle pour y faire jouer du théâtre de variétés. Son extérieur
relativement sobre, avec sa façade en maçonnerie à deux étages, ne
correspond pas à son intérieur somptueux abritant l'élégant théâtre
Elgin au rez-de-chaussée et le magique théâtre Winter Garden à l'étage.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada des
Théâtres-Elgin-et-Winter Garden réside dans le fait que ses salles sont
superposées, et qu'il est représentatif de l'architecture des premiers
cinémas. De plus, conçu pour la chaîne Loew Theatres par Thomas Lamb, un
architecte de cinémas de New-York, il constitue un exemple préservé des
conceptions de ce dernier. Le théâtre Elgin situé au rez-de-chaussée,
avec son décor de style néorenaissance, a ouvert ses portes à la fin de
1913. Il partageait ses séances de cinéma et des variétés avec le Winter
Garden, situé à l'étage supérieur et de dimensions moindres. Ouvert en
1914, celui-ci offrait un décor naturaliste et atmosphérique. Il ferma
ses portes en 1928, mais il resta essentiellement intact pendant plus de
50 ans. Le théâtre Elgin est resté ouvert et a été fréquemment modifié
pour s'adapter à l'époque. La Fondation du patrimoine ontarien a
restauré les deux théâtres dans les années 1980.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Butterill, 1994 |
Lieu historique national du Canada de la Tour-Murney
Kingston, Ontario
Fortifications en maçonnerie de l'Empire britannique; milieu du XIXe
siècle.
Le lieu historique national du Canada de la Tour-Murney est une tour
défensive compacte en pierre située sur une élévation appelée pointe
Murray, sur la rive ouest du port de Kingston. La tour Murney fait
également partie du lieu historique national du Canada des
Fortifications-de-Kingston.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la
Tour-Murney a trait au fait qu'il s'agit d'un excellent exemple de tour
martello, un type d'ouvrage militaire. Sa conception stratégique, les
formes de ses éléments bâtis et paysagés, ses matériaux, son travail de
qualité, la technologie de sa construction et sa fonction, ainsi que sa
situation stratégique et les liens défensifs mutuels avec les autres
composantes des fortifications de Kingston, ajoutent encore à sa valeur.
La tour Murney (appelée à l'origine tour Murray) a été bâtie en 1846
dans le cadre des nouvelles défenses navales du port de Kingston,
autorisées par le gouvernement impérial pendant la crise de l'Oregon de
1845-46. C'est l'un des derniers ouvrages défensifs entrepris par les
Britanniques à l'intérieur du Canada. Même si on l'a utilisée
régulièrement comme caserne dès 1849, elle n'a pas été complètement
armée avant 1862, alors qu'elle était déjà dépassée, vu les progrès
rapides de la technologie militaire offensive. Ses canons devaient
protéger l'approche ouest de Kingston.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, F. Cattroll, 1982 |
Lieu historique national du Canada de la Tour-Shoal
Kingston, Ontario
Fortifications en maçonnerie de l'Empire britannique; milieu du XIXe
siècle.
Le lieu historique national du Canada de la Tour-Shoal est une tour
défensive circulaire en pierre, située sur un haut-fond du port, au
large de la côte, directement en face de l'hôtel de ville historique et
du site de l'ancienne batterie Market de Kingston, en Ontario. La tour
Shoal possédait un angle de visé dominant du port commercial de Kingston
et de l'entrée du canal Rideau.
La valeur patrimoniale de ce lieu réside dans ses liens avec les quatre
autres composantes du lieu historique national du Canada des
Fortifications-de-Kingston, illustrant un système de défense. Le
gouvernement britannique a construit la tour Shoal, une de quatre tours
Martello, de 1846 à 1847, ainsi que la batterie Market, pour renforcer
le système défensif existant de Kingston face à la menace américaine
pendant la crise de l'Orégon.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2006 |
Lieu historique national du Canada des Tumulus-Serpent
Keene, Ontario
Le lieu historique national du Canada des Tumulus-Serpent est situé dans
un lieu ouvert avec des chênes sur Roach's Point et East Sugar Island,
en surplomb du lac Rice, dans le comté de Peterborough, en Ontario. Site
funéraire datant de 50 av. J.-C. à 300 apr. J.-C., le lieu est un
groupement de six tumulus distincts de forme sinueuse qui serpente plus
de 60 mètres de longueur, 8 mètres de largeur et 1.5 à 1.8 mètres de
hauteur. Le lieu est présenté au public dans le parc Serpent Mounds sur
les berges du lac Rice.
Des tumulus Serpent occupe 4,4 hectares sur Roach's Point ainsi que 49
hectares sur East Sugar Island. Le lieu désigné comprend six zones
distinct d'intérêt archéologique, y compris le site des tumulus Serpent,
le site Alderville, le site Island Centre, le site East Sugar Island, le
site Corral et le site BbG m-22, non nommé. Le lieu historique national
du Canada des Tumulus-Serpent proprement dit est le site archéologique
le plus étudié au Canada. Il est associé à la culture de Point Peninsula
et contient des renseignements sur la vie quotidienne et rituelle de
cette culture qui date de 50 av. J.-C. à 300 apr. J.-C. On y a découvert
également des vestiges de la branche Pickering de la tradition Iroquoise
ancienne de l'Ontario, des Iroquoiens et des Hurons et de plusieurs
cultures archaïques. Ces sites ont fait l'objet de fouilles
systématiques en 1897, 1910, 1955, 1960 et 1968.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada University College
Toronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada University College est un vaste
bâtiment du milieu du 19e siècle, situé sur le campus St. George de
l'Université de Toronto. Son emplacement bien en vue sur le point le
plus élevé de la pelouse centrale du campus témoigne du rôle important
que l'édifice a joué dans l'histoire et la vie de l'institution. De
style néo-roman, cette vaste structure comprend une façade orientée sud
avec les tours, deux ailes au nord et un bâtiment rond d'inspiration
médiévale qui était à l'origine un amphithéâtre de chimie. Les éléments
réunis encadrent un campus quadrangulaire traditionnel.
Construit entre 1856 et 1859, lieu historique national du Canada
University College est lié à la fois à l'évolution de l'Université de
Toronto et à un système national d'établissements d'enseignement
supérieur laïques subventionnés par le gouvernement. Les plans du
bâtiment d'origine, réalisés par F.W. Cumberland, témoignent du talent
de cet architecte pour adapter librement le style néo-roman aux besoins
d'un établissement d'enseignement nord-américain. En 1890, un incendie a
détruit en grande partie l'extrémité est du bâtiment. Les murs
extérieurs sont demeurés debout et la reconstruction a été effectuée
dans le même style que le bâtiment d'origine, sous la direction de
l'architecte David Dick.
|
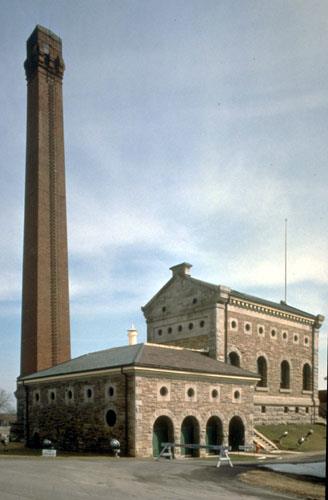
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |
Lieu historique national du Canada Usine-Hydraulique-de-Hamilton
Hamilton, Ontario
Le lieu historique national du Canada Usine-Hydraulique-de-Hamilton est
un élégant complexe d'édifices industriels en brique du milieu du XIXe
siècle, situé à l'ouest et non loin de l'adduction d'eau actuelle de la
Ville de Hamilton, sur une étroite bande de terre entre l'avenue
Woodward et la promenade Queen Elizabeth. On peut facilement repérer ce
complexe grâce à sa haute cheminée et au profil à l'italienne distinct
de la station de pompage d'origine.
L'Usine hydraulique de Hamilton a été désignée lieu historique national
du Canada en 1997 parce que c'est un rare exemple préservé de complexe
d'édifices industriels victoriens pratiquement intacts sur les plans
architectural et fonctionnel.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada
Usine-Hydraulique-de-Hamilton a trait au fait qu'il représente
physiquement un complexe industriel victorien. Dans ce cas, il s'agit
d'une adduction d'eau municipale préservée qui illustre de façon rare
comment on utilisait la technologie victorienne pour améliorer la
qualité de vie. Sa valeur a trait au site dans son ensemble, à sa
disposition, et à la conception, aux matériaux et à la fonction du
complexe et de ses composantes, avec un accent particulier sur les
éléments d'adduction d'eau originaux de 1859.
L'Usine hydraulique de Hamilton a été conçue par Thomas Coltrin Keefer
et bâtie par la Ville de Hamilton de 1856 à 1859. Elle servait à fournir
à cette ville en expansion rapide de grandes quantités d'eau saine pour
la consommation en toute sécurité et pour combattre les incendies.
L'installation a été modernisée au cours des années suivantes, pour
répondre aux besoins de la ville grandissante. En 1882, on a remplacé
les pompes Gartshore d'origine. En 1887, on a construit une deuxième
station de pompage. Et de 1910 à 1913, on a installé une troisième
station avec des moteurs de turbine électriques et à vapeur. Lorsque le
complexe lui-même a été remplacé en 1970 par une nouvelle adduction
d'eau sur un terrain adjacent, on a démoli plusieurs bâtiments du
complexe original. Aujourd'hui, l'ancien complexe hydraulique se compose
de la station de pompage de 1859, avec ses moteurs et son équipement,
d'une chaufferie, d'une cheminée et d'un hangar à bois, tous d'origine
(de 1859), ainsi que du hangar Worthington (1910) qui contient une
petite pompe à vapeur, d'une deuxième station de pompage (1913), d'une
remise de charpentier (1915) et de nombreuses vannes souterraines et
chambres des vannes datant pour la plupart du XXe siècle. La Ville de
Hamilton a restauré l'usine originale qui est ouverte aujourd'hui à la
visite publique.
|
|
Lieu historique national du Canada Usine-de-Textile-Penman
Paris, Ontario
Grande usine de tricot construite en , la première et la plus importante
usine de la Penman Manufacturing Company, pendant longtemps la plus
grande entreprise de bonneterie au Canada.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1996 |
Lieu historique national du Canada Victoria Hall
Hamilton, Ontario
Victoria Hall est un immeuble commercial de trois étages et demi qui a
été construit à la fin du XIXe siècle. Il est situé bien en vue dans une
rangée d'immeubles commerciaux en face du parc Gore dans le quartier
commercial du centre-ville de Hamilton.
Victoria Hall a été désigné comme lieu historique national à cause de
son importance historique et architecturale nationale. C'est un exemple
supérieur et rare d'un immeuble commercial à façade architectonique
décorative construite entièrement à la main plutôt qu'à la machine. Sa
façade métallique bien conçue et bien exécutée de trois étages qui
comprend des éléments architecturaux de haut-relief est pour ainsi dire
intacte. L'immeuble est un élément irremplaçable du continuum
architectural des immeubles commerciaux de la rue King allant de la
période précédant la Confédération jusqu'à maintenant.
L'mmeuble commercial conventionnel de la fin du XIXe siècle a une façade
de tôle zincar construite à la main sur les trois étages supérieurs.
Conçue par l'architecte de Hamilton, William Stewart, et construite par
Alexander Bruce, un avocat bien en vue de Hamilton, la façade projette
une image de prospérité par la simulation d'un ouvrage de maçonnerie
exubérant. C'est un exemple très rare au Canada d'une façade en tôle
construite à la main, sur place, et c'est l'une des façades de tôle les
mieux construites sur le plan architectural et les plus anciennes au
Canada.
Victoria Hall fait partie d'une rangée continue d'immeubles commerciaux
donnant sur le parc Gore, un quartier qui fonctionne depuis longtemps
comme le quartier des affaires de la ville et le point central des
événements publics. Victorial Hall est l'un des derniers immeubles
commerciaux solides de la grande époque victorienne dans le quartier
Gore.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1990 |
Lieu historique national du Canada Victoria Hall / Hôtel-de-Ville-de-Cobourg
Cobourg, Ontario
Le Victoria Hall / Hôtel de ville de Cobourg est un grand édifice public
en pierre, de trois étages construit au milieu du XIXe siècle. Le style
néoclassique de l'édifice présente aussi une variété de détails
éclectiques. Il est surmonté d'une tour d'horloge proéminente. L'édifice
abondamment orné abrite des salles d'audience, un espace de réunion, des
bureaux et une salle de concert bien préservés. Il est situé bien en vue
sur la rue King, en face de l'ancienne caserne de pompiers et de la
place du marché.
Si le Victoria Hall / Hôtel de ville de Cobourg a été désigné lieu
historique national en 1959, c'est parce qu'il s'agit d'un bon exemple
d'édifice public canadien du milieu du XIXe siècle.
Le Victoria Hall / Hôtel de ville de Cobourg fait partie du groupe
d'édifices municipaux construits en Ontario après l'adoption, en 1849,
de la Loi sur les municipalités qui modifiait et augmentait les
attributions de l'administration municipale. Il est typique de ces
édifices municipaux du milieu du XIXe siècle dans ses grandes
dimensions, ses détails architecturaux recherchés et ses fonctions
multiples d'être sous un même toit. Il s'agit, toutefois, d'un des
exemples les plus extravagants pour ce qui est des proportions et des
détails architecturaux. Conçu selon les plans de l'architecte torontois
Kivas Tully, l'édifice avec ses proportions monumentales et son style
néoclassique victorien reflète la prospérité et le formidable optimisme
de Cobourg dans les années 1850. Victoria Hall / Hôtel de ville de
Cobourg a gardé l'essentiel de son aménagement original, qui comprend
des espaces pour les cours de comté, deux paliers de gouvernement
(municipalité et comté), une salle de concert, un temple maçonnique, des
bureaux privés et un espace de location commerciale.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national du Canada Victoria Hall / Hôtel-de-Ville-de-Petrolia
Hamilton, Ontario
Le lieu historique national du Canada Victoria Hall /
Hôtel-de-Ville-de-Petrolia est un bâtiment extravagant de taille moyenne
en brique jaune, orné d'une tour de l'horloge proéminente. Il a été bâti
à la fin du XIXe siècle dans la tradition éclectique de la fin de l'ère
victorienne. Victoria Hall / Hôtel de ville de Petrolia est situé dans
le cœur historique de Petrolia, au milieu d'autres édifices en brique
également construits à la fin du XIXe siècle.
Victoria Hall / Hôtel de ville de Petrolia a été désigné lieu historique
national du Canada en 1975 parce que cet édifice opulent, bâti en 1889
en plein boom pétrolier, illustre cette étape de la croissance de la
ville.
Victoria Hall / Hôtel de ville de Petrolia, qui a été construit à
l'apogée d'un boom pétrolier à la fin des années 1880, illustre une
époque où Petrolia était une des villes les plus prospères du Canada. On
y a découvert du pétrole pour la première fois dans les années 1860, si
bien que le village est devenu une ville en 1874. Dès les années 1880,
des bâtiments permanents en brique avaient remplacé les petits édifices
de bois du début du boom pétrolier. La construction de l'hôtel de ville
a été le fait saillant de cette phase d'expansion urbaine constante.
Victoria Hall / Hôtel de ville de Petrolia a été conçu pour accueillir
plusieurs fonctions municipales, y compris une prison au sous-sol, des
bureaux municipaux, une chambre du conseil, une salle d'audience, une
caserne de pompiers et une armurerie au rez-de-chaussée, ainsi qu'une
salle d'opéra de 1000 places à l'étage. L'insistance de la ville à
inclure une salle d'opéra dans le nouvel hôtel de ville traduit
l'abondance qui régnait à Petrolia à la fin du XIXe siècle. Le boom
pétrolier avait en effet engendré une classe d'hommes d'affaires
prospères qui exigeaient des divertissements correspondant à leur statut
économique.
Victoria Hall / Hôtel de ville de Petrolia a été conçu par George
Durand, un architecte de London, en Ontario. Sa masse asymétrique, sa
ligne de toiture diversifiée et ses ornements dynamiques illustrent le
goût éclectique exubérant qui régnait à l'apogée de l'ère victorienne.
La conception du bâtiment a également été influencée par les formes
américains du style néo-Queen Anne. La forme d'origine et les ornements
de maçonnerie du bâtiment subsistent, même si en 1989 un incendie a
ravagé l'intérieur et détruit la plus grande partie des boiseries et du
vitrage extérieurs. L'édifice a été remis en état en 1992, et il
contient un théâtre consacré aux arts du spectacle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2006 |
Lieu historique national du Canada Vieille-Église-en-Pierre
Beaverton, Ontario
Le lieu historique national du Canada Vieille-Église-en-Pierre est une
petite église de campagne en pierre des champs située aux abords de la
ville de Beaverton, près du lac Simcoe, en Ontario. De culte
presbytérien, ce bâtiment empreint de simplicité aux caractéristiques
classiques élégantes s'élève sur un lot boisé et est séparé d'une route
de campagne par un mur de pierre. Le cimetière, devenu le cimetière
municipal de Beaverton, s'étend sur les côtés sud et ouest de l'église.
La vieille église en pierre a été désignée lieu historique national en
1991, car elle est un exemple particulièrement élégant des rares
bâtiments en pierre de style vernaculaire encore existants au Canada.
La vieille église en pierre a été construite dans le canton de Thorah
sur un terrain de 100 acres cédé en 1835 à l'Église d'Écosse par
l'assemblée législative du Haut-Canada. En 1840, la congrégation
embauchait à contrat un maçon, John Morrison, pour construire un
bâtiment devant remplacer la première église en rondins. La construction
a été terminée en 1853. Connu sous le nom d'église St. Andrew's, ce
nouveau bâtiment n'a pas beaucoup changé depuis sa construction. En
1991, l'Église presbytérienne de Beaverton a entrepris sa restauration
et l'utilise actuellement pour des services spéciaux et durant l'été. La
valeur patrimoniale de la vieille église en pierre est le résultat d'une
rare combinaison : son niveau élevé d'intégrité et ses origines
modestes.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2004 |
Lieu historique national du Canada Vieux-Moulin-en-Pierre
Delta, Ontario
Le lieu historique national du Canada de Vieux-Moulin-en-Pierre est un
moulin à provende en pierre de trois étages composé d'un moulin datant
de 1810 et d'un hangar à turbines annexé construit dans les années 1860.
Il est situé dans le petit village de Delta, niché entre les lacs Upper
et Lower Beverly, dans la région des lacs Rideau, au nord de Kingston.
Construit en 1810 par William Jones, le Vieux moulin en pierre de Delta
est le plus ancien moulin en pierre préservé en Ontario. Cet ouvrage,
dont la maçonnerie de pierre est de très bonne qualité, était considéré
très avancé sur le plan technologique à l'époque. Sa hauteur et ses
dimensions, de même que la configuration des fermes, étaient conçues
pour faire fonctionner le système de meunerie d'Oliver Evans, une
innovation de la fin du XVIIIe siècle qui améliorait la circulation du
grain dans les bâtiments du moulin.
Ce vieux moulin en pierre, typique des moulins du début du XIXe siècle
dans l'est de l'Ontario, a joué un rôle important dans la colonisation
et le développement économique du comté de Leeds. Il a favorisé la
colonisation agricole de la région, et contribué au développement du
village de Delta. Le moulin a fonctionné sans interruption de 1810 à
1949. Le remplacement en 1860 de la roue à aubes d'origine par des
turbines en fonte (installées dans un nouveau hangar à turbines) et
l'installation d'un moulin à cylindres en 1893 faisaient partie des
efforts déployés à la fin du XIXe siècle pour continuer à assurer la
viabilité commerciale du moulin.
|


©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Villa-Bellevue
Kingston, Ontario
Importante villa à l'italienne 1840's; maison de sir John A. Macdonald,
premier ministre du Canada (1867-1873, 1878-1891).
La Villa Bellevue, située dans un parc paysager, dans une ancienne
banlieue de Kingston, en Ontario, est un édifice d'inspiration italienne
qui fut la résidence de Sir John A. Macdonald, premier Premier ministre
du Canada.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à sa conception et à son
emplacement pittoresques, ainsi qu'à l'architecture italienne dont elle
s'inspirait particulièrement en 1948-1949, période durant laquelle elle
fut habitée par Sir John A. Macdonald.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Villa-Elizabeth
Kingston, Ontario
Le lieu historique national du Canada Villa-Elizabeth est une résidence
de style néo-gothique datant du milieu du XIXe siècle. Construite à
l'origine de 1841 à 1843, elle a été considérablement agrandie à la fin
du XIXe siècle. Elle est située sur une rue résidentielle d'une ancienne
banlieue de Kingston, en Ontario. Contrairement aux maisons voisines,
elle est en retrait par rapport à la rue et sa parcelle d'angle est
exceptionnellement grande.
Conçue et construite à l'origine de 1841 à 1843 par l'architecte de
Kingston Edward Horsey à titre de résidence familiale personnelle, la
Villa Elizabeth a été agrandie dans les années 1880. On lui a adjoint
une annexe d'un étage et demi conçue par l'architecte William Newlands,
aussi de Kingston. La villa et son annexe constituent un charmant
exemple de villa de style néo-gothique respectant l'esthétique
pittoresque. Sa masse attrayante, son plan irrégulier, ses ornements
gothiques et ses liens étroits avec le parc composent un ensemble
pittoresque qui définit les villas du milieu du XIXe siècle. Les
éléments distincts du corps central et de l'annexe ultérieure illustrent
l'évolution des styles au cours du XIXe siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2000

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |
Lieu historique national du Canada de la Voie-Navigable-Trent-Severn
Trenton / Port Severn, Ontario
Canal long de 386 km ouvert à la navigation; comporte 44
écluses.
Le lieu historique national du Canada de la Voie-Navigable-Trent -
Severn est une voie navigable naturelle et artificielle qui serpente sur
environ 400 km dans le centre de l'Ontario, et relie la baie Georgienne
à la baie de Quinte. L'Écluse-ascenseur hydraulique de Peterborough, en
Ontario, et les ouvrages d'ingénierie d'origine de la partie de la voie
navigable située entre les lacs Simcoe et Balsam revêtent une importance
particulière.
La voie navigable Trent - Severn a été désignée lieu historique national
parce qu'elle fait partie du réseau national de canaux du Canada.
La valeur patrimoniale de la voie navigable Trent - Severn a trait à sa
lisibilité et à son intégralité en tant que voie de transport construite
par le gouvernement du Canada au début du XXe siècle (de 1882 à 1920).
Elle a trait également aux divers éléments et utilisations qui y sont
associés, notamment les ouvrages d'ingénierie, bâtiments, écluses,
barrages, ponts, et paysages culturels liés aux aménagements
hydroélectriques et récréatifs, ainsi qu'aux éléments naturels et aux
utilisations variées qui leur sont associées.
Certaines ressources importantes situées le long du canal ont également
fait l'objet d'une désignation. Par exemple, le lieu historique national
du Canada de l'Écluse-Ascenseur-de-Peterborough doit sa reconnaissance
au fait qu'elle est encore une merveille technique de renommée
internationale, et parce qu'elle était la plus haute écluse-ascenseur
hydraulique ainsi que l'ouvrage en béton armé anciennement réputé comme
étant le plus grand au monde. Conçue par les ingénieurs R.B. Rogers &
Baird, elle a été construite en 1904 par les firmes Corry and Laverdure
Construction (préparation du site et ouvrages de béton) et Dominion
Bridge of Montreal (ouvrages métalliques).
La partie de la voie située entre les lacs Simcoe et Balsam a également
fait l'objet d'une reconnaissance pour ses nombreux ouvrages
d'ingénierie préservés datant de la période initiale de construction de
la voie navigable (1900 à 1907), et de ses postes d'éclusage dont la
plupart sont tels qu'ils étaient au début du XXe siècle.
|

©Willowbank, Sean Marshall, October 2011 |
Lieu historique national du Canada Willowbank
Niagara-on-the-Lake, Ontario
Le lieu historique national du Canada Willowbank est un élégant domaine
boisé avec une majestueuse demeure de trois étages et demi dont la
façade rappelle un temple. Cette demeure du début du XIXe siècle,
construite sur une éminence surplombant la rivière Niagara et la
frontière entre le Canada et les États-Unis, est la pièce maîtresse
d'une propriété boisée de cinq hectares située à l'extrémité nord du
village de Queenston, qui fait partie de la municipalité de
Niagara-on-the-Lake.
Le domaine de Willowbank reflète les idéaux romantiques associés à la
colonisation du Haut-Canada au début du XIXe siècle. Inspirés en partie
par les sensibilités romantiques du néoclassicisme, des membres de
l'élite de la société du Haut-Canada construisaient de grands domaines
ruraux dans des endroits considérés comme reculés. Willowbank est un
exemple typique d'une attitude romantique qui faisait construire des
demeures ressemblant à des temples dans des lieux surélevés, dans un
paysage naturel et pittoresque. Willowbank est un des rares exemples de
telles demeures autrefois beaucoup plus courantes dans le paysage du
Haut-Canada à avoir survécu.
L'intérieur de la maison a été rénové en 1912, puis dans les années
1930, et depuis les années 1980, après son acquisition pour en faire une
école de restauration architecturale.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Women's College Hospital
Toronto, Ontario
Le lieu historique national du Canada Women's College Hospital est un
immeuble en brique jaune de dix étages, de style Art Déco, construit en
1935, situé rue Grenville, au centre de Toronto. L'hôpital consiste en
un ensemble d'édifices ayant la même fonction, situés les uns à côté des
autres sur les rues Grenville, Grafton et Bay.
Grâce à la campagne vigoureuse de la première femme médecin au Canada,
le Dr Emily Howard Jennings Stowe, une école de médecine pour femmes a
été ouverte en 1883, rue Sumach, à Toronto. En 1895, elle a fusionné
avec une institution similaire de Kingston (créée par le Dr Jennie
Trout) pour devenir l'Ontario Medical College for Women, et elle a
continué à offrir une formation médicale aux femmes jusqu'en 1898, année
où l'Université de Toronto a commencé à admettre des étudiantes en
médecine.
L'institut est devenu un dispensaire pour femmes, le Women's College
Hospital and Dispensary. Avec une clientèle grandissante et des besoins
en locaux toujours plus grands, il a déménagé plusieurs fois. En 1935,
il a pu réunir suffisamment d'argent pour construire l'immeuble de dix
étages qui est maintenant au cœur de l'ensemble du Women's College
Hospital (WCH). Affilié à l'Université de Toronto depuis les années
1950, le WCH est devenu officiellement hôpital universitaire en 1961,
date à laquelle les arrêtés municipaux ont été modifiés pour permettre
de nommer des médecins, hommes et femmes, à des postes permanents. Une
nouvelle école d'infirmières (aile est) et la résidence de Burton Hall
avaient alors déjà été construits (1956) et, en 1967, une nouvelle aile
sud de dix étages a été ajoutée.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada Women's
College Hospital tient à son association avec la lutte des femmes
canadiennes pour entrer dans la profession médicale et à leur
participation à cette profession. L'emplacement remarquable du lieu, le
point de repère que représente ce grand édifice de 1935, la construction
graduelle de l'ensemble, sa taille considérable et l'ensemble des
activités de recherche, d'enseignement et de traitements qu'il abrite,
sont autant de témoignages de sa valeur.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2003 |
Lieu historique national du Canada Woodside
Kitchener, Ontario
Maison d'enfance de William Lyon Mackenzie King, premier ministre du
Canada (1921-1926, 1926-1930, 1936-1948).
Le lieu historique national du Canada Woodside est un domaine
pittoresque et boisé, situé au sein d'une banlieue moderne du nord-est
de Kitchener. Il se compose d'une maison d'un étage et demi,
reconstruite en 1942 dans le style des maisons du milieu du XIXe siècle,
et meublée dans le style des années 1890. La propriété comprend aussi
des sentiers et des éléments paysagers naturels qui recréent le calme
qui y régnait lorsqu'elle était habitée par William Lyon Mackenzie King,
alors adolescent, et sa famille.
William Lyon Mackenzie King a été Premier ministre du Canada de 1921 à
1930, puis de 1935 à 1948. Son père a loué Woodside et y vécu avec sa
famille de 1886 à 1893. Mackenzie King y a passé les huit années de son
adolescence. Selon lui, c'est à Woodside qu'il a acquis les valeurs et
les croyances qu'il a respectées toute sa vie. Il faisait toujours
référence à Woodside dans ses derniers discours et écrits portant sur la
vie de famille idéale. Quand la maison d'origine de 1853 a été
démantelée, puis reconstruite dans les années 1940, Mackenzie King et sa
sœur ont fourni des informations fiables relatives à son plan et son
aménagement.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc marin national du Canada Fathom Five
Siège social: Tobermory, Ontario
Le paysage marin crée par l'escarpement du Niagara.
Les eaux cristallines et profondes à l'embouchure de la baie Georgienne
font partie du parc marin Fathom Five, première aire marine nationale de
conservation du Canada. Le parc protège un riche patrimoine culturel qui
comprend vingt-deux épaves et plusieurs phares historiques. Les eaux de
l'écosystème d'eau douce de Fathom Five sont parmi les plus limpides des
Grands Lacs. Les îles sauvages du parc rappellent la topographie
impressionnante du lit du lac.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada des Îles-de-la-Baie-Georgienne
Siège social: Midland, Ontario
Îles captivantes représentatives du paysage du lac Huron.
Découvrez le paysage canadien emblématique du parc national des
Îles-de-la-Baie-Georgienne. Situé dans le plus gros archipel d'eau douce
au monde, les 30 000 îles, le parc national des
Îles-de-la-Baie-Georgienne est l'endroit où vous découvrirez des
paysages spectaculaires, des parois rocheuses usées par le temps, des
habitats variés, la beauté sauvage du Bouclier canadien et une histoire
culturelle qui date de 5000 ans. Ces îles magnifiques ne sont
accessibles que par la voie des eaux. Empruntez la navette du parc le
DayTripper pour explorer la plus grande île, l'île Beausoleil. Cette île
offre des terrains de camping pour tentes, des chalets rustiques,
l'amarrage de jour ou de nuit, de la géocachette, des sentiers de
randonnée et de cyclisme et des programmes d'interprétation.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada des Mille-Îles
Siège social: Mallorytown, Ontario
Crée en 1904 comme parc national des Îles-du-Saint‑Laurent,
ce premier parc national canadien à l'est des Rocheuses.
À quelques heures seulement de Toronto, de Montréal et d'Ottawa, dans
une atmosphère sauvage du nord, vous attendent des îles rocheuses, des
pins balayés par les vents et les eaux fraîches du parc national des
Mille-Îles.
Nature et culture s'entremêlent dans cette maison d'été traditionnelle
des Haudenosaunee et de la nation Mississauga Anishinaabe. La présence
de somptueuses villas et de résidences d'été historiques marque un
contraste avec l'aspect sauvage des îles de granit sur lesquelles
poussent des pins et où tortues, aigles et d'innombrables autres espèces
évoluent à leur rythme.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada de la Péninsule-Bruce
Siège social: Tobermory, Ontario
Paysages de l'extrémité septentrionale de l'escarpement du
Niagara.
Situé au cœur d'une réserve de la biosphère, le parc national de la
Péninsule-Bruce est un endroit d'importance internationale. Des milliers
de visiteurs viennent chaque année admirer les immenses falaises
escarpées du parc, ses cèdres millénaires et les eaux cristallines de la
baie Georgienne. Le parc abrite une diversité incroyable d'habitats —
rares landes de calcaire (alvars), denses forêts et lacs clairs.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada de la Pointe-Pelée
Headquarters; Leamington, Ontario
Point le plus méridional de la partie continentale du Canada.
Oasis de forêt carolinienne luxuriante à l'extrême sud du Canada, le
parc national de la Pointe-Pelée s'anime du chant des oiseaux migrateurs
au printemps, bourdonne du crépitement des cigales tropicales en été,
frémit des battements d'ailes des monarques à l'automne et se tait en
hiver pour laisser place à la quiétude.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada Pukaskwa
Headquarters; Heron Bay, Ontario
Paysage ancien du Bouclier canadien sur la rive nord du lac
Supérieur.
D'une exceptionnelle beauté, le parc national Pukaskwa offre des vues
panoramiques du lac Supérieur et un paysage accidenté ancien
caractéristique du bouclier canadien et de la forêt septentrionale.
L'esprit de la nature habite tous ceux et celles qui choisissent de
visiter et d'explorer ce lieu unique. Seul parc national sauvage de
l'Ontario, Pukaskwa protége 1878 kilomètres carrés d'un écosystème
incluant la forêt boréale et la rive du lac Supérieur.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc urbain national de la Rouge
Headquarters; Toronto, Ontario
Une fois sa création achevée, le parc urbain national de la Rouge comptera parmi
les parcs urbains les plus vastes et les mieux protégés d'Amérique du Nord.
Sa superficie totale est à 79,5 km2 (7 956 ha) — c'est 19 fois
plus que le parc Stanley à Vancouver, 22 fois plus que Central Park à New York
et près de 50 fois plus que le parc High à Toronto.
Le parc urbain national de la Rouge chevauche les villes de Toronto, de Markham
et de Pickering ainsi que le canton d'Uxbridge. Situé tout près de 20 % de la
population du Canada, le parc urbain national de la Rouge offrira au peuple
canadien des possibilités sans précédent de découvrir le vaste réseau d'aires
patrimoniales protégées du pays. La Loi sur le parc urbain national de la Rouge
a été adoptée par la Chambre des communes le 26 janvier 2015 et par le Sénat le
2 avril 2015. Elle a reçu la sanction royale du gouverneur général le 23 avril
2015. La Loi — qui crée officiellement le parc urbain national de la Rouge — est
entrée en vigueur par voie de décret en conseil le 15 mai 2015. Elle a été
taillée sur mesure de manière à procurer à la rivière Rouge un niveau de
protection encore inégalé. Le parc urbain national de la Rouge abrite une
collection exceptionnelle de caractéristiques naturelles, culturelles et
agricoles : 1 700 espèces de plantes, d'oiseaux, de poissons, de mammifères,
d'insectes, de reptiles et d'amphibiens; des vestiges de plus de 10 000 ans
d'histoire humaine et de vastes parcelles de terres agricoles de catégorie 1 —
les plus rares, les plus fertiles et les plus menacées du pays.
|
|