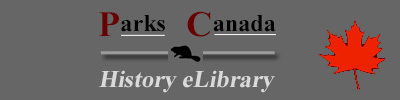|
Résumés parc
Nouveau-Brunswick
Tous les textes et photos sont la propriété de Parcs Canada ou le Répertoire canadien des lieux patrimoniaux
(Sauf indication contraire) et ont été extraites de l'une ou l'autre Parcs
Canada ou Lieux patrimoniaux du Canada. Les parcs avec un fond
gris sont gérés par Parcs Canada.

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, HRS 0544, 1993 |
Lieu historique national du Canada 1 Chipman Hill
Saint John, Nouveau-Brunswick
Le 1, Chipman Hill est une maison en rangée en brique datant du milieu
du 19e siècle.Elle est située au sommet de la colline Chipman Hill dans
l'arrondissement historique du centre-ville de Saint-Jean.
Le 1, Chipman Hill a été désigné lieu historique national en 1984 en
raison de l'importance et de la diversité des peintures en trompe-l'oeil
de son intérieur.
Cet intérieur rare constitue un des premiers exemples des peintures
artistiques pour orner les murs et plafonds des maisons cossues de la
bourgeoisie à la fin du 19e siècle. Ces peintures de la fin de l'époque
victorienne (probablement les années 1870) créent l'illusion de textures
et de profondeurs, imitent des matériaux et reproduisent des motifs
traditionnels.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1990 |
Lieu historique national du Canada de l'Ancienne-Résidence-du-Gouverneur
Fredericton, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada de l'Ancien-Hôtel-du-Gouverneur
est une grande résidence en pierre de style palladien où habite le
lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. Cet hôtel est situé chemin
Woodstock, dans un site de 4.5 hectares (11 acres) de superficie, juste
à l'ouest du centre de Fredericton, sur les rives de la rivière
Saint-Jean.
Le lieu historique national du Canada de l'Ancien-Hôtel-du-Gouverneur a
été conçu par J.W. Woolford, un concepteur et artiste anglais. Construit
de 1826 à 1828 comme résidence du gouverneur de la colonie du
Nouveau-Brunswick, il remplaçait une résidence du gouverneur plus
ancienne (de 1787) détruite par un incendie. Une rencontre historique y
a eu lieu le 7 avril 1866, alors que le gouverneur Arthur Gordon a pavé
la voie de la Confédération avec le Premier ministre Albert J. Smith.
Les gouverneurs, puis les lieutenants-gouverneurs du Nouveau-Brunswick y
ont résidé jusqu'en 1893, date à laquelle on leur a construit une
nouvelle résidence. L'édifice est devenu par la suite un hôpital pour
les anciens combattants, puis, de 1932 à 1988, il a abrité le siège
social de la division J de la GRC. Restauré depuis, il est redevenu la
résidence du lieutenant-gouverneur.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de
l'Ancien-Hôtel-du-Gouverneur a trait à son rôle fonctionnel de résidence
officielle (de 1828 à 1893, et de 1988 à aujourd'hui), à son
architecture de style palladien, et au fait qu'un événement important de
l'histoire canadienne y a pris place. De plus, sa situation et son cadre
augmentent cette valeur patrimoniale.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Katherine Spencer-Ross, 1994 |
Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Historique-de-Marysville
Fredericton, Nouveau-Brunswick
Marysville est une ancienne communauté industrielle, aujourd’hui
résidentielle, comprenant une filature de coton restaurée du XIXe
siècle, d’anciens magasins et de nombreux logements qui subsistent.
L’arrondissement est situé sur les rives de la rivière Nashwaak, aux
abords de la ville de Fredericton. Les bâtiments sont disposés autour de
l’ancienne filature, et l’ancienne zone commerciale se trouve à
proximité. Les maisons en rangée en brique et les maisons jumelées
prédominent, et sont concentrées le long du côté est de la rivière. Les
principales ressources comprennent la filature de coton en brique de la
fin du XIXe siècle, restaurée; les immeubles locatifs en brique à
proximité (39 duplex, 14 maisons individuelles et une ancienne pension
endommagée par le feu); 11 duplex à ossature de bois sur la rive est;
deux anciennes maisons de commerçant et un ancien magasin sur les rues
Mill et Canada; et 19 propriétés résidentielles, destinées autrefois aux
gestionnaires, le long de la rue Canada.
L’arrondissement historique de Marysville a été désigné lieu historique
national en tant qu’exemple rare d’une ville de compagnie à industrie
unique du XIXe siècle, avec son usine et ses logements fournis par la
compagnie; en tant qu’arrondissement historique comprenant un éventail
complet d’installations communautaires, notamment des bâtiments
industriels, commerciaux et résidentiels, construits entre 1840 et 1890
environ; et parce qu’il conserve dans une grande mesure son apparence et
son caractère du XIXe siècle. L’endroit est également associé à deux
importants thèmes historiques qu’il illustre : le commerce des produits
de première nécessité, et le développement industriel du Canada dans le
cadre de la Politique nationale. L’ancienne filature de coton de
Marysville a également reçu une désignation individuelle en tant que
lieu historique national.
Marysville a d’abord été une communauté d’exploitation forestière, avec
une scierie sur la rive ouest de la rivière Nashwaak, et une rangée
d’habitations pour les travailleurs sur la rive opposée. Les duplex de
la « rangée blanche » sur la rue River témoignent de cette époque aux
environs des années 1840.
En 1862, Alexander « Boss » Gibson a acheté la propriété de la scierie,
lui donnant le nom de Marysville et y ajoutant des installations
manufacturières, des habitations et une zone commerciale. Un magasin à
ossature de bois et neuf maisons dans le secteur de Nob Hill témoignent
de l’époque de la scierie de Gibson. Le dessin et les matériaux de ces
bâtiments sont typiques des habitations construites à l’intention de la
classe ouvrière au milieu du XIXe siècle au Nouveau-Brunswick. Sept
duplex sont des bâtiments originaux du milieu du XIXe siècle. Cinq
duplex ont été reconstruits en 1920 pour remplacer des bâtiments
détruits en 1920 par un incendie à la scierie. La disposition des duplex
en une rangée le long de la rive est fidèle à leur configuration au
milieu du XIXe siècle.
Marysville témoigne de l’utilisation de la Politique nationale par
l’administration Macdonald en vue de créer une économie industrielle au
Canada. En 1883, encouragé par l’imposition de tarifs douaniers
protectionnistes dans le cadre de cette Politique nationale, Gibson a
embauché les architectes de Boston Lockwood, Greene & Company pour
dessiner une filature de coton d’avant-garde à Marysville. Lockwood,
Greene & Company ont également dessiné une communauté planifiée autour
de la filature, avec des immeubles locatifs en brique à l’intention des
travailleurs, d’autres habitations pour les gestionnaires, et une zone
commerciale élargie. Les habitations en brique des travailleurs, des
gestionnaires et des marchands qui subsistent à côté de la filature
témoignent de cette époque.
La communauté planifiée de Marysville fait partie des exemples les plus
anciens et les plus complets d’une communauté industrielle/résidentielle
intégrée au Canada. Elle présente le modèle paternaliste des relations
de travail au XIXe siècle, dans lequel les industriels cherchaient à
contrôler les conditions de travail en même temps que les conditions de
vie des travailleurs, dans le but d’optimiser la production. La
construction en brique de haute qualité tant des habitations que de la
filature témoigne de l’optimisme qu’entretenait Gibson à l’égard de
cette communauté. La zone commerciale de la rue Mill montre le modèle
paternaliste du développement industriel tel que poursuivi par Gibson,
modèle dans lequel des magasins de compagnie desservaient les employés
de la filature dans le cadre d’une communauté industrielle/résidentielle
intégrée. Les bâtiments qui subsistent témoignent des besoins
commerciaux d’une communauté du XIXe siècle, et comprennent les
résidences prévues pour les marchands.
|

©Provincial Archives of New Brunswick /Archives provinciales du Nouveau-Brunswick, P11-189, ca. 1914 |
Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Historique-de-St. Andrews
St Andrews, Nouveau-Brunswick
L'arrondissement historique de St. Andrews comprend la partie originale
de l'actuelle ville Saint Andrews au Nouveau-Brunswick. Disposées en un
quadrillage de soixante pâtés de maisons s'étendant vers l'intérieur
depuis la rive, les constructions, dressées au fil des années, sont des
variations d'une architecture d'inspiration classique. Les bâtiments
commerciaux sont concentrés sur la rue qui court parallèlement au port.
Les lots relativement spacieux et le terrain communal en grande partie
non bâti entourant le district assurent un équilibre de verdure à ce
paysage bâti.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1987 |
Lieu historique national du Canada du Blockhaus-de-St. Andrews
Saint Andrews, Nouveau-Brunswick
Blockhaus en bois de la guerre de 1812; bâtiment restauré.
Le lieu historique national du Blockhaus-de-St. Andrews est situé dans
la pittoresque ville de villégiature de St. Andrews, au sud-ouest du
Nouveau-Brunswick. Ici, vous vous plongerez dans une époque troublée par
des conflits le long de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et les
États-Unis. Imaginez une époque où ces voisins étaient sur un pied de
guerre. Craignant une invasion américaine, les villageois ont bâti ce
blockhaus d'après les prescriptions militaires pendant la Guerre de
1812.
Le blockhaus de St. Andrews est une structure défensive en bois située
sur la pointe ouest du port, à l'extrême limite de la ville historique
de St. Andrews (Nouveau-Brunswick).
La valeur patrimoniale du blockhaus de St. Andrews réside dans sa
représentation d'un type particulier de structure défensive et dans ses
origines datant de la guerre de 1812. Les citoyens de St. Andrews l'ont
construit en 1812-1813 pour préserver leur ville contre les invasions
américaines. À la fin du XIXe siècle, il est devenu une attraction
touristique pittoresque dans la ville de villégiature de St. Andrews,
avant d'être acheté et restauré par les Lieux historiques nationaux
(1962-1967). Le blockhaus a été sérieusement endommagé par le feu en
1993, mais a été restauré tel qu'il était à l'origine.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Ian Doull, 1999 |
Lieu historique national du Canada Boishébert
Beaubears Island, Nouveau-Brunswick
Colonie de réfugiés acadiens (1756-1759).
Le lieu historique national du Canada Boishébert est une zone boisée
contenant les vestiges archéologiques d’un camp de réfugiés acadiens du
18e siécle à la pointe Wilsons et sur l’île Beaubears, au confluent des
rivières Miramichi Sud-Ouest et Nord-Ouest au Nouveau-Brunswick.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada Boishébert
réside dans les paysages contenant les ressources culturelles
souterraines associées à la colonie des réfugiés acadiens, les
perspectives historiques et un milieu naturel peu perturbé.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |
Lieu historique national du Canada du Bureau-de-Poste-de-St. Stephen
St. Stephen, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada du-Bureau-de-Poste-de-St. Stephen
est un édifice de deux étages et demi en brique et en pierre, de style
néo-roman, présentant des matériaux de couleurs et de textures
contrastantes, une façade symétrique avec des entrées jumelées, et un
grand pignon central avec des gravures décoratives. Situé bien en vue
sur une des principales artères de la ville, il sert maintenant d'hôtel
de ville.
Cet édifice, construit de 1885 à 1887, avait pour vocation initiale
d'abriter le bureau de poste local, ainsi que ceux des douanes et du
revenu. Sa conception a été dirigée par Thomas Fuller, architecte en
chef du gouvernement fédéral. Cet ouvrage fait partie d'une série
d'édifices construits afin d’assurer la visibilité du gouvernement
fédéral dans tout le pays. Sa composition pittoresque, ainsi que la
diversité des couleurs et des textures des matériaux de construction
extérieurs, en font un excellent exemple d'architecture de la fin du
XIXe siècle. L'influence du style néo-roman est illustrée par les portes
et fenêtres en plein cintre, et les gravures décoratives. L'édifice
abrite l’hôtel de ville de St. Stephen depuis 1965.
|
|
Lieu historique national du Canada de la Cale-Sèche-La Coupe
Aulac, Nouveau-Brunswick
Lieu qui pourrait être représentatif des chantiers navals acadiens du
XVIIIe siècle.
Cette déposition quadrilatérale de digues aurait été construite par les
Acadiens afin de régler le courant de la rivière La Coupe permettant
l'entrée et la sortie de vaisseaux de grandeur moyenne.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1987 |
Lieu historique national du Canada de la Cathédrale-Christ Church
Fredericton, Nouveau-Brunswick
La cathédrale Christ Church est une élégante cathédrale du milieu du
XIXe siècle dont la flèche délicate surplombe le centre historique de
Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Elle est située sur un emplacement
spectaculaire, au milieu d'un grand espace vert bordant la rivière
Saint-Jean. Cette cathédrale, qui évoque les cathédrales antérieures
d'Angleterre, est devenue un symbole de l'architecture religieuse au
Canada. La reconnaissance officielle fait référence au bâtiment sur son
lot.
La valeur patrimoniale de ce lieu réside dans le fait qu'il illustre
concrètement le style d'architecture néo-gothique. En effet, la
cathédrale Christ Church est un des plus beaux exemples d'architecture
de style néo-gothique religieux au Canada. Elle a servi au XIXe siècle
de modèle architectural à de nombreuses églises, petites et grandes, du
Canada. L'architecture, la conception et la décoration de la cathédrale
Christ Church répondent aux objectifs de la Ecclesiological Society, un
mouvement réformateur anglican qui prônait la renaissance des modèles
d’église médiévaux, tant sur le plan de l'architecture que du rituel. À
la demande de John Medley, premier évêque du Nouveau-Brunswick et membre
de ladite Society, l'architecte anglais Frank Wills a conçu les plans de
la cathédrale, en s'inspirant de ceux d'une église du Norfolk, en
Angleterre, datant du XIVe siècle. Lors de la dernière phase de sa
construction, l'éminent architecte anglais William Butterfield a modifié
l'extrémité est de la cathédrale en y construisant une seule tour au
lieu de deux. Il a également conçu la plupart des meubles et
l’orfèvrerie de la cathédrale. Les murs de pierre, la tour sur la
croisée du transept et la masse pittoresque de la cathédrale, faisant
écho à ses caractéristiques intérieures, sont typiques du style
néo-gothique. Suite à l'incendie de 1911, l'architecte new-yorkais J.
deLancey Robinson y a effectué des restaurations, de 1911 à 1913, y
compris l'allongement de la flèche et la conversion de l'ancienne
sacristie en la chapelle actuelle.
|

©Moncton Museum |
Lieu historique national du Canada de la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption
Moncton, Nouveau-Brunswick
Conçue et édifiée en 1939-1940, la cathédrale raconte l’histoire du peuple
acadien. Des éléments décoratifs dépeignent leur histoire religieuse et
séculière partout dans la cathédrale, y compris la sculpture extérieure de la
Vierge Marie, sainte patronne des Acadiens, et des vitraux qui illustrent des
épisodes historiques et religieux importants de ce peuple. Son architecture
extérieure est un mélange achevé et éclectique de néogothique et d’Art déco,
alors que l’intérieur emprunte au style roman. Édifiée comme instrument
d’affirmation identitaire et pour rendre hommage à la résilience des
Acadiens, la construction de cette église a rassemblé la communauté et la
diaspora acadiennes autour d’un projet visant à ériger le premier grand
édifice qui les glorifierait comme peuple distinct. Indissociable de la
création de l’archidiocèse de Moncton en 1937, la cathédrale témoigne de la
phase ultime de la Renaissance acadienne. Ce lieu de culte demeure un symbole
tangible des réalisations des Acadiens tout au long de leur histoire.
Construit selon les plans dressés par l’architecte Louis-Napoléon Audet
(1881-1971), la cathédrale mesure environ 70 mètres de longueur et 43 mètres
de largeur. Outre l’église elle-même, le bâtiment comporte deux chapelles,
deux sacristies et de nombreuses salles réparties sur plusieurs étages.
Plusieurs des éléments décoratifs font référence au peuple acadien et à son
histoire. À l’intérieur, les chapiteaux des colonnes faisant face au
maître-autel et réalisés par des artisans acadiens sont décorés d’objets
associés aux différents métiers exercés par les Acadiens à travers leur
histoire. Les deux grandes verrières, situées dans les transepts de la
cathédrale, illustrent les grands moments de l’histoire religieuse acadienne
et les moments forts de l’histoire laïque ou civique du peuple acadien.
La cathédrale de Notre-Dame-de-l’Assomption est la manifestation physique de
l’apogée de décennies de revendications menées par les Acadiens et Acadiennes
pour faire reconnaître leur présence, leur poids démographique, ainsi que
leurs droits légitimes comme citoyens à part entière dans les contextes
politique, social et économique, culturel et religieux des provinces
maritimes. En plus de bénéficier du soutien des Acadiens de l’archidiocèse,
le projet de construction a reçu l’appui d’Acadiens des provinces maritimes,
du Québec, de la Louisiane et de la Nouvelle-Angleterre.
Élevée sur l’ancien site d’une crypte et chapelle inachevée qui servait de
lieu de culte à la première paroisse francophone de Moncton, née elle-même du
démembrement de la paroisse St. Bernard en 1914, elle est l’œuvre de son
premier archevêque titulaire, Mgr Louis-Joseph-Arthur Melanson (1879-1941).
Les Acadiens du Nouveau-Brunswick, voire des provinces maritimes, la
considèrent comme le principal joyau de leur patrimoine architectural. La
valeur historique et patrimoniale de la cathédrale tient donc en grande
partie aux valeurs associatives et symboliques que lui confère la communauté
acadienne.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1995 |
Lieu historique national du Canada de la Chapelle-St. Anne of Ease
Fredericton, Nouveau-Brunswick
La Chapelle-St. Anne of Ease est une petite église élégante en pierre,
de style néo-gothique archéologique, bâtie de 1846 à 1847. Elle est
située au centre ville de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, dans un
quartier résidentiel historique.
La Chapelle-St. Anne of Ease a été désignée lieu historique national en
1989 car elle est un exemple important de l'architecture religieuse de
style néo-gothique basée sur les principes de la Société
ecclésiologique.
La Chapelle-St. Anne of Ease illustre la première période de l'adoption
des principes de la Société ecclésiologique, une organisation anglicane
d'origine anglaise qui prônait l'utilisation du style gothique médiéval
dans l'architecture religieuse pour la construction des églises
paroissiales au XIXe siècle. Dès sa nomination à titre d'évêque du
Nouveau-Brunswick en 1845, John Medley a encouragé activement ce style
pour la conception et la construction des églises dans les provinces
canadiennes de l'Atlantique. L'église succursale St. Anne, bâtie en même
temps que la cathédrale Chirst Church de Fredericton, a servi de modèle
d'utilisation des principes prônés par Medley. Les deux firmes Beers,
d'Exeter, et Warrington, de Londres, ont réalisé les belles fenêtres à
lancette lancéolées à vitraux.
|


©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Complexe-Militaire-de-Frédéricton
Fredericton, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada du
Complexe-Militaire-de-Fredericton est un complexe militaire qui comprend
quatre bâtiments datant du début du XIXe siècle situés dans le quartier
historique de la garnison, au centre-ville de Fredericton, au
Nouveau-Brunswick. Le complexe militaire est situé tout juste à côté du
majestueux fleuve Saint-Jean et comprend la caserne des soldats, la
maison du gardien, la caserne des officiers et le dépôt d’armes
militaire. À l’est de la caserne des officiers se trouve un grand espace
vert connu sous le nom de Place des officiers qui fait environ 70 mètres
sur 90 mètres. D’autres bâtiments ont été construits sur les lieux à la
fin du XIXe siècle et au XXe siècle.
Le Complexe militaire de Fredericton est construit en 1784 pour servir
de garnison militaire à l’armée britannique. À un certain moment, il
compte plus de cinquante bâtiments, dont un grand nombre est détruit par
un incendie en 1825. Après l’incendie, d’autres bâtiments militaires,
qui subsistent encore aujourd’hui, sont construits. La garnison
britannique occupe le Complexe militaire de Fredericton jusqu’en 1869,
date à laquelle le Dominion du Canada prend en charge la défense du
pays. Seulement quatre bâtiments de la garnison britannique d’origine
subsistent encore : la caserne des soldats (1826), la maison du gardien
(1828), la caserne des officiers (1839, 1851) et le dépôt d’armes
militaires (1832). Ces bâtiments sont représentatifs de l’architecture
militaire britannique du début du XIXe siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2001 |
Lieu historique national du Canada de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears
Beaubears Island, Nouveau-Brunswick
Site archéologique associé à la construction navale du XIXe siècle au
Nouveau-Brunswick.
Lieu historique national du Canada de Boishébert et lieu historique
national du Canada de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears, J.
Leonard O'Brien Memorial sont administrés par Parcs Canada en
collaboration avec les Amis de l'Île Beaubears . L'île, situé au milieu
de la rivière Miramichi à 45 minutes au nord de Kouchibouguac et à 45
minutes au sud de la ville de Bathurst, est un bel exemple d'une forêt
acadienne mature ayant conservé des pins blancs de plus de 200 ans.
L'île Boishébert et la pointe Wilsons forment ensemble le lieu
historique national du Canada de Boishébert. De 1756 à 1760, lors de la
Déportation, les Acadiens, sous la conduite de Charles Deschamps de
Boishébert, trouvèrent refuge à la pointe Wilsons. L'île Boishébert
était à la fois une partie intégrante et une composante fonctionnelle de
cet établissement qui témoigne de l'importance de l'expérience
acadienne. Les Mi'kmaq avaient auparavant campé dans l'île pendant des
centaines d'années et ne faisaient qu'un avec la terre.
Le lieu historique national du Canada de la
Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears, J. Leonard O'Brien Memorial, est
le seul site archéologique connu, encore intact, qui représente
l'importance nationale de la construction des navires en bois au
Nouveau-Brunswick durant le 19e siècle.
Le lieu historique national du Canada de la
Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears comprend environ 24 hectares (60
acres) de terrain sur la rive sud-est (aval) de l'île Beaubears, au
confluent des rivières Miramichi Sud-Ouest et Nord-Ouest, ainsi que le
chenal sud adjacent de la rivière Miramichi. L'endroit renferme les
vestiges d'un chantier naval du 19e siècle.
Le site de la Construction Navale de l'Île Beaubears a été désigné lieu
historique national parce qu'il est représentatif des sites de
construction navale du Nouveau-Brunswick renfermant des ressources
archéologiques sur place.
La valeur patrimoniale du lieu réside dans son cadre et dans son paysage
qui renferment des ressources archéologiques associées aux anciennes
installations de construction navale. Ces ressources sont typiques des
chantiers navals du début et du milieu du 19e siècle au
Nouveau-Brunswick et se trouvent dans la région qui réunit la plus
importante concentration de sites du même genre le long de la Miramichi.
Ce site est au deuxième rang parmi les centres de construction navale de
la province.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1980 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-Christ Church
Maugerville, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-Christ
Church est une église de bois de style néo-gothique qui date du milieu
du XIXe siècle. Elle est située dans la petite localité rurale de
Maugerville au Nouveau-Brunswick.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à la conception, à la forme et
aux matériaux du bâtiment, représentatifs de la phase archéologique du
style néo-gothique d'architecture religieuse. L'Église anglicane Christ
Church, construite en 1856, est un exemple d'église de bois de style
néo-gothique, conforme sur le plan religieux. Construite par Frank
Wills, l'architecte du diocèse, sous la supervision de l'évêque John
Medley, fervent supporteur du mouvement archéologique, cette église
concrétise le retour aux formes gothiques médiévales dans l'architecture
des églises. La conception réalisée par Wills reproduit avec succès les
volumes et le caractère angulaire du style néo-gothique, en utilisant le
bois, un matériau de construction convenant au contexte canadien.
L'église respecte les principes religieux, notamment par l'inspiration
médiévale de son plan, l'expression nette des composantes intérieures
dans les volumes extérieurs, le respect des qualités inhérentes à ses
matériaux de construction, et l'utilisation limitée des ornements de
style néo-gothique. La volumétrie simple et hardie de l'église et ses
ornements sculpturaux limités reflètent aussi l'adaptation du style
néo-gothique au climat canadien propice au gel, et au relatif manque de
main d'œuvre qualifiée.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1992 |
Lieu historique national du Canada de l'Église anglicane St. John / église en pierre
Saint John, Nouveau-Brunswick
L'Église anglicane St. John, communément appelée «l’église en pierre»,
est une des premières églises anglicanes construite de 1823 à 1826 selon
le style néo-gothique romantique. L'église comprend un chœur de style
gothique archéologique et une salle paroissiale, tous deux bâtis après
la période de construction initiale. Elle est située bien en vue dans la
rue Carleton, en haut du rang Wellington, une rue nivelée très pentue du
centre ville de Saint John, au Nouveau-Brunswick.
L'Église anglicane St. John a été désignée lieu historique national en
1987 car elle est un des plus beaux et des plus anciens exemples
d'églises de la phase romantique du style néo-gothique au Canada.
L'église St. John illustre la plus ancienne phase du style néo-gothique
au Canada, qui a fait le pont entre la tradition classique et la
renaissance de l'architecture gothique, connue sous le nom de style
néo-gothique romantique. Cette église, bâtie de 1823 à 1826 sur des
plans de John Cunningham, est typique du style néo-gothique romantique,
évident dans l'emploi de formes et d'une composition de style classique
du XVIIIe siècle, sur lesquelles on a ajouté des ornements de style
gothique. L'église St. John est l’une des premières bâties dans ce style
au Canada. On l'a appelée l'«église en pierre» parce qu'elle est
construite dans ce matériau, inhabituel dans cette colonie où on
utilisait généralement le bois à cette époque. L'église comprend un
chœur ajouté en 1872, selon les plans de l'architecte local Matthew
Stead, qui est de style gothique archéologique, une phase plus tardive
et plus conforme sur le plan historique du style néo-gothique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2003 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. Luke
Quispamsis, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. Luke,
situé à Quispamsis, au Nouveau-Brunwick, est un exemple tardif du modèle
Wren-Gibbsien. Sa volumétrie simple, ses proportions élégantes, et sa
décoration sobre, toutes habilement réalisées en bois, attestent de la
capacité d'adaptation du classicisme à pratiquement n'importe quelle
circonstance, réussissant ainsi à donner un caractère digne et
tranquille même aux structures les plus modestes. La désignation a trait
à l'église sur son lotissement.
Cet édifice, bâti de 1831 à 1833, est un bel exemple d'architecture
classique vernaculaire illustrant l'apogée de la première phase de
construction d'églises anglicanes dans l'Est du Canada. Elle concrétise
les efforts déployés par l'évêque John Inglis pour répandre
l'anglicanisme dans son diocèse en y construisant des églises. Bâtie à
la manière de Wren et Gibb, comme en témoignent son auditorium et ses
ornements classiques, l’église anglicane St. Luke est un exemple récent
du style architectural des églises anglicanes en vogue de la fin du
XVIIe siècle au début du XIXe siècle. Selon les architectes fondateurs
James Gibb et Christopher Wren, les petits auditoriums décorés
d’ornements classiques sont ceux qui conviennent le mieux à la
célébration du culte anglican, puisqu’ils permettent à tous les
paroissiens d’entendre la prêche et la liturgie. Pratiquement toutes les
églises anglicanes sont construites d’après le modèle de Wren et Gibb
jusqu’au milieu du XIXe siècle, et l’église St. Luke constitue le
meilleur exemple de ce style à subsister au Nouveau-Brunswick.
Sa conception, attribuée à Edwin Fairweather, est remarquable à cause de
son plan, de sa symétrie, de ses proportions harmonieuses, et de ses
ornements classiques qui attestent de l'influence du classicisme
britannique sur l'architecture des édifices coloniaux. St. Luke était
une église succursale jusqu'en 1988, année où elle est devenue église
paroissiale de la Pointe Gondola.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Greenock
St. Andrews, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada de l'Église-Greenock est une belle
église en bois de style palladien, qui se distingue par son porche
d'entrée et sa flèche étagé d'inspiration classique. Son intérieur à
double hauteur avec sa chaire élevée, ses bancs et ses tribunes,
s’inspire des lieux de rassemblement plus anciens. L'église est située
au cœur du centre historique de la ville, reconnu comme lieu historique
national du Canada de l'Arrondissement-Historique-de-St. Andrews.
Cette élégante église atteste la croissance du presbytérianisme et de
l’église d'Écosse au Nouveau-Brunswick. Construite de 1821 à 1824 par le
constructeur local Donald D. Morrison, cet ouvrage réussit à combiner la
forme des lieux de rassemblement américains avec le style palladien
britannique. Les proportions harmonieuses et les ornements classiques de
l'édifice complètent son plan symétrique simple. Les bancs d’église
originaux et la chaire à deux étages, les colonnes en érable moucheté et
les moulures décoratives composent son riche intérieur. Le chêne vert
sculpté sur la flèche symbolise Greenock, le lieu de résidence écossais
du bienfaiteur de l'église, Christopher Scott.
|


©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l’Église-et-Presbytère-Trinity
Kingston, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada de l’Église-et-Presbytère-Trinity
comprend une église de tradition géorgienne et de plan basilical, ainsi
qu’une résidence de deux étages, également de tradition géorgienne,
toutes deux construites en 1789. Les deux bâtiments, qui se font face
sur la route 845, dans le village de Kingston, au Nouveau-Brunswick,
constituent l’un des rares ensembles église-presbytère à subsister du
XVIIIe siècle.
Les loyalistes arrivent à Kingston en 1784 et prennent tout de suite des
dispositions en vue de l’érection d’une église anglicane. En 1787, on
choisit l’emplacement : c’est au sommet d’une colline que commence
ensuite la construction de l’église et du presbytère, qui s’achèvera en
1789. Au cours du XIXe siècle, plusieurs améliorations et
agrandissements sont réalisés dans le style néo-gothique, mais l’église
Trinity conserve la forme classique des basiliques, ayant pour élément
central une longue nef qui s’étend de l’entrée jusqu’au chœur. Par
ailleurs, il subsiste également dans l’église Trinity une part de la
sobriété harmonieuse caractéristique de la tradition géorgienne.
Le presbytère, quant à lui, est construit entre 1787 et 1788 pour loger
le premier ministre du culte résident et sa famille. Sa silhouette
traditionnelle et modeste demeure à peu près inchangée, le bâtiment
ayant conservé beaucoup des caractéristiques des maisons construites
pour la classe moyenne durant la période géorgienne. L’église et
presbytère Trinity forment un ensemble remarquable, d’autant plus que
les duos église-presbytère ayant été préservés depuis le XVIIIe siècle
sont rares dans les Maritimes.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |
Lieu historique national du Canada de l'Église-Unie-St. Paul
Fredericton, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada de l'Église-Unie-St. Paul illustre
très formellement le style néo-gothique de la grande époque victorienne.
Elle en a le caractère hardi et musclé, avec un mélange de détails
néo-historiques de diverses époques, et de matériaux aux textures riches
et diversifiées, ainsi qu'un intérieur volumineux ayant une excellente
acoustique. Elle est située au centre ville de Fredericton, au
Nouveau-Brunswick. Avec sa haute flèche, elle constitue un point
d'intérêt de la ville.
Le style néo-gothique de la grande époque victorienne, en vogue au
Canada dans la deuxième moitié du XIXe siècle, est caractérisé par une
conception hardie et vigoureuse qui interprète librement les styles
gothiques antérieurs. Cette ancienne église presbytérienne bâtie en 1886
présente des caractéristiques typiques de ce style, y compris une tour
cornière élevée, des faîtages entrecroisés, une riche diversité
d'ornements, et une maçonnerie en pierre rustiquée polychrome. La
rosace, d'inspiration gothique française, marque une ouverture, nouvelle
à l'époque, vis-à-vis des conceptions non britanniques. Son énorme
volume intérieur, bordé sur trois côtés par un vaste balcon incliné,
contient des bancs disposés en demi-cercle, pour faire face à la chaire
et au grand orgue Casavant. Le somptueux décor intérieur se compose de
riches boiseries d'inspiration gothique, de peintures décoratives, de
vitraux et d'un plafond en voûte.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, HRS 1075, 1996 |
Lieu historique national du Canada des Étals de harengs fumés de Seal Cove
Grand Manan Island, Nouveau-Brunswick
Le LHNC des Étals de harengs fumés de Seal Cove sur l'île de Grand
Manan, se compose de quelque 54 bâtiments vernaculaires de bois dont la
plupart ont été construits entre 1870 et 1930, ainsi que l'élément
paysager associé entourant une anse bordée de digues à son embouchure et
d'une crique à sa tête. Ces étals sont situés entre l'océan Atlantique,
et le village et les collines en arrière.
La valeur patrimoniale de ce site a trait à la fusion des éléments bâtis
et naturels en un tout esthétique, qui est typique des paysages
maritimes vernaculaires de la fin du XIXe siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Butterill, 1995 |
Lieu historique national du Canada de la Filature-de-Coton-de-Marysville
Fredericton, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada de la
Filature-de-Coton-de-Marysville est le point central du lieu historique
national du Canada de l'Arrondissement-Historique-de-Marysville.
Réhabilité pour servir de bureaux du gouvernement, le bâtiment de
briques rouges de quatre étages se distingue par sa tour centrale
coiffée d’un toit plat, et des fenêtres à multiples carreaux. Elle est
située à l’intérieur de l’ancien établissement de Marysville, une
communauté modèle construite pour abriter les travailleurs de la
filature, dans le quadrilatère délimité par les rues McGloin, Fisher,
Duke, Marshall et Bridge.
L’industriel Alexander «Boss» Gibson a construit cette filature entre
1883 et 1885. Conçue par le cabinet bostonnais d’architectes et
d’ingénieurs Lockwood, Greene and Company, la filature a été construite
sur le modèle de la Nouvelle-Angleterre et elle est un exemple classique
de la «filature en brique assurée» de la fin du 19e siècle.
Le bâtiment de quatre étages érigé sur des piliers de briques a été
construit avec des briques fabriquées localement et comporte un château
d’eau central et des matériaux ignifuges à l’intérieur. En 1900, la
filature de Marysville comptait parmi les plus grandes au Canada. Conçue
sur le modèle dit «à combustion lente», la filature était à la fine
pointe de la technologie pour cette époque et comprenait non seulement
l’éclairage électrique mais aussi toutes les caractéristiques des usines
fonctionnant à partir d’un moteur central et dont l’énergie était
distribuée par des courroies, des poulies et des dispositifs de
transmission suspendus vers des machines situées dans l’usine selon un
cadre de production défini. Malgré son emplacement relativement éloigné,
la filature a été conçue pour desservir un marché national, ce qu’elle a
fait pendant toutes ses années d’opération. La filature n'a cessé ses
activités de fabrication de textiles que vers la fin des années
70.
|


©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
ieu historique national du Canada du Fort Beauséjour – Fort Cumberland
Aulac, Nouveau-Brunswick
Vestiges d'un fort français construit en 1750-1751; en 1755, il est
tombé aux mains des troupes britanniques et de
Nouvelle-Angleterre.
Situé au fond de la baie de Fundy, à la frontière du Nouveau-Brunswick
et de la Nouvelle-Écosse, le fort Beauséjour – Fort Cumberland est à la
croisée de l'histoire naturelle et culturelle. C'est un endroit tout
désigné pour admirer un paysage patrimonial qui revêt une grande
importance dans l'histoire du Canada.
Déclaré lieu historique national en 1926, le lieu historique national du
Fort-Beauséjour – Fort Cumberland est le témoin d'une époque où les
nations impérialistes de l'Europe se disputaient le contrôle des terres
coloniales de l'est de l'Amérique du Nord. Depuis les hauteurs du lieu
historique, on a un panorama des marais environnants, et les vents qui
balaient le paysage transportent des échos du riche passé historique de
la région.
Le lieu historique national du Canada du Fort Beauséjour - Fort
Cumberland, une fortification militaire en forme d’étoile, de la fin du
XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, est situé sur l’étroite bande
de terre qui relie la Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick, à
l’extrémité sud-ouest de la chaîne Cumberland, près d'Aulac
(Nouveau-Brunswick).
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du Fort
Beauséjour - Fort Cumberland tient à son rôle historique illustré par le
vaste paysage terrestre culturel qui entoure à la fois la forteresse et
ses constructions défensives, ainsi que cinq propriétés éloignées qui
lui sont associées (la butte Roger, l’île de la Vallière, Chipoudy
Point, la redoute au pont à Buot, la ferme Inverma). Les Français ont
commencé à construire le fort Beauséjour en 1751, qui a été terminé par
les Anglais qui en ont pris possession et l’ont rebaptisé Fort
Cumberland. Le fort a fermé ses portes en 1835. Parcs Canada gère à
présent ce lieu historique national du Canada, ouvert au public.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada Anne Bardou, 2006. |
Lieu historique national du Canada Fort-Charnisay
Saint John, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada Fort-Charnisay, dont il ne
subsiste aucun vestige apparent, est situé à Saint John, au
Nouveau-Brunswick. Entre 1645 et le début du XIXe siècle, on y construit
successivement plusieurs forts en raison de sa position stratégique en
surplomb de la rivière Saint-Jean, à la limite ouest du port de la
ville. Le lieu est marqué d’une plaque et d’un cairn de la Commission
des lieux et monuments historiques du Canada, installés à environ 400
mètres au sud du lieu désigné, sur la rue Market Place. Le tracé au sol
du fort est situé près de l’endroit où se trouve aujourd’hui le poste de
péage du pont du Port. Au début du XXe siècle, ce site industriel était
associé au port de Saint John et au chemin de fer.
C’est un conflit entre Charles Menou d’Aulnay de Charnisay et Charles de
la Tour qui entraîne la construction du fort Charnisay. Charles de la
Tour, qui avait construit le fort Sainte-Marie (aussi aussi connu sous
le nom de fort La Tour) sur la rive est du port de Saint John en 1631,
conteste la nomination de Charnisay en 1632 en tant que
lieutenant-colonel du roi en Acadie. Charnisay détruit le fort Sainte
Marie au cours d’une attaque en 1645, puis construit le fort Charnisay,
un poste de traite fortifié, sur la rive ouest du port.
Joseph Robinau de Villebon fait ériger le fort Saint-Jean, la première
installation militaire à cet endroit, pour protéger les colons acadiens
des Britanniques. Son successeur, Jacques-François de Monbeton de
Brouillan, démolit le fort et s’établit à Port Royal en 1700, car il
estime que l’emplacement défensif du fort et ses sources d’eau potable
sont inadéquats. Un nouveau fort, appelé Menagoueche, est aménagé en
1749 par le lieutenant Charles Deschamps de Boishébert et de Raffetot,
qui a reçu l’ordre de protéger l’embouchure de la rivière Saint-Jean
contre les Britanniques. Au début de la guerre de Sept Ans (1756-1763),
le fort Menagoueche est détruit lorsque le lieutenant de Boishébert y
met le feu, avant de fuir les troupes du colonel britannique Robert
Monckton. La forteresse de Louisbourg est alors la seule fortification
française qui subsiste en Acadie.
Monckton fait ériger le fort Frederick en 1758. Des corsaires américains
le détruisent en 1775, mais le fort est reconstruit une dernière fois
pour parer aux attaques qui ont lieu durant la guerre de 1812. Les forts
qui ont été construits successivement à cet endroit témoignent des
importantes batailles qui se sont déroulées dans la région aux XVIIe et
XVIIIe siècles.
Pendant la majeure partie de la première moitié du XXe siècle, le site
prend une vocation industrielle et sert au port et au chemin de fer,
jusqu’à ce qu’il laisse place, au milieu des années 1960, au poste de
péage du pont du Port, entré en fonction en 1968.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Fort-Gaspareaux
Port Elgin, Nouveau-Brunswick
Ruines et cimetière militaires d'un fort français établi en
1751.
Le lieu historique national du Canada du Fort-Gaspareaux est un site
archéologique situé à l’extérieur du Port Elgin (Nouveau-Brunswick) à
4,8 km du village de Baie Verte, sur une petite pointe de terrain qui
s’avance dans la Baie Verte, dans le détroit de Northumberland qui
sépare le continent de l’Ïle-du-Prince-Édouard. Le lieu, qui comprend
1,23 hectares de terrain côtier plat sur la côte sud de l’estuaire de la
rivière Gaspareaux, est protégé par une digue importante. Son paysage
est composé de traces archéologiques du Fort Gaspareaux français et de 9
tombes de soldats provinciaux tués en 1756 alors qu’ils étaient en
garnison au fort.
Le Fort Gaspareaux a été classé lieu historique national en 1920 en
raison de son rôle dans la bataille qui a opposé la France et la
Grande-Bretagne pour l’Amérique du Nord dans les années 1750.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du
Fort-Gaspareaux tient à son lien historique comme le montre le site, le
cadre et les vestiges associés. Elle se traduit par sa situation
stratégique et le tracé du fort, ses matériaux, la technologie de sa
construction et sa disposition.
Fort Gaspareaux était un avant-poste frontière, construit par les
troupes françaises en 1751 sur ordre du Marquis de Jonquière,
gouverneur-général de la Nouvelle-France, afin d’empêcher les
Britanniques d’entrer dans l’isthme de Chignecto. Il a aussi servi de
base d’approvisionnement aux forts de l’Acadie pendant le régime
français. Quand, le 17 juin 1755, le fort a été attaqué par des soldats
britanniques qui étaient sous la direction du colonel John Winslow, un
personnel réduit composé de 19 soldats, dirigé par M. De Villeray, le
gardait et a dû se rendre. Les Britanniques ont mis le feu à la
forteresse en septembre 1756. Son emplacement est connu depuis, même si
le lieu a été utilisé comme terre agricole pendant longtemps. Il s’agit
d’un des premiers lieux classés par la Commission des lieux et monuments
historiques du Canada, et il a fait l’objet de fouilles archéologiques
en 1996.
|
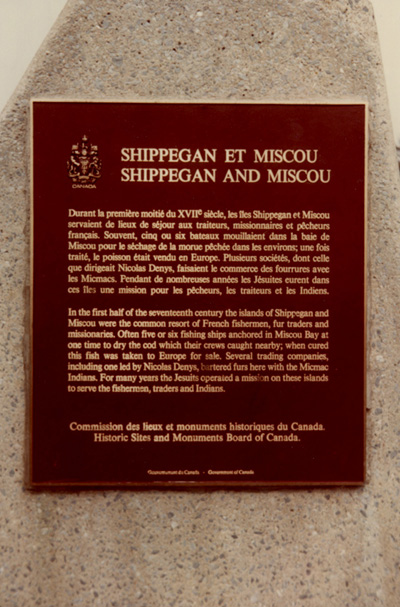
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |
Lieu historique national du Canada Fort / Habitation-de-Denys
Shippagan, Nouveau-Brunswick
Durant la première moitié du XVIIe siècle, les îles Shippegan et Miscou
servaient de lieux de séjour aux traiteurs, missionnaires et pêcheurs
français. Souvent, cinq ou six bateaux mouillaient dans la baie de
Miscou pour le séchage de la morue pêchée dans les environs; une fois
traité, le poisson était vendu en Europe. Plusieurs sociétés, dont celle
que dirigeait Nicolas Denys, faisaient le commerce des fourrures avec
les Micmacs. Pendant de nombreuses années les Jésuites eurent dans ces
îles une mission pour les pêcheurs, les traiteurs et les Indiens.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2003 |
Lieu historique national du Canada Fort-Howe
Saint John, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada Fort-Howe est situé à l’intérieur
d’un parc enclavé dans la ville de Saint John, au Nouveau Brunswick. Le
fort, dont il ne reste pas des vestiges visibles, est situé à un endroit
stratégique, sur un affleurement de calcaire, au sommet d’une colline
qui surplombe la rivière Saint Jean. Une plaque de la Commission des
lieux et monuments historiques du Canada est installée à l’extrémité
ouest du parc. Le site a été épargné par le développement urbain qu’a
connu le secteur avoisinant.
En réponse aux demandes répétées des habitants de la région de
l’embouchure de la rivière Saint Jean qui désiraient que leur petite
colonie soit protégée contre les attaques des corsaires américains, les
Britanniques construisent le fort Howe en 1777. Édifié sur un imposant
rocher offrant une vue incomparable sur le port et la rivière, le fort
Howe et sa garnison protègera les colonies environnantes jusqu’à la fin
de la guerre de 1812. À l’origine, le fort était occupé par un
détachement des « Royal Fencible Americans » sous le commandement du
major Gilfred Studholme. Il se composait d’un blockhaus et d’une caserne
entourée d’une palissade à l’extrémité ouest de la colline et d’un autre
blockhaus à l’extrémité est de celle-ci. Après la fondation de Parrtown,
rebaptisé Saint John en 1783, le fort a abrité le quartier général de
l’armée ainsi que la première prison civile de la nouvelle ville. En
1819, un incendie détruit la caserne d’origine et le fort tombe en
ruine. En 1870, il ne restait plus rien des fortifications
d’origine.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Fort-Jemseg
Jemseg, Nouveau-Brunswick
L'un des postes de commerce établis par Thomas Temple durant
l'occupation de l'Acadie par les anglais. Cédé à la France en 1667. En
1674, une expédition commandée par le cap. Jurriaen Aernouts s'en empara
au nom du prince d'Orange et donna au pays le nom de Nouvelle
Hollande.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Fort-La-Tour
Saint John, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada Fort-La-Tour est un site
archéologique contenant les vestiges d'un poste de traite fortifié du
XVIIe siècle, à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Il est situé sur un
monticule herbeux de Portland Point, à l'embouchure de la rivière
Saint-Jean. De par sa situation géographique stratégique, le fort jouit
de points de vue ininterrompus de la rivière jusqu’à la baie de Fundy.
Depuis le XIXe siècle, la zone environnante du site s'est industrialisée
et est désormais caractérisée par une série de quais et de structures
côtières.
En 1631, Charles de Saint-Étienne de La Tour, gouverneur de l’Acadie et
entrepreneur en commerce de la fourrure, établit à l'embouchure de la
rivière Saint-Jean un poste de traite fortifié baptisé Fort
Sainte-Marie. Traditionnellement situé sur un terrain utilisé par les
membres des Premières nations, ce fort devint l’un des tous premiers
comptoirs français pour la traite des fourrures dans la région. En
effet, les commerçants autochtones apportèrent leurs fourrures depuis la
rivière Saint-Jean jusqu’au fort pour troquer leurs ballots contre des
marchandises telles que des perles, des pointes de lance en fer et des
pointes de flèches. De plus, le fort constitua pour Sieur de La Tour, un
bastion stratégiquement positionné pour contrer les attaques de son
rival, Charles de Menou d'Aulnay, lui-même basé à Port-Royal, de l'autre
côté de la baie de Fundy. En 1645, profitant de l’absence du Sieur de La
Tour, d’Aulnay passa à l’offensive et attaqua le fort. Françoise-Marie
Jacquelin, l’épouse du Sieur de La Tour, dirigea la défense de la
garnison jusqu’à sa capitulation auprès d’Aulnay, quatre jours plus
tard. Dès la prise de possession du fort, d'Aulnay revint sur les
conditions préétablies de la capitulation et exécuta les membres de la
garnison. La bravoure et la mort de Françoise-Marie Jacquelin, lors de
sa détention sous la garde d'Aulnay, eurent fait d’elle une héroïne
canadienne. Le fort lui-même fut détruit à une date inconnue soit au
XVIIe siècle ou au début du XVIIIe siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Fort Nashwaak (Naxoat)
Fredericton, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada Fort-Nashwaak (Naxoat) est manqué
par une plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du
Canada, situé au parc Carleton, à proximité de l’intersection des rues
Union et Gibson, à Fredericton, Nouveau-Brunswick. Même s’il ne reste
aucun vestige, ni preuve archéologique, il s’agissait autrefois d’un
fort français typique du XVIIe siècle, cerné d’une palissade de pieux en
bois et de bastions en losange. Le fort a été érigé à l’embouchure de la
rivière Nashwaak, à l’endroit où elle se jette dans la rivière Saint
Jean, à environ 700 mètres au sud de l’emplacement actuel de la plaque.
Construit par le gouverneur de la Nouvelle-France, Joseph Robineau de
Villebon, durant l’hiver 1691-1692, le fort Nashwaak (Naxoat) sert à
défendre la frontière entre la Nouvelle-Angleterre et l’Acadie et permet
d’éviter l’annexion de la colonie française par les Britanniques. Avec
l’aide des Abénakis, les Français organisent et lancent diverses
incursions contre les établissements de la Nouvelle-Angleterre à partir
du fort. Durant l’une d’elle menée à l’été 1696, un détachement français
mené par de Villebon et son frère prend d’assaut le fort William Henry.
Les troupes anglaises ripostent en attaquant le fort Nashwaak (Naxoat)
par la rivière Saint Jean, mais leurs efforts échouent et le siège est
levé après deux jours. En 1698, le roi ordonne à de Villebon de
construire un nouveau fort à l’embouchure de la rivière Saint Jean, et
le fort Nashwaak (Naxoat) est démoli. Le lieu et tout vestige
archéologique ont ensuite été détruits par l’érosion.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |
Lieu historique national du Canada Fort-Nerepis
Grand Bay-Westfield, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada du Fort-Nerepis est situé dans un
endroit stratégique à Woodmans Point, au Nouveau-Brunswick, au confluent
des rivières Saint Jean et Nerepis. Ce lieu, qui accueillait à l’origine
un village autochtone fortifié, a été choisi par Charles Deschamps de
Boishébert vers 1749 pour y ériger un petit fort français. Les vestiges
du fort Nerepis et son emplacement précis n’ont jamais été découverts.
Toutefois, un emplacement à Woodmans Point est marqué d’un monument et
d’une plaque, installés par la Commission des lieux et monuments
historiques du Canada.
Nerepis est d’abord et avant tout le lieu d’un village autochtone
fortifié, dont l’emplacement stratégique est utilisé pour contrôler
l’entrée vers les terres intérieures du Nouveau Brunswick, le long des
rivières Saint-Jean et Nerepis. L’endroit est mentionné pour la première
fois dans un document datant de 1697, dans lequel on peut lire que le
seigneur de Neuvillette amenait avec lui des éclaireurs de Nerepis
lorsqu’il séjournait le long de la rivière. Peu après 1749, le
lieutenant Charles Deschamps de Boishébert et de Raffetot s’établit à
cet endroit pour y construire un petit fort. Les autres appellations
servant à désigner le fort seront d’ailleurs inspirées de son nom. Cette
construction sert de base aux Français jusque vers 1755, date à laquelle
les forces britanniques, sous le commandement du colonel Robert
Monckton, commencent l’expulsion des pionniers franco-acadiens de toute
la région.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1987 |
Lieu historique national du Canada de la Gare-du-Canadien-Pacifique-à-McAdam
McAdam, Nouveau-Brunswick
La gare du Canadien Pacifique de McAdam est un grand édifice de deux
étages et demi en pierre, de style château, qui abrite une gare
ferroviaire et un hôtel. Situé dans la petite ville de McAdam, au
Nouveau-Brunswick, l'édifice construit en 1900-1901 puis agrandi en
1910-1911 se démarque des autres bâtiments de cette localité.
La gare du Canadien Pacifique de McAdam a été désignée lieu historique
national en 1976 parce qu’elle est associée au développement de la
Compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique (CP) et représente un
des rares exemples de gare de style château qui abrite un hôtel.
La gare de McAdam, construite au tournant du siècle, atteste le début de
la période de croissance et d’expansion rapides du CP. Elle est un des
plus grands exemples préservés de gare de style château du CP. Elle
remplace une ancienne gare et témoigne ainsi du maintien de la
prospérité de McAdam et de son rang à titre de nœud ferroviaire ainsi
que du désir de maintien de cet état. Sa disposition, son aménagement et
ses éléments fonctionnels sont typiques des gares de cette taille,
toutefois, elle s'en distingue par ses installations hôtelières.
Actuellement, la gare n'est plus en service, et son édifice est
entretenu par la McAdam Historical Restauration Commission Inc.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |
Lieu historique national du Canada de la Gare-du-European and North American Railway-à-Rothesay
Rothesay, Nouveau-Brunswick
La gare du European and North American Railway à Rothesay est une gare
ferroviaire de deux étages et demi de style néogothique, dont l'étage
supérieur sert de résidence au chef de gare. Elle a été construite au
milieu du XIXe siècle et elle est située au centre de la communauté de
Rothesay.
La gare du European and North American Railway à Rothesay a été désignée
lieu historique national en 1976 parce qu'elle rappelle le développement
des chemins de fer dans les Maritimes et parce qu'elle est un bon
exemple d'une gare standard de l'European and North American Railway
(ENAR).
La gare du European and North American Railway à Rothesay est l'une des
premières gares qui ont été construites par la nouvelle compagnie
ferroviaire ENAR sur la ligne Saint-Jean - Shediac. De conception
standard, la gare du European and North American Railway à Rothesay fait
partie du petit nombre de gares de l'ENAR qui ont été construites avant
1860 et qui sont les exemples d'architecture ferroviaire les plus
anciens dans les Maritimes.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |
Lieu historique national du Canada de l'Hôpital de la Marine
Miramichi, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada de l’Hôpital-de-la-Marine, un
édifice en grès d’un étage surmonté d’une coupole en dôme, a été
construit en 1830 et 1831 sur un terrain surplombant sur la rivière
Miramichi. L’ancien hôpital est entouré de maisons à charpente de bois
de la petite localité de Douglastown, qui fait à présent partie de la
banlieue de la ville de Miramichi, où il sert de salle paroissiale et de
lieu de réunion communautaire.
L’hôpital de la Marine, qui a été construit à Douglastown par Matthew
Lamont pour les Commissaires du port de Miramichi, en 1830-1831, est le
plus vieil hôpital de la Marine qui subsiste encore au Canada. Jusqu’en
1921, il a offert des soins aux marins indigents, malades ou handicapés,
dont la plupart travaillaient dans le commerce du bois, le long de la
rivière Miramichi. Sa forme, sa composition, ses lignes de toit et sa
coupole reflètent les traditions architecturales classiques en vogue en
Amérique du Nord britannique au XIXe siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Frédéricton
Fredericton, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Frédéricton
est un édifice en brique rouge de trois étages, de style Second Empire,
construit en 1875-1876. Il est situé bien en vue sur une parcelle
d'angle au centre ville de Frédéricton. Un grand square public pavé
contenant une fontaine et des allées pavées, connu sous le nom de square
Phoenix, sépare le bâtiment de la rue.
L’hôtel de ville de Frédéricton, construit en 1875-1876, est conçu dans
le style Second Empire, un style fréquemment utilisé pour les grands
édifices publics dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le square
public qui est devant lui accentue sa présence imposante et sa fonction
d'édifice municipal.
Comme beaucoup d'édifices municipaux du XIXe siècle, l'hôtel de ville de
Frédéricton a été conçu pour remplir de multiples fonctions. Pendant
plus de soixante ans, il a abrité des bureaux municipaux et des salles
du conseil au rez-de-chaussée, un auditorium connu sous le nom d'«Opéra»
à l'étage supérieur, et un marché au sous-sol. La présence d'un marché
dans un hôtel de ville était moins fréquente dans les années 1870
qu'auparavant, car les fonctions administratives avaient alors gagné en
importance et en complexité. En 1940, on a déménagé les salles du
conseil à l'étage dans l'auditorium, et en 1951, le marché a quitté
l'édifice. Le bâtiment abrite toujours des bureaux municipaux et les
salles du conseil.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique international de l'Île-Sainte-Croix
Nouveau-Brunswick
L'Île-Sainte-Croix est le site de la première tentative d'établissement
en Amérique du Nord par Pierre Dugua qui a ouvert la voie aux colonies
permanentes de l'Acadie et de la Nouvelle-France.
Bienvenue au lieu historique international de l'Île-Sainte-Croix, site
de la première tentative d'établissement en Amérique du Nord par Pierre
Dugua qui a ouvert la voie aux colonies permanentes de l'Acadie et de la
Nouvelle-France. Le 8 juin 1949, le lieu a été déclaré monument national
par le United States National Park Service et lieu historique
international le 25 septembre 1984. En 1958, la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada recommandait que l'importance historique
nationale de l'île Sainte-Croix pour le Canada soit reconnue. Le site
d'interprétation canadien, administré par Parcs Canada, se trouve à
Bayside au Nouveau-Brunswick, non loin de St. Andrews. Il surplombe
l'île Sainte-Croix, située au milieu de la rivière Sainte-Croix.
élieutenant général de « La Cadie » (Acadie). L'année suivante, il
arrive en Acadie à bord du navire étendard la Bonne-Renommée, qui
transporte également une poignée d'hommes aux talents divers, dont
Samuel de Champlain, chroniqueur et cartographe expérimenté.
L'expédition, partie à la recherche d'un endroit où s'installer, arrive
dans la baie Passamaquoddy à la fin de juin. De Mons choisit l'île qu'il
baptise île Sainte-Croix, et voulu y fonder le premier établissement
français en Amérique occupé toute l'année, et qui symbolise la fondation
de l'Acadie.
Même si l'établissement a été de courte durée, à l'été de 1605 Mons
déménagea ses gens sur les côtes du bassin d'Annapolis en
Nouvelle-Écosse et fonda Port-Royal, l'expérience qu'ils ont acquise
leur servira à établir avec succès une habitation à Port-Royal et
permettra une présence française en Amérique du Nord jusqu'à ce
jour.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2002 |
Lieu historique national du Canada de l'Île-de-La-Vallière
Sackville, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada de l’Île-de-La-Vallière est situé
sur une section triangulaire d’une terre appelée marais Tantramar, près
de Sackville au Nouveau-Brunswick. Établissement acadien important, le
lieu consiste en une colline de faible élévation, appelée île de La
Vallière, qui est couverte de marais salés et située du côté ouest de la
rivière Missaguash.
En 1676, Michel Le Neuf de la Vallière reçoit en concession une petite
section de terre sur la rive sud-ouest de l’isthme de Chignectou, en
face du petit établissement acadien de Beaubassin, le long de la rivière
Missaguash. La Vallière construit son manoir à l’ouest de la rivière sur
une colline peu élevée entourée de marais salés. Le petit établissement
prend de l’expansion, les Acadiens construisant des aboiteaux pour
drainer et dessaler lentement les marais. Une palissade et un moulin
sont également érigés.
Lorsque la Vallière devient gouverneur de l’Acadie en 1678, son
établissement de l’île de La Vallière en devient la capitale. La
localité conserve ce rang jusqu’en 1684 où, en raison d’un litige avec
d’autres seigneurs au sujet de l’octroi de licences de pêche à des
navires bostoniens, les Français dépouillent la Vallière de son titre de
gouverneur. L’établissement de l’île de La Vallière connaît un déclin
pendant le siècle suivant tandis que la communauté de Beaubassin, de
l’autre côté de la rivière, se développe et devient une ville acadienne
importante. Lorsque les tensions s’accroissent entre les Britanniques et
les Français, les villageois de Beaubassin fuient à l’ouest de la
rivière Missaguash pour s’installer majoritairement au nouveau fort
Beauséjour, construit sur la crête située au nord des marais, plutôt
qu’à l’île de La Vallière, plus difficilement défendable.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada des Magasins-Militaires
Saint John, Nouveau-Brunswick
Lieu historique national du Canada des Magasins-Militaires a été érigé en 1842,
le bâtiment des magasins militaires est un spécimen rare de magasins militaires
construits pendant la période coloniale; il est le produit des recommandations
de la Commission royale de 1825 qui avaient défini pour les colonies une
stratégie de défense générale appuyée par le commandant en chef de l’armée
britannique, le duc de Wellington; le bâtiment a été agrandi en 1911 grâce à
l’ajout d’une toiture à la Mansart, décision correspondant pour le Canada à une
période d’expansion de son infrastructure militaire; il est caractéristique des
magasins militaires par son architecture utilitaire de style classique, sa
construction robuste et son adaptabilité; la présence d’éléments de construction
datant de deux périodes distinctes, la période coloniale et la période du
Dominion, le rend particulièrement digne d’intérêt. il compte parmi les rares
bâtiments de Saint John à avoir échappé au grand incendie de Saint John en
1877.
|

©Canadian Inventory of Historic Buildings/ Inventaire des bâtiments historiques du Canada, ca.1975 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Belmont / Maison-R.-Wilmot
Lincoln, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Belmont /
Maison-R.-Wilmot est une vaste maison de campagne de style néo-classique
construite au début du XIXe siècle sur la rive sud-ouest de la rivière
Saint-Jean, à environ 16 kilomètres de Fredericton.
La maison Belmont / maison R. Wilmot est un bon exemple du style
néoclassique tel qu'il était employé au Canada entre 1820 et 1830. Sa
façade, à laquelle le toit au bout du pignon imprime sa forme, est
conçue comme la devanture d'un temple. Reprise sur la façade arrière,
cette devanture de temple de même que la symétrie et l'ordre classique
des façades, reflètent la forte influence du néoclassicisme dans
l'architecture domestique canadienne de l'époque.
Robert Duncan Wilmot (1809-1891), un Père de la Confédération et un
éminent politicien et homme d'État à l'oeuvre sur les scènes locale,
provinciale et fédérale, a vécu par intermittence à la maison Belmont de
1839, date à laquelle son père en est devenu le propriétaire, jusqu'à sa
mort en 1891.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1980. |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Chandler / Rocklyn
Dorchester, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Chandler / Rocklyn
est situé dans la ville de Dorchester, au Nouveau-Brunswick. De style
néoclassique et bien proportionnée, cette maison construite en 1831
présente cinq ouvertures à chacun de ses deux étages, ainsi qu’un
parement extérieur en pierre ouvrée et un toit bas à quatre versants
percé de hautes cheminées en pierre. Sa porte avant est agrémentée d’un
porche ouvert coiffé d’un fronton et flanqué de colonnes.
La valeur patrimoniale de la maison réside dans son style néoclassique.
Parmi les éléments de décoration extérieure, notons les proportions
harmonieuses, la façon dont le fronton du porche rappelle l’angle du
toit d’ardoise à quatre versants, ainsi que les murs rustiqués du
rez-de-chaussée, qui contrastent avec le parement lisse en pierre de
taille du deuxième étage. Les triglyphes et les colonnes cannelées
agrémentent le magnifique porche en bois reposant sur une base de
pierre. La maison, dont l’architecture est inspirée du style classique
avec ses détails ouvragés et l’utilisation de matériaux durables,
reflète le statut social et économique d’Edward Barron Chandler, un
leader du Canada atlantique au XIXe siècle.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Connell
Woodstock, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Connell est une
gentilhommière imposante en bois de deux étages et demi, caractérisée
par une véranda à colonne de deux étages de haut ornant l'avant et une
façade latérale de l'édifice. Cette maison est un des anciens édifices
les plus exceptionnels de la ville historique de Woodstock, au
Nouveau-Brunswick, à cause de sa façade principale ressemblant à un
temple de style néo-grec. Elle sert maintenant de musée et d'archives,
gérés par la Carleton County Historical Society.
Charles Connell, marchand de bois et politicien, a fait construire cette
maison vers 1840. Ce type de maison, inspirée des temples classiques,
était rare au Canada, même s'il était plus répandu aux États-Unis, où
Connell, dont la famille était loyaliste, a pu puiser son inspiration.
La forme de temple du bloc d'origine a été relativement estompée par
plusieurs ajouts, bâtis à la fin du XIXe et au début du XXe siècles. Le
bâtiment est demeuré la maison de la famille Connell jusqu'en 1975, date
à laquelle la Carleton County Historical Society l'a achetée pour en
faire un musée et des archives.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2008 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Hammond
Sackville, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Hammond est une vaste
maison de style néo-Queen Anne située dans un cadre paysager, sur le
campus de l'Université Mount Allison.
La maison Hammond a été désignée lieu historique national en 1990 parce
qu'elle est un exemple exceptionnel du style néo-Queen Anne transposé
dans l'architecture domestique.
La valeur patrimoniale du lieu réside dans son expression matérielle des
formes fantaisistes, de la masse asymétrique et des surfaces polychromes
qui caractérisent le style néo-Queen Anne, populaire de 1870 à 1914.
La maison a été conçue par la firme d'architectes Burke and Horwood et
construite en 1896 pour l'artiste John Hammond. La famille Hammond
vivait là depuis Mars 1897. Elle a ensuite été acquise par l'Université
Mount Allison.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Loyaliste
Saint John, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Loyaliste, qui
rappelle avec élégance les premiers jours de la colonisation de Saint
John, réunit les plus belles qualités du classicisme du début du XIXe
siècle, tel qu'il s'est exprimé au Canada atlantique. Sa construction de
bois, dont la conception d'ensemble est classique, a été réalisée par
d'excellents ouvriers spécialisés avec des matériaux locaux et importés
de bonne qualité. Le public peut maintenant faire l’expérience de ses
intérieurs raffinés.
Cette maison, construite avant 1820 par le marchand David Merritt, a été
préservée pratiquement sans changement par cinq générations de sa
famille, qui l'ont habitée jusqu'en 1959. Ses proportions harmonieuses,
sa composition symétrique, ainsi que son aménagement et ses ornements
intérieurs et détails illustrent l'influence des traditions
néo-classiques venant de Nouvelle-Angleterre, où on qualifiait ce style
«Fédéral». La Maison Loyaliste, une des plus anciennes de la ville, est
un édifice important parce qu'il a survécu au grand incendie de 1877 qui
a détruit une grande partie du centre ville de Saint John. La même
famille l'a habitée pendant une grande partie de son existence, et elle
est demeurée remarquablement inchangée au fil des ans.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1987 |
Lieu historique national du Canada de la Maison-Tilley
Gagetown, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Tilley est une maison
en bardeaux d’un étage et demi, située sur un vaste lot dans la ville de
Gagetown (Nouveau-Brunswick). On pense qu’il s’agit du lieu de naissance
de Sir Samuel Leonard Tilley, père de la Confédération, qui l’a habité
jusqu'à l’âge de treize ans. Typique des maisons construites dans les
années 1780 dans les Maritimes, sa charpente de bois, taillée à la
hache, s’inspire de la tradition loyaliste.
On pense que Sir Samuel Leonard Tilley (1818 – 1896) est né dans cette
maison. Construite à l’origine pour un certain Docteur Stickles,
probablement à la fin du XVIIIe siècle, la maison a été achetée, en
1805, par Samuel Tilley, l’arrière-grand-père de Sir Leonard. Dans les
années 1830, c’est-à-dire à l’époque où Sir Leonard Tilley en est parti,
elle a été considérablement agrandie, avec l'ajout d'une aile sur le
côté nord et des modifications à l’extrémité sud. En 1897, la maison a
été convertie en hôtel. Elle est maintenant gérée par le Queens County
Museum.
Sir Leonard Tilley a passé son enfance dans cette maison, puis il a
quitté Gagetown pour aller travailler à Saint-Jean à l’âge de treize
ans. En 1850, il s’est intéressé à la politique. Il a d’abord été député
provincial puis député fédéral pour Saint-Jean, avant de devenir
lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick et ministre du gouvernement
fédéral. Il a été fait chevalier par la reine Victoria en 1879.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1987 |
Lieu historique national du Canada du Marché-de-Saint John
Saint John, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada du Marché-de-Saint John, grand
édifice en brique, occupe toute la longueur d’un pâté de maisons au coin
nord-ouest de King Square, dans le quartier d’affaires central de Saint
John (Nouveau-Brunswick). Cet immeuble de bureaux de trois étages et
demi, de style Second Empire, avec sa façade à entrée officielle, qui
donne sur la place, a été construit en 1876. Dans son prolongement à
l’arrière se trouvent les halles, composées d’un espace ouvert d’une
hauteur double organisé autour une grande allée centrale avec des étals
individuels de part et d’autre. L’espace du marché se distingue par sa
structure en bois et des arbalètes à deux poinçons soutenues par des
colonnes en fonte.
Le marché de Saint John est un exemple de la conception d’édifices
destinés à accueillir des marchés au XIXe siècle au Canada. Les halles
de Saint John, solides et résistantes au feu, ont été construites entre
1874 et 1876 selon les plans des architectes du Nouveau-Brunswick McKean
et Fairweather. Elles ont survécu au grand incendie de 1877 et ont été
rénovées au fil des ans, ce qui leur a permis de rester une structure
municipale importante qui continue de remplir sa fonction
originale.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, L. Maitland, 1995 |
Lieu historique national du Canada Minister's Island
St. Andrews, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada Minister’s Island consiste en un
domaine estival et une ferme rentière pittoresques, bien préservés,
aménagés à la fin du XIXe siècle et au début de XXe siècle. La propriété
occupe les 280 hectares de l’île située dans la baie Passamaquoddy, sur
la côte orientale du Nouveau-Brunswick. À marée basse, l’île est reliée
au continent par une voie terrestre. Le domaine se compose d’un ensemble
de bâtiments conçus dans une version élégante mais élargie du style
Shingle et entourés de forêts et de champs. Le paysage comprend quatre
zones reliées entre elles : la maison principale et les dépendences, les
pelouses et les jardins annexes; les terres agricoles et les édifices
situés au nord; les terrains d’activités de loisir, soit les plages, les
terrains de tennis et de croquet, les sentiers et les routes
carrossables; la forêt qui couvre le tiers de l’île. La maison
principale est soutenue par des communs, c’est-à-dire un garage, une
remise, un moulin à vent, une installation de gaz et des bains. Les
bâtiments agricoles comprennent une étable, une laiterie, un
pavillon-dortoir, une maison de jardinier avec des vestiges d’une serre
à vigne, et un bâtiment de ferme en pierre de la fin du XVIIIe siècle.
L’endroit désigné comprend toute l’île avec tous ses édifices et ses
éléments paysagers.
Le domaine évoque de manière éloquente la vie et l’époque du
constructeur du chemin de fer du Canadien Pacifique, Sir William
Cornelius Van Horne. Il a aménagé la propriété avec l’assistance de son
épouse, Lucy Adeline Hurd Van Horne, et de sa fille Adeline, qui a
continué de développer le domaine après la mort de son père. Le domaine
est directement associé à la vie professionnelle de William Cornelius
Van Horne et reflète ses nombreux intérêts.
L’architecte montréalais Edward Maxwell, un des architectes canadiens de
bâtiments résidentiels et commerciaux les plus connus, a conçu les
ensembles résidentiels et agricoles du domaine. Les structures sont
autant de beaux exemples des édifices de style Shingle américain et des
idées esthétiques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle
pour ce qui est de la nécessité de relations harmonieuses entre les
édifices et les paysages.
Le domaine, où se marient agréablement l’océan, les plages, la ferme,
les champs, les forêts et les édifices aux façades en pierre et en bois,
est une réponse personnelle et régionale aux traditions en matière de
domaines campagnards inspirée des modèles britanniques et américains. Le
domaine a eu une influence sur le développement d’autres lieux de
villégiature et, tout particulièrement, de St. Andrew’s
(Nouveau-Brunswick).
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada du Monument-Lefebvre
Memramcook, Nouveau-Brunswick
Édifice polyvalent, symbole de la renaissance culturelle
acadienne.
Le lieu historique national du Canada du Monument-Lefebvre est situé
dans la vallée de Memramcook, au sud-est du Nouveau-Brunswick. L'édifice
patrimonial du Monument-Lefebvre est le symbole de la renaissance de
l'Acadie contemporaine. Il est un signe tangible qui permet à tous
d'apprécier l'histoire, la culture et les réalisations du peuple
acadien.
« L'Odyssée acadienne ». Cette exposition est en quelque sorte un centre
d'interprétation culturel où les visiteurs peuvent se plonger dans un
univers acadien. On y explore les jalons de la renaissance acadienne,
notamment l'éducation, la religion, la politique, l'économie et des
aspects culturels du passé comme du présent.
Le lieu historique national du Canada du Monument-Lefebvre, structure en
pierre imposante, est situé sur un endroit élevé du campus du Collège
Saint-Joseph à Memramcook, Nouveau-Brunswick. Le bâtiment est construit
en grès rustiqué du Nouveau-Brunswick de couleur olive et sa façade
classique symétrique est caractérisée par des détails néoromans. La
structure abrite un théâtre et des salles de classe qui ont contribué à
soutenir et à nourrir la culture et l’éducation acadiennes.
Le monument Lefebvre a été construit à la mémoire du père Camille
Lefebvre, décédée en 1895. Les travaux ont été entrepris en 1896, et
l’édifice a officiellement ouvert ses portes en 1897. Le père Camille
Lefebvre a fondé le Collège Saint-Joseph à Memramcook, premier
établissement francophone à conférer des diplômes universitaires dans la
région de l’Atlantique, et il a joué un rôle important dans la
renaissance de la culture acadienne au Canada à la fin du XIXe siècle.
Le bâtiment, qui a fermé dans les années 1970, a été préservé en tant
que monument dédié à la culture acadienne et de l’œuvre du père Camille
Lefebvre. Sa valeur patrimoniale tient à son association avec ce
dernier, comme le montre son utilisation et ses caractéristiques
physiques.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1992. |
Lieu historique national du Canada de l'Observatoire William-Brydone-Jack
Fredericton, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada de l’Observatoire
William-Brydone-Jack est une petite structure comprenant une tour
octogonale coiffée d’un toit conique octogonal, et comportant un
appendice d’un étage à toit en pignon sur le côté. L’édifice est couvert
de clins de planches de bois et de simples moulures de bois et des
consoles sous le toit complètent les surfaces extérieures. Les espaces
intérieurs sont également sobres et pratiques.
L’Observatoire William Brydone Jack a été construit en 1851 à
l’instigation de William Brydone Jack, professeur de mathématiques, de
philosophie de la nature et d’astronomie; et président de l’Université
du Nouveau-Brunswick entre 1861 et 1865. Selon les traditions des
universités écossaises, il équipa l’observatoire des meilleurs
instruments de l’époque. De concert avec l’observatoire de Harvard, il
détermina la longitude de Fredericton et d’autres lieux du
Nouveau-Brunswick, et corrigea les erreurs dans les frontières
internationales.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, ca. 1982 |
Lieu historique national du Canada Oxbow
Red Bank Indian Reserve (Metepenagiag Mi'kmaq Nation), Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada Oxbow est un site archéologique
situé dans la réserve de la nation Mi'kmaq Metepenagiag, au
Nouveau-Brunswick, sur la rivière Little Southwest Miramichi, du côté
opposé à la communauté mi'kmaq actuelle. Le site, dont la rive nord est
formée par un ancien méandre, comprend l'endroit où des ressources
archéologiques stratifiées sont enfouies jusqu'à deux mètres de
profondeur dans le limon et le gravier de la berge. Il est situé à
l’intérieur du parc historique de Metepenagiag, au même titre que le
lieu historique national du Canada Tumulus-Augustine.
Oxbow a été désigné lieu historique national du Canada en 1982, car ce
lieu est un site culturel unique ouvrant une fenêtre sur une communauté
mi’kmaq florissante qui s’est maintenue pendant au moins 3 000 ans et
attestant un rapport direct entre la vie quotidienne de la communauté et
son centre spirituel, le tumulus Augustine.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada Oxbow a
trait à son rôle de témoin de 3 000 ans d'occupation continue du site
par les Mi'kmaq, tels que l'attestent son emplacement, son site, sa
composition dense, les interrelations spatiales fonctionnelles et
culturelles de ses composantes stratifiées, et la nature riche et
diversifiée des vestiges archéologiques qu'il contient. Sa valeur repose
aussi sur le rapport direct entre les anciens éléments du site et le
tumulus Augustine, désigné lieu historique national du Canada en 1975.
Le lieu historique national du Canada Oxbow contient des vestiges
attestant que les Mi'kmaq sont établis depuis 3 000 ans (soit de 1 000
avant J.-C. jusqu'à présent) sur la rive nord de la rivière Little
Southwest Miramichi, à la ligne extrême des eaux de marée. Les
inondations annuelles de la berge ont formé un site bien stratifié dont
les multiples couches de sédiments attestent son caractère culturel
développé au fil des ans. La profondeur de ce site stratifié est tout à
fait unique dans les Maritimes. La majorité des vestiges archéologiques
constituent une collection entreposée au bureau des services
archéologiques du gouvernement du Nouveau-Brunswick, à
Fredericton.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2003 |
Lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-du-Comté-de-Charlotte
Saint Andrews, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada du
Palais-de-Justice-du-Comté-de-Charlotte est un bâtiment simple à
ossature de bois d’un étage et demi doté d’un portique à fronton
monumental érigé de 1839 à 1840, dans la ville de Saint Andrews, sur un
promontoire à côté de la prison.
Le palais de justice du comté de Charlotte est représentatif des palais
de justice construits au milieu du XIXe siècle en raison de son
implantation, sa composition, de sa forme, de ses matériaux et de ses
détails d'inspiration classique. Comme les autres palais de justice
érigés à la même période dans les Maritimes, il possède une masse
vernaculaire simple en bois à laquelle on a ajouté des caractéristiques
monumentales témoignant de sa vocation et de son statut et le
distinguant des autres bâtiments de la communauté. Ces caractéristiques
incluent son implantation sur un promontoire, son portique à fronton en
saillie et la transposition des détails en maçonnerie classique dans le
bois. Le palais de justice du compté Charlotte jouxtait la prison de
comté pour des raisons fonctionnelles. L’élégance et la qualité
d’exécution de ce palais de justice reflètent la prospérité de la
communauté et témoignent de sa fierté à l’égard de ses bâtiments
publics, surtout ceux associés au système judiciaire. En 1858, Charles
Kennedy a sculpté les armoiries royals dans le tympan du fronton pour
représenter les origines britanniques des Loyalistes qui se sont établis
dans la région.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1980 |
Lieu historique national du Canada du Palais-de-Justice-du-Comté-de-Saint John
Saint John, Nouveau-Brunswick
Le palais de justice du comté de Saint John est un édifice de trois
étages en pierre, de style néoclassique, construit entre 1826 et 1829.
Il est situé dans la ville de Saint John, au Nouveau-Brunswick, dans un
quartier composé de bâtiments du XIXe siècle. Le palais de justice se
dresse sur un terrain d’angle surélevé, avec la prison en arrière-plan.
De l’autre côté de la rue se trouve le cimetière loyaliste et une place
publique boisée, soit le King Square.
Le palais de justice du comté de Saint John a été désigné lieu
historique national en 1974 parce qu’il est représentatif des bâtiments
judiciaires du Nouveau-Brunswick et que la disposition étudiée de ses
éléments classiques crée une impression d’ordre et de grandeur.
Le palais de justice du comté de Saint John a été érigé entre 1826 et
1829 afin d’abriter les salles d’audience et les bureaux pour les
sessions de la Cour suprême et de la Cour des sessions trimestrielles.
Il a également logé la salle du conseil municipal. De nos jours, il
abrite le bureau du shérif-coroner et les salles pour les sessions de la
Cour du Banc de la Reine et de la Cour provinciale.
De par ses matériaux, sa forme, sa composition et ses éléments
architecturaux, le palais de justice est représentatif des édifices
publics britanniques érigés au Canada au début du XIXe siècle. Son style
néoclassique lui confère la sobriété et la sophistication qui
conviennent à sa fonction de palais de justice. Le palais de justice est
remarquable pour son escalier intérieur circulaire en porte-à-faux, dont
les marches de pierre couvrent trois étages sans aucun support central.
Conçu selon les plans de John Cunningham, un architecte de Saint John,
le palais de justice a été rénové en 1924 sous la supervision de
l’architecte Garnet Wilson, après avoir été ravagé par un incendie en
1919.
|
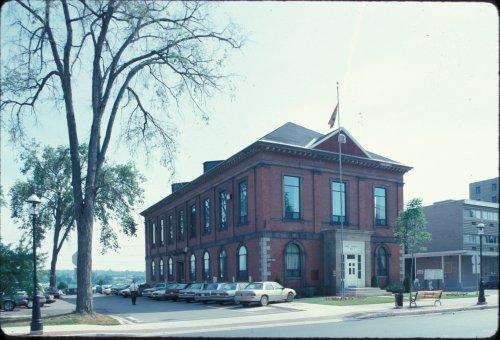
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1992 |
Lieu historique national du Canada du Palais de justice du comté de York
Fredericton, Nouveau-Brunswick
Le Palais de justice du comté de York est un édifice en brique rouge de
deux étages construit en 1857 et 1858. Il est situé au centre ville de
Fredericton.
Le Palais de justice du comté de York a été désigné lieu historique
national en 1980 parce qu'il est représentatif d'un type fonctionnel
important et parce que la combinaison des fonctions de marché et de
palais de justice sous un seul toit en fait un exemple unique parmi les
palais de justice subsistants dans les provinces de l'Atlantique.
Le Palais de justice du comté de York, bâti en 1857 et 1858 est le plus
vieux palais de justice de brique subsistant au Nouveau-Brunswick. Il
illustre le début de la tendance de bâtir en brique et en pierre la
plupart des édifices de la province, principalement à cause des risques
d'incendie.
À l'origine le bâtiment a été conçu pour abriter un marché au
rez-de-chaussée et des salles d'audience au deuxième étage. Cette
combinaison, découlant d'une concession de terre restrictive contractée
par le comté du début du XIXe siècle, est unique parmi les édifices
publics subsistants dans les provinces de l'Atlantique. Étant donné les
exigences différentes des deux fonctions, leur combinaison n'a jamais
été harmonieuse. En 1882 et 1883, une grande partie des espaces réservés
au marché ont été convertis en greffe du tribunal.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1987 |
Lieu historique national du Canada du Pavillon des Arts
Fredericton, Nouveau-Brunswick
Le Pavillon-des-Arts, grand édifice de trois étages en maçonnerie
d’inspiration classique, est situé à flanc de coteau sur la College
Hill, au centre du pittoresque campus de l’Université du
Nouveau-Brunswick. Il s’agit du plus vieil édifice universitaire
toujours en fonction au Canada. Il surplombe la ville de Fredericton et
la rivière Saint John.
Le Pavillon des Arts a été désigné lieu historique national en 1951
parce qu’il est le plus vieil édifice universitaire toujours en fonction
au Canada.
La valeur patrimoniale de ce lieu tient à son association historique
avec les débuts de l’enseignement supérieur au Canada, comme le montrent
son site, sa conception et ses matériaux. Le collège King’s,
établissement d’enseignement post-secondaire, a été construit entre 1826
et 1828 et est devenu en 1860 l’Université du Nouveau-Brunswick. C’est
en 1829 qu’il a ouvert ses portes et que les premiers cours y ont été
donnés. Le comble brisé, qui constitue un troisième étage, a été ajouté
en 1876. Pendant de nombreuses années, l’édifice a abrité des bureaux et
le quartier d’habitation du président de l’université. L’Université du
Nouveau-Brunswick l’utilise actuellement pour ses bureaux
administratifs.
L’édifice porte aussi le nom de Sir Howard Douglas Hall, en hommage à
Sir Howard Douglas (1776-1861), lieutenant gouverneur du
Nouveau-Brunswick et fondateur du Collège King’s, qui en a dirigé la
construction dans les années 1820.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Ministry of Transport, 1990 |
Lieu historique national du Canada du Phare-de-Miscou Island
Miscou Island, Nouveau-Brunswick
Lieu historique national du Canada du Phare-de-Miscou Island est un
phare en bois datant du milieu du XIXe siècle, situé à l’extrémité
nord-est de Miscou Island, sur le cap Birch Point, au Nouveau-Brunswick.
Il est situé stratégiquement sur la ligne de côte plate et dégagée,
entouré d’un terrain broussailleux, à l'entrée sud de la baie des
Chaleurs, dans le golfe du Saint-Laurent. Le phare, à la volumétrie
octogonale et effilée, est recouvert de bardeaux, et coiffé d’un
lanterneau polygonal derrière un rail en fonte. À coté se dresse un
bâtiment de sifflet de brune du milieu du XXe siècle.
La valeur patrimoniale du phare de Miscou Island a trait au rôle
essentiel qu'il joue depuis longtemps à titre de phare, tels que
l'attestent sa fonction, sa situation et sa composition. Ce phare est
construit en 1856, par la province du Nouveau-Brunswick, afin de réduire
le nombre d’accidents maritimes dans la région. Par la suite, il est
devenu une aide précieuse à la navigation côtière, assurant une
navigation sécuritaire pour les navires à l'entrée de la baie des
Chaleurs, et pour la circulation côtière entre les provinces de
l'Atlantique et le Québec.
Le phare de Miscou Island est l’un des rares phares construits en bois
dans une forme octogonale effilée ayant subsisté. La technique de
construction utilisée était inhabituelle puisque les huit panneaux ont
été bâtis indépendamment les uns des autres. La conception fonctionnelle
du phare a été améliorée avec l’installation d’un puissant éclairage
dioptrique et une corne de brume. En 1903, la hauteur du phare est
passée de 22,5 à 24,3 mètres pour accroître la portée de l’éclairage,
et, en 1946, étant donné l'érosion de la côte, il est déplacé en entier,
61 mètres en arrière-pays. Aujourd'hui, le feu est automatisé, et
toujours en fonction.
|
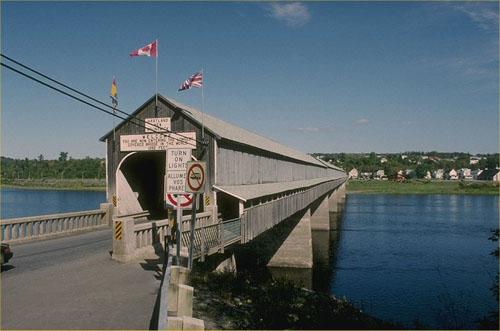
©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada 1987 |
Lieu historique national du Canada du Pont-Couvert-de-Hartland
Hartland, Nouveau-Brunswick
Le pont couvert de Hartland, caractéristique frappante du paysage du
Nouveau-Brunswick, est le plus grand de ce type au monde. Ses piliers
énormes en béton soutiennent un long pont fermé en bois, tenu par des
poutres Howe. Le pont offre un abri pour traverser la Rivière Saint-Jean
au village de Hartland.
Le pont couvert de Hartland a été désigné lieu historique national du
Canada parce que cette structure constitue le pont couvert le plus long
au monde.
La valeur patrimoniale de ce lieu tient à sa conception et à sa
structure physique. Avec ses 390,75 mètres de long, c’est le pont
couvert le plus long au monde, et de loin. Les ponts couverts datent de
la première décennie du XIXe siècle, époque où des poutres en bois ont
commencé à être utilisées dans la construction en Amérique du Nord pour
les longues travées. Elles ont été recouvertes afin de éviter la
corrosion sur leurs joints. Après 1840, la poutre Howe, dans laquelle
des tiges de tension en fer étaient introduites, a été largement
adoptée. De nombreux ponts ont été construits au Nouveau-Brunswick selon
cette technique, dont celui-ci, construit en 1921, sur lequel une voie
piétonnière a été ajoutée en 1943.
|

©Harold E. Wright, Heritage Resources / Ressources patrimoniales, Saint John, 2009 |
Lieu historique national du Canada du-poste-d'incendie-de-la-No.2 Mechanics' Volunteer Company
Saint John, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada du-poste-d'incendie-de-la-No.2
Mechanics' Volunteer Company est une élégante caserne de pompiers en
pierre située au cœur de Saint John, au Nouveau-Brunswick, en face de
King's Square, le plus vieux parc municipal de la ville. Encadré par le
palais de justice plus imposant et par une rangée d'édifices commerciaux
de quatre étages, ce petit édifice de deux étages au toit en pente est
représentatif de son époque et de sa vocation.
Au début du XIXe siècle, la fréquence et la gravité des incendies qui
s’étendaient aux villes entières traumatisaient tellement les Canadiens
que les communautés ont commencé à construire des casernes de pompiers
permanentes. Cet élégant édifice, construit en 1840 dans le style
néoclassique, est un des premiers exemples de caserne conçue pour
héberger une brigade de pompiers bénévoles utilisant des autopompes à
main. Œuvre de l'architecte local John Cunningham, cet immeuble rappelle
la phase initiale du développement de la lutte contre les incendies dans
les municipalités canadiennes, alors que les brigades de pompiers
bénévoles constituaient la meilleure ligne de défense contre les feus
dévastateurs, et qu'elles jouaient un rôle important dans la vie urbaine
de l'époque victorienne. L'édifice a servi de caserne de pompiers
jusqu'en 1948 et il est maintenant ouvert au public à titre de musée de
la lutte contre les incendies.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1992 |
Lieu historique national du Canada de la Rue-Prince William
Saint John, Nouveau-Brunswick
Ce paysage de rue comprend douze édifices publics et commerciaux au
centre-ville de Saint John, au Nouveau-Brunswick. Ces bâtiments
distinctifs en maçonnerie, datant de la fin du XIXe siècle, sont
concentrés en deux pâtés de maisons sur la rue Prince William, à
proximité des rues Princess et Duke.
La valeur patrimoniale de la Rue Prince William réside dans la
concentration de bâtiments publics et commerciaux remarquables du point
de vue architectural à l'intérieur d'un secteur comportant deux pâtés de
maisons. La plupart des bâtiments ont été construits après le Grand
Incendie de 1877, et l'utilisation des styles architecturaux de la fin
du XIXe siècle et des matériaux ignifuges ainsi que l'excellente
exécution illustrent la détermination de la ville de Saint John à
retrouver sa prospérité après les ravages de l'incendie.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1939 |
Lieu historique national du Canada des Sites-Archéologiques-Minister's Island
St. Andrews, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada des
Sites-Archéologiques-Minister's Island est composé d’un groupe de sites
archéologiques souterrains situés dans la baie Passamaquoddy, à la
pointe sud-ouest du Nouveau-Brunswick. Cette île ainsi nommée est reliée
à la partie continentale par une bande de terre naturelle, recouverte à
marée haute et dégagée à marée basse. Les vestiges associés à ces sites
datent de 1000 à 500 ans avant notre ère. L’île, qui s’étend sur
quelques 280 hectares (700 acres), a été mise en valeur par le magnat
des chemins de fer William Van Horne, qui en a fait une résidence d’été
du nom de Covenhoven, devenue depuis le lieu historique national du
Canada Minister’s Island, et ouvert au public. Le groupe de sites
archéologiques est identifié par une plaque commémorative.
Ces sites archéologiques, situés sur les anciens terrains de la
résidence d’été de William Van Horne sur Minister’s Island (à présent le
lieu historique national du Canada Minister's Island), près de la ville
de St. Andrews, contiennent des vestiges de quatre maisons datant d’au
moins 1 200 ans ainsi que des buttes de coquillages, amoncelées par des
générations de ramassage de coquillages, le tout indiquant qu’il
s’agissait probablement d’un hameau côtier habité pendant
l’hiver.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Cameron |
Lieu historique national du Canada Station-de-Quarantaine-de-l'Île-Partridge
Saint John, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada Station de quarantaine de l'Île
Partridge comprend l’île Partridge, à l’entrée du port de Saint John, à
environ 1 kilomètre du littoral de Saint-Jean Ouest au Nouveau
Brunswick.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada
Station-de-Quarantaine-de-l'Île-Partridge tient à son rôle historique de
poste de quarantaine au XIXe siècle, comme l’indique le site, le cadre
et le paysage de l’île et les vestiges liés à la quarantaine qu’il
contient. L'île Partridge était un des deux principaux postes de
quarantaine canadiens du XIXe siècle. Dans la station, créée en 1830
pour protéger les Canadiens des maladies contagieuses apportées par les
bateaux qui arrivaient, on soignait les immigrants et les membres
d’équipage malades. On y trouvait aussi des installations de
purification pour les passagers sains à bord. Cette station a servi
pendant une première période d’immigration canadienne particulièrement
active. En 1847, 2 000 immigrants irlandais fuyant la Grande famine y
ont été placés en quarantaine pendant l’épidémie de typhus : 601 d’entre
eux sont décédés et ont été inhumés dans une fosse commune sur l’île.
Les passagers mis en quarantaine sur cette île se sont finalement
installés au Nouveau-Brunswick, dans le Haut-Canada et aux États-Unis.
L'île Partridge a servi de poste de quarantaine jusqu’en 1941. Pendant
les deux Guerres mondiales, elle a été occupée pour la défense militaire
de Saint John, et elle a aussi servi de station de phare. Tous les
édifices de l’île ont été démolis en 1955 et en 1998-1999. Présentement,
le site contient des vestiges d’édifices et de structures associés au
rôle important qu’a joué le poste de quarantaine au XIXe siècle et des
vestiges de la résidence du médecin (construite aux environs de 1872),
des hôpitaux voyageurs de 2e classe, des officiers de marine, et de
lutte antivariolique (1899-1901), une jetée basse, un cimetière avec des
tombes remontant à l’épidémie de typhus de 1847.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2008 |
Lieu historique national du Canada du Temple-Libre
Moncton, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada du Temple-Libre est un élégant
édifice à ossature de bois dont la conception extérieure, et notamment
sa façade symétrique et ses ornements classiques, reflète l'influence
classique britannique. Sa conception intérieure, avec son espace ouvert
et ses bancs en caisson, est caractéristique des temples historiques. Ce
temple, situé au centre-ville de Moncton, est maintenant un site
historique accessible au public.
La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à ses liens historiques avec
la tolérance religieuse dans les provinces Maritimes tels qu'illustrés
par l'emplacement et la conception du bâtiment. Construit initialement
par les membres de la communauté à titre de simple lieu de rencontre, il
a été désigné lieu de culte en 1821. Étant donné qu'il s'agissait du
seul lieu de culte local, il était conçu pour accueillir toutes les
confessions, si bien que de nombreuses congrégations religieuses
(protestante, catholique romaine, juive) l'ont utilisé jusqu'en 1963. Le
bâtiment a été modifié au fil des ans pour répondre à l'évolution des
mœurs et des goûts. En 1990, on l'a restauré pratiquement à son état
d'origine, dans le cadre d'un projet commémorant le centenaire de
Moncton. Le Temple libre a repris son rôle historique de lieu d'accueil
des services spéciaux pour divers groupes religieux de la
communauté.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, HRS 0543, 1993 |
Lieu historique national du Canada du Théâtre Impérial / Bi-Capitol
Saint John, Nouveau-Brunswick
Le Lieu historique national du Canada du Théâtre Imperial / Bi-Capitol
est un théâtre du début du XXe siècle en face de la place King's Square
à Saint John.
La valeur patrimoniale du Théâtre Imperial / Bi-Capitol a trait à ses
caractéristiques physiques qui attestent de son rôle de théâtre conçu
pour des représentations théâtrales. Le Théâtre Imperial, construit de
1912 à 1923 par la chaîne de vaudeville new-yorkaise Keith-Albee et par
sa filiale la Saint John Amusement Company (architecte A.E. Westover), a
ouvert ses portes en 1913 à titre de combinaison de théâtre et de
cinéma. Rebaptisé Théâtre du Capitole, il a servi principalement de
cinéma de 1929 à 1957, tout en offrant de temps en temps des
représentations théâtrales. Au milieu des années 1980, il a été restauré
à titre de théâtre et rebaptisé Théâtre Bi-Capitol.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada de la Tour-Martello-de-Carleton
Saint John, Nouveau-Brunswick
Fortification construite pour défendre Saint John pendant la guerre de
1812.
La tour martello de Carleton date de la Guerre de 1812 et a joué un rôle
primordial dans l'endiguement des conflits jusqu'à la Deuxième Guerre
mondiale. Les visiteurs peuvent voir une poudrière et des baraquements
restaurés, ainsi que des expositions dans la tour et dans la centre
d'acceuil. La tour offre également une vue spectaculaire sur Saint John
et son port.
Le lieu historique national du Canada de la Tour-Martello-de-Carleton
consiste en une tour de défense circulaire en pierre érigée sur un
terrain ouvert abrupte et rocheux. Elle est située sur les hauteurs de
Carleton, du côté du port opposé au centre-ville de Saint-Jean
(Nouveau-Brunswick).
La valeur patrimoniale de la tour martello de Carleton réside dans
l’origine de sa construction. Le gouvernement britannique l’a érigé
entre 1812-1815 pour protéger Saint-Jean contre une attaque américaine
terrestre, venant de l’Ouest, lors de la guerre de 1812. La tour a servi
pendant une courte période à des fins militaires au cours de la Première
Guerre mondiale.
La valeur patrimoniale de la tour martello de Carleton repose également
sur son intérêt architectural. L’ouvrage initial est représentatif du
type de fortifications côtières utilisées par les Britanniques entre
autres dans les îles britanniques durant les guerres napoléoniennes, à
la fin du 18e siècle au début du 19e siècle. En effet, la tour
circulaire est constituée de murs rampants en pierre, épais à la base,
et s’amincissant graduellement jusqu’au plafond. En 1941, la tour a été
coiffée d’un ajout de deux étages et a abrité les installations de
défense du port de Saint-Jean jusqu’en 1948.
La valeur patrimoniale de la tour martello de Carleton repose aussi dans
sa position stratégique. Située sur les hauteurs de Carleton, à environ
68,5 mètres du niveau de la mer, la tour a été érigée sur la ligne de
partage des eaux dans Saint John Ouest. Cette position offre des vues
sur toute la périphérie, du côté de la terre et de la mer.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2001 |
Lieu historique national du Canada Tumulus-Augustine
Metepenagiag Mi'kmaq Nation, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada (LNHC) Tumulus-Augustine est un
site archéologique situé en face de la réserve de la nation Mi'kmaq
Metepenagiag, au Nouveau-Brunswick, sur la rive nord de la Petite
rivière Miramichi Sud-Ouest. Il comprend un cercle rituel entourant un
tertre funéraire légèrement surélevé, situé sur une basse terrasse près
de l’intersection de la Petite rivière Miramichi Nord-Ouest et de la
Petite rivière Miramichi Sud-Ouest. Le LHNC Tumulus-Augustine est situé
à 700 m à l'est du LNHC Oxbow.
La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada
Tumulus-Augustine a trait à ses liens de longue date avec un phénomène
religieux plutôt rare constaté particulièrement dans l'Est du Canada,
ainsi qu'avec la vie spirituelle, communautaire et culturelle des
Mi'kmaq. Ces liens sont attestés par la disposition, la forme et la
composition du site, ainsi que par la nature des vestiges archéologiques
qu’il contient, et par le rôle qu’il joue depuis très longtemps à titre
de site sacré.
Le lieu historique national du Canada Tumulus-Augustine est un tertre
funéraire, érigé il y a environ 2 500 ans, attestant la culture Adena
qui, issue de la vallée de l’Ohio, s’est répandue dans l’Est de
l’Amérique du Nord. Ce site se compose d'une zone circulaire d'environ
30 m de diamètre ayant en son centre un tertre peu élevé et entouré
d'une zone de cérémonie. Il contient des vestiges humains, ainsi que des
artefacts archéologiques. De plus, on y trouve deux axes
perpendiculaires ou bermes, formant une croix. Ces bermes, orientées
vers les points cardinaux, mesurent environ 1 m de large sur 10 à 11 m
de long, et s'élèvent à une hauteur de 0,5 m du niveau du sol jusqu'au
centre. En 1975-76, les premières fouilles effectuées sur le tumulus
révèlent que sa partie centrale a été perturbée peu avant le début des
travaux archéologiques. Aujourd’hui, seulement une partie du tumulus est
demeurée intacte. Le site revêt encore une importance spirituelle et
rituelle pour les Mi’kmaq.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2008 |
Lieu historique national du Canada Village-de-Mehtawtik (Médoctec)
Meductic, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada Village-de-Mehtawtik (Médoctec)
est situé près du confluent des rivières Eel et Saint-Jean, au Nouveau
Brunswick. Le lieu dantant d’avant le 17e siecle, et qui à l’origine
était situé sur un plateau à l’ouest de la rivière Saint-Jean, mais la
construction du barrage hydroélectrique de Mactaquac en 1968 a inondé la
majeure partie de la vallée de la rivière Saint Jean et par ce fait même
le territoire entier de Médoctec. L’emplacement du lieu est marqué par
un cairn et une plaque de la Commission des lieux et monuments
historiques du Canada érigés à proximité, sur le chemin Fort
Meductic.
Le village fortifié de Médoctec est établi par la Première nation des
Malécites sur un plateau près de la rive de la rivière Saint Jean, à
l’ouest de la rivière Eel. Les basses terres autour du plateau se
remplissent d’eau chaque printemps, ce qui les rend propices à
l’agriculture. Jusqu’au 17e siècle, le peuple nomade des Malécites se
rend régulièrement à cet endroit pour y planter du maïs au printemps et
faire la moisson par la suite. Dans leur combat pour s’approprier ce
précieux territoire, les colons français de la région s’allient avec les
Iroquois, les Malécites et les Penobscots, tandis que les Anglais
s’associent aux Mohawks. Pour se défendre contre les Mohawks ainsi que
pour protéger leur position sur ce territoire stratégique, les Malécites
construisent un fort sur le plateau.
À la fin du 17e siècle, le village de Médoctec est une mission jésuite
annexée à une seigneurie française. La mission change le paysage de
Médoctec : en 1760, les Malécites abandonnent définitivement le village
pour se rendre dans d’autres communautés. Le territoire est utilisé
sporadiquement comme camp autochtone jusqu’en 1841. Peu après et jusqu’à
la fin du 19e siècle, l’endroit devient une terre agricole, propriété de
la famille Hay. En 1968, la construction du barrage de Mactaquac inonde
la majeure partie de la vallée de la rivière Saint Jean ainsi que le
territoire entier de Médoctec.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national du Canada Wolastoq
Saint John River, Nouveau-Brunswick
Le lieu historique national du Canada du Wolastoq (fleuve Saint-Jean)
désigne le paysage culturel traçant un arc de 700 kilomètres le long du
fleuve qui prend sa source au Québec et dans le nord du Maine et qui
débouche au port Saint John, dans la baie de Fundy. Situé principalement
dans la province du Nouveau-Brunswick, dans l’Est du Canada, le bassin
hydrographique du Wolastoq couvre l’ensemble du territoire traditionnel
de la Première Nation des Wolastoqiyiks. Le fleuve se compose de trois
tronçons: le tronçon supérieur, qui prend son cours au Québec et au
Maine, se verse dans le Nouveau-Brunswick par-delà Edmunston; le tronçon
central, au confluent des rivières Aroostook et Tobique, coule au
sud-est de Mactaquac; et le tronçon inférieur, qui afflue depuis
Mactaquac dans un estuaire de 140 kilomètres composé de lacs, de zones
humides et d’îles jusqu’au port de Saint John. Le bassin hydrographique
en entier a favorisé les Wolastoqiyiks, qui l'ont parcouru et se sont
nourri de la faune et de la flore de son milieu aquatique et de ses
environs.
La valeur patrimoniale du Wolastoq (fleuve Saint-Jean) réside dans le
paysage culturel qui borde le fleuve. Elle repose également sur le rôle
important que tient le fleuve dans la vie, la culture et la spiritualité
de la Première Nation wolastoqiyik. Le fleuve Wolastoq, ses lacs et ses
affluents sont liés aux Wolastoqiyiks par leurs récits oraux qui donnent
un sens à l’histoire du paysage telle qu’ils la connaissent. Le Wolastoq
ou « belle rivière » est le nom du fleuve Saint-Jean dans la langue des
Malécites. Les Wolastoqiyiks se désignent eux-mêmes comme le « peuple de
la belle rivière ». Ce territoire comporte de nombreux lieux
significatifs pour les Wolastoqiyiks sur les plans de l’établissement,
des communications, de l’exploitation des ressources et de la
spiritualité, mais c’est précisément le Wolastoq, ainsi que ses lacs et
affluents, qui relient ces lieux entre eux et qui unissent les
Wolastoqiyiks et en font une nation. Le territoire traditionnel des
Wolastoqiyiks, qui couvre l’ensemble du bassin hydrologique du Wolastoq,
comporte de nombreux lieux terrestres significatifs pour les
Wolastoqiyiks du point de vue de l’établissement, des communications, de
l’exploitation des ressources et de la spiritualité. Le grand nombre de
toponymes autochtones se trouvant dans le bassin hydrologique
établissent des liens entre le présent et le passé ainsi qu’avec les
récits des aînés sur les utilisations traditionnelles des lieux et les
vestiges archéologiques trouvés sur place.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada Fundy
Siège social: Alma, Nouveau-Brunswick
Sanctuaire de l'Atlantique, site des plus hautes marées au
monde.
Le parc national du Canada Fundy englobe quelques-unes des dernières
régions sauvages du sud du Nouveau-Brunswick. Les collines calédoniennes
boisées où dominent les résineux s'étendent jusqu'à la baie de Fundy,
grande productrice de brouillard. L'amplitude des marées dans la baie de
Fundy est la plus forte du monde. Regardez les bateaux de pêche aller et
venir au rythme des marées. À l'intérieur des terres, explorez les
forêts luxuriantes et les profondes vallées fluviales.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national du Canada Kouchibouguac
Siège social: Kouchibouguac National Park, Nouveau-Brunswick
Mélange d'habitats côtiers et de l'intérieur des terres en Acadie.
Étant représentatif de la région naturelle de la plaine des Maritimes,
Kouchibouguac offre une fascinante mosaïque de tourbières, de marais
salés, d'estuaires, de systèmes d'eau douce, de lagunes abritées,
d'anciens champs et de forêts aux arbres majestueux.
|
|