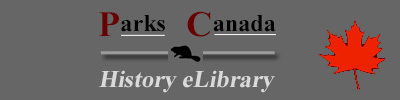|
Sites Canadiens du Patrimoine Mondial
Les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO se trouvent partout dans
le monde; parmi ceux-ci figurent les Pyramides d'Égypte, la
Grande Barrière de corail de l'Australie et la Grande Muraille de
Chine. Le Canada compte 18 sites du patrimoine mondial et six autres
sites figurent sur la Liste indicative canadienne pour le patrimoine
mondial. ParcsCanada est responsable de la mise en application de la
Convention du patrimoine mondial au Canada. L'Agence est
également chargée de la protection et de la conservation
de 12 des sites du patrimoine mondial au pays.
Plus d'informations sur les sites du patrimoine mondial se trouve dans le
suivant brochures.
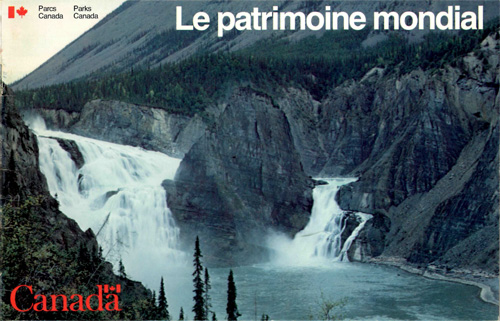
1983 |
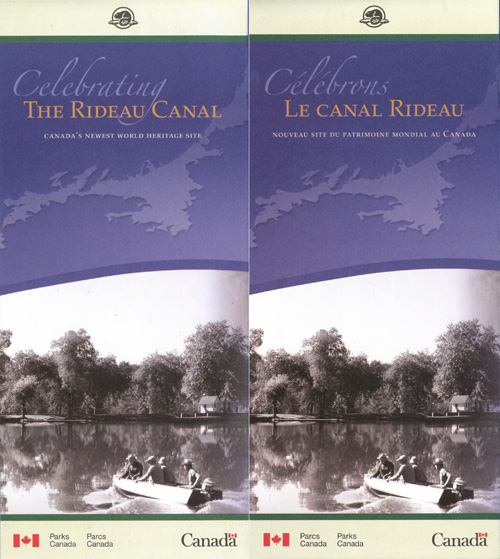
2005 |
Tous les textes et photos sont la propriété de Parcs
Canada et étaient extraite du Monde de Parcs Canada Le site web de sites du patrimoine, ou de plusieurs
Document d'information (daté 08-Aug-2016). Sites avec un fond
gris sont gérés par Parcs Canada.

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Arrondissement historique du Vieux-Québec
Québec
Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1985
Fondée au XVIIe siècle, Québec
témoigne d'étapes importantes de la colonisation des
Amériques par les Européens: elle fut notamment la
capitale de la Nouvelle-France et, après 1760, celle de la
nouvelle colonie britannique.
L'arrondissement historique du Vieux-Québec est formé
de deux secteurs: la Haute-Ville, protégée par une
citadelle fortifiée et des remparts, ainsi que plusieurs
bastions, portes et divers autres ouvrages défensifs, et la
Basse-Ville, développée autour de Place-Royale et des
installations portuaires. Ensemble urbain cohérent et bien
préservé, l'arrondissement historique est un exemple
remarquable de ville coloniale fortifiée, unique au nord du
Mexique.
Près de la moitié des édifices de l’arrondissement historique du
Vieux-Québec ont été construits avant 1850. Certains datent de l'époque
de la Nouvelle-France, et deux d'entre eux remontent presque au temps de
la fondation de la ville par Samuel de Champlain en 1608. Bien que la
ville soit devenue une métropole d'environ 600 000 habitants,
l'arrondissement historique, qui couvre 135 hectares ou près de 5 p.
cent de la ville, offre une continuité historique des plus remarquables
en Amérique du Nord. Ayant conservé presque toutes ses fortifications,
la vieille capitale mérite d'être qualifiée de seule ville fortifiée en
Amérique du Nord.
Champlain a construit sa première habitation aux abords du fleuve
Saint-Laurent, près du site de l’ancien village iroquois de Stadacona,
au pied du majestueux promontoire du Cap Diamant. Le peuplement s’est
d’abord effectué le long du fleuve, mais certains colons ont plus tard
suivi les institutions militaires et religieuses en haut du promontoire.
La rive, ou la basse-ville, est demeurée résidentielle et commerciale,
alors que la haute-ville est devenue le siège de l’administration et de
la religion.
Dans les années 1820, alors que Québec était le principal port de mer du
Canada, l’armée britannique a construit une imposante citadelle sur le
Cap Diamant et renforcé les fortifications autour de la haute-ville.
Cinquante ans plus tard, lord Dufferin, alors gouverneur général, posait
un des premiers gestes de conservation du patrimoine urbain, en
convainquant la ville de ne pas détruire les murs, rendus désuets du
point de vue stratégique. Il contribua ainsi à définir le caractère
historique - et maintenant touristique - du Vieux-Québec.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Canal Rideau
Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2007
Ce canal spectaculaire qui date du début du XIXe
siècle s'étend sur 202km, le long des rivières
Rideau et Cataraqui, depuis Ottawa jusqu'à Kingston. Ce canal
monumental a été construit à des fins militaires et
stratégiques à une époque où la
Grande-Bretagne et les États-Unis se disputaient le
contrôle de la région. Il s'agit du canal à plans
d'eau le mieux préservé d'Amérique du Nord et du
seul canal de ce continent datant du début du
XIXesiècle qui soit encore opérationnel sur
tout son tracé initial et dont les structures d'origine sont
toujours intactes.
Le canal Rideau est un véritable paradis pour les activités récréatives
et il attire des visiteurs de partout en Amérique du Nord et d'ailleurs,
qui viennent parcourir son tracé de 202 kilomètres et découvrir ses 24
écluses qui témoignent de merveilles d'ingénierie historique et de hauts
faits militaires. Composé de rivières et de lacs magnifiques reliés par
des canaux, le canal Rideau s'étend de Kingston à Ottawa, la capitale du
Canada, et il est le plus ancien canal à avoir été utilisé de façon
continue en Amérique du Nord.
Cette merveille de l’ingénierie et les fortifications construites à
Kingston pour la protéger illustrent ensemble une époque où la
Grande-Bretagne et les États-Unis se disputaient le contrôle de la
partie nord du continent américain. La construction du canal Rideau est
une conséquence de la guerre de 1812 avec les États-Unis. En cas de
conflit armé, le canal devait constituer une voie de transport
alternative qui permettrait aux troupes et aux approvisionnements
expédiés à partir de Montréal d’atteindre en sécurité le Haut-Canada et
l’important chantier naval de Kingston. Grâce à son génie créateur, le
lieutenant-colonel John By des British Royal Engineers a conçu et
construit un canal reliant les rivières Cataraqui et Rideau. Des
milliers d’immigrants irlandais et de Canadiens français comptaient
parmi tous ces travailleurs qui ont percé les bois, les marécages et le
relief sauvage et rocheux de l’Est de l’Ontario. Le canal a été terminé
en 1832; c’est l’un des ouvrages du génie les plus remarquables du XIXe
siècle. Aujourd’hui, le canal Rideau est le canal à plans d’eau
successifs le mieux conservé d’Amérique du Nord et le seul canal datant
de la grande époque de la construction des canaux au XIXe siècle qui est
encore utilisé aujourd’hui sur son tracé original, et dont la plupart
des structures d’époque sont intactes.
Après que la crainte d’une guerre se soit estompée, le canal Rideau
devint l’une des principales artères commerciales de la région.
Aujourd'hui, les trains de bois, les barges et les navires à vapeur ont
cédé la place aux embarcations de plaisance; les routes panoramiques,
les pistes cyclables et les sentiers de randonnées situés le long de la
voie navigable donnent maintenant un accès facile aux écluses par voie
terrestre.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Falaises fossilifères de Joggins
Nouvelle-Écosse
Inscrites sur la Liste du patrimoine mondial en 2008
Les falaises fossilifères de Joggins, situées dans la
baie de Fundy, en Nouvelle-Écosse, constituent l'assemblage de
fossiles de la période du Pennsylvanien (ou Carbonifère)
le plus important au monde. Leurs affleurements de roches
fossilifères, complets et accessibles, relatent l'histoire de
certains des premiers animaux sur Terre. Le site de Joggins nous permet
également de remonter jusqu'à l'origine des amniotes, les
premiers vertébrés capables de se reproduire en milieu
terrestre.
Il y a environ 300 millions d’années, l’actuelle rive est de la baie
Chignectou, au nord de la baie de Fundy, était une forêt tropicale
humide située près de l’équateur. Connues sous le nom de « Galápagos de
l’âge du charbon », les falaises fossilifères de Joggins offrent un
exemple remarquable de l’évolution de la vie sur Terre durant la période
pennsylvanienne (l’« âge du charbon »).
Les falaises fossilifères de Joggins constituent les archives les plus
complètes au monde de la vie terrestre durant la période pennsylvanienne
de l’histoire de la Terre, appelée « âge du charbon ». Le site renferme
les plus importants vestiges au monde des deux éléments caractéristiques
de l’« âge du charbon » : les tétrapodes terrestres, notamment les
premiers reptiles et les premiers amniotes, et les « forêts humides
carbonifères » qui leur servaient d’habitat. L’apparition des amniotes,
les premiers vertébrés à acquérir la capacité de se reproduire hors de
l’eau, a été l’un des évènements les plus marquants de l’histoire de la
vie sur Terre. Ce sont les traces de cette étape cruciale de l’évolution
qui ont été préservées dans les fossiles de Joggins. Ces falaises, qui
sont constamment rongées par les plus hautes marées du monde, et les
fossiles d’environ 200 espèces d’animaux et de plantes trouvés sur le
site constituent depuis longtemps des témoins essentiels nous permettant
d’approfondir notre compréhension de l’évolution de la vie et de
l’histoire de la Terre.
De riches gisements de charbon attirent les mineurs à Joggins depuis le
XVIIe siècle. Par ailleurs, des géologues étudient le site depuis plus
de 150 ans, et les découvertes qu’ils y ont faites ont contribué à
façonner notre compréhension de l’évolution et de la géologie. En effet,
sir Charles Lyell, considéré comme le père de la géologie moderne, a
exploré les falaises de Joggins en 1842 et en 1852 en compagnie de sir
William Dawson, né en Nouvelle-Écosse et devenu plus tard le recteur de
l’Université McGill. Grâce à eux, le site de Joggins est mentionné dans
l’ouvrage De l’origine des espèces de Darwin. Abraham Gesner, également
né en Nouvelle-Écosse et inventeur de l’huile de charbon (ou kérosène),
et sir William Logan, fondateur de la Commission géologique du Canada,
ont aussi étudié les falaises de Joggins.
De nos jours, le Joggins Fossil Centre est situé sur le site de
l’ancienne mine numéro sept de Joggins. Il présente la plus remarquable
collection de spécimens carbonifères fossilisés du monde et explique
l’incidence qu’ils ont eu sur notre conception de l’histoire de la Terre
et de l’évolution. Les falaises de Joggins sont accessibles au public,
et des visites guidées du site sont également offertes.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Le Paysage de Grand-Pré
Nouvelle-Écosse
Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2012
Le Paysage de Grand-Pré est un paysage agricole vivant, sur la
baie de Fundy, où se trouvent les plus grandes marées au
monde. Le paysage culturel de l'endroit témoigne de l'utilisation
de techniques traditionnelles comme des digues et des aboiteaux, pour
l'aménagement des terres agricoles, ainsi que d'un système
de gestion communautaire durable établi par les Acadiens et
utilisé par la suite par les planteurs et leurs successeurs
aujourd'hui. Cette région est habitée depuis des
millénaires par les Mi'kmaq et possède une valeur
symbolique pour les Acadiens puisqu'elle représente leur histoire
au XVIIe et au XVIIIesiècles, de même
que leur déportation. Le lieu historique national de
Grand-Pré, qui appartient à l'Agence Parcs Canada et qui
est géré par cette dernière, représente un
peu moins de 2% de la superficie du site du patrimoine mondial du
paysage de Grand-Pré. Il s'agit d'un établissement acadien
important de 1682 à 1755 et aujourd'hui l'on y raconte l'histoire
de la déportation et des réalisations des Acadiens, et les
membres de cette communauté y sont toujours profondément
attachés.
Le paysage de Grand-Pré raconte l’histoire remarquable de l’interaction
des humains avec leur environnement et donne une idée à quel point le
lien entre un endroit et ses habitants peut définir l’identité
collective.
Situé au bord du bassin Minas, bras sud de la baie de Fundy, en
Nouvelle-Écosse, le rivage de Grand-Pré est soumis aux marées les plus
extrêmes de la planète. En effet, leur amplitude atteint en moyenne 11,6
mètres. C’est dans ces conditions qu’il y a trois siècles, des colons
français (acadiens) entreprennent de transformer un environnement côtier
hostile de marais salants en terres fertiles. Les terres agricoles
qu’ils arrachent à la mer sont considérées comme un exemple exceptionnel
de l’adaptation des colons européens aux conditions prévalant sur la
côte est de l’Amérique du Nord.
À compter de la fin du XVIIe siècle, avant l’invention des ouvrages de
drainage modernes, les colons acadiens mettent au point un réseau
novateur et ingénieux de digues en terre, de fossés et d’aboiteaux
(vannes en bois) pour retenir les puissantes marées. Ils lancent aussi
une tradition de gestion collectiviste axée sur la communauté.
Aujourd’hui, le réseau de drainage susmentionné protège toujours le
domaine agricole, où les champs exhibent encore leurs formes
caractéristiques d’antan et où les principes de gestion collectiviste
sont toujours en vigueur. L’un des mieux préservés au monde, le polder
agricole de Grand-Pré témoigne du labeur des premiers colons acadiens,
puis des planteurs de la Nouvelle-Angleterre et des agriculteurs
d’aujourd’hui, qui ont successivement développé et entretenu ce réseau.
Important établissement acadien de 1682 à 1755, Grand-Pré est non
seulement directement associé à l’émergence de l’identité nouvelle de
ces colons français en terre d’Amérique, mais aussi à leur tragique
déportation forcée, connue sous le nom de Grand Dérangement, qui a
commencé en 1755. Considéré comme le plus important lieu de mémoire des
Acadiens, Grand Pré est un exemple évocateur d’une patrie reconquise
symboliquement et pacifiquement par une diaspora qui a affronté mille et
une épreuves. À cet endroit, les Acadiens célèbrent leur patrimoine
commun et réaffirment leur identité collective. Ils sont fiers de faire
découvrir Grand Pré au reste du monde en tant que symbole de
persévérance et d’espoir.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Le précipice à bisons Head-Smashed-In
Alberta
Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1981
La valeur du paysage du précipice à bisons
Head-Smashed-In réside dans l'intérêt qu'il suscite
sur les plans scientifique, archéologique et culturel. Pendant
des millénaires, les Blackfoot, grâce à leur grande
connaissance du comportement des bisons, pourchassaient les troupeaux
pour les faire tomber d'un précipice. Les carcasses
étaient ensuite débitées dans un campement en
contrebas. Les vestiges de pistes balisées et les restes d'un
campement autochtone s'y trouvent toujours. Les imposants tumulus
composés d'épaisses couches de squelettes de bisons qui se
trouvent au pied de la falaise illustrent un usage pratiqué
pendant près de six millénaires par les peuples
autochtones des grandes plaines du Nord. Ce site offre des
renseignements précieux sur le mode de vie et les pratiques des
groupes culturels traditionnels ayant vécu de la chasse dans le
monde.
Le bison a assuré la survie des Autochtones des grandes plaines
d'Amérique du Nord durant des millénaires. Sa viande servait de
nourriture, sa peau était utilisée pour des vêtements et des abris, ses
nerfs, ses os et ses cornes pour des outils, et son crottin alimentait
le feu. Le précipice à bisons représentait le moyen le plus efficace
d'abattre un grand nombre de ces bêtes. Les Autochtones les dirigeaient
vers le précipice et, en bas, les dépeçaient. Les précipices à bison
étaient communs dans les plaines septentrionales d'Amérique du Nord,
mais Head-Smashed-In (ou estipah-skikikini-kots en pied-noir) dans les
collines de Porcupine dans le sud-ouest de l'Alberta est le plus
imposant, le plus vieux et le mieux préservé.
On ne peut compter les milliers de bisons qui ont subi cette chute de 10
à 18 mètres, depuis 5 700 ans peut-être et jusqu'au milieu du 19e
siècle. Au pied de la falaise, des ossements sont enfouis jusqu'à 11
mètres sous terre. Un site de dépeçage d'un kilomètre de long se trouve
tout près, marqué de traces d'entrepôts de viande et de lieux de cuisson
et recouvrant jusqu'à un mètre d'os de bisons abattus. Les terres au
sommet de la falaise offraient — comme aujourd'hui — une grande surface
de pâturage de première qualité. Un système composé de plus de 500
monticules de pierres, près desquels on allumait des feux ou agitait des
couvertures, débute à 10 kilomètres à l'ouest des falaises. Il servait à
canaliser les bisons vers le précipice.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Le Vieux-Lunenburg
Nouvelle-Écosse
Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1995
Le Vieux-Lunenburg est le meilleur exemple qui subsiste d'un
établissement colonial britannique planifié en
Amérique du Nord. La ville fut fondée en 1753; sa
structure d'origine, obéissant à un plan en damier
conçu en métropole, ainsi que son aspect
général demeurent intacts. Les habitants ont
préservé l'identité de la ville au cours des
siècles en sauvegardant l'architecture de bois des maisons et des
édifices publics, dont certains datent du
XVIIIesiècle. L'âme de la ville se
reflète dans cette architecture de bois et ces techniques de
construction traditionnelles qui évoquent les racines
européennes et le patrimoine naval de ses habitants.
Dans la vieille partie de Lunenburg, toutes les rues sont droites et les
coins, carrés. Il s'agit du meilleur exemple encore existant d'une
politique de l'ancien empire britannique selon laquelle un plan de ville
modèle était imposé sur les espaces vierges où le roi voulait bien
installer des colons. Au moins 21 villes nord-américaines ont été ainsi
bâties, dont Cornwall et Niagara-on-the-Lake en Ontario, Savannah en
Géorgie et Philadelphie en Pennsylvanie. De toutes ces villes, c'est
Lunenburg, sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse, qui a le mieux
survécu.
Les Anglais ont créé Lunenburg en juin 1753 pour abriter 1 453 colons,
principalement des protestants germanophones d’Allemagne, de la Suisse
et de la région de Montbéliard en France. Selon les conventions de
l’époque, cette ville a été formée de sept rues alignées du nord au sud
de 48 pieds de large (sauf la rue King qui fait 80 pieds), croisées à
angle droit par neuf rues alignées d’est en ouest de 40 pieds de large.
Chaque bloc a été subdivisé en 14 lots de 40 pieds sur 60 pieds,
subséquemment distribués à chaque famille. Le Board of Trade and
Plantations de Londres créait ces plans modèles sans égard à la
topographie locale, ce qui explique pourquoi les rues de Lunenburg sont
si droites mais parfois d’une inclinaison à donner le vertige.
Des quelque 400 édifices principaux du Vieux-Lunenburg, 70 p. cent
datent des 18e et 19e siècles, presque tous sont en bois et bon nombre
sont vivement colorés.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national de Áísínai'pi
Parc provincial Writing-On-Stone
Alberta
Liste indicative des sites du patrimoine mondial
Au sein du territoire traditionnel des Niitsítapi (Pieds-Noirs : Kainai,
Piikáni et Siksika), Áísínai'pi (« c'est dessiné/écrit ») est un lieu
sacré où les formations géologiques abritent des esprits, dont les «
écrits » se reflètent dans plus d'une cinquantaine de sites d'art
rupestre. Le parc provincial Writing-On-Stone (Áísínai'pi), dont les
1718 hectares s'étendent dans la vallée de la rivière Milk, est une
enclave spectaculaire dans le paysage de la prairie mixte qui couvre le
centre-sud de l'Alberta et s'étend jusqu'aux puissants monts
Kátoyissiksi (Sweetgrass Hills, Montana, États-Unis). Défini par les
anciennes falaises de grès érodées de la vallée, le site est caractérisé
par des vues saisissantes, des lueurs et des sons fantastiques, des
formations de «cheminées de fées», des coulées adjacentes, de même que
par des habitats des Prairies riches en espèces mammifères, aviaires et
végétales. Pendant 4000 ans au moins, des Autochtones se sont arrêtés en
ce lieu au cours de leurs migrations saisonnières. Les sites de
pétroglyphes et de pictogrammes que l'on aperçoit sur les parois de la
vallée comprennent plusieurs milliers de motifs répartis en des
centaines de scènes, surtout des motifs anthropomorphes, zoomorphes et
matériels. Les images illustrent des figures cérémonielles et rituelles,
les exploits de chasseurs et de guerriers, ainsi que des animaux divers.
De nouveaux motifs, créés après le contact avec les Européens au début
du XIIXe siècle, comprennent des fusils, des chevaux et des figures
humaines dynamiques, les instruments des contacts entre Autochtones et
Blancs et les changements culturels. Des lieux de sépulture, des lieux
de recherche de visions ainsi qu'un cercle d'influences, en bordure de
la vallée, marquent également la spiritualité des lieux. Les
connaissances traditionnelles décrivent les origines et l'histoire. Un
poste de la Gendarmerie royale du Canada a été reconstruit sur
l'emplacement du poste originel. L'identification, par les Niitsítapi,
des monts Kátoyissiksi (situés aux États-Unis) en tant qu'élément
intégrant du paysage culturel, de même que leur souhait de voir cet
endroit inclus dans une proposition d'inscription, nécessiteront une
étude plus approfondie.
Note: Ces critères ont été identifiés durant le
processus d’établissement d’une liste indicative. Les critères utilisés
peuvent changer au fur et à mesure de la nomination.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Lieu historique national de L'Anse aux Meadows
Terre-Neuve-et-Labrador
Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1978
Ce site archéologique à la pointe Nord de l'île
de Terre-Neuve contient les vestiges mis au jour d'un
établissement viking du XIe siècle
composé d'édifices en pans de bois et mottes de tourbe
(maisons, ateliers, etc.) qui sont identiques à ceux
trouvés au Groenland et en Islande à la même
époque. Le site est donc un témoignage unique en son genre
de la toute première présence européenne connue sur
le continent américain. Certains édifices ont
été reconstruits et des guides interprètes
racontent des récits du passé.
Les restes d'un site viking millénaire à L'Anse aux Meadows sont connus
comme le premier lieu habité par des Européens en Amérique du Nord. Les
Vikings y ont construit trois longues maisons en bois et en gazon et
cinq édifices plus petits, en plus d'y avoir travaillé le fer - une
première dans le Nouveau Monde.
Poussés hors-trajectoire par de grands vents vers 985, des marchands
islandais en route vers le Groenland ont été les premiers à décrire de
nouveaux territoires à l'ouest. Quinze ans plus tard, Leif Eriksson
passe un hiver à Straumfiord - aussi connu sous le nom Camp de Leif - ,
sur une terrasse gazonnée près de L'Anse aux Meadows. Au cours des
années qui suivent, des membres de sa famille et des colons visitent le
camp et voyagent possiblement aussi loin au sud qu'au Nouveau-Brunswick.
Des conflits avec les Autochtones de la région, toutefois, auraient
obligé les Scandinaves à retourner au Groenland en moins d'une décennie.
En 1960, les Norvégiens Helge Ingstad et Anne Stine Ingstad trouvent les
ruines de Straumfiord en se basant sur des sagas vikings tirées de
manuscrits médiévaux d'Islande. Lors de leurs excavations et des
fouilles subséquentes menées par Parcs Canada, on a trouvé les restes de
huit édifices ainsi que des centaines d'artefacts vikings faits surtout
de bois mais aussi de fer, de pierre, de bronze et d'os.
Des contacts sporadiques entre les Scandinaves et le Nouveau Monde ont
continué au moins jusqu'au milieu du 14e siècle, et les navigateurs
européens qui ont traversé l'océan Atlantique dans les années 1490 ont
probablement bénéficié de la découverte de ces terres.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Mistaken Point
Terre-Neuve-et-Labrador
Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2016
Mistaken Point est un site fossilifère de l'Édiacarien
situé à l'extrémité sud-est de la
presqu'île Avalon à Terre-Neuve. Les fossiles de Mistaken
Point datent de l'époque de l'Édiacarien moyen (il y a 580
à 560 millions d'années) et sont les premiers exemples
documentés de grands organismes à l'architecture complexe,
multicellulaire – c'est-à-dire quand " la vie grandit "
– un moment charnière de l'évolution de la vie sur
Terre.
Mistaken Point est un site fossilifère d’importance mondiale à
l’extrémité sud-est de l’île de Terre-Neuve. Le site du patrimoine
mondial se situe presque entièrement dans la réserve écologique de
Mistaken Point, où plus de 10 000 empreintes fossiles, de quelques
centimètres à près de deux mètres de long, sont facilement accessibles
aux chercheurs scientifiques ainsi qu’aux visiteurs, qui peuvent les
admirer sous supervision, dans le panorama de la côte accidentée de
l’Atlantique.
Les fossiles à Mistaken Point illustrent un moment crucial de l’histoire
de la vie : l’apparition de grands organismes biologiquement complexes,
y compris les premiers animaux ancestraux. Ces créatures à corps mou
vivaient à l’époque de l’Édiacarien moyen (il y a 580 à 560 millions
d’années), dans le fond des eaux profondes d’un ancien océan où elles
ont été enfouies et préservées de façon exceptionnelle par des apports
de cendres volcaniques. Les animaux sont morts là où ils ont vécus, et,
après avoir été ensevelis durant des centaines de millions d’années,
l’érosion les a progressivement exposés, découvrant plus de 100 surfaces
fossilifères du fond marin, allant de petits gisements d’un seul fossile
à des surfaces de la taille d’un terrain de tennis pouvant porter 4 500
mégafossiles.
Les fossiles préservés dans les moindres détails de Mistaken Point
forment l’assemblage le plus abondant et diversifié de grands fossiles
édiacariens des profondeurs marines connus dans le monde, et ils
fournissent une chronologie détaillée sur 20 millions d’années des
débuts de l’évolution des formes complexes de vie.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc international de la paix Waterton-Glacier
Alberta et Montana
Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1995
Le premier "parc international de la paix" au monde, composé
des parcs nationaux des Lacs-Waterton et des Glaciers, est situé
de part et d'autre de la frontière entre le Canada et les
États-Unis, où la montagne rencontre la prairie. Cette
région, qui revêt une valeur panoramique remarquable,
occupe une place centrale au sein du continent et protège une
flore unique et des paysages spectaculaires qui ne se retrouvent nulle
part ailleurs dans le monde.
En 1931, les clubs Rotary de l'Alberta et du Montana proposent une
première mondiale : unir le parc national des Lacs-Waterton en Alberta
et le Glacier National Park au Montana sous le nom de Parc international
de la paix Waterton-Glacier. Leur but n'était pas seulement de
promouvoir la paix et les bonnes relations entre les pays, mais aussi de
souligner le caractère international de la nature et la coopération
nécessaire à sa protection.
Il y a effectivement beaucoup de nature à protéger à l’intérieur des 526
kilomètres carrés du parc national des Lacs-Waterton et des 4 051
kilomètres carrés du Glacier National Park : des montagnes vertigineuses
et des canyons profonds, des ceintures forestières et des prairies
herbeuses vallonnées, de profonds lacs de vallée glaciaire et des
rivières qui se déversent dans trois océans. En fait, peu de régions
contiennent autant de diversité sur une surface si concentrée. Il ne
faut surtout pas oublier l’endroit où les plates prairies amorcent leur
ascension vers les sommets des Rocheuses.
Cet éventail d’écosystèmes abrite une faune extrêmement diversifiée :
des chèvres de montagne et des mouflons d’Amérique, des coyotes et des
grizzlis, d’innombrables oiseaux et un troupeau bien connu de wapitis
qui migrent annuellement entre leur habitat estival dans les montagnes
du parc Glacier et leur habitat hivernal dans les prairies du parc
Waterton.
La présence d’Autochtones dans la région remonte à 12 000 ans, et
plusieurs endroits dans le parc revêtent une valeur particulière pour
ces derniers. En fait, le Parc international de la paix regroupe
maintenant trois nations : le Canada, les États-Unis et la Confédération
des Pieds-Noirs.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national Gros-Morne
Terre-Neuve-et-Labrador
Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1987
La géologie du magnifique parc national du Gros-Morne,
situé sur la côte ouest de l'île de Terre-Neuve, est
un exemple rare du résultat de la dérive des continents.
Ici, la croûte océanique profonde et le manteau terrestre
sont exposés. Les rochers du parc national du Gros-Morne
présentent le cours intégral des événements
géologiques qui ont eu lieu lorsque l'ancienne marge continentale
de l'Amérique du Nord s'est trouvée modifiée
à la suite du mouvement des plaques tectoniques qui a
transféré une vaste portion de croûte
océanique et de dépôts sédimentaires
au-dessus du niveau de la mer. Le paysage spectaculaire du parc national
du Gros-Morne, composé de basses terres côtières, de
plateaux alpins, de fjords, de vallées glaciaires, de falaises
abruptes, de chutes et de plusieurs lacs à l'état naturel,
est un espace d'une très grande valeur panoramique.
Les paysages au Gros-Morne comptent parmi les plus spectaculaires dans
l'est du Canada : des crêtes de montagnes dentelées, d'immenses
falaises, des tourbières et de superbes lacs et bras de mer. Mais ce
sont principalement les caractéristiques géologiques du parc, et non sa
beauté exceptionnelle, qui lui ont valu le titre de site du patrimoine
mondial.
Ce parc national est considéré comme une illustration parfaite de la
tectonique des plaques, cette théorie qui affirme que des plaques de la
croûte terrestre, grosses comme des continents, se sont heurtées et
séparées tout au long de l’évolution géologique de la terre, ouvrant et
fermant des oc éans entre elles.
Bien que toujours jointes, l’Europe et l’Amérique du Nord étaient en
train de se séparer il y a 600 millions d’années. Du magma de la croûte
terrestre inférieure est alors monté à la surface pour combler le vide.
Il s’est solidifié et est maintenant visible dans les falaises du
Western Brook Pond (à gauche) au Gros-Morne. Il y a entre 570 et 420
millions d’années, un océan surnommé Japet se trouvait entre l’Europe et
l’Amérique du Nord. Les strates sédimentaires du parc ont préservé des
fossiles de presque chaque phylum connu de l’époque, créant un véritable
catalogue de l’évolution. Il y a 460 millions d’années, les deux
continents se rapprochaient, alimentant l’ascension des Appalaches et se
refermant sur l’océan Japet. Quelques blocs de croûte océanique et
mantélique ont alors été déplacés vers l’ouest et sont montés à la
surface de la terre. Bien plus tard, les glaciers ont remodelé la
région, créant des fjords et effectuant des coupes transversales dans
les montagnes qui ont révélé leur passé géologique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national Ivvavik
Parc national Vuntut
Parc territorial Herschel Island (Qikiqtaruk)
Yukon
Liste indicative des sites du patrimoine mondial
Le parc national du Canada Ivvavik, le parc national du Canada Vuntut et
le parc territorial Herschel Island (Qikiqtaruk) couvrent ensemble une
aire naturelle de 15 500 km² qui englobe la plaine côtière du Yukon, les
monts Richardson, une partie des terres marécageuses de la plaine Old
Crow ainsi qu'une île arctique située dans la mer de Beaufort. Ces trois
parcs forment conjointement une terre riche en faune, en paysages
diversifiés et en végétation. Cette région n'a pas été englacée, et fait
partie du corridor de la Béringie, comme en fait foi son riche
assemblage de dépôts archéologiques et paléontologiques. De grandes
rivières traversent la plaine côtière, creusant des canyons
spectaculaires en s'écoulant vers la mer de Beaufort. Une partie de la
région - la plaine Old Crow - est un site Ramsar reconnu à l'échelon
international pour son gibier d'eau nicheur et migrateur. Trois espèces
d'ours vivent dans certaines parties de la région, de pair avec une
série d'autres animaux sauvages, dont le mouflon de Dall et l'orignal.
La région abrite près de 10 % de la population mondiale de caribous, et
la harde de la Porcupine compte près de 123000 têtes. Une partie des
lieux de mise bas que fréquente le troupeau est située dans le parc
national du Canada Ivvavik. Il s'agit là de la terre des Inuvialuit et
des Vuntut Gwitchin, qui y chassent, y pêchent et y font du commerce
depuis des milliers d'années. L'histoire humaine riche et complexe du
paysage culturel s'exprime par des vestiges archéologiques et par
l'histoire orale. Cette région, importante pour le peuplement de
l'Amérique du Nord, illustre des occupations successives, qui s'étendent
sur des milliers d'années d'adaptation à des épisodes climatiques en
évolution. Lors de la préparation des documents de proposition
d'inscription, une attention particulière sera portée aux limites
proposées définitives, de façon à englober la totalité des parties quasi
protégées, comme le parc territorial Fishing Branch (Ni'iinlii'njik) (7
000 km²), qui est situé au Sud du parc national du Canada
Vuntut.
Note: Ces critères ont été identifiés durant le
processus d’établissement d’une liste indicative. Les critères utilisés
peuvent changer au fur et à mesure de la nomination.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national Kluane
Parc nationaux Wrangell-St. Elias (U.S.)
Parc nationaux Glacier Bay (U.S.)
Parc provincial Tatshenshini-Alsek
Yukon, Colombie-Britannique et Alaska
Inscrits pour la première fois sur la Liste du patrimoine mondial en 1979; ajouts en 1992 et 1994
Les parcs nationaux et provinciaux de Kluane/Wrangell-St.
Elias/Glacier Bay/Tatshenshini-Alsek situés de part et d'autre de
la frontière entre le Canada et les États-Unis
d'Amérique constituent le plus grand champ de glace à
l'extérieur des calottes polaires et offrent des exemples de
glaciers parmi les plus longs et les plus spectaculaires au monde.
Caractérisée par de hautes montagnes, des champs de
glace et des glaciers, la région offre une abondante
biodiversité de communautés végétales et
animales aussi bien dans le milieu marin que dans la forêt
côtière, la forêt montagnarde, la toundra alpine et
la forêt subalpine, le tout à des étapes
d'évolution diverses. Les vallées des rivières
Tatshenshini et Alsek constituent des voies sans glace reliant la
côte à l'intérieur des terres pour la migration de
la faune et de la flore. Les parcs offrent quelques-uns des meilleurs
exemples de glaciation et de modification du paysage par l'action
glaciaire dans une région encore active sur le plan tectonique,
d'une beauté saisissante, où prédominent les
processus naturels.
Quel empire de montagnes et de glace! On trouve, dans cette aire
protégée internationale, la plupart des montagnes les plus élevées
d'Amérique du Nord et les plus grands champs de glace à l'extérieur des
calottes polaires. La moitié du territoire est recouvert en permanence
de glace et de neige, et l'autre moitié abrite forêts et toundra et
populations stables d'aigles, de grizzlis et d'autres espèces souvent
menacées ailleurs.
La portion canadienne de cet ensemble écologique de 97 000 kilomètres
carrés, intacte sauf pour la présence historique d’Autochtones, comprend
le parc national et réserve Kluane, au Yukon et le parc
Tatshenshini-Alsek, en Colombie-Britannique (cogérés avec les Premières
nations Champagne et Aishihik). Le Wrangell–St. Elias National Park et
le Glacier Bay National Park, en Alaska s’y ajoutent pour former ce qui
fut la première inscription binationale sur la Liste du patrimoine
mondial.
Les monts St. Elias couvrent la majeure partie de cette aire protégée
qui regroupe la plus importante concentration de sommets élevés sur le
continent, y inclus le mont Logan (5 959 mètres), le plus élevé au
Canada. L’air humide, en provenance de l’océan Pacifique, provoque
d’impressionnantes précipitations, créant un champ de glace massif ainsi
que des centaines de glaciers, dont certains sont parmi les plus gros et
les plus mobiles au monde. Le fleuve Yukon et trois douzaines de
rivières importantes drainent la région, transportant d’imposantes
cargaisons de limon et de roches et remodelant constamment le paysage.
La végétation, qui englobe de la toundra alpine et des forêts de
littoraux et de vallées, soutient, entre autres espèces, la plus
importante concentration de mouflons de Dall (ci-dessous) au
monde.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national de Miguasha
Québec
Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1999
Situé au sud-est de la péninsule gaspésienne, au
Québec, le parc national de Miguasha est un site
paléontologique remarquable, considéré comme la
meilleure illustration de la période du Dévonien ou
"âge des poissons". Datant de 370 millions d'années, la
falaise de Miguasha renferme cinq des six groupes de poissons fossiles
associés à cette période. L'importance du site
tient au fait qu'on y trouve la plus grande concentration de
spécimens fossiles de poissons à nageoires charnues
desquels sont issus les premiers vertébrés terrestres
respirant de l'air. La faune et la flore fossiles de Miguasha sont
reconnues pour leur état exceptionnel de conservation depuis plus
d'un siècle. De nombreux scientifiques et collectionneurs
américains et européens ont visité ce site.
Il y a 370 millions d'années, dans la région de Miguasha, située dans la
péninsule gaspésienne, coulait un estuaire sous un climat équatorial et,
au loin, se dressaient les cimes d'une jeune chaîne de montagnes appelée
Appalaches. En bordure de cet estuaire, poussait une forêt d'arbres
primitifs où vivaient scorpions et araignées. Au gré des courants et des
marées, une faune diversifiée de poissons vivait dans les eaux tièdes de
cet estuaire. Certains poissons étaient dotés d'épines rigides, d'autres
étaient protégés par une carapace ossifiée. D'autres avaient des poumons
et des nageoires paires lobées leur permettant de franchir de courtes
distances hors de l'eau. L'acquisition de ces nageoires représente une
des plus importantes étapes de l'évolution, soit celle de la transition
entre les poissons et les tétrapodes.
Cet épisode marquant dans l’évolution des vertébrés est connu
aujourd’hui grâce à une séquence géologique de deux millions d’années,
appelée Formation d’Escuminac et conservée dans une falaise située à
Miguasha, en bordure de la côte méridionale de la Gaspésie, à
l’embouchure de la baie des Chaleurs. Il existe, à l’échelle de la
planète, quelque 60 sites fossilifères de la période dévonienne.
Miguasha se distingue cependant par l’abondance des spécimens, la
qualité de conservation des fossiles et la représentativité des
événements évolutifs chez les vertébrés. C’est le seul site dévonien
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.
La grande biodiversité de vertébrés, d’invertébrés, de plantes, d’algues
et de micro-organismes de Miguasha a permis aux scientifiques de
reconstituer un tableau quasi complet de cet écosystème dévonien. Mais
ce sont les 21 espèces de poissons fossiles qui ont assuré à Miguasha sa
renommée mondiale. L’Eusthenopteron foordi, surnommé le « prince de
Miguasha », (ci-dessous) était pourvu de poumons et de structures
osseuses dans les nageoires paires; il a ainsi engendré l’idée
contemporaine que les vert ébrés terrestres sont issus des poissons.
Le site fossilifère de Miguasha a été découvert en 1842. À compter de
1880, des milliers de spécimens de fossiles ont été récoltés et emportés
vers des musées et des universités partout dans le monde confirmant
ainsi sa notoriété scientifique.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national Quttinirpaaq
Nunavut
Liste indicative des sites du patrimoine mondial
Encompassing the northernmost lands in Canada, only 720 km from the
North Pole, Quttinirpaaq National Park of Canada (37 775 km²) covers the
northern portion of Ellesmere Island. The park consists of sedimentary
mountains, ice caps, glaciers, ice shelves and fiords. The park borders
on the Arctic Ocean and rises to Mount Barbeau (a nunatak), at 2 616 m
the highest mountain in eastern North America. Much of the park,
including the Hazen Plateau, is a polar desert receiving less than 2.5
cm of annual precipitation. Some areas of highly productive sedge
grasslands occur, which support a range of Arctic wildlife including
muskox, arctic hare, wolves and the endangered Peary caribou. Lake Hazen
is one of the largest freshwater lakes in the circumpolar region, and
has attracted great scientific interest as a thermal oasis in a polar
desert. Unique physical features are the ancient deposits of 80 m-thick
freshwater ice shelves that extend several kilometres out over the
Arctic Ocean. The major valleys of the park are central to one of the
routes by which early Aboriginal peoples moved from the Canadian Arctic
to Greenland. The route contains three major axes of contact during the
early Palaeo-Eskimo period (4500-3000 years ago). All pre-contact
cultural groups known to have occupied High Arctic Canada, including
Independence I (4500-3000 years ago) and Independence II (ca. 3000-2500
years ago), Late Dorset (ca. 1300-800 years ago) and Thule (ca. 900-300
years ago), are represented by archaeological sites in the park. The
park has one of the highest concentrations of pre-contact sites surveyed
in the High Arctic, including sites associated with the earliest
documented human inhabitants of this remote region.
Note: Ces critères ont été identifiés durant le
processus d’établissement d’une liste indicative. Les critères utilisés
peuvent changer au fur et à mesure de la nomination.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc national Wood Buffalo
Alberta et Territoires du Nord-Ouest
Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1983
Le parc national Wood Buffalo est un exemple exceptionnel de
phénomènes écologiques et biologiques permanents
qui comprend certaines des plus vastes et des dernières prairies
d'herbe et de laîche vierges en Amérique du Nord. Les
vastes étendues de forêt boréale du parc constituent
un habitat vital pour de grandes concentrations d'animaux migrateurs
sauvages qui ont une importance mondiale. L'évolution continue
d'un vaste delta intérieur d'eau douce, des plaines salées
et de karsts gypseux a également une valeur sur le plan
international. Le parc national Wood Buffalo est l'habitat de la plus
grosse harde de bisons des bois au monde où le rapport
prédateur-proie entre le loup et le bison s'est maintenu, sans
s'interrompre, au fil du temps.
Wood Buffalo est le plus grand parc national au Canada et l'incarnation
même des grands espaces sauvages qui symbolisent le nord canadien. Ses
44 807 kilomètres carrés comprennent de vastes forêts boréales, des
plaines et certaines des plus grandes et des dernières prairies d'herbe
et de laîche vierges en Amérique du Nord. Et ces prairies abritent le
plus important troupeau de bisons en liberté au monde.
De grandes rivières enjolivent le parc, notamment la puissante rivière
de la Paix et les rivières Slave et Athabasca qui en forment la
frontière à l’est. La rencontre du lac Athabasca et des rivières de la
Paix et Athabasca forme le plus important delta intérieur d’eau douce au
monde. Les innombrables rivières et marécages du delta abritent une
multitude d’oiseaux aquatiques, dont des canards, des oies, des cygnes,
des huards et des grèbes.
Le parc a été créé en 1922, principalement pour sauver les bisons qui
avaient échappé au carnage de la fin du 19e siècle. De 60 millions, la
population de cette bête avait été réduite presque à néant. Les plaines
du parc se trouvent à l’extrémité nord du territoire traditionnel du
bison, et des milliers de bisons ont été transportés du sud pour
accroître la population indigène de bisons des bois. Le parc abrite
aussi la dernière volée au monde de grues blanches d’Amérique, une
espèce en danger de disparition.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parc provincial Dinosaur
Alberta
Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1979; ajouts en 1992
Le parc provincial Dinosaur, situé au cœur des bad-lands
de la province de l'Alberta, contient quelques-uns des plus importants
spécimens de fossiles de "l'âge des dinosaures" jamais
découverts. Ce parc est inégalé pour le nombre et
la variété de ses spécimens de haute qualité
qui datent de 75 à 77millions d'années.
Il y a 75 millions d'années, ce qui est maintenant l'est de l'Alberta,
était une plaine littorale de faible altitude aux abords d'une mer vaste
mais peu profonde. La température subtropicale ressemblait à celle du
nord de la Floride aujourd'hui. D'innombrables créatures fréquentaient
l'endroit : des poissons, des amphibiens, des tortues, des oiseaux, des
mammifères primitifs et environ 35 espèces de dinosaures. Certaines de
ces créatures sont mortes dans les lits des rivières et dans les
vasières, et leurs os ont été enfouis sous des couches de sable et de
boue. Le passage du temps, combiné à la pression, à l'absence d'oxygène
et au dépôt de minéraux, a produit des fossiles, soit des empreintes
d'os, de dents et de peaux de créatures qui fréquentaient autrefois la
région. La formation de couches de roches sur ces fossiles en a permis
la conservation.
Ce n’est qu’à la fin de la dernière période glaciaire il y a environ 13
000 ans — une fraction de seconde dans l’histoire géologique — que les
glaciers ont enlevé les couches supérieures de roches. D’importantes
quantités d’eau de fonte ont sculpté les couches fragiles de grès et de
mudstone, dénudant les sédiments fossilifères et, parallèlement, créant
la vallée de la rivière Red Deer. Les cheminées de fées, les mesas
isolées et les basses ravines de cette vallée, située au cœur des bad
lands de l’Alberta, contiennent la plus importante concentration de
fossiles de dinosaures de la période du crétacé supérieur jamais
découverte.
Les fouilles entreprises dans les années 1880 sur ce site de 27
kilomètres aux abords de la rivière Red Deer ont permis de prélever plus
de 300 squelettes en excellente condition. Des douzaines d’entre eux se
trouvent maintenant dans 30 musées à travers le monde. Depuis 1985, la
plus importante collection de trésors du parc se trouve au Royal Tyrrell
Museum of Palaeontology, à Drumheller, à deux heures de route au
nord-ouest du parc.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Parcs des montagnes Rocheuses canadiennes
Alberta et Colombie-Britannique
Inscrits pour la première fois sur la Liste du patrimoine mondial en 1984; ajouts en 1990
Reconnus pour la splendeur de leurs paysages, les parcs des montagnes
Rocheuses canadiennes comprennent les parcs nationaux Banff, Jasper,
Kootenay et Yoho et les parcs provinciaux du Mont Robson, du Mont
Assiniboine et Hamber, en Colombie-Britannique. On trouve dans
toute la zone des exemples typiques de processus géologiques
glaciaires – pics montagneux, champs de glace, vestiges de
glaciers de vallée, lacs, chutes, canyons et gouffres. Le site
cambrien de Burgess Shale et les sites précambriens aux alentours
sont reconnus mondialement pour leurs fossiles d'organismes marins
à corps mou.
Pour observer certains des panoramas de montagnes les plus connus sur la
terre, peu de sites peuvent rivaliser avec les sept parcs des montagnes
Rocheuses canadiennes. À travers le monde, la mention du Canada évoque
les sommets de montagnes couverts de neige et les hôtels (ou plutôt les
châteaux) des parcs Banff et Jasper. Plus de neuf millions de personnes
visitent chaque année ces parcs situés à la frontière de l'Alberta et de
la Colombie-Britannique.
La région compte quatre parcs nationaux (Banff, Jasper, Yoho et
Kootenay) qui comprennent la plus grande partie des 22 990 kilomètres
carrés du site patrimoine mondial. S’y ajoutent trois parcs provinciaux
de la Colombie-Britannique, soit ceux du mont Robson, du mont
Assiniboine et de Hamber. Banff a été construit autour des sources
thermales Cave et Basin, découvertes par les travailleurs du Canadien
Pacifique lors de la construction du chemin de fer transcontinental au
début des années 1880. En 1885, la région devient le premier parc au
Canada, annonçant la naissance du réseau des parcs nationaux.
Au cours du demi-siècle qui a suivi, le parc a été élargi afin
d’englober tout un trésor de merveilles naturelles : des sommets en
dents de scie et des pentes couvertes de conifères, des lacs et des
ruisseaux aux eaux turquoise glaciales chargées de limon, le vaste champ
de glace Columbia et l’inextricable labyrinthe des cavernes Castleguard.
Le schiste de Burgess, sis dans le parc Yoho, recèle l’un des plus
riches gisements fossilifères au monde d’animaux marins au corps mou,
datant du milieu de l’ère cambrienne et comptant quelque 150 espèces,
dont certaines ne présentent aucune ressemblance avec les animaux
connus.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Pimachiowin Aki
Manitoba et Ontario
Liste indicative des sites du patrimoine mondial
Anciennement connu sous le nom: Atikaki/Woodland Caribou/Premières
nations visées par l’Accord
Certaines Premières Nations du Manitoba et de l’Ontario, avec l’appui du
gouvernement des deux provinces, ont proposé la création d’un réseau
mondialement reconnu d’aires protégées et de paysages aménagés sur leurs
territoires ancestraux, et envisagent de demander la désignation de ce
réseau comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce projet, connu
sous le nom de Pimachiowin Aki, vise une région du bouclier boréal et
couvre 33 400 km2 de forêt englobant des terres ancestrales des
Premières Nations et des aires protégées contiguës situées de part et
d’autre de la frontière provinciale. La majorité de l’aire visée par le
projet est composée de territoires traditionnels des Premières Nations.
Les parcs touchés comprennent le parc provincial Atikaki au Manitoba
ainsi que le parc provincial Woodland Caribou et la réserve de
conservation Eagle – Snowshoe en Ontario. Ces parcs et ces terres
protégées, dont il faut préserver les valeurs naturelles et le caractère
sauvage, couvrent au total une superficie de plus de 8 500 km2. Les
territoires traditionnels des Premières nations et les terres de
désignation provinciale appartiennent tous à la forêt boréale
coniférienne continue recouvrant tout le nord du Canada.
La forêt est dominée par des peuplements d’épinette noire et de pin gris
et comporte une strate arbustive formée d’éricacées, de mousses et de
lichens. Au nombre des espèces forestières secondaires figurent le
tremble, le bouleau blanc, l’épinette blanche et le sapin baumier, de
même que certaines espèces issues des prairies et des régions de forêts
décidues de l’Est. Quatre cours d’eau importants, assortis de falaises,
de chutes et de rapides, traversent la région. L’un d’eux, la rivière
Bloodvein, a été reconnu et désigné en tant que rivière du patrimoine
canadien. On trouve aussi dans cette région des reliefs caractéristiques
du Bouclier, dont des stries glaciaires, des dépôts de till et des
vestiges du lac glaciaire Aggasiz. La région procure un habitat
essentiel à un segment de population d’une espèce menacée, le caribou
des bois, et protège aussi l’habitat de la lamproie brune, une espèce
dont la situation est jugée préoccupante. D’autres animaux sauvages
représentatifs de la région sont l’ours noir, le loup, le lynx et le
hibou, de même que la truite grise, le brochet et le doré jaune. Il
existe sur les lieux de nombreux sites archéologiques, ce qui démontre
que la région revêt depuis longtemps une importance spéciale pour les
Premières Nations. Le site est l’une des aires protégées de la région
circumpolaire qui ont été recommandées à l’issue de l’atelier sur les
forêts boréales tenu en Russie en octobre 2003 en vue d’une éventuelle
inscription sur la Liste du patrimoine mondial. L’aire visée par le
projet est considérée comme faisant partie de l’écorégion mi occidentale
du Bouclier canadien, laquelle fait elle-même partie de la province
biogéographique de la Taïga canadienne (classification
d’Udvardy).
Note: Ces critères ont été identifiés durant le
processus d’établissement d’une liste indicative. Les critères utilisés
peuvent changer au fur et à mesure de la nomination.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Réserve de parc national Gwaii Haanas
Colombie-Britannique
Liste indicative des sites du patrimoine mondial
La réserve de parc national et le site du patrimoine haïda Gwaii Haanas
couvrent environ 15 % des îles de la Reine-Charlotte, un archipel situé
à 80 kilomètres au large de la côte nord-ouest de la partie continentale
de la Colombie-Britannique et séparant le détroit d'Hecate de l'océan
Pacifique. La superficie du secteur terrestre, qui se compose de 138
îles, est de 1495 km2, et ce dernier est entouré d'une aire marine de
conservation (proposée) de 3400 km2. La réserve de parc englobe le Site
du patrimoine mondial SGaang Gwaii, une île de 3 km2 inscrite en 1981 en
fonction du critère culturel (iii). Deux autres villages haïdas anciens
d'une qualité remarquable - Tanu et Skedans - se trouvent dans cette
réserve de parc. En outre, dans ce dernier, plus de 600 vestiges
archéologiques témoignent de l'occupation et des activités des Haïdas
dans la région. Les récits, les chants, la langue et les noms de lieu
traditionnels créent un lien intime entre la réserve de parc et
l'histoire et le mode de vie des Haïdas. La culture riche et vivante de
ce peuple imprègne toute la région, dont les ressources naturelles, qui
abondent en éléments essentiels à la subsistance et à la croissance,
font partie intégrante de la culture traditionnelle des Haïdas, ainsi
que de la vie en milieu terrestre et maritime. Les caractéristiques
naturelles de Gwaii Haanas vont des monts San Christoval fort découpés,
formant l'épine dorsale de la région, jusqu'à des fjords, 40 lacs d'eau
douce et de forêts ombrophiles anciennes tempérées, en passant par une
faune très diversifiée et abondante. L'aire marine de conservation qu'il
est proposé d'établir s'étend le long d'une section de la plaque
tectonique de la Reine-Charlotte et abrite des communautés marines
intertidales et subtidales vivantes des plus diversifiées. Elle est
également située à un endroit stratégique, le long de la voie migratoire
du Pacifique, et accueille ainsi de gigantesques colonies de
nidification d'oiseaux de mer, en plus de constituer une importante
halte migratoire. L'aire de conservation recèle aussi des mammifères
marins, dont des lions de mer, des marsouins, des épaulards et des
baleines grises migratrices.
Note: Ces critères ont été identifiés durant le
processus d’établissement d’une liste indicative. Les critères utilisés
peuvent changer au fur et à mesure de la nomination.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Réserve de parc national Nahanni
Territoires du Nord-Ouest
Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en 1978
La réserve de parc national Nahanni est un espace naturel
intact composé de profonds canyons creusés dans des
massifs montagneux, d'immenses cascades, de sources chaudes et de
systèmes de grottes complexes. Le parc offre des exemples de
presque toutes les catégories connues de fleuves ou de cours
d'eau. Les chutes Virginia, deux fois plus hautes que les chutes
Niagara, figurent parmi les plus grandes cascades d'Amérique du
Nord.
Les rivières Flat et Nahanni Sud, qui sont plus anciennes que
les montagnes qu'elles découpent, ont produit les plus beaux
exemples de canyons de rivière au monde, surplombés de
pics granitiques spectaculaires. Le parc abrite une riche faune
boréale, y compris des loups, des grizzlis, des ours et des
caribous.
Les chercheurs d'or ont commencé à passer au crible la rivière
Nahanni-Sud il y a cent ans, sans grand succès. Devant eux, par contre,
se dressait un des environnements les plus variés et les plus
spectaculaires imaginables — des montagnes escarpées et des plaines de
toundra, des marécages et des dunes, des bad lands et des forêts
luxuriantes, des cygnes trompettes et des grizzlis. Il y a aussi des
sources thermales et des cavernes tapissées de stalagmites et de
stalactites colorées ou de cristaux de glace.
Partout, des filets d’eau, des ruisseaux et des rivières agitées se
déversent dans la grande et turbulente Nahanni-Sud. Cette rivière de
rapides fous et de tourbillons, de méandres et d’anastomoses fluviales
s’écrase au fond des chutes Virginia, deux fois la hauteur des chutes
Niagara, et coule au centre de canyons de 1 000 mètres de haut avant de
se cogner à une étroite gorge surnommée la Porte de l’enfer.
Heureusement, rien n’a changé depuis l’arrivée des chercheurs d’or. La
rivière Nahanni gronde et tourbillonne, les sources thermales
bouillonnent et les grizzlis rôdent. Il n’y a ni route ni agglomération
— la nature est presque vierge. En fait, c’est l’eau qui crée le plus de
changements, par le biais de rivières qui creusent des canyons dans les
montagnes Mackenzie et répandent leurs cônes alluviaux. Et comme la
région n’a pas goûté à la dernière période glaciaire, les falaises des
canyons ne sont pas élargies et arrondies, mais aiguisées et
profondes.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
SGang Gwaay
Colombie-Britannique
Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1981
Au village de SGang Gwaay llnagaay (Nan Sdins), datant du
XIXe siècle, les vestiges des longues maisons de
cèdre et d'un certain nombre de mâts totémiques
funéraires et commémoratifs sculptés illustrent
l'art et la puissance de la société Haïda. Le site
raconte l'histoire de la culture du peuple Haïda ainsi que la
relation des Haïdas avec la terre et la mer; il offre
également une clé visuelle de leurs traditions orales. Le
village a été occupé jusque peu après
1880.
Jadis un village haïda dynamique de 300 personnes, SGang Gwaay est
aujourd'hui un rassemblement quelque peu mystérieux des ruines de
charpentes de maisons, de colonnes mortuaires et de mâts totémiques
abîmés par le temps. Vers les années 1880, des maladies avaient décimé
la population du village de Nan Sdins situé sur l'île SGang Gwaay à
l'extrémité sud de l'archipel de Haïda Gwaii (îles de la
Reine-Charlotte). Au tournant du siècle, il ne restait que les ruines.
Quinze totems ont été logés dans des musées dans les années 1930 et
1950, et plusieurs autres pièces, endommagées par le temps et les
éléments, sont retournées à la forêt. Mais ce qui reste est unique au
monde : un village haïda du 19e siècle, composé des ruines de 10 maisons
et de 32 mâts et colonnes qui témoignent de la puissance et du talent
artistique d ’une société riche et flamboyante.
Les Haïdas ont toujours profité des richesses de la mer et des forêts.
Les fruits de mer et le saumon servent de denrées de base, alors que les
thuyas géants permettent de construire des canots de mer, des maisons
faites de larges planches et poteaux et de grands mâts qui portent des
symboles de l’histoire familiale et, à l’intérieur, des ossements
d’ancêtres. Les Haïdas ont habité SGang Gwaii durant des millénaires,
comme le prouvent les dépôts de coquillages de deux mètres de haut. Les
restes de Nan Sdins aident à perpétuer l’histoire épique de cette
communauté aux artistes de talent indéniable.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Station baleinière basque de Red Bay
Terre-Neuve-et-Labrador
Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en 2013
Red Bay est un exemple exceptionnel de la tradition des baleiniers
basques outremer et, à son apogée au
XVIesiècle, le lieu était le plus grand et le
plus important port du monde associé aux débuts de la
pêche à la baleine à l'échelle mondiale.
Grâce à ses nombreux vestiges archéologiques, Red
Bay présente la preuve la plus complète et extraordinaire
des débuts de l'industrie baleinière commerciale de grande
envergure et des traditions et techniques connexes qui se sont
développées et qui ont été florissantes
à l'échelle mondiale pendant trois siècles.
La station baleinière basque de Red Bay est l'exemple le plus
extraordinaire de l'utilisation des terres et de la mer associée
aux débuts commerciaux de grande envergure de la pêche
à la baleine et de la production d'huile de baleine. Les
ressources archéologiques trouvées à Red Bay
donnent un aperçu sans précédent de l'adaptation
des Basques du XVIesiècle aux conditions terrestres et
marines arides qui régnaient au Labrador pendant leur ascension
comme chefs de file mondiaux de la pêche à la baleine et de
la production d'huile de baleine il y a plus de quatre cents
ans.
Des années 1540 au début des années 1600, jusqu’à deux mille hommes et
garçons basques quittent chaque année leur village, dans le Sud de la
France et le Nord de l’Espagne, pour une traversée qui les mène de
l’autre côté de l’Atlantique Nord, dans l’Eldorado des baleiniers. Cet
endroit propice à la chasse, à plus de 4 000 kilomètres de distance, se
trouve plus précisément sur la côte est du Canada, dans le détroit de
Belle Isle, au Labrador, et le long de la Basse-Côte-Nord, au Québec.
Avec l’appui de propriétaires de navire et de pourvoyeurs, ces hommes
intrépides viennent chasser la baleine franche de l’Atlantique Nord et
du Groenland. Ils transforment ensuite sur place la graisse des prises
en huile, puis la mettent en tonneau, afin de la vendre en Europe. En
effet, l’huile de baleine constitue un bien essentiel en forte demande
sur le continent européen, car elle brûle avec plus d’intensité dans les
lampes que les autres combustibles et représente un lubrifiant utile
pour les produits de cuir ainsi qu’un additif commode pour la peinture,
le vernis et le savon. Bien documentée, cette chasse à la baleine
véritablement industrielle constitue l’un des premiers exemples de
l’exploitation économique des richesses naturelles de l’Amérique du Nord
par des intérêts commerciaux européens.
Des excavations archéologiques menées à terre et sous l’eau ont montré
que, durant la période où la chasse à la baleine battait son plein, soit
à partir des années 1580, des milliers d’hommes travaillaient à la
station baleinière de Red Bay uniquement. Appelée par les Basques Butus
ou Grande Baie, cette station était probablement la plus importante au
monde à cette époque. Le site, fortement utilisé, révèle tous les
aspects principaux de la tradition basque de la chasse à la baleine
outre mer, ainsi que ses principes et techniques. (Il s’agit d’une
industrie où ce peuple excellera durant trois siècles.) Parmi les
découvertes figurent un réseau de plus d’une douzaine de stations sur le
rivage, qui comprennent des fondoirs, où la graisse de baleine est
transformée en huile dans des chaudrons de cuivre chauffés sur un foyer,
des tonnelleries, des ateliers, des résidences temporaires et des quais.
On trouve aussi sur place un cimetière et des tours de guet. Des
artéfacts de l’époque, ainsi qu’un amas considérable d’os de baleine
boréale et de baleine franche complètent la collection. Les archéologues
ont aussi découvert dans le port de Red Bay lui-même des pièces de la
carcasse d’un certain nombre de navires, ce qui a permis d’approfondir
considérablement nos connaissances sur la technologie navale dans la
péninsule ibérique au XVIe siècle. Parmi ces navires, mentionnons quatre
baleinières (galions) et plusieurs embarcations plus petites servant à
la chasse.
Après plusieurs décennies de prospérité, l’industrie baleinière des
Basques au Canada commence à décliner vers la toute fin du XVIe siècle.
Ce déclin est attribuable à de nombreux facteurs, dont l’exploitation
excessive de la ressource, la découverte de nouvelles zones de chasse,
les changements climatiques et l’évolution de la situation politique. La
somme des connaissances acquises à Red Bay durant les nombreuses années
de recherche terrestre et subaquatique a bouleversé nos connaissances
sur le début de la chasse à la baleine à grande échelle outre-mer, le
début de l’occupation européenne en Amérique du Nord, et plus
particulièrement, le rôle joué par les Basques à cet égard.
|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |
Tr'ondëk Klondike
Yukon
Liste indicative des sites du patrimoine mondial
The transboundary serial cultural landscapes in First Nations
traditional territories, including the Tr’ochëk fishing camp, and the
Chilkoot Trail, the Klondike gold fields and the historic district of
Dawson, illustrate life before, during and after the Klondike Gold Rush
of 1896-1898, the last and most renowned of the world’s great 19th
century gold rushes. First Nations story cycles and languages articulate
this environment, which reflects centuries of continuing indigenous use
as well as the physical and cultural transformations wrought by a
half-century of corporate mining. The 53-km Chilkoot Trail, from Taiya
Inlet in Alaska over the Coast Mountains to the headwaters of the Yukon
River in British Columbia, links the Pacific coast to the Yukon
interior. An Aboriginal trade and travel route for centuries, the trail
brought thousands of Stampeders to the Klondike gold fields from 1896 to
1898. Downriver from this commemorative trail, at the confluence of the
Klondike and Yukon rivers, is the Tr’ochëk fishing camp, the centre of
the Tr’ondëk Hwëch’in traditional territory. Dawson sits opposite. Its
hastily constructed, false-fronted wooden buildings, with some relicts
and open spaces amid them, illustrate life during the gold rush and
after. More opulent administrative and institutional buildings speak to
the one-time prosperity of this former territorial capital. Beyond lie
the Klondike gold fields centred on Rabbit (later Bonanza) Creek, site
of the 1896 discovery of gold by James “Skookum Jim” Mason (Keish),
sites of the labour-intensive individual miner society, the gigantic
Dredge No. 4, and massive tailing piles left by corporate mechanized
mining. Nearby are the relict mining camp headquarters at Bear Creek.
Small-scale mining operations continue in the gold fields today. First
Nations and newcomers continue an ongoing cultural accommodation,
including negotiated land settlement agreements. The American components
of this proposal, including the historic district of Skagway, Alaska,
are not yet on the American Tentative List.
Note: Ces critères ont été identifiés durant le
processus d’établissement d’une liste indicative. Les critères utilisés
peuvent changer au fur et à mesure de la nomination.
|
|