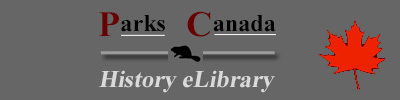
Dirigeants de Parcs Canada |
|
Dirigeants de Parcs Canada J.B. Harkin (1911-1936)1
« Les parcs sont par les présentes dédiés au peuple canadien pour son bénéfice, son instruction et sa jouissance [...], et ces parcs doivent être entretenus et utilisés de manière qu'ils restent intacts pour la jouissance des générations futures. » Dans la clause dédicatoire de la Loi sur les parcs nationaux de 1930, M. Harkin a résumé sa vision du rôle des parcs nationaux, vision façonnée par les deux décennies au cours desquelles il a dirigé le premier service de parcs au monde.
M. Harkin a été nommé au poste de commissaire de la Division des parcs du Dominion après sa création en 1911. Au cours des 25 années suivantes, il a fait du premier service de parcs du monde un modèle de conservation et d'agrément dont s'inspire l'Agence Parcs Canada encore aujourd'hui, un siècle plus tard. Dès ces débuts modestes, M. Harkin a élaboré un vaste cadre sur les thèmes suivants : l'accès pour tous, la conservation de la faune, la nécessité de promouvoir l'histoire du pays, l'inviolabilité des parcs et les avantages du tourisme pour le pays.
Dans le domaine de la conservation, il était évident que les responsables des parcs devaient trouver un juste équilibre entre l'importance des travaux de construction et d'aménagement et la conservation « des beautés naturelles et des merveilles panoramiques, des forêts, des animaux, des poissons et des oiseaux ». M. Harkin encourageait également la gestion scientifique des parcs, qu'il jugeait nécessaire « si nous voulons appliquer la loi et préserver la faune intelligemment », disait il.
En 1914, le fort Howe est devenu le premier parc historique national du Canada; cet événement a marqué le début des activités de conservation et d'éducation axées sur les lieux historiques. La création, en 1919, de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, dont le mandat consistait à donner des conseils éclairés au gouvernement sur les lieux qu'il convenait de désigner en raison de leur importance historique nationale, est un autre héritage légué par M. Harkin. Après avoir constaté que les lieux historiques étaient de par leur nature fondamentalement différents des parcs nationaux, M. Harkin a plus tard recommandé l'élaboration de dispositions législatives qui tenaient mieux compte de cette réalité. M. Harkin était bien conscient du rôle des parcs dans le tourisme et, par conséquent, de leurs retombées sur l'économie canadienne. Ayant constaté la popularité grandissante de l'automobile, il a veillé à la construction de routes et d'hôtels et à l'aménagement de terrains de camping dans les parcs nationaux afin d'offrir des installations aux visiteurs qui venaient profiter des merveilles de la nature. M. Harkin a pris sa retraite en 1936. Dans une lettre, il a écrit : « Je passe maintenant le flambeau à d'autres. Mon vœu le plus cher est que les travaux continuent d'être guidés par l'idéalisme, sans quoi les parcs perdront leur âme et deviendront comme les centaines de milliers de centres de villégiatures ordinaires que l'on trouve partout dans le monde. » 1Source: E.J. (Ted) Hart, J.B. Harkin, University of Alberta Press, 2010. Frank H.H. Williamson (1936-1941)1
M. Williamson a été nommé contrôleur du Bureau des parcs nationaux en 1936, après avoir agi comme conseiller principal de M. Harkin pendant plusieurs années, en sa qualité de commissaire adjoint des parcs. Il possédait une connaissance approfondie du mandat des parcs et avait acquis de nombreuses années d'expérience au Bureau des parcs nationaux, où il avait commencé à occuper un poste avant le début de la Première Guerre mondiale. M. Williamson partageait l'opinion de M. Harkin selon laquelle le contact avec la nature dans un parc national pouvait être une expérience inspirante et revigorante, qui permettait aux gens de se ressourcer. Il a même déjà déclaré que le jardin d'Eden était le premier parc national! Étant donné que la majorité des parcs nationaux se trouvaient dans l'Ouest du Canada, M. Williamson a voulu élargir le réseau en établissant des parcs partout au pays, près des agglomérations. Il a commencé dans l'Est du pays en créant les parcs nationaux de l'Île du Prince Édouard et des Hautes Terres Cap Breton entre 1937 et 1939.
M. Williamson s'intéressait également aux lieux historiques nationaux. Il a supervisé le transfert de Green Gables et de Dalvay-by-the Sea, deux demeures situées à l'Île du Prince Édouard, au Bureau des parcs nationaux. Il a également participé à l'aménagement du lieu de naissance de sir Wilfrid Laurier à Saint Lin, au Québec. En 1939, M. Williamson et M. W.D. Cromarty, son assistant pour le programme des lieux historiques nationaux, ont décidé d'appliquer une disposition de la Loi sur les parcs nationaux de 1930 en classant plusieurs des principaux lieux historiques et parcs nationaux parmi les parcs historiques nationaux. En vertu du décret de 1940, le statut de parc historique national a donc été accordé, entre autres, à la forteresse de Louisbourg et aux forts de Chambly, Wellington et Prince de Galles. Cette décision allait permettre au ministère d'exercer une meilleure supervision de ses activités liées au patrimoine, car il recevrait des crédits annuels réguliers pour la gestion de ces biens. De plus, ces endroits deviendraient la responsabilité de directeurs de parc salariés qui relèveraient du Bureau des parcs nationaux.
M. Williamson était au fait de la recherche écologique et tenait compte des derniers résultats des études avant de prendre des décisions. Il a présidé le débat sur les espèces prédatrices et leur place dans les parcs. Ce débat avait été amorcé par les politiques antérieures, qui obligeaient les gardes de parc à éliminer ces espèces. Après avoir consulté des études menées par des biologistes, M. Williamson a émis des directives qui interdisaient cette pratique et a également demandé aux gardes de parc de veiller à l'équilibre des espèces dans les parcs. Le mandat de Williamson en tant que contrôleur du Bureau des parcs nationaux a pris fin subitement à sa mort, en septembre 1941. 1Source : Histoire des parcs nationaux du Canada, vol. II, W.F. Lothian, Parcs Canada, 1977; Negotiating the Past: The Making of Canada's National Historic Parks and Sites, C.J. Taylor, 1990; Natural Selections: National Parks in Atlantic Canada, 1935-1970, Alan MacEachern, 2001. James Smart (1941-1953)1
M. Smart a intégré la Division des parcs nationaux en 1930, après avoir commencé sa carrière au Service fédéral de sylviculture. Il a occupé le poste de directeur dans des parcs du Manitoba et des Maritimes et a ensuite été nommé contrôleur adjoint en 1937 et contrôleur en 1941. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a établi des camps de travail dans les parcs de l'Ouest afin de fournir un emploi aux objecteurs de conscience. Au cours de cette période, les terrains de camping des parcs des montagnes ont fait l'objet des premiers travaux d'agrandissement importants, et les installations de ski des parcs Banff, Jasper et du Mont-Revelstoke ont été améliorées. Passionné de golf, M. Smart a orienté la planification et l'aménagement des terrains de golf de trois parcs des Maritimes.
Faisant écho au succès remporté par Harkin lors de la construction de la route Banff-Windermere pour relier l'Alberta et la Colombie-Britannique, M. Smart a amorcé la construction de la Transcanadienne dans le parc national Banff. Un certain nombre de parcs nationaux créés pour offrir un refuge aux espèces de gibier menacées d'extinction ont été abolis pendant son mandat. En Alberta, le parc Nemiskam et le parc Buffalo ont été abolis en 1947, car les populations d'antilocapres et de bisons d'Amérique ont été ramenées à un niveau satisfaisant et les parcs n'étaient donc plus nécessaires pour préserver ces espèces.
Au printemps 1949, la Commission royale d'enquête sur l'avancement des arts, des lettres et des sciences au Canada, aussi appelée la Commission Massey, a commencé à tenir des séances publiques dans les principales villes canadiennes. Les commissaires ont entendu des témoignages sur l'état des arts, de la culture et du patrimoine au pays. Le rapport Massey, publié en 1951, s'est avéré un document d'une grande importance pour l'histoire culturelle du Canada et a eu des répercussions pour la Division des parcs nationaux. M. Smart a pris sa retraite en février 1953, avant que les recommandations du rapport aient pu être mises en application. 1W.F. Lothian, Histoire des parcs nationaux du Canada, vol. II, Parcs Canada, 1977; et « Massey Commission » [en anglais seulement], Encyclopédie canadienne en ligne. J.A. Hutchison (1953-1957)1
Durant le mandat de M. Hutchison, les travaux d'aménagement effectués dans les parcs nationaux pour en faire des destinations touristiques étaient essentiellement axés sur la construction d'autoroutes. Les autoroutes de Banff, de Jasper et du Cap-Breton ont été améliorées et la Transcanadienne a été prolongée pour joindre Banff à Yoho. L'utilisation accrue de voitures personnelles et la popularité croissante du camping et des activités de plein air ont nécessité l'ajout de terrains de camping et de caravaning. L'aménagement d'un nouveau terrain de camping à la pointe Pelée a permis de mettre fin à l'établissement d'emplacements de camping dispersés qui menaçaient l'écologie du parc. Dans l'Est du pays, le parc national Terra Nova a été ajouté au réseau de parcs en mai 1957.
Durant le mandat de M. Hutchison, le programme des lieux historiques a pris un grand essor. L'importance accordée à l'histoire et au patrimoine dans le rapport Massey a donné lieu à l'affectation de fonds et à l'adoption de lois et de politiques à l'appui du programme des lieux historiques nationaux. Le programme n'avait pas bénéficié de telles mesures depuis plus de 25 ans.
La Loi sur les lieux et monuments historiques a été adoptée en 1953 et modifiée en 1955; elle constituait le fondement législatif du programme des lieux historiques. La Loi prévoyait notamment la désignation de lieux historiques nationaux en fonction de leur importance architecturale, ce qui a donné naissance à la désignation de bâtiments historiques, une nouvelle activité du programme. De plus, le ministère a élargi certains secteurs traditionnels d'aménagement et entrepris des projets de grande envergure dans divers lieux historiques existants, partout au pays. Durant son court mandat en tant que dirigeant, M. Hutchison a contribué à l'accroissement de la visibilité de la Direction générale des parcs nationaux auprès des Canadiens et à l'augmentation du taux de fréquentation dans les parcs, lequel a dépassé les 1,5 million de visiteurs. 1Source : Histoire des parcs nationaux du Canada, vol. II, W.F. Lothian, Parcs Canada, 1977; Negotiating the Past: The Making of Canada's National Historic Parks and Sites, C.J. Taylor, 1990. J.R.B. Coleman (1957-1968)1
Pendant son mandat, J.R.B. Coleman met l'accent sur la création de parcs et sur l'amélioration des commodités qui y sont offertes. Les travaux de construction d'autoroutes dans les parcs contribuent à l'accroissement du nombre de visiteurs et au développement des installations qui leur sont destinées. En 1959, la Section de l'éducation et de l'interprétation voit le jour et est placée sous la surveillance immédiate du directeur des parcs nationaux. Elle a pour objectif de mieux faire comprendre au public les buts et la signification des parcs nationaux. On embauche un naturaliste en chef ainsi que des naturalistes saisonniers dans plusieurs parcs. Ces initiatives mènent à l'aménagement de sentiers de promenade, à l'organisation d'excursions, ainsi qu'à la tenue de conférences et d'expositions sur place pour faire connaître la faune et les phénomènes naturels aux visiteurs.
L'expansion rapide des activités dans les parcs nationaux, jumelée au potentiel touristique des lieux historiques nationaux, mène, en 1966, à une restructuration majeure de l'organisation. Alors connue sous le nom de Direction des parcs nationaux et historiques, l'organisation passe sous la responsabilité du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Pendant le mandat de M. Coleman, on assiste à un accroissement remarquable de la fréquentation des parcs nationaux et historiques, qui passe de 4 millions de visiteurs en 1957 à 13 millions une décennie plus tard. Cet accroissement est en partie attribuable à l'aménagement d'autoroutes et de routes panoramiques dans les parcs de l'Est et de l'Ouest. En 1967, des terrains de camping modernes accueillent 1,2 million de campeurs chaque année et le parc Kejimakujik s'ajoute au réseau et devient le deuxième parc national en Nouvelle-Écosse.
Le réseau des lieux historiques nationaux connaît aussi une expansion, alors que plus de 80 endroits sont désignés pendant son mandat. On investit aussi massivement dans les lieux historiques nationaux existants, notamment pour la réalisation d'un certain nombre de projets d'immobilisation d'envergure. En 1964, le Ministère fait l'acquisition de la villa Bellevue, qui fut pendant une courte période la résidence du premier premier ministre du Canada, sir John A. Macdonald. Restaurée avec soin en portant une attention toute particulière aux détails architecturaux, la villa Bellevue témoigne d'une technique de restauration appliquée avec succès. Elle ouvre ses portes au public en 1967, à l'occasion du centenaire de la Confédération.
La reconstruction de la forteresse de Louisbourg, qui date du XVIIIe siècle, est une réalisation majeure du Ministère pendant le mandat de M. Coleman. En 1961, le gouvernement fédéral s'engage à investir des millions de dollars dans ce projet, qui commence par une recherche préparatoire à l'échelle planétaire et culmine avec la reconstruction, exécutée par des experts aidés de travailleurs locaux, d'environ un cinquième du village d'origine et des fortifications. La forteresse est aujourd'hui un musée historique vivant qui présente la vie au XVIIIe siècle à des milliers de visiteurs chaque année. Bien que le projet de reconstruction ait pris fin en 1983, bien après le mandat de M. Coleman, les fouilles archéologiques se poursuivent encore aujourd'hui pour mettre au jour la richesse et la complexité de l'histoire du lieu.2 1Inspiré de W.F. Lothian, Histoire des parcs nationaux du Canada, vol. 2, [Ottawa], Parcs Canada, 1977. 2Comptes rendus des réunions de la CLMHC d'octobre 1964 et mai 1966; L.D. Cross, « Fortress Louisbourg », Legion Magazine = La revue Légion,http://www.legionmagazine.com/en/index.php/2004/01/fortress-louisbourg/, January 2004 (en anglais seulement). John I. (Jack) Nicol (1968-1978)1
Il arrive parfois que les étoiles s'alignent dans le firmament politique, permettant ainsi de grandes réalisations. Il en a été ainsi pendant la décennie où M. Nicol a dirigé Parcs Canada. Son ministre, Jean Chrétien, aimait la nature et possédait un flair politique hors du commun tandis que le premier ministre Trudeau partageait le même sentiment d'appartenance et la même passion pour la nature sauvage que ces deux hommes. Nicol, un gestionnaire dynamique qui savait mener les choses à bien, a ajouté dix nouveaux parcs nationaux au réseau existant, en plus d'agrandir le réseau de lieux historiques nationaux, d'acquérir des canaux historiques et de mettre sur pied des initiatives en matière de conservation du patrimoine à l'échelle nationale et internationale.
Au cours des 30 années précédentes, seulement trois parcs nationaux avaient été créés. L'établissement de dix parcs en une décennie représente donc une réalisation importante. En 1968, le personnel de Parcs Canada jetait les bases de l'agrandissement du réseau, cernant les régions qui n'étaient pas représentées par le réseau existant et préparant des études sur ces régions. Sous le leadership politique de M. Chrétien, des fonds ont été alloués en vue de l'établissement de nouveaux parcs et des négociations avec les provinces ont été entamées. C'est ainsi que neuf de ces dix parcs ont vu le jour en l'espace de cinq ans. Pendant le mandat de M. Nicol, un équilibre a été atteint entre les préoccupations relatives à la conservation et l'utilisation par la population des parcs et lieux à des fins de divertissement et d'interprétation. Sur le plan de la conservation, on a dressé des inventaires biophysiques et établit les fondements de la gestion des ressources naturelles. Après le rejet massif du développement commercial de la région de Lake Louise et l'expropriation de terres en vue de créer les parcs Forillon et Kouchibouguac, Parcs Canada a commencé à accorder davantage d'importance à la consultation publique, ainsi qu'au respect de l'utilisation des terres et des valeurs culturelles existantes. En ce qui a trait aux lieux historiques nationaux, Parcs Canada a choisi de remettre en état des bâtiments et des propriétés afin de les présenter au public plutôt que, comme par le passé, d'installer des plaques commémoratives. À l'époque de M. Nicol, une équipe de spécialistes a été mise sur pied pour accélérer la conservation et la mise en valeur d'endroits tels que la forteresse de Louisbourg, sur l'île du Cap Breton. C'est aussi à cette époque que le programme de partage des coûts a été étendu pour favoriser l'établissement de lieux historiques gérés par d'autres organismes que Parcs Canada.
En 1972, Parcs Canada a fait l'acquisition de six canaux historiques, et le gouvernement libéral a proposé l'établissement d'un réseau de parcs linéaires, comprenant notamment des rivières et des sentiers du patrimoine. M. Nicol a aussi amené le Canada à jouer un rôle dans le domaine du patrimoine mondial en négociant la Convention du patrimoine mondial et a favorisé l'adhésion du pays à l'Union internationale pour la conservation de la nature. De bien des façons, la période Nicol représente une ère nouvelle pour Parcs Canada, grâce à l'établissement de parcs dans l'ensemble du pays et à l'élaboration de programmes d'interprétation et de mise en valeur plus raffinés dans les lieux historiques nationaux. M. Nicol, ainsi que d'autres personnes, ont saisi toutes les occasions de mettre en valeur les lieux naturels et culturels protégés du Canada et d'en faire des endroits dont tout le peuple canadien pourrait être fier. 1Tiré de l'ouvrage En plein essor — Parcs Canada à l'époque de Jack Nicol, 1968-1978, Bill Wylie et coll., Direction générale des lieux historiques nationaux Al Davidson (1978-1985)1
Lors de l'entrée en fonction d'Al Davidson, l'objectif général de Parcs Canada était énoncé dans une nouvelle politique sur les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux : « Sauvegarder à jamais des aires naturelles représentatives d'intérêt canadien et favoriser chez le public la connaissance, l'appréciation et la jouissance de ce patrimoine naturel de telle manière qu'il soit légué intact aux générations à venir. » En 1980, Al Davidson présente un document au 15e International Seminar on National Parks and Equivalent Reserves. Parcs Canada compte alors 28 parcs nationaux, dont au moins un dans chacune des dix provinces et dans chacun des deux territoires, ainsi que 68 lieux historiques nationaux. Il est fier de faire connaître la réputation internationale du réseau de parcs du Canada, et compare les parcs à des îles dans l'océan du développement et de la détérioration de l'environnement. Faisant écho à la vision de Harkin, il parle du rôle que jouent les parcs comme moyen d'échapper aux pressions de la vie rapide et moderne en milieu urbain, ainsi que de la possibilité qu'ils nous offrent d'améliorer notre forme physique. Toujours dans le même ordre d'idées que Harkin, il dresse la liste des avantages économiques que génèrent les parcs. Il conclut en disant que notre patrimoine naturel et culturel commun, le Nord et le concept de milieux sauvages sont tous des éléments des parcs qui représentent l'esprit de notre pays. Le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO semble d'accord avec l'énoncé d'Al Davidson sur notre réseau de parcs et sur les parcs eux-mêmes, parce qu'il décerne au parc national Nahanni la première plaque du patrimoine mondial. Au début des années 1980, les temps sont difficiles au pays, et le gouvernement doit composer avec des restrictions budgétaires. Les compressions dans les parcs ont des répercussions sur les infrastructures et la protection. Malgré tout, la réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan ainsi que les parcs nationaux Ivvavik et des Prairies sont créés, tout comme un grand nombre de lieux historiques nationaux et de canaux historiques. En 1985, lors d'un forum de la haute direction, Al Davidson présente trois défis à relever pour la décennie à venir : 1) assurer la protection de notre patrimoine naturel et culturel pour tous les Canadiens d'aujourd'hui et de demain; 2) continuer à bien servir nos visiteurs afin d'assurer un appui solide à la conservation; 3) trouver une façon de compléter le réseau de parcs. Une génération plus tard, ces défis sont toujours les mêmes. En guise de conclusion, voici un extrait du discours qu'il a prononcé devant la haute direction, en 1985, et qui nous donne un bon aperçu de l'homme qu'il était : « [Traduction] Selon moi, le tourisme et les parcs vont de pair, tout comme le whisky et le soda. Pris chacun de leur côté, ils sont bons, mais ils deviennent de loin meilleurs lorsqu'on les combine. » 1Tiré de documents de Parcs Canada (RG 84), Gabrielle Blais, Division des archives fédérales, Archives publiques du Canada. J.D. Collinson (1985-1990)1
D'une entrevueQue signifiait pour vous le fait de devenir sous-ministre adjoint (SMA) de Parcs Canada et de poursuivre l'œuvre de M. Harkin? Il faut d'abord se situer dans le contexte. Lors de la création des premiers parcs nationaux, le Canada était un pays très différent. Le peuplement de l'Ouest se poursuivait, le Chemin de fer Canadien Pacifique était en voie d'être terminé; les gens se sentaient des pionniers dans tout ce qu'ils entreprenaient. M. Harkin devait notamment tenir compte des intérêts du gouvernement à l'égard de l'aménagement du parc Banff et des autres parcs des montagnes pour les touristes fortunés. Le but était que ces touristes s'y rendent en train afin d'augmenter l'achalandage sur les chemins de fer et ainsi les rendre plus viables. Ainsi, au début, la conservation était importante pour attirer les touristes. Quand je suis arrivé à Parcs Canada dans les années 1980, les choses avaient beaucoup changé. La clause dédicatoire de la Loi sur les parcs nationaux était interprétée très différemment, et l'accent était mis sur la protection. La conservation devenait plus importante, de même que les restrictions sur le développement et la gestion active des ressources dans les parcs, ce qui limitait l'expérience du visiteur. C'était aussi une époque de sensibilisation accrue et de militantisme sur les questions liées à l'environnement (j'ai exigé que tous les véhicules des parcs utilisent de l'essence sans plomb : nous étions alors les seuls à le faire au sein d'Environnement Canada). Telle était la situation de gestion difficile dans laquelle je me trouvais et que beaucoup ne comprenaient pas tout à fait. Des pressions politiques nous poussaient à autoriser d'autres aménagements au parc Banff et dans d'autres parcs, mais on nous disait en même temps qu'il fallait protéger l'environnement. Les lieux historiques nationaux étaient confrontés aux mêmes difficultés, mais il leur était un peu plus facile de trouver un équilibre. Par exemple, le remplacement des escaliers de la maison de Lucy Maud Montgomery, qui devait être effectué tous les trois ans environ en raison de l'usure causée par l'achalandage, ne posait pas vraiment de problème! Comment en êtes-vous venu à participer aux activités de l'UNESCO liées au patrimoine mondial? Peu de temps après mon entrée en fonction à titre de SMA, on m'a dit que je devais représenter le Canada lors des réunions du Comité du patrimoine mondial. Mais comme je venais juste d'arriver en poste et que je devais gérer un grand nombre de dossiers importants, je ne pouvais pas me permettre de consacrer du temps à cette tâche et j'ai donc demandé à Al Davidson, mon prédécesseur, d'y aller à ma place. L'année suivante, je suis allé à Paris pour participer à ma première réunion, et l'ambassadeur du Canada à l'UNESCO m'a demandé si j'accepterais le rôle de vice-président au sein du comité. Quand la réunion a commencé, j'ai constaté avec surprise que j'avais en fait été choisi président : je jouais maintenant un rôle de leader. C'était à une époque où le Canada avait, sur la scène internationale, la réputation d'être un pays pacifique et juste, et ce rôle m'a donc permis d'établir des rapprochements. Par exemple, pour que les États-Unis paient ses arriérés à l'UNESCO, nous avons créé un compte spécial en garantissant qu'aucuns fonds ne seraient versés à des pays avec lesquels les États-Unis avaient des différends. Un autre exemple est l'établissement, avec la Banque mondiale, d'une entente selon laquelle la Banque doit consulter le Comité avant de financer un projet qui pourrait avoir une incidence sur un site du patrimoine mondial. J'étais très à l'aise de travailler sur les mises en candidature du volet des biens naturels du patrimoine mondial, ainsi que sur les propositions liées à l'histoire, mais un peu moins lorsqu'il s'agissait de sites culturels liés à l'architecture (qui représentent un nombre considérable de sites examinés). C'est pourquoi j'ai demandé à Christina Cameron de m'accompagner pour me faire profiter de son expertise, et, évidemment, elle a fini par jouer un rôle important pour le patrimoine mondial. Avec le recul, lesquelles de vos réalisations considérez-vous comme une partie du legs que vous avez laissé? Je me suis toujours assuré d'une chose : ne pas dépasser mon budget et respecter le mieux possible les objectifs du gouvernement. À l'époque, les contraintes budgétaires étaient importantes, et c'était une tâche considérable que de maintenir l'organisation en bon état de marche. Toutefois, nous avons trouvé des moyens d'obtenir de l'argent frais et de réaffecter des fonds existants de façon à ce que nous puissions continuer à créer de nouveaux parcs. Les deux dont je suis le plus fier sont ceux de l'île d'Ellesmere (Quttirnipaaq) et de Moresby-Sud (Gwaii Hanaas). La création du parc à Moresby-Sud a été un processus difficile, premièrement lorsqu'il a fallu conclure une entente avec la province, et ensuite lors des deux années de négociations avec les Haïdas. Vers la fin des négociations, j'ai pris un bout de papier et tracé une ligne dans le milieu. D'un côté, j'ai dressé une liste des points de vue des Haïdas sur la question, et de l'autre ceux de Parcs Canada. Ensuite, j'ai tracé une ligne en bas et inscrit la remarque suivante : en dépit des points de vue susmentionnés, les deux parties acceptent de travailler ensemble afin de gérer ce territoire comme ceci... Ce bout de papier est devenu la base de l'entente de cogestion que nous avons établie pour administrer le parc. C'était une façon novatrice de créer un parc, et elle n'a été possible qu'après une modification de la Loi sur les parcs nationaux. Je me rappelle avoir hésité à créer un parc sur l'île d'Ellesmere en raison des problèmes inhérents à une telle entreprise dans un endroit aussi éloigné. Un ami des Forces canadiennes a pris les dispositions nécessaires pour que je puisse me rendre à la SFC Alert à bord d'un Hercules. Une fois rendu là-bas, on m'a prêté un Twin Otter et j'ai pu survoler le secteur envisagé pour la création du parc. Alors que je pilotais l'avion au-dessus de cette partie magnifique du Canada, j'ai vu des sites de recherches abandonnés, des ornières profondes, des bidons de carburant et des déchets éparpillés sur le sol. Ces constatations m'ont convaincu du besoin de mieux protéger ce secteur et, environs six semaines plus tard, nous avons organisé une cérémonie officielle au fiord Tanqueray pour la signature de l'entente de création du parc avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Le parc incluait le site historique de Greely, aujourd'hui abandonné, qui a déjà été utilisé pour atteindre le pôle Nord. J'ose croire que j'ai exercé une certaine influence lors de la centralisation des services à un seul endroit, afin qu'il n'y ait pas les parcs nationaux (PN) d'un côté et les lieux historiques nationaux (LHN) de l'autre. Les directeurs généraux de l'époque (Christina Cameron pour les LHN et Ian Rutherford pour les PN) m'ont aussi été d'un grand secours dans l'établissement d'intérêts communs. Au bout du compte, je crois que j'ai eu une incidence positive sur la composition du groupe de la haute direction. Quand je suis arrivé, au milieu des années 80, tous les cadres supérieurs étaient des hommes. Cela m'avait un peu surpris, et j'ai commencé à chercher activement des femmes qualifiées pour occuper des postes au sein de la haute direction. Lorsque je suis parti, le ratio était d'environ 50/50. J'ai aussi essayé, en règle générale, d'assigner un poste supérieur vacant sur deux à une personne de l'extérieur de l'Agence afin que nous puissions profiter de ses nouvelles perspectives. 1À partir d'une entrevue téléphonique avec J. France. Tom Lee (1993-2002)1
Tom Lee a été nommé sous-ministre adjoint de Parcs Canada en 1993. À l'époque, l'organisation faisait face à un avenir incertain, car le gouvernement se proposait d'abolir la Direction des parcs nationaux d'Environnement Canada dans le cadre de son engagement à l'égard du Plan vert, élaboré à la suite du Sommet de la Terre de 1992. Parcs Canada a échappé à ce destin grâce à la création du ministère du Patrimoine canadien en 1994, mais M. Lee devait encore composer avec les difficultés que posait le maintien des capacités opérationnelles de Parcs Canada en cette période de restrictions gouvernementales. En 1996, à la fin de cette période difficile, Parcs Canada a été parmi les premiers organismes à être transformés en agences de services distincts. Le mandat de M. Lee a été marqué par des réalisations exceptionnelles sur le plan législatif. À la suite de l'adoption de la Loi sur l'Agence Parcs Canada en 1998, M. Lee est devenu le premier directeur général de la nouvelle agence. Il a ensuite été témoin de l'adoption de la Loi sur les parcs nationaux du Canada en 2000, de la Loi sur les aires marines nationales de conservation en 2002, et de l'entrée en vigueur de la Charte de Parcs Canada, qui définit les rôles et les responsabilités de l'agence. Pour répondre à ses besoins, la nouvelle agence a dû mettre en œuvre de nouvelles politiques, dont le cadre de gestion des ressources humaines. De plus, un énoncé de vision, ainsi qu'un énoncé des valeurs et des principes de gestion ont alors été élaborés. À l'époque, M. Lee s'est engagé à préparer un plan directeur pour chaque parc national et chaque lieu historique national. L'intendance de ces parcs et lieux a été renforcée grâce à l'instauration des énoncés d'intégrité commémorative et d'intégrité écologique. La visibilité de l'Agence auprès du public a également été améliorée par l'ajout de son logo sur les uniformes, les véhicules et les panneaux. Parmi ses réalisations les plus importantes, M. Lee a contribué à l'accroissement de la participation des peuples autochtones, grâce à la création du Secrétariat des affaires autochtones et d'un partenariat avec Tourisme autochtone Canada. En outre, il a organisé une table ronde des ministres sur le tourisme autochtone et formé le Comité consultatif autochtone, créant ainsi des assises solides qui ont permis à Parcs Canada d'établir des relations fructueuses avec les Autochtones. Pendant les neuf années de son mandat, 139 lieux historiques nationaux, 5 parcs nationaux et 2 aires marines nationales de conservation se sont ajoutés au réseau de Parcs Canada. C'est le leadership de M. Lee qui constitue l'une de ses principales contributions. Il a transformé la culture d'entreprise, en lui insufflant une énergie nouvelle. Grâce à sa capacité de se concentrer sur les enjeux, à son souci d'intégrité, à son ouverture d'esprit et à l'importance qu'il accordait à la consultation et à la collaboration en vue d'atteindre des objectifs stratégiques clairement définis, M. Lee a instauré une culture dynamique fondée sur la confiance et le respect mutuels. 1Tiré de l'ouvrage Hommage à Tom Lee, le premier directeur général de l'Agence Parcs Canada, par Christina Cameron et coll., Direction générale des lieux historiques nationaux Alan Latourelle (2002-2015)
Entrevue avec le DGALorsqu'il a pris sa retraite, James Harkin a dit qu'il passait le flambeau, et ce flambeau a été porté par neuf personnes avant que Tom Lee ne vous le confie. En quoi consiste selon vous l'héritage cumulatif que ce flambeau symbolique représente? Il s'agit d'abord d'un réseau exceptionnel d'endroits que je qualifierais de sacrés. Le flambeau symbolise un réseau qui témoigne de la richesse et de la diversité naturelles et culturelles du Canada. Il symbolise notre identité en tant que Canadiens. Mais ce flambeau représente également l'équipe de Parcs Canada. Chacun d'entre nous qui avons eu le privilège, je dirais même l'honneur, de diriger l'Agence Parcs Canada avons contribué à un siècle de professionnalisme, de passion, de compétence et d'innovation en matière de leadership international. Il est clair que les dirigeants de Parcs Canada doivent aussi trouver des façons de maximiser ces forces et d'atteindre de nouveaux sommets. Nous pourrons ainsi miser sur ce qui a constitué notre réussite et en tirer parti dans le contexte actuel. Selon vous, parmi les nombreuses réalisations de l'Agence depuis que vous êtes son DGA, quelle est celle qui aura la plus grande incidence au moment où nous entamons notre deuxième siècle d'existence? Je ne considère jamais les réalisations comme étant celles du DGA de Parcs Canada. Depuis 100 ans, les réussites sont le fruit des contributions apportées par les membres de l'équipe de Parcs Canada. Il est évident que James Harkin était un visionnaire. Tom Lee en était un également, comme j'ai pu le constater lorsque j'ai eu le privilège de travailler avec lui. Mais en bout de ligne, la réussite dépend de toute l'équipe, et le rôle du DGA est de créer une organisation et une culture qui favorisent l'innovation. Lorsque je passe en revue les huit dernières années, je crois que le forum « Une vision, une équipe » a été un moment marquant. Ce que je veux dire, c'est que nous avons pris des décisions et des mesures très pratiques en tant qu'organisme. Mentionnons seulement les uniformes : les employés sont fiers de les porter et d'être reconnus par la population. Je crois que nous avons su mettre à profit chaque fonction et chaque endroit et créer une organisation homogène. Une autre réussite que la présente génération de membres de l'équipe de Parcs Canada laissera derrière elle est, selon moi, l'expansion quasi sans précédent du réseau. Peut être pas en nombre de parcs, si l'on prend exemple des parcs nationaux, mais plutôt en ce qui touche la taille des expansions. Au cours des quatre dernières années seulement, la superficie des aires protégées terrestres et fluviales s'est accrue de près de 50 p. 100 sous la gouverne de Parcs Canada. Et il ne s'agit pas que des parcs nationaux, mais aussi des lieux historiques nationaux, comme Sahoyúé §ehdacho, le plus grand lieu historique national de l'histoire de notre pays. Dans le cas des monts Mealy, nous avons même réussi, 125 ans après la création du premier parc, à conclure un accord sur la création du plus grand parc national de l'Est du Canada. Je suis donc très fier du travail accompli par tous les membres de notre équipe, parce que nous sommes la dernière génération qui peut encore donner de l'expansion au réseau de parcs. Si nous ne réussissons pas, l'occasion ne se présentera plus dans l'avenir aux Canadiens et aux futurs dirigeants de notre organisation. Notre troisième réussite est ce que j'appelle la communication de la passion et du leadership. Je crois que la présente génération des membres de notre équipe a fait passer Parcs Canada d'une organisation introvertie à une organisation extravertie qui collabore avec les autres et qui communique sa passion, ses connaissances, son expertise et son esprit d'innovation avec un nombre croissant de Canadiens. L'un des aspects de cette transformation dont je suis le plus fier est notre relation avec les Autochtones. Souvenons nous que Tom Lee avait déjà amorcé ce mouvement. Peut être qu'avec le recul, on se rend compte que seules quelques initiatives qui se déroulent pendant le mandat d'un DGA de Parcs Canada ont commencé et se sont terminées pendant ce même mandat. On tente toujours d'améliorer ce que le dirigeant précédent a mis en place. Dans le cas des peuples autochtones, Tom et les personnes qui l'ont précédé ont fait un excellent travail, et j'ai eu l'occasion et le privilège de faire avancer les choses, mais ce n'est pas moi qui ai commencé. J'ai simplement poursuivi le travail. Enfin, pour ce qui est de communiquer la passion et le leadership, nous avons mis l'accent sur les jeunes et les leaders de demain pour la première fois dans l'histoire de l'Agence. Les programmes comme Le meilleur emploi d'été au Canada, Mon passeport Parcs et d'autres encore, dont certains sont très pratiques ou se situent à l'échelle locale comme l'initiative du Centre des Palissades du parc national Jasper, ont réellement pour but d'assurer l'avenir de nos parcs et de nos lieux en y attirant les futurs leaders de notre pays. Qu'est ce que cela signifie pour vous de faire partie de Parcs Canada? Pour moi, il s'agit vraiment de prendre soin de tous ces endroits sacrés du Canada, de communiquer la fierté, le professionnalisme et la passion que les membres de l'équipe de Parcs Canada des générations précédentes ont développés et transmis aux autres. C'est la joie de faire partie d'une grande équipe qui se dépasse quotidiennement. C'est aussi la fierté d'appartenir à une grande famille d'individus qui font du Canada une meilleure nation. Je crois également que faire partie de Parcs Canada nous fait prendre conscience que par les décisions prises, les gestes posés et les étapes franchies aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est sans doute unique à la fonction publique fédérale et même partout ailleurs en général, nous faisons partie d'une équipe qui a pour mission de rendre son pays en meilleur état dans cent ans. C'est une mission sacrée que nous partageons tous, en tant qu'adeptes des parcs et dignes représentants de Parcs Canada, et le sentiment de fierté que nous éprouvons à l'égard de cette grande institution vient en partie de la reconnaissance publique dont Parcs Canada fait l'objet et de ce que ce nom évoque aujourd'hui. Cela fait cent ans qu'il en est ainsi, cent ans que la population considère Parcs Canada comme l'une des meilleures organisations du pays. Lorsque viendra le temps de passer à votre tour le flambeau de Harkin, quel héritage espérez vous léguer? Si je regarde devant moi et que j'examine certains des objectifs que je me suis fixés avant de céder ma place, je crois d'abord pouvoir dire que j'aurai bâti l'équipe de l'avenir. À mon avis, les meilleurs dirigeants de Parcs Canada ont toujours mis sur pied des équipes solides sur le plan des comités de direction, des personnes qui travaillent sur le terrain et des employés des centres de services, et je crois qu'une partie de cette réalisation consiste à assurer la réussite de l'organisation à long terme, grâce à la qualité de ses membres et en favorisant leur développement et leur épanouissement. J'espère sincèrement que l'un de mes legs sera d'avoir préparé le prochain DGA au sein même de Parcs Canada. Je pense qu'il s'agit d'un élément important de notre histoire et que beaucoup de dirigeants de Parcs Canada provenaient de l'intérieur de l'organisation. C'est donc selon moi une immense responsabilité, compte tenu des enjeux actuels, et je ne dois jamais perdre de vue la suite des choses et la façon dont l'organisation réussira dans l'avenir. L'héritage que j'aimerais laisser, et que d'autres laisseront peut être aussi, est de faire de mon mieux pour tirer parti de toutes les possibilités et de vraiment mettre en place ces possibilités dans notre réseau de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux et d'aires marines nationales de conservation. J'ai eu beaucoup de chance jusqu'à présent, depuis que je suis en poste, et ce que j'aimerais par dessus tout réaliser, c'est d'insuffler dans le cœur et l'esprit des Canadiens un intérêt à l'égard de notre programme d'aires marines nationales de conservation, grâce au processus d'établissement de ces endroits très spéciaux. Par exemple, la création d'une aire marine dans le détroit de Lancaster serait un héritage appréciable pour le Nord. Je suis persuadé que ce qui pourra constituer l'héritage de l'équipe dont je fais partie sera d'explorer de nouvelles avenues pour mobiliser les Canadiens à l'égard des endroits sacrés, à l'égard de LEURS trésors nationaux, afin qu'ils bâtissent un meilleur Canada pour demain. Daniel Watson (2015-2018)
Né en Saskatchewan, Daniel Watson est diplômé de l'Université de la Colombie-Britannique en histoire et littérature française. Il a amorcé sa carrière comme superviseur dans un Centre d'emploi du Canada pour étudiants de l'est de Vancouver. Après avoir œuvré dans lœ domaine de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels à l'ancien ministère fédéral de l'Emploi et de l'Immigration, il a passé les dix années suivantes au sein du gouvernement de la Saskatchewan où il a dirigé les politiques et la recherche en matière d'enseignement postsecondaire ainsi que les questions de formation, puis il a travaillé au gouvernement de la Colombie- Britannique où il a été responsable des mandats d'application de traités et des lois de mise en œuvre. Il a agi comme négociateur pour l'Accord définitif Nisga'a et a mené le développement de la de la première loi créée au Canada pour mettre en œuvre un traité conclu avec une Première nation et prévoyant l'autonomie gouvernementale. Il est revenu au gouvernement fédéral en 1999 comme directeur des Relations autochtones et territoriales du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC). En 2001, il a assumé les fonctions de directeur général de la Direction de la justice applicable aux Autochtones à Justice Canada, où il est resté jusqu'à ce qu'il soit nommé, en 2003, sous-ministre adjoint de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada en Saskatchewan. En 2006, il accédait au poste de sous-ministre adjoint principal des Politiques et de l'Orientation stratégique à AINC. En mars 2009, il devenait sous-ministre délégué de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, avant de se voir confier le poste de sous-ministre en juillet de la même année. En 2012, il a été nommé dirigeant principal des ressources humaines du gouvernement du Canada, puis en 2015, directeur général de l'Agence Parcs Canada. Michael Nadler (2018-2019)
Michael Nadler a été directeur général de Parcs Canada par intérim base de septembre 2018 à août 2019. Il s'est joint à la fonction publique fédérale en 1998 et a occupé divers postes de direction, notamment en tant que cadre supérieur exécutif régional dans le territoire du Nunavut pendant cinq ans et en tant que cadre supérieur leader dans les négociations sur les traités modernes et l'autonomie gouvernementale des Autochtones l'Arctique, le Québec et les provinces de l'Atlantique pendant cinq ans. Michael a rejoint Parcs Canada en 2015 en tant que vice-président des relations extérieures et des visiteurs Expérience et a joué un rôle clé dans un certain nombre d'initiatives importantes aidant plus de Canadiens se connectent à la nature et à l'histoire et embrassent la conservation de naturel et culturel. Au cours de son mandat de chef de la direction par intérim, Parcs Le Canada a terminé un important projet de modernisation de l'environnement écologique et commercial la gestion d'actifs touristiques à grande échelle, tels que les domaines skiables ; introduit un nouveau cadre d'histoire et de commémoration axé sur l'inclusion et racontant la diverses histoires de l'histoire du Canada sous plusieurs angles; et avancé le création collaborative de deux des plus grandes aires protégées du Canada dans partenariat avec les Inuits du Nunavut et les Dénés et Métis de South Slave Région des Territoires du Nord-Ouest à Tallurutiup Imanga et Thaidene Nene. Translation courtesy Google Translate Ron Hallman (2019-présent)
Je suis vraiment heureux de revenir à Parcs Canada en tant que président et directeur général de l'Agence. Parcs Canada occupe depuis longtemps une place spéciale dans mon cœur, depuis l'époque où j'étais un membre du personnel exclu du ministre pendant l'élaboration et l'adoption de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (2000). Ce fut une expérience qui a tellement marqué mon imagination que je me suis joins à la fonction publique en 2002 et ensuite à l'Agence en tant que chef de cabinet du DGA (2003-2006) avant d'accepter les rôles de directeur administratif des parcs des montagnes (2006-2009) et de vice-président de l'établissement et de la conservation des aires protégées (2009-2011). Depuis mon départ en 2011, une grande partie du travail que j'ai accompli dans le cadre de mes postes de sous-ministre adjoint principal, Opérations régionales à Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (2011-2013) et en tant que président de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (2013-2019) a fait écho à des aspects clés du travail de Parcs Canada, notamment composer avec le point de rencontre de l'environnement et de l'économie, favoriser la participation du public et travailler en partenariat avec des groupes autochtones — le tout dans un contexte de sciences, de preuves et de savoir autochtone. Plus récemment, une partie importante de mon rôle à l'ACEE consistait à soutenir la ministre de l'Environnement et du Changement climatique dans le cadre de l'élaboration de la Loi sur l'évaluation de l'impact, laquelle est entrée en vigueur le 28 août 2019 et établit une nouvelle approche en matière d'évaluation de projets majeurs au Canada et crée la nouvelle Agence d'évaluation d'impact du Canada (qui remplace l'ACEE). À l'avenir, les évaluations d'impact fédérales se pencheront sur les impacts environnementaux, économiques, sociaux et de santé positifs et négatifs de projets potentiels et la nouvelle Agence d'évaluation d'impact du Canada dirigera tous les examens pour les projets désignés. Au fil des ans, j'ai suivi de près les travaux de l'Agence. Il est inspirant de constater les progrès accomplis pour agrandir le réseau des aires protégées comme la création du premier parc urbain national du Canada, le parc urbain national de la Rouge, et de plusieurs autres parcs nationaux, aires marines nationales de conservation et lieux historiques nationaux. D'importants partenariats ont été tissés et renforcés avec des partenaires autochtones grâce, entre autres, à la création de la réserve de parc national Akami-Uapishkᵁ - KakKasuak - Monts Mealy, du lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror et, plus récemment, de la réserve de parc national Thaidene Nëné. Plusieurs sont des partenariats auxquels j'ai contribué, à divers titres, pendant mon passage précédent à l'Agence. Je suis également heureux que l'entrée aux sites de Parcs Canada soit maintenant gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins. Cela, en plus des nombreuses expériences de visite intéressantes offertes aux plus de 24 millions de visiteurs annuels, permet à l'Agence de partager ce réseau d'endroits uniques avec les Canadiens et Canadiennes et les visiteurs de partout dans le monde tout en assurant la protection de l'intégrité écologique. |
 Harkin, James B.
Harkin, James B. Fort Anne environ 1928
Fort Anne environ 1928 Fort Beauséjour environ 1936
Fort Beauséjour environ 1936 Photo de J.B. Harkin par Karsh 1937
Photo de J.B. Harkin par Karsh 1937 Les écluses du Canal Rideau - Merrickville (ON)
Les écluses du Canal Rideau - Merrickville (ON) Lieu de naissance de sir Wilfrid Laurier à Saint Lin, au Québec
Lieu de naissance de sir Wilfrid Laurier à Saint Lin, au Québec La plage au Parc National de l'Île du Prince Edouard environ 1940
La plage au Parc National de l'Île du Prince Edouard environ 1940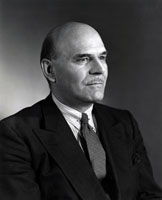 James Smart
James Smart Lieu historique national de Lower Fort Garry, 19e siècle
Lieu historique national de Lower Fort Garry, 19e siècle Maison Green Gables, façade nord et ouest, 1930's
Maison Green Gables, façade nord et ouest, 1930's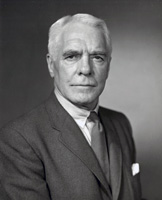 J.A. Hutchison
J.A. Hutchison Lieu historique national du Canada de la Maison-Laurier, Ottawa (ON)
Lieu historique national du Canada de la Maison-Laurier, Ottawa (ON) Parc national du Canada Terra-Nova, Terre-neuve
Parc national du Canada Terra-Nova, Terre-neuve J.R.B. Coleman
J.R.B. Coleman Parc national du Canada Kejimkujik (NE)
Parc national du Canada Kejimkujik (NE) Lieu historique national du Canada de la Villa-Bellevue (ON)
Lieu historique national du Canada de la Villa-Bellevue (ON) Lieu historique national du Canada S.S. Klondike (TY)
Lieu historique national du Canada S.S. Klondike (TY) John Ingram Nicol
John Ingram Nicol Parc national du Canada Forillon (QC)
Parc national du Canada Forillon (QC) Parc national du Canada Kouchibouguac (NB)
Parc national du Canada Kouchibouguac (NB) A.T. Davidson
A.T. Davidson J.D. Collinson
J.D. Collinson Aimée Lefèbvre-Anglin
Aimée Lefèbvre-Anglin Parc national de Aulavik (TN)
Parc national de Aulavik (TN) Tom Lee
Tom Lee Alan Latourelle
Alan Latourelle Daniel Watson
Daniel Watson Michael Nadler
Michael Nadler Ron Hallman
Ron Hallman